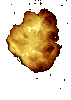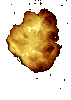
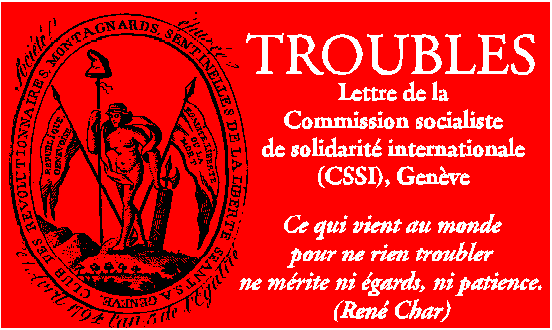





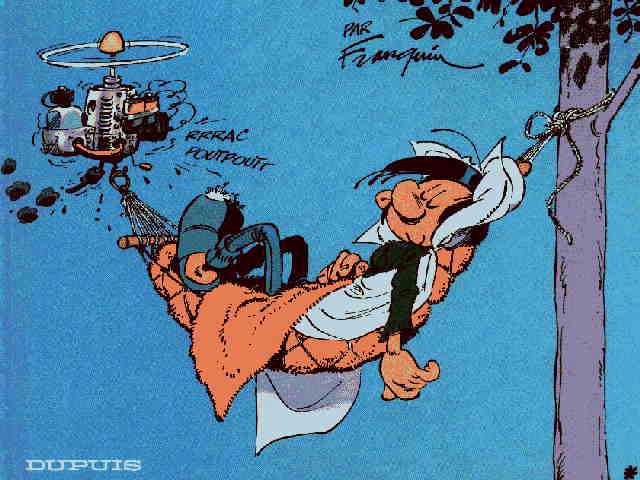
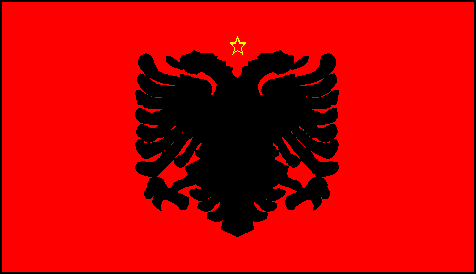
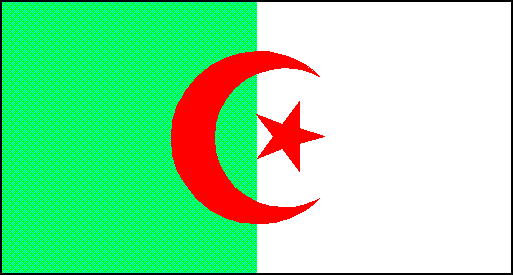




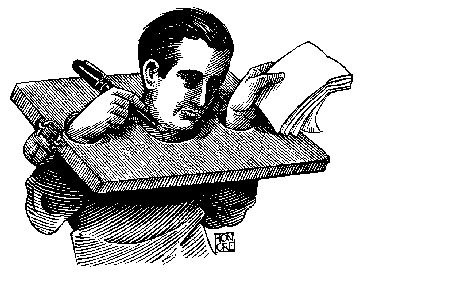

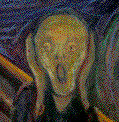


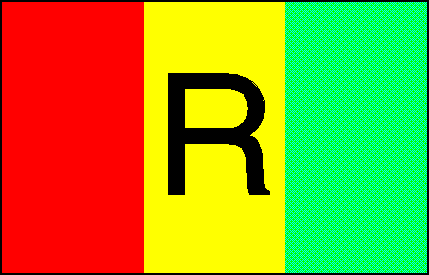
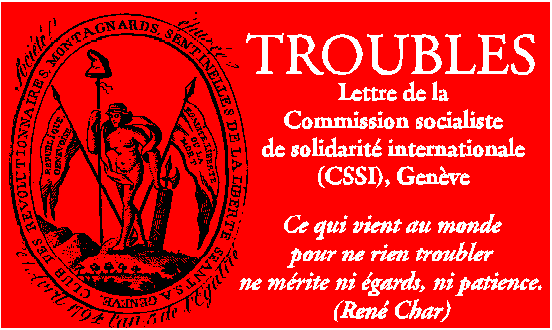
Etat des lieux : le travail, le chômage
Mise à jour : 3 janvier 2008
©Pascal Holenweg, Genève, 2008

le problème économique est résolu, l'humanité se trouvera donc privée de sa finalité traditionnelle. (...) Ainsi, pour la première fois depuis sa création, l'homme fera-t-il face à son problème véritable et permanent : comment employer la liberté arrachée aux contraintes économiques ) (...) Pendant longtemps encore, le vieil Adam sera toujours si fort en nous que chaque personne aura besoin d'effectuer un certain travail afin de lui donner satisfaction. (...) Trois heures de travail chaque jour par roulement, ou une semaine de quinze heures, peuvent ajourner le problème pour un bon moment.
J.-M. Keynes, "Perspectives économiques pour nos petits-enfants" (1930)

Partage du travail, revenu minimum :
Pour un débat à gauche
La crise économique des années '90 marque la fin d'une époque (qui dure depuis un siècle et demi) : celle de la généralisation du salariat. Le nombre croissant des chômeurs, des travailleurs occasionnels, des exclus du travail et des retraités "sortis" bon gré, mal gré, du cycle salarial, l'allongement enfin de la durée de la formation non salariée, tout concourt à ce que les travailleuses et les travailleurs "normalement" salariés (à plein temps) deviennent tendanciellement minoritaires par rapport à une masse composite et contradictoire de non salariés, de salariés à temps partiel et de salariés épisodiques. Cette remise en cause du salariat se fait par le capitalisme lui-même, dans l'improvisation et à un coût social considérable. La gauche n'y réagit que défensivement, par le recours aux vieilles recettes (plus ou moins "modernisées" de l'Etat social et de l'investissement keynésien, quand elle ne se replie pas sur le conservatisme corporatiste. A une offensive contre les salariés, les organisations qui affirment les représenter opposent, assez obstinément, la défense du salariat -c'est-à-dire la défense d'un mode de rémunération du travail (ou plutôt du temps de travail) qu'elles ont eu initialement pour projet constitutif de combattre : le travail à plein temps, stable et salarié.
Nous sortons donc par la crise d'une société organisée autour d'une certaine conception du travail (salarié, stable, masculin et à plein temps) qui en avait faît cet enclôs où le citoyen n'était plus qu'un producteur -et hors duquel il était surtout un consommateur. Ainsi défini par des normes sociales héritées du XIXe siècle, le travail n'est que le sacrifice de ce que l'on est au profit de ce que "le système" veut que l'on soit -et c'est encore dans la confusion des termes que se fait cette définition : pour être reconnu comme tel, le travail devait, et doit encore, être salarié et dépendant, alors que la plus grande part du volume de travail réel effectué socialement est le fait d'engagements différents, à commencer par celui des femmes assumant la quasi-totalité du travail "domestique". Il n'y a en réalité aucune synonymie entre les mots de "travail" (qui désigne toute activité de transformation d'une réalité) et d'"emploi" qui ne désigne une telle activité que si elle s'insère dans un cycle productif, pour un temps payé par le salaire.
L'une des absurdités du salariat est que plus le travail que l'on fait est intéressant, "enrichissant" pour le travailleur, mieux est payé le temps qu'on passe à le faire alors que, logiquement et éthiquement, un travail devrait s'accompagner d'un salaire d'autant plus élevé que la tâche est rebutante, dépourvue d'intérêt pour qui la fournit et utile à la collectivité. Il n'y aucune raison, ni sociale, ni économique, ni -et moins encore- éthique pour qu'un présentateur de télévision soit mieux payé qu'un éboueur.
L'exigence d'une critique du salariat
Si le moment présent est celui d'une crise, il peut être aussi -et par le fait même- celui d'une exigence, qui tiendrait à la fois d'un bon usage du présent et d'un retour aux sources du mouvement socialiste : repenser le travail, rompre avec le modèle salarial et l'organisation des vies individuelles autour du travail salarié, tout assurant à chacune et chacun la couverture de ses besoins essentiels (y compris ceux, "immatériels" mais non moins essentiels, liés à la culture, à l'information et aux relations sociales). Rendu indispensable par la rupture du léien entre la croissance et l'emploi, et a contrario par l'inanité de l'attente d'une éradication du chômage par la croissance, le projet d'un dépassement du salariat, où se conjuguent réduction du temps de travail, partage de l'emploi et revenu minimum fait peur à la gauche -à toutes les gauches. Né d'une critique virulente, radicale, du salariat, de l'Etat et de la propriété privée, le mouvement socialiste (au sens large) a, par son action et ses réussites même, généralisé le salariat, renforcé l'Etat et diffusé la propriété privée. Intégré à l'appareil d'Etat jusqu'à parfois s'y dissoudre, totalement inséré dans une société qu'il est supposé avoir pour projet de changer, coupé par cette intégration et cette insertion de la nouvelle "classe pauvre", le mouvement socialiste (toutes organisations confondues) a-t-il achevé son parcours historique sans réaliser le projet qui le justifiait mais en confortant le réalité qu'il combattait ?
Parler au nom de tous les salariés en méconnaissant ce qui distingue un professeur d'université d'une auxiliaire de grands magasins, ou se replier sur le projet technocratique de rationalisation des fonctionnements de l'Etat, ne peut mener qu'au néo-corporatisme (dans le premier cas) ou à un sorte de "radical-socialisme" consensuel (dans le deuxième cas), c'est-à-dire -et dans les deux cas-, à l'oubli du "monde d'en-bas".
Car la crise a un effet contradictoire : en même temps qu'elle élargit la marge sociale en accroissant le nombre de ceux qui y sont rejetés, et des raisons pour lesquelles ils y sont rejetés, elle réduit la tolérance de la société à l'égard de la marge et des marginaux. La gauche n'est pas préservée de ce mal : en se repliant sur la défense corporatiste ou en réduisant son projet à la rationalisation technocratique, elle rompt avec les victimes de la crise; en se refusant à remettre en cause le modèle salarial et l'organisation classique du travail, elle concourt à accroître le nombre de ses victimes; en ne poussant pas sa réflexion au-delà de ce que les membres de ses organisations sont a priori en état d'accepter, elle perd sa légitimité même.
Le retour des pauvres
Les pauvres sont de retour -et partout. Plus de 16'000 chômeurs sont officiellement recensée à Genève, qui en compte à peu près le double en réalité. 6000 personnes doivent dans une des villes les plus riches d'Europe recourir à l'assistance publique pour couvrir leurs besoins essentiels : les sociétés les plus prospères redécouvrent le chômage et redécouvrent leurs pauvres. Ils n'avaient pas disparus : on les avait oubliés; ou plutôt, on les avait cac hés, comme on avait exporté les chômeurs dans les années '70. Méthode bien helvétique, d'ailleurs, que ce camouflage social -mais les chômeurs ont réapparu, et les pauvres, et les exclus du travail, et les sous-payés, et les travailleurs non reconnus comme tels parce qu'ils ne reçoivent pas de salaire en "échange" partiel de leur temps de travail (et ces travailleurs là, dans leur grande majorité, sont des travailleuses).
De plusieurs parts est alors avancé le double projet du partage du travail et du revenu minimum (quelques propositions, trop prudentes et partielles, s'en tenant à l'un ou l'autre de ces deux projets, ou à certains de leurs éléments constitutifs : des allocations complémentaires à celles déjà existantes, quelques mesures de réduction de la durée du travail dans quelques secteurs réputés pouvoir le supporter...). Or ce double projet, s'il n'est pas réduit à ce qui serait immédiatement acceptable par une opinion publique "fonctionnant" encore (et fort logiquement) aux critères sociaux des 150 ans qui précèdent, pourrait bien être le projet le plus subversif du siècle finissant et du siècle commençant. Sa logique, en tous cas, rompt radicalement avec celle instaurée et installée depuis 150 ans : la logique du salariat et de l'emploi stable et à plein temps.
Un projet subversif
La normalité sociale dont nous héritons, et avons grand'peine à nous défaire, est celle d'un individu échangeant son temps contre de l'argent en tirant l'essentiel ou la totalité de son revenu du paiement de ce temps "vendu" à d'autres, le revenu qu'il en tire lui permettant de continuer à vendre son temps. Le projet de réduction massive du temps consacré à l'obtention d'un salaire, rlduction conjuguée à la reconnaissance du droit de tout individu à obtenir sans contrepartie les moyens nécessaires à son existence sociale, est un bouleversement dans une société fondée sur le travail "obligé", et pour un mouvement social (le nôtre), ou ce qu'il en reste, fondé sur l'exaltation du travail, l'organisation des travailleurs et la généralisation du salariat (après s'est constitué en réclamant son abolition).
Nous voilà donc donsuits par la réalité sociale autant que par nos propres principes ("à chacun selon ses besoins"...) à revendiquer la possibilité de travailler le moins possible et un droit au revenu sans obligation de travail. On dira sans doute d'un tel projet qu'il est irréaliste, mais, outre que la réalité pourrait bien se charger d'en rendre la concrétisation inévitable, on pourra utilement se dire que, comme le suggère Serge Livrozet, le premier anthropophage a avoir émis l'idée qu'il fallait cesser de bouffer ses petits camarades n'était déjà sans doute qu'un utopiste dépourvu du sens des réalités -et promis à ce titre à être dévoré pour qu'elles lui soient rappelées.
Le débat qui doit se tenir au sein de toutes les organisations, politiques et syndicales, de la gauche "plurielle" (comme s'il pouvait en exister une autre) illustrera sans nul doute le fossé qui sépare encore les pratiques et les habitudes de pensée des nécessités. Nous avons à prendre l'individu comme tel et tel qu'il est, non comme producteur et tel que la norme sociale le voudrait; nous avons à ne plus le juger en fonction de critères utilitaires ou défensifs, à ne plus le mesurer à l'aune de son intégration sociale, de l'utilité de son activité ou du prix auquel il se vend (Que fait-il ? Combien gagne-t-il ?) mais en fonction de son seul droit à exister comme il l'entend.
Rien au fond n'est plus subversif que cette rupture entre le droit individuel aux moyens de vivre et les vieilles exigences sociales de travail et d'activité "utiles" ou "rentables"; rien n'est plus subversif, et rien n'est plus nécessaire : ceux que la crise rejette dans la marge ou, plus loin encore, hors du lien social, n'ont pas besoin d'un discours moral et d'une commisération paternaliste, mais des moyens de se loger, de se vêtir, de se nourrit, de se soigner, de se déplacer et de s'informer.
Ce qu'ensemble le partage du travail et le revenu minimum subvertissent sont aussi de bonnes, vieilles et solides valeurs de gauche : le travail, précisément, mais aussi l'intégration sociale, le salaire, le maintien des droits acquis. Ne serait-ce que pour cette raison, le débat est nécessaire. Mais il l'est aussi parce que l'urgence nous y pousse : ne s'embarassant ni de réflexion, ni de projet, ni de critères éthiques ou sociaux, l'"économie" a sa propre réponse à la crise, et dispose d'au moins autant de moyens d'imposer cette réponser qu'elle en a eu de provoquer cette crise. Cette réponse est simple : faire payer les conséquences de la crise aux victimes de la crise. Ces moyens sont politiques : des organisations, des majorités, des gouvernements acquis à la réalisation d'un programme libéral, ou capables d'imposer les critères d'un tel programme aux forces politiques qui pourraient s'y opposer.
Tant qu'à gauche on se contentera du choix entre le corporatisme défensif des uns et la transformation des autres en un succédané technocratique du radical-socialisme, seule la réponse de droite à la crise aura quelque chance de s'imposer.
La fin du travail ou la fin du salariat ?
Paul Lafargue : Le droit à la paresse
L'ampleur du chômage
Le chômeurs en fin de droits
Le chômage de longue duré
Les occupations temporaires de chômeurs
Des propositions de réduction de la durée du travail en Ville de Genève
Les propositions du Parti Socialiste Suisse
Le travail non rémunéré en Suisse
Fin du travail ou fin du salariat ?
Il ne faut rien attendre d'un traitement symptomatique de la crise, car il n'y a plus de crise : un nouveau système s'est mis en place qui abolit massivement le travail.
(André Gorz)
Misères du présent, Richesse du possible
André Gorz et la fin du salariat
Dans son dernier livre, André Gorz rompt avec une démarche qui fut longtemps la sienne, démarche réformiste de changement (radical, certes) du cadre social du travail salarié, pour constater qu'il s'impose désormais une remise en cause fondamentale du salariat lui-même. En d'autres termes, on n'en est plus à répondre é la crise, à proposer diminution d'horaires, aménagement du temps de travail, partage du travail, mais à envisager sérieusement l'abolition même du travail salarié. Pour Gorz, désormais, cette abolition n'est plus une menace à conjurer, mais une chance, la possibilité d'instaurer un ordre social nouveau. Construction sociale arbitraire, le travail salarié n'est pas une fatalité mais peut être aboli, précisément parce qu'il n'est qu'une forme contingente de l'organisation des forces productives. Une forme parmi d'autres. Le problème est que nous sortons de la société du travail salarié sans qu'aucune autre forme de société ne soit proposée. D'où la généralisation de la précarité :
"C'est cette figure centrale du précaire qui est potentiellement la nôtre; c'est elle qu'il s'agit de civiliser et de reconnaître au double sens du mot pour que, de condition subie, elle puisse devenir mode de vie choisi (...) (et) droit pour tous de choisir les discontinuité de leur travail sans subir de discontinuité de leur revenu".
D'où le ralliement de Gorz à la proposition, qu'il a longtemps combattue, du revenu minimum , c'est-à-dire d'une "allocation universelle de revenu suffisante et inconditionnelle" pour continuer à garantir les droits sociaux fondamentaux, même s'ils sont un héritage de la société du salariat, et permettre le développement d'une société de "multiactivité" en rupture avec la société du travail mais capable de faire le meilleur usage possible de l'énorme puissance productive (mais pas seulement économiquement productive) de l'intelligence collective ("general intellect".
extraits de l'entretien d'André Gorz avec Robert Maggiori et Jean-Baptiste Marongiu, "Libération" (supplément "livres") du 24 septembre 1997
J'essaie d'envisager le terme ultime auquel, en vertu de leur logique propre, mènent les mutations présentes. Or cette logique débouche sur l'abolition du salariat et du capital, selon des modalités qui sont d'ailleurs celles que prévoyaient les "Grundrisse" de Marx (...). Il faut se placer dans cette perspective et se demander ce qu'on peut faire pour s'approprier le travail, pour avancer dès à présent dans le sens de cette appropriation. Il faut se retirer mentalement de la société salariale, de la société de travail comme seule forme de société : voilà ce que j'apelle l'Exode. Le premier acte de tout changement politique, de toute transformation de la société, est un changement culturel. (...)
On était dans une société dont la source de productivité était l'énergie, qu'il fallait produire en quantités de plus en plus grandes. On est passé à une économie fondée sur l'information, celle qui, par bits électroniques, permet de stocker non seulement du savoir mais aussi du savoir faire, et de le mopbiliser à volonté n'importe où et n'importe quand. (...) Aujourd'hui, l'argent cherche à produire de l'argent sans passer par le travail. (...)
A l'heure d'Internet, de la cybernation, de l'informatisation, de la mise en réseau de tous les savoirs, il est encore plus aisé de voir que le temps de travail ne peut plus être pris pour mesure du travail, ni le travail pour mesure de la richesse produite, puisque le travail immédiat de production n'est, en grande partie, que le prolongement matériel d'un travail immatériel, intellectuel, de réflexion, de concertation, d'échange d'informations, de mise en commun des savoirs, bref du "général intellect". Il est virtuellement possible aujourd'hui que l'utilisation de la force de travail possédée par chacun conduise à un développement fantastique de l'autoactivité et que la richesse n'ait plus besoin d'être produite dans des entreprises capitalistes avec un capital fixe, une direction, un marketing, etc. La demande doit donc être celle de lieux de vie, d'activités, d'échanges, où les gens puissent produire et de la socialité et de la richesse, matérielle et immatérielle.
C'est l'acquisition de facultés non productives en elles-mêmes qui est la grande source de productivité actuelle. Aussi devient-il de plus en plus difficile de définir une quantité de travail incompressible à accomplir par chacun au cours d'une période déterminle. Seule donc l'allocation universelle et inconditionnelle d'un revenu de base suffisant, cumulable avec le revenu d'un travail, peut inciter à réduire l'activité professionnelle au profit d'une vie multiactive, et éviter d'avoir à se battre sur un marché du travail saturé pour obtenir quelques miettes. (...) aujourd'hui déjà 50 % du revenu (60 % dans certains pays) est du revenu social indépendant de tout travail : RMI, indemnités et allocations diverses, etc. Le revenu garanti à tous va devenir incontournable. Sans lui, presque personne ne pourra acheter les richesses produites, parce que personne ou presque n'aura été payé pour les produire. (...)
D'une part on dit que le travail est une source de réalisation de soi, de satisfaction, d'identité, d'insertion sociale, d'autre part on dit que si on ne les paie pas, les gens n'iront pas travailler. Il faut s'entendre ! (...) il faut que le travail devienne une activité qu'on a envie de faire, et par laquelle on s'épanouit. La finalité de l'allocation onconditionnelle est celle d'une société où la nécessité du travail ne se fait plus sentir comme telle, parce que chacun se trouve sollicité et entraîné par un foisonnement d'activités (...) et trouve la "richesse" dans ces activités et leur partage. Un pas dans ce sens est que tout le monde puisse choisir sa forme de travail discontinu ou à temps très réduit tout en étant assuré d'un revenu suffisant. (...) L'emploi du temps n'est plus le temps de l'emploi.
"Nous allons sûrement vers l'entreprise sans salariés permanents et à plein temps"
(André Gorz, "Le Monde" du 6.1.1997)
(...) Le terme "travail" recouvre au moins quatre réalités différentes que l'on rabat tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre d'entre elles. Si le travail est entendu comme une modalité du faire, de l'agir, de l'oeuvrer, du "se donner la peine", il est évident qu'il ne peut ni manquer ni disparaître, qu'on ne peut ni en "avoir" ni en "créer". Ce qu'on peut "avoir" ou ne pas "avoir", en revanche, c'est le travail à forme d'emploi, c'est-à-dire une tâche socialement et juridiquement prédéfinie, qui vous est donnée à faire et pour laquelle on vous paie. C'est cette forme emploi du travail qui tend à disparaître.
Nous vivons une mutation fondamentale et irréversible qui invalide les paradigmes de la théorie économique dominante, tend à éliminer le salariat et porte en elle des chances immenses à condition que nous cherchions à nous emparer des changements au lieu de nous lamenter et de chercher à les combattre. (...) (Ce) n'est pas simplement la forme et la nature du travail qui change, mais aussi la nature du capital et de la richesse. Quand des dirigeants d'entreprise nous disent que le "capital humain" est plus important que le capital machines, que disent-ils donc, sinon que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la propriété privée du capital devient une notion problémagique et où le temps de travail immédiat est peu de chose en comparaison du temps nécessaire aux individus pour développer leurs capacités imaginatives et cognitives ? Comment peut-on, simultanément, vouloir ne rémunérer que le temps de travail immédiat ?
(...) (Si) vous reconnaissez que le travail immédiat ne peut plus être au centre de la vie de chacun et au fondement de la société, vous remettez en question le pouvoir que le capital et l'entreprise exercent l'un sur l'autre. Vous professez alors qu'il est absurde de demander aux individus de servir la société; la société doit avoir pour but le libre épanouissement de chacun et de tous. Cela se trouvait déjà dans le "Manifeste du parti communiste".
Si, en revanche, vous soutenez que le travail emploi conserve et doit conserver sa centralité, alors vous niez qu'il doive et qu'il puisse y avoir une société au-delà de la société salariale et vous renforcez la domination d'un patronat qui veut que les gens ne voient d'autre issue que de se battre entre eux pour obtenir à n'importe quelles conditions un de ces emplois que, par ailleurs, on abolit.
(...) Nous allons sûrement vers l'entreprise sans salariés permanents et à plein temps. L'entreprise se transforme en un système auto-organisateur de réseaux reliant un très grand nombre d'unités souvent minuscules. Beaucoup de celles-ci sont des entreprises individuelles sans capital autre qu'intellectuel, donc immatériel. (...)
Selon quels principes peut-on distribuer la richesse socialement produite quand de moins en moins de gens sont régulièrement salariés pour la produire ? Que faut-il faire quand le temps de travail immédiat n'est plus la mesure du travail ni le travail la mesure de la richesse ? Eh bien, il faut garantir à tous un revenu de base suffisant, indépendant du temps de travail et, finalement, du travail lui-même ! Le RMI n'est qu'un pas misérable dans cette direction. On fait déjà beaucoup mieux au Danemark et aux Pays-Bas, et on le fera aussi en Allemagne, d'ici deux ans. La garantie inconditionnelle d'un revenu de base suffisant permet de transformer la flexibilité chère au patronat en droit au temps choisi, en droit à négocier collectivement et individuellement toutes les formes de travail discontinu.
Le débat, qui a lieu aussi en France, porte sur la question de savoir si la garantie du revenu de base doit être inconditionnelle ou si elle doit avoir pour condition que, en l'absence d'un travail rémunéré, les gens asument des tâches bénévoles dans le cadre d'associations homologuées. Cette dernière condition me paraît inacceptable. Car si, pour subsister, je suis tenu au bénévolat, je ne suis plus bénévole. La garantie d'un revenu suffisant doit précisément avoir pour objet qu'une infinité d'activités qui créent du sens, du lien, etc., puissent se développer pour elles-mêmes, sans être assujetties à des critères extrinsèques.
(...) (L'emploi) ne peut être un but en soi. Le but ne peut-être que ce que le travail emploi, professionnalisé et monétarisé, permet de réaliser seul, ou mieux, ou plus efficacement. La question à poser n'est donc pas : Comment fournir le maximum d'emplois ? Mais : Quelles activités, quelles compétences faut-il professionnaliser, et lesquelles faut-il absolument protéger contre la professionnalisation parce qu'elles sont ou devraient être des compétences communes, non formalisables, ni tarifables, ni transmissibles par un enseignement formel ?
(...) (Chaque) fois que vous créez une profession certifiée, vous retirez une activité du champ des compétences communes à tout le monde. Vous créez ce qu'Ivan Illitch appelle "un monopole radical", et vous disqualifiez les "savoirs vernaculaires" dont est faite la culture du quotidien, l'artt de vivre.
La politique de l'emploi pour l'emploi finit par faire de chacun le spécialiste certifié d'une seule activité, imcompétent, dépendant et irresponsable pourntout le reste. S'il faut des spécialistes pour tout, si toute activité est un moyen de gagner sa vie, personne ne sait résoudre les problèmes quotidiens de vie et se prendre en charge.
(...) Il appartient à la société de s'attaquer à la cause des risques qu'elle-même fait courir aux individus et, d'autre part, de fournir les moyens qui permettent aux individus de mieux se prendre en charge. Ce qui suppose notamment que tous aient un accès illimité et permanent à toutes les ressources culturelles, à toutes les sources du savoir, aux outils d'autoproduction qui leur permettent de réduire leur dépendance à l'égard des échanges marchands et de l'Etat.
Si l'on tient que "le monde doit être présenté aux jeunes non pas comme construit mais comme à construire", selon la formule de Gilles de Gennes, il est impératif qu'ils réussissent à s'émanciper, psychologiquement et économiquement, des routines du travail emploi, des formes d'activité et de vie stéréotypées, balisées et prévisibles. Impératif qu'ils découvrent le goût de l'aventure, de l'improvisation, de l'invention, de la découverte. Or, si seuls doivent être assurés d'un revenu de base celles et ceux qui, durant les intermittences de leur travail emploi, se livrent à des activités connues "socialement et économiquement utiles", qui jugera de cette utilité ? On ne peut quand même pas évaluer les instituants selon les normes de l'institué.
Jusqu'à aujourd'hui, chaque nouvelle révolution technologique finissait par provoquer la création de nouveaux emplois -après, d'ailleurs, avoir supprimé nombre d'emplois dans des activités ou des formes de production traditionnelles.
Les technologies de l'information -et les modes informatiques de production- se distinguent fondamentalement de cette évolution passée, non seulement en changeant la nature même des emplois existants dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi en se diffusant de manière si large et si rapide que les conséquences de leur introduction se font sentir dans le monde entier dans des délais extrêment brefs.
Technologies de l'information et modes informatiques de production favorisent enfin une délocalisation massive , et particulièrement commode, de la presque totalité des activités. Les anciens lieux de production au "nord" (au "centre") se transforment en lieux de contrôle de production matériellement délocalisées au "sud" (à la "périphérie"); ce mouvement se poursuit ensuite dans les lieux mêmes où la production a été délocalisées, et qui la délocalisent à leur tour vers une nouvelle périphérie -un "sud du sud". A plus ou moins long terme, la destruction des emplois engagée dans les pays du "nord" se poursuivra dans ceux du "sud", avant même que la main d'oeuvre de ces pays ait passé par le processus de "prolétarisation" qui a marqué l'Europe. On passera sans doute directement à la périphérie de la paysannerie traditionnelle au chômage moderne, sans l'étape de la constitution d'une classe ouvrière.
- Au XIXème siècle, les paysans européens, en surnombre par rapport aux possibilités d'emploi et de subsistance offertes par l'agriculture, ont massivement grossi les rangs de la classe ouvrière et des "armées de réserve" de la révolution industrielle. Un siècle plus tard, dans les années 1960 et 1970, ce sont les secteurs des services et le secteur public qui ont absorbé la main d'oeuvre que l'industrie, en pleine restructuration, licenciait ou n'embauchait plus. Aujourd'hui, ces mêmes secteurs sont en état de restructuration profonde, radicale, licencient, suppriment des postes, et ne peuvent absorber les excédents de main d'oeuvre. L'émergence d'un "secteur quaternaire", secteur du savoir, de la création, de l'information, se fait certainement sentir, mais elle est pratiquemt sans effet sur l'emploi.
Les nouvelles technologies ne permettent pas seulement de rationaliser la production, mais elles rendent possible une réorganisation complète des entreprises.
- Le groupe helvético-suédois ABB a supprimé 50'000 emplois en quelques années, tout en augmentant son chiffre d'affaire de 60 %.
La "machine intelligente" ne supprime plus seulement les emplois les moins qualifiés, occupés par les travailleurs les moins bien formés, mais de plus en plus d'emplois qualifiés et de postes de travail de cadres. La menace de la marginalisation sociale et de la paupérisation économique pèse désormais aussi sur la "classe moyenne", sur les salariés les mieux formés, sur les universitaires.
Au bout du compte, si la "société à deux vitesses" n'est certes pas une nouveauté et qu'il faille une solide dose d'inculture historique et une assez profonde cécité sociale pour pouvoir présenter comme une menace ce qui est une réalité depuis 150 ans, le ligne de partage entre les différentes "vitesses" sociales -entre les "compétants" et les "exécutants", les "intégrés" et les "marginaux", les "riches" et les "pauvres"- se fait plus profonde. De plus en plus nombreux seront celles et ceux qui, bien qu'ayant un emploi, n'en tireront plus ni lien social valorisant, ni revenu suffisant.
Nous nous retrouvons donc dans la situation de constater l'explosion d'une productivité économique dont la majorité de la population ne profite plus, ni sous la forme d'un accroissement des revenus, ni sous celle d'une augmentation du temps libre. Les profits réalisés grâce aux nouvelles technologies et à la restructuration des entreprises sont accaparés par une infime minorité de dirigeants et d'actionnaires.
En France, 42 % des accroissements de la valeur ajoutée des sociétés vont à l'épargne et 36 % aux salaires. La capacité d'autofinancement des entreprises, qui est de 155 %, se partage après le remboursement des dettes entre le capital financier, qui ne créée pas d'emplois, et l'investissement de productivité, qui en supprime. Résultat :
- La durée du travail a été divisée par deux entre le milieu du XIXème siècle et la fin des années 1970/début des années 1980. L'évolution technologique et l'accroissement des profits qu'elle génèrent pourraient aujourd'hui permettre une réduction proportionnellement comparable du temps de travail -réduction que nul ou presque ne risque à proposer. Le comble de l'audace politique reste la proposition de la semaine de 32 à 35 heures, quand la réalité économique rend déjà possible celle de 20 heures.
Face à cette mutation sociale majeure, qualifiée par certains (Jeremy Rifkin, Viviane Forrester, par exemple) de "mort du travail", et qui correspond en tous cas à la "mort" d'un modèle traditionnel du travail, les ppolitiques -de gauche comme de droite- n'ont été jusqu'à présent capables de proposer que d'inconséquents rafistolages de ce même modèle qui meurt sous leurs yeux.
Maintenir les emplois existants dans leur état existant relève précisément de ce rafistolage, quand le chômage a doublé en 15 ans (de 1979 à 1994) dans les seuls pays du "G7", et qu'aux chômeurs dument estampillés comme tels s'ajoutent tous ceux qui ne s'inscrivent pas au chômage, n'y ont pas droit, ne sont pas considérés comme des chômeurs ou se contentent, de gré ou de force, de stages sous-payés, de travaux précaires, d'emplois clandestins -bref, d'un "travail de pauvres" qui reproduit en enracine la pauvreté.
- (Usine Nouvelle 3.9) Les Pays Scandinave (Suède, Norvège, Danemark) et la Belgique figurent parmi les "champions" européens du travail au noir, selon une enquête de la Fédération patronale allemande BDA. L'Italie reste cependant en tête de ce classement particulier. Le travail au noir "pèse" 25,8 % du PIB italien, 21,4 % du PIB belge, 18,3 % du PIB suédois, 15 % du PIB allemand, 14,3 % du PIB français, 13,6 % du PIB néerlandais. Il "pèse" 9,4 % du PIB aux USA et 7,5 % du PIB suisse.
- (Les Echos 10.6.99) Selon une étude de l'Université de Saragosse, l'économie au noir a représenté en 1995 environ 14,13 % du produit intérieur brut espagnol, contre 3,5 % à 6,5 % dans les décennies 60 et 70, et 12 % à la fin des années 80. C'est à partir de la seconde moitié des années '80 que l'économie parallèle, qui pesait 54,5 milliards d'euros en 1995, s'est le plus développée, du fait de la reconversion industrielle et des suppressions d'emplois (et du chômage, qui a atteint 16,9 % au premier trimestre 1999) qu'elle a entraîné. Le travail au noir représenterair 43 % de l'emploi dans la confection, 38 % dans la chaussure, 34 % dans le textile, 32 % dans le cuir et 26 % dans l'hôtellerie.
- (PSS 12.1.99) On estime en Suisse, pour 1998, à 30 milliards de FS (120 mias de FF), soit 8 % du PIB, le volume des activités rémunérées couvertes par la loi suisse mais exécutées des conditions illégales, par des travailleurs sans permis de séjour, ou sans paiement des cotisations sociales, par exemple. Pour l'assurance vieillesse et invalidité, pour l'assurance chômage et pour le fisc, le manque à gagner correspondant s'élève à 6 ou 7 milliards de FS par an (soit de 24 à 30 milliards de FF). Dans cette économie parallèle, l'emploi illégal d'étrangers a progressé en raison des carences de la politique d'immigration et d'asile (renvoi de travailleurs saisonniers venant de l'ex-Yougoslavie, et revenant comme requérants d'asile à qui on interdit de travailler, par exemple).
Tout se passe en somme comme si l'on était d'autant plus obsédé par le travail qu'il y en a moins, et par la création d'emplois que l'évolution technologique et économique en supprime. Ainsi fait-on d'une vieille malediction ("tu travailleras à la sueur de ton front") une promesse électorale. Ainsi culpabilise-t-on celles et ceux qui ne participent pas, qu'ils l'aient ou non choisi, de l'aliénation laborieuse, en même temps d'ailleurs que l'on tente de culpabiliser ceux qui en participent en les présentant comme "favorisés" par rapport aux premiers. La norme sociale reste le travail salarié à plein temps, quand la réalité sociale a depuis longtemps défait la crédibilité de cette norme; or les sociétaires sont appelés à se conformer non à la réalité sociale, mais à la norme produite par une réalité passée.
(OCSTAT-GE, novembre 1997) Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 et de 1996, le nombre d'emplois dans le canton de Genève était de 249'201 en septembre 1995, soit 5,1 % de moins (ou 13'514 emplois de moins) que quatre ans auparavant, et 2,2 % de plus (ou 5'428 emplois de plus) que dix ans auparavant. -Dans le même temps, la population résidente totale augmentait de 27'660 personnes en dix ans (+ 7,45) % et de 14'424 personnes en quatre ans (+ 3,75 %), et la population âgee de 20 à 64 ans augmentait de 7989 personnes en dix ans (+ 6,82 %) et de 3005 personnes en quatre ans (+ 2,46 %). Sur quatre ans, alors que la population augmente, les emplois diminuent, et sur dix ans, les emplois augmentent bien moins vite que la population. Sur quatre ou dix, là où et quand l'emploi augmente, c'est du fait de la seule augmentation de l'emploi à temps partiel et essentiellement du fait de l'augmentation de l'emploi féminin.
- Entre 1991 et 1995, compte tenu du recul de l'emploi à plein temps et de la croissance de l'emploi à temps partiel, le nombre d'"équivalents d'emplois à plein temps" diminue de 5,9 %. En 10 ans, il ne progresse que de 1 %.
- Entre 1991 et 1995, le nombre d'emplois occupés par des hommes régresse de 6,9 % et celui des emplois occupés par des femmes de 2,7 %. Entre 1985 et 1995, l'effectif des femmes employées progresse de 9,1 % et celui des hommes reculs de 1,3 %.
- Entre 1985 et 1995, l'effectif des emplois occupés par des Suisses recule de 1,5 % et celui des emplois occupés par des étrangers augmente de 8,2 %. En 1995, 46,6 % des emplois sont occupés par des étrangers.
- Entre 1991 et 1995, la baisse de l'emploi est de 6,1 % dans le secteur privé (8,3 % en moins pour les emplois à plein temps, 3,4 % en plus pour les emplois à temps partiel) et de 2,6 & dans le secteur public (- 2,6 % pour les emplois à plein temps, + 13,3 % pour les emplois à temps partiel). En dix ans, de 1985 à 1995, La part du secteur public sur l'emploi global dans les secteurs secondaire et tertiaire est passée de 24,7 % à 27,4 %.
- Entre 1991 et 1995, l'emploi a reculé de 13,6 % dans le secteur secondaire et de 3,3 % dans le secteur tertiaire. En dix ans (1985-1995) l'emploi a reculé de 18,2 % dans le secteur secondaire et a progressé de 8,3 % dans le secteur tertiaire.
- En dix ans (1985-1995), le nombre des intérimaires (y compris les chômeurs occupés dans le cadre de programmes d'occupation temporaire) a augmenté de 49 % et a atteint 1,5 % du total de l'emploi en 1995.
- Selon les statistiques officielles genevoises, 18 % des chômeurs genevois en fin de droits réintègrent le "tissu socio-économique" et le "marché du travail"... en devenant indépendants, c'est-à-dire en s'éloignant du salariat.(/UL>
La fin de la société du travail ?
- (OFS mai 99) Selon la statistique trimestrielle de la population active occupée, le nombre d'actifs occupés a augmenté de 1 % entre le premier trimestre de 1998 et le premier trimestre de 1999, en diminuant de 0,1 % dans le secteur secondaire et en augmentant de 1,5 % dans le secteur tertiaire. Le 31 mars 1999, la Suisse comptait 3,856 millions de personnes occupées (+ 1 % en un an). Le nombre des femmes occupées a augmenté de 1,3 % en un an, celui des hommes de 0,8 %, celui des Suisses de 0,2 % et celui des étrangers de 3,6 %. Le nombre des emplois s'est accru de 1 % (1,5 % dans les services, mais - 0,1 % dans le secondaire). 50,1 % des actifs occupés dans le secteur des services sont des femmes (leur proportion est de 91,3 % dans les "services domestiques", de 75,6 % dans la santé et les activités sociales, de 74,3 % dans les services personnels, de 55,2 % dans l'enseignement tous secteurs qui présentent des pourcentages considérables d'emplois en temps partiel : 54 % dans l'enseignement, 48,5 % dans la santé et les activités sociales, 36,3 % dans le commerce de tail, ces trois branches totalisant 46,6 % de tous les postes à temps partiel. D'une manière générale, d'ailleurs, la croissance (modeste) de l'emploi tient pour beaucoup à celle de l'emploi à temps partiel : si le nombre de travailleurs (salariés ou indépendants) augmente, le volume global d'heures de travail tend à diminuer.
- De 1991 à 1996, la progression de l'offre de travail a été exclusivement due à celle du travail féminin, l'offre de travail des hommes ayant diminué. 123'000 femmes supplémentaires sont entrées dans la vie active alors que le nombre des actifs baissait de 24'000. La proportion des femmes parmi les personnes actives est passée de 39,8 % à 42,2 %.
(OFS 106/98) Selon la statistique trimestrielle de la population active occupée (SPAO, le nombre d'actifs occupés (au minimum 6 heures par semaine) a augmenté de 1,2 % entre le troisième trimestre 1997 et le troisième trimestre 1998 (+1,4 % pour les femmes, 1,2 % pour les hommes, + 3,7 % pour les étrangers et + 0,4 % pour les Suisses). Cette augmentation est inférieure à celle observée entre les deuxièmes trimestres de 1997 et 1998 (+ 1,4 %). L'emploi (nombre de places de travail) a quant à lui augmenté de 1,4 % entre les troisièmes trimestres de 1997 et 1998 (1,6 % dans le secteur tertiaire, 1 % dans le secondaire). Fin septembre 1998, la Suisse comptait 3,878 millions de personnes actives occupées, dont 42 % de femmes et 15 % d'étrangers.
(OFS 5/97) Selon une étude de l'Office fédéral suisse de la statistique, l'importance du travail à temps partiel s'est continuellement accrue au cours des trente dernières années. Ce sont en particulier les mères d'enfants de moins de 15 ans qui travaillent à temps partiel et les emplois à temps partiel sont particulièrement répandus dans le tertiaire. Pour l'OFS, il n'existe pas de lien direct entre le travail à temps partiel et le chôpmage, ni dans le sens d'une augmentation de celui-ci, ni dans le sens d'une diminution.
- 24,6 % des emplois à fin septembre 1998 en Suisse étaient des emplois à temps partiel (10,2 % dans le secteur secondaire, 30,9 % dans le secteur tertiaire). 53,3 % des emplois dans le secteur de l'enseignement, 49,2 % dans celui des activités associatives, 48,4 % dans celui de la santé et de l'action sociale étaient des emplois à temps partiel. 75,8 % des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes. L'emploi à temps partiel a augmenté de 2,6 % entre les troisièmes trimestres de 1997 et 1998, soit plus de deux fois plus que l'emploi en général.
- (Die Presse, 20.4) Moins de la moitié (48 %) des actifs et à peine plus du tiers (36 %) des actives ont un temps de travail "normal" en Autriche, selon une étude du ministère des Affaires sociales. 57 % des salarié(e)s sont concerné(e)s par le travail à temps partiel, le travail le week-end (22 % des actifs), le soir (10 %), de nuit (9 %) ou en équipe (17 % des hommes, 13 % des femmes).
- (Les Echos 22.6) 17,2 % des actifs français occupaient un emploi à temps partiel en janvier 1999 (+ 0,1 % par rapport à 1998). La durée moyenne de travail à temps partiel s'établit à 23 heures par semaine.
- Depuis les années soixante, le travail à temps partiel a pris de plus en plus d'importance en Suisse. En 1970, 12 % des actifs occupés travaillaient à temps partiel, 15 % en 1980, 19 % en 1990, 27 % en 1996. Entre 1991 et 1995, le volume du travail fourni par les actifs occupés à TP s'est accru de 66 millions d'heures, soit le volume de travail de 35'000 actifs occupés à temps plein. Pendant la même période, l'effectif des actifs occupés à TP a augmenté d'environ 100'000 personnes. Environ 500'000 actifs occupés à plein temps souhaiteraient travailler à temps partiel (300'000 hommes, 200'000 femmes).
- La moitié des actifs occupés à TP ont un taux d'occupation inférieur à 50 % (17 % un taux d'occupation inférieur à 20 %, 31 % un taux d'occupation de 20 à 49 %)) et un tiers un taux d'occupation de 50 à 74 %.
- Le travail à temps partiel est majorité féminin : 83 % des actifs occupés à TP sont des femmes, et 52 % des femmes travaillent à TP. 38 % des femmes âgées de 20 à 61 ans et ayant des enfats de moins de 15 ans sont "non actives" professionnellement ou au chômage. 47 % sont "actives" professionnellement à TP, 15 % le sont à plein temps. 45 % des femmes sans enfants sont "actives" à plein temps, 32 % à TP et 23 % sont "non-actives" ou au chômage. Le nombre d'enfants influence directement la proportion des femmes "actives" travaillant à temps partiel : de 43 % pour les femmes sans enfants à 66 % pour les femmes avec un enfant, 84 % pour les femmes avec deux ou trois enfants, 81 % pour les femmes avec 4 enfants ou plus. Par contre, seuls 6 % des hommes de 20 à 64 ans travaillent à temps partiel, avec une proportion plus élevée chez les hommes de moins de 25 ans (15 %), de 55 à 65 ans (8 %) et particulièrement de 62 à 65 ans (62 %), et chez les hommes sans diplôme professionnel (13 %) ou universitaires (9 %). Les Romands travaillent moins à TP que les Alémaniques (26 % contre 29 %, 46 % contre 55 % pour les femmes), et les étrangers moins que les indigènes (17 % contre 30 %, 35 % contre 56 % pour les femmes).
- Le travail à temps partiel est majoritairement situé dans le secteur tertiaire. 85 % des actifs occupés à TP travaillent dans le secteur des services, 31 % des employés du tertiaire travaillent à TP. La croissance de l'emploi enregistrée par le secteur tertiaire depuis 1970 résulte en grande partie de l'augmentation des smplois à TP et d'un engagement accru de femmes.
- Le travail à temps partiel est essentiellement un travail d'"exécutant", et marginalement un travail de direction. Seules 14 % des personnes exerçant des fonctions de direction travaillent à temps partiel, alors que 27 % des actifs travaillent à TP.
Au 31 mars 1998, la Suisse comptait 3,820 millions de personnes actives occupées, dont 42 % de femmes et 24 % d'étrangers.
- L'emploi à temps partiel représente 24,7 % des emplois : 10,7 % des emplois dans le secteur secondaire (25,7 % dans l'imprimerie et les arts graphiques), 30,9 % des emplois dans le secteur tertiaire (34,1 % dans le commercial de détail, 53,5 % dans l'enseignement, 47,7 % dans la santé et l'action sociale, 50,1 % dans le secteur associatif, 41,8 % dans les loisirs, la culture et le sport). Les secteurs à forte proportion d'emploi à temps partiel sont aussi les secteurs à forte proportion d'emplois occupés par des femmes (à l'exception de l'imprimerie-arts graphiques). Les femmes occupent 75,7 % des emplois à temps partiel.
- L'emploi à plein temps recule au profit du travail à temps partiel, dont la part à l'emploi total est passée de 25,4 % en 1991 à 28,3 % en 1997. Entre 1991 et 1997, le nombre des personnes occupées à plein temps est tombé de 2,811 millions à 2,7 ,millions de personnes, et celui des personnes occupées à temps partiel estpassé de 956'000 à 1,065 million de personnes.
- La part des indépendants dans la population active occupée passe de 15,2 % en 1991 à 18,4 % en 1997 (respectivement 16,0 à 20,1 % chez les hommes, 14,0 à 16,2 % chez les femmes). Les indépendants étaient 572'000 en 1991 et 692'000 en 1997.
- A Genève, le nombre de travailleurs "indépendants" (c'est-à-dire non salariés) est passé de 14'540 (dont 19,5 % de femmes) en 1980 à 25'900 (dont 29 % de femmes) en 1995. Leur poids dans la population active est passé dans le même temps de 8,1 % à 11,9 %
Le travail non rémunéré en Suisse : une valeur de 140 à 215 milliards de francs, soit entre 37,5 et 58 % du produit intérieur brut
(OFS 1999) Selon l'Office fédéral suisse de statistiques (OFS), "Le travail non rémunéré est nettement sous-estimé par rapport à son importance réelle au plan social, juridique et économique". Quelques études ont cependant été faites en Suisse sur ce thème. En 1980. celle de P, Schellenbauer et S. Merk estimait la valeur du travail non-rémunéré à environ 60 milliards de FS, et l'Alliance des sociétés féminines suisses à 78 milliards. En 1995, R. Widmer et A. Sousa-Poza la situaient dans une fourchette de 99 à 158 milliards. En 1999, l'OFS la situe dans une fourchette de 140 à 215 milliards.
Pour son étude, l'OFS a considéré les travaux non rémunérés s'effectuant dans les "ménages", c'est-à-dire "une communauté de personnes vivant ensemble" (ou de personnes vivant seules) "et constituant une unité économique à but non lucratif destinée à subvenir (...) aux besoins" de ses membres. Le "travail non rémunéré" correspond d0abord aux "prestations domestiques", à la "production domestique" et/ou au "travail domestique" effectué dans le ménage, c'est-à-dire "l'ensemble des activités délibérées, organisées, dispositives et exécutoires que les ménages accomplissent afin de subvenir à court et à long terme aux besoins matériels et immatériels des membres du ménage", ce qui comprend la production de biens et de services. Par "travail non rémunéré", l'OFS entend "des activités accomplies gratuitement, mais qui pourraient également être accomplies contre rémunération par une tierce personne".
L'OFS considère donc comme un travail non-rémunéré, par distinction avec un loisir, "toute tâche qu'il serait possible de confier contre rémunération à des tiers" Il s'agit d'une "prestation génératrice de valeur ajoutée fournie par un individu en dehors du marché", et n'apparaissant pas dans la comptabilité nationale.
L'OFS distingue enfin le "travail non-rémunéré" des loisirs par le fait que le premier "peut être dissocié de la personne qui l'exécute, contrairement aux activités de loisir, qui sont toujours accomplies par les personnes mêmes qui en bénéficient". Autrement dit, le travail non rémunéré bénéficie ou peut bénéficier à une tierce personne, et a contrario "être exécuté par un tiers". La frontière entre le travail non-rémunéré et les loisirs est donc "déterminée par le critère de la tierce personne", qui repose sur l'idée "de la substituabilité du travail marchand" : on considérera comme du travail non rémunéré toute activité qu'il serait possible de faire exécuter contre rémunération par des tiers (personnes ou entreprises). A cette définition, et pour la préciser (en excluant de la liste des travaux non-rémunérés des activités dont le bénéficiaire est identique au "travailleur"), s'ajoutera une liste d'activités considérées comme du travail non rémunéré (chaque pays établissant d'ailleurs ses propres listes).
L'Office fédéral de la statistique a recensé en Suisse douze groupes d'activités non rémunérées, qu'il a réparti en quatre catégories :
- 1. Les travaux ménagers
(préparer les repas, laver et ranger la vaisselle, mettre la table, faire les achats, nettoyer, ranger, passer l'aspirateur, faire les lits, faire la laissive, repasser, réparer, rénover, coudre, tricoter, soigner les animaux d'appartement ou les plantes, travailler au jardin, travaux administratifs)
- 2. L'éducation et les soins aux enfants et à d'autres membres du ménage
(nourrir, donner le biberon, laver, aider à faire les devoirs, jouer, se promener, accompagner les enfants, soigner les membres du ménage ayant besoin d'assistance)
- 3. Les activités bénévoles
- 4. Les activités informelles
(soins et assistance à des parents ou à des connaissances)
Pour évaluer monétairement le travail non rémunéré, l'OFS évoque deux modèles macro-économiques possibles, l'un basé sur l'"input" (évaluation d'après le salaire d'un substitut marchand, ou d'après le "coût d'opportunité", c'est-à-dire la perte de gain entraînée par l'activité non rémunérée pour la personne qui s'y adonne), l'autre basée sur l'"output" (détermination de la valeur du travail non rémunéré d'après le prix des biens et services substitutifs produits sur le marché). L'OFS a privilégié, pour des raisons de simplicité, la première méthode, faute d'informations suffisemment complètes et détaillées sur les quantités et les types de biens et de services produits dans les ménages, lesquels n'ont d'ailleurs pas toujours de substituts marchsnds, ou n'ont de substituts que difficulement évaluables, ou assurée par des services publics à des tarifs non fixés par le marché (par exemple dans le cas des services personnels et des soins aux enfants).
Pour calculer la valeur du travail non rémunéré, l'OFS a multiplié la durée de ce travail par une variable salariale (valeur du travail non rémunéré = temps de travail x salaire). Pour évaluer le temps de travail, l'OFS a tenu compte du temps de travail effectif déclaré par les personnes interrogées, par analogie à un travail sous contrat (temps de travail contractuel + heures supplémentaires rémunérées). Pour évaluer le salaire auquel ce temps de travail donnerait droit s'il ne s'agissait pas d'un travail non rémunéré, l'OFS a tenu compte du salaire net (cotisations sociales déduites) après impôt direct
Pour évaluer le travail rémunéré, l'OFS a procédé à une enquête auprès de 16'207 personnes âgées de plus de 14 ans, à qui il a été demandé combien de temps elles avaient consacré la veille aux diverses activités non rémunérées recensées, et combien de temps elles ont consacré durant les quatre dernières semaines aux activités honorifiques ou de bénévolat d'une part, à l'ensemble du travail non rémunéré informel d'autre part.
En 1997, la valeur monétaire du travail non rémunéré se montait, selon la comparaison avec la valeur d'un substitut marchand (méthode du substitut spécialisé), à 215,235 milliards de FS, soit 57,9 % du PIB, dont 141,290 milliards pour la contribution des femmes et 73,975 milliards pour la contibution des hommes. Selon la méthode des coûts d'opportunité (manque à gagner), la valeur du travail non rémunéré se situerait à 139,247 milliards de FS, soit 37,5 % du PIB, dont 85,938 pour le travail non rémunéré des femmes et 53,409 pour le travail non réuméré des hommes). Dans l'un et l'autre cas, la valeur du travail non rémunéré des femmes atteint environ le double de celle du travail non rémunéré des hommes.
. En Allemagne, la valeur du travail non rémunéré a été évaluée en 1991/1992, sur la base du salaire horaire net, à 34 % du PIB selon la méthode du substitut spécialisé et à 46 % selon la méthode des coûts d'opportunité.
. En Australie, la valeur du travail non rémunéré a été évaluée en 1992 à 52 % du PIB selon la méthode du substitut spécialisé et 69 % selon la méthode des coûts d'opportunité
. Au Canada, une enquête de 1992 estime la valeur du travail non rémunéré à 31 % du PIB selon la méthode des coûts d'opportunité sur la base du salaire net et à 41 % selon la méthode du substitut spécialisé.
. En Finlande, une enquête de 1987/1988 a permis d'évaluer la valeur monétaire du travail non rémunéré à 45 % du PIB selon la méthode des coûts du marché, à 59 % selon celle des coûts d'opportunité
. En Norvège, une enquête de 1990/1991 estime la valeur du travail rémunéré à 37 ou 38 % du PIB, respectivement selon la méthode du substitut spécialisé et selon celle du substitut global.
. Aux Pays-Bas, une en quête réalisée en 1990 par M. Bruyn-Hundt a situé la valeur du travail non rémunéré dans une fourchette de 51 % (méthode des coûts d'opportunité sur la base du salaire minimum) à 63 % (méthode du substitut global).
Selon l'OFS, dans sept couples sur dix (72 %) et neuf familles (couples avec enfant de moins de 15 ans) sur dix (90 %), c'est la femme qui assume principalement, voire exclusivement les tâches domestiques et familiales.Les ménages dans lequels les tâches domestiques sont partagées à égalité ne représentent que 14 % des couples ou des familles, 7 % des familles avec enfant(s) de moins de 15 ans.
- Environ 24 heures sont investies en moyenne chaque semaine dans les tâches domestiques non-rétribuées, soit 31 heures en moyenne par les femmes et 16 heures en moyenne par les hommes. Dans les familles avec enfant(s) de moins de 15 ans, les femmes investissent environ 52 heures par semaine (de sept jours) dans les tâches ménagères, et les hommes 22 heures. Les hommes ne consacrent que 15 heures par semaine aux tâches domestiques dans les familles avec enfants de plus de 15 ans, ou d'autres adultes. La charge de travail totale incombant à chacun des deux partenaires (travail domestique plus travail salarié) représente en moyenne 62 heures par semaine de sept jours pour l'homme comme pour la femme, celle-ci travaillant moins contre rémunération (une moitié des mères d'enfants en bas âge n'exercent aucune activité lucrative, un quart travaillant à moins de 50 %, toutes -travailleuses salariées ou domestiques- investissant en moyenne 22 heures par semaine dans l'éducation et les soins aux enfants) . Les personnes élevant seules des enfants travaillent en moyenne 45 heures par semaine aux tâches domestiques (mais le total du travail professionnel et du travail domestique se monte à 67 heures par semaine pour les femmes qui ont un travail rémunéré) et les célibataires sans enfants 36 heures pour les femmes, 44 pour les hommes (la différence s'expliquant par le plus grand nombre de femmes que d'hommes à l'âge de la retraite, c'est-à-dire sans activité rémunérée). La charge de travail domestique correspond à 31 heures hebdomadaires pour les femmes de 62 à 71 ans, et 19 heures pour les hommes du même âge. Elle diminue ensuite avec l'âge.
- La charge de travail domestique des femmes au foyer s'établit à 48 heures par semaine en moyenne.
- Les jeunes filles de 15 à 24 ans participent à raison de 13 heures par semaine aux tâches domestiques, les garçons du même âge à raison de 8 heures par semaine.
- Les personnes vivant seules consacrent 17 heures par semaine en moyenne aux travaux domestiques (20 heures pour les femmes, 15 heures pour les hommes, alors que ces tâches sont pratiquement équivalentes pour les unes et les autres dès lors qu'il s'agit d'un "ménage à personne unique". L'écart entre les hommes et les femmes s'accroît d'ailleurs avec l'âge, et le temps de travail domestique diminue avec le niveau de formation d'une part et, évidemment, le temps de travail réumunéré d'autre part.
- La participation des hommes aux tâches domestiques non rémunérées est plus forte dans la tranche d'âge de 25 à 39 ans (18 heures par semaine en moyenne) et de plus de 74 ans (19 heures) que dans les autres tranches d'âge, plus forte chez les hommes au bénéfice d'une formation tertiaire (18 heures) que chez les hommes sans formation post-obligatoire. Chez les femmes, la même différenciation selon le niveau de formation est constatable (28 heures pour les femmes sans formation post-obligatoire, 33 heures pour les femmes avec formation secondaire).
- Le temps investi par les femmes au foyer (sans activité rémunérée) dans les tâches domestiques s'établit à 62 heures par semaine pour les mères d'enfants de moins de 7 ans. Si elles ont une activité réumunérée à mi-temps, la charge de travail domestique atteint encore 53 heures par semaine (temps auquel il faut donc ajouter le temps de travail rémunéré pour obtenir le temps de travail total, soit en l'ocurrence autour de 73 heures)
Selon la mêne enquête de l'OFS, une personne sur quatre (26 % de la population résidente) exerce au moins une activité bénévole, militante ou honirifique au sein d'une association, d'une institution ou d'une organisation. 7 % de la pupulation cumulent au moins deux et 1,6 % au moins trois activités de ce type. Les hommes s'y engagent davantage que les femmes (sauf pour les travaux non rémunérés informels, tels que l'aide entre voisins ou la garde d'enfants de tiers), les personnes de 40 à 54 ans davantage que les personnes plus jeunes ou plus âgées, les personnes avec un niveau de formation universitaire davantage que les autres, les personnes mariées avec enfants davantage que les autres. Les hommes invetissent en moyenne 15 heures par mois dans ce type d'activité (contre 12 heures pour les femmes) et représentent la majorité absolue des "militants et béévoles" (voire les deux tiers des personnes cumulant au moins deux activités militantes et bénévoles), les femmes y consacrant pour leur part environ 12 heures par mois. Par contre, les femmes consacrent en moyenne 16 heures par mois et les hommes 9 heures aux travaux non rémunérés informels, tels que les soins aux proches, les gardes d'enfants, l'entraide avec les voisins etc...
- 15 % de la population est active bénévolement dans des sociétés sprtives et culturelles, 4,9 % dans le cadre de fonctions politiques et de services publics (pompiers volontaires, samaritains etc...), 4.2 % dans le cadre d'associations de défense d'intérêts (comme les syndicats ou les organisations de défense de l'environnement) et à peu près autant dans des associations caritatives ou humanitaires, 3,3 % dans des institutions religieuses.Les activités bénévoles les plus fréquentes se font, outre dans des associations portives et culturelles, dans des organisations politiques, de défense d'intérêt ou de service public pour les hommes, caritatives, humanitaires et religieuses pour les femmes.
- 54 % des activités militantes et bénévoles sont liées à des tâches "dirigeantes", qui représentent 62 % de ces activités lorsqu'elles sont accomplies par des hommes et 42 % lorsqu'elles sont accomplies par des femmes, 68 % de ces activités lorsqu'elles se font dans des associations de défense d'intérêts, mais seulement 35 à 38 % lorsqu'elles se font dans des organisations caritatives et humanitaires ou religieuses.
30 % des résidents en Suisse effectuent des "travaux non-rémunérés informels" (aide aux voisins, garde d'autres enfants que les siens, etc...). Les femmes sont 36 % à être actives de cette manière, contre 24 % des hommes, et les "ruraux" 34 %, contre 28 % des "urbains".
- La personne-type effectuant des "travaux non rémunérés informels" est une retraitée de 62 à 74 ans (40 ans d'entre elles s'y adonnent), ayant poursuivi une formation après l'école ogligatoire.
- La plupart des travaux informels non-rémunérés (58 %) sont effectués pour les connaissances hors de la famille, et 41 % pour des parents. Il s'agit surtout de tâches domestiques, de services de transports et de travaux de jardinage (32 %), puis de garde d'enfants (22 %). L'aide accordée à des parents adultes occupe en moyenne 26 heures par mois, la garde d'enfants 21 heures, les soins à des connaissances (non parentes) 13 heures.
- Les hommes investissent nettement moins de temps que les femmes dans les "travaux informels non-rétribués", avec 9 heures par mois pour les premiers et 16 heures par mois pour les secondes (pour une moyenne épicène de 14 heures). Les retraité-e-s investissent 21 heures par mois dans ces activités, les femmes au foyer 17 heures, les chômeurs 16 heures, les actifs occupés moins de 10 heures et les personnes en formation 6 heures et demi.
La modification de la réalité du travail se mesure par la non-concordance entre la durée "normale" ou "habituelle" du travail et la durée effective du travail par emploi :
- En 1995, la durée "habituelle" du travail (fondée sur les déclarations d'accidents professionnels) était de 41,9 heures hebdomadaires, la durée "normale" du travail des salariés à plein temps de 42,1 heures hebdomadaires, mais la durée effective moyenne du travail (nombre total d'heures de travail accomplies divisé par le nombre total d'emplois dénombrés) était de 1583 heures annuelles, soit 30,4 heures hebdomadaires sur la base de 52 heures par an, de 33 heures sur la base de 48 semaines, de 34,4 heures sur la base de 46 semaines.
- En 1996 en Suisse la durée annuelle moyenne du travail par emploi se situait autour des 1600 heures, soit, grosso modo, 30 heures et 45 minutes par semaine.
- Le nombre total d'heures de travail accomplies en Suisse a diminué de 0,6 % entre 1995 et 1996. Le recul du nombre d'emplois à plein temps a été de 0,7 %, (soit 20'000 emplois en moins) alors que le volume du travail à temps partiel augmentait de 0,6 %.(soit 8000 emplois en plus).
- Le volume du travail réalisé dans le cadre d'emplois à temps partiel représentait 14,5 % du volume total du travail en 1996 (14,3 % en 1995). La hausse du volume de travail à temps partiel entre 1991 et 1996 a été de 11,3 % chez les hommes et de 5,7 % chez les femmes. En termes absolus, lle travail à temps partiel a représenté en 1996 41 millions d'heures de plus qu'en 1991 chez les femmes, 20 millions d'heures de plus chez les hommes.
- Entre 1991 et 1996, le volume annuel effectif de travail a diminué de 3,6 % chez les femmes et de 2,8 % chez les hommes. 107'000 emplois masculins ont été supprimés (4,4 % de recul de l'emploi), 11'000 emplois féminins ont été créés (1,7 % de progression de l'emploi). La durée annuelle du travail par emploi s'accroissait de 1,7 % (soit 31 heures) pour les hommes,. alors qu'elle diminuait de 4,2 % (54 heures) chez les femmes.
- La durée moyenne des absences au travail a été de 90 heures par an, pour les hommes comme pour les femmes, en 1996. Le taux d'absentéisme masculin est passé de 1991 à 1996 de 6,3 % à 4,7 % chez les hommes.
- En 1995, les personnes occupant un emploi à plein temps (au minimum 90 % de la durée normale du travail) concentraient 71 % de l'emploi total et fournissaient 86 % du volume total de travail rémunéré. Les personnes occupant un emploi à temps partiel équivalant à un moins un mi-temps concentraient 13 % de l'emploi total et fournissaient 10 % du volume total de travail rémunéré. Les personnes occupant un emploi à moins de mi-temps concentraient 16 % de l'emploi total et fournissaient 4,6 % du volume total de travail rémunéré.
- En 1995, les femmes occupaient 43 % des emplois mais n'accomplissaient que le tiers du volume total du travail rémunéré, du fait de la forte proportion de femmes travaillant à temps partiel : sur 100 heures de travail à temps partiel, environ 80 étaient effectuées par des femmes.
(OFS 1997) De 1994 à 1995, le volume annuel effectif de travail a progressé de 1,4 % pour les emplois à temps partiel alors qu'il ne progressait que de 0,4 % pour les emplois à plein temps, et de 0,5 % pour l'ensemble des emplois. Dans le même temps, le nombre d'emplois à temps partiel progressait de 1,1 % et celui des emplois à plein temps de 0,6 %.
- Le volume du travail réalisé dans le cadre d'emplois à temps partiel représentait 14,2 % du volume total du travail en 1995, contre 12,8 % en 1991.
- Les activités "accessoires" rémunérées ont progressé de 22,4 % chez les hommes et de 11 % chez les femmes entre 1994 et 1995. La hausse du volume de travail la plus marquée d'une année à l'autre a été observée chez les hommes occupés à temps partiel (+ 6,1 %).
- La durée annuelle du travail par emploi est passée de 1587 heures en 1994 à 1583 heures en 1995, grâce essentiellement à une baisse de la durée annuelle du travail à plein temps (1917 heures contre 1922). Les hommes ont cependant travaillé en moyenne annuelle 21 heures de plus en 1995 qu'en 1991 (+ 1,1 %), alors qu'ils occupaient 76'000 emplois de mois (-3,1 %) Les femmes, par contre, ont travaillé 33 heures de moins en 1995 qu'en 1991 (-2,6 %), à niveau d'emploi égal.
- La durée annuelle moyenne du travail était de 1264 heures dans le secteur des "autres services" (enseignement, recherche, santé, oeuvres sociales, culture) et de 2136 heures dans le secteur de l'agriculture et de la sylviculture (moyenne de tous les secteurs : 1585 heures). Par ailleurs, les indépendants travaillaient en moyenne annuelle environ 400 heures de plus que les salariés.
- Tous secteurs économiques confondus, la durée moyenne des absences a été de 99 heures par emploi et par année en 1995. La moyenne des heures supplémentaires, dans le même temps, a été de 41 heures.
Au deuxième trimestre 1997, 3'737'000 personnes exerçaient une activité professionnelle en Suisse, soit un peu plus de la moitié de la population résidente. Cette "population active occupée" était coomposée de 59,4 % d'hommes et de 40,6 % de femmes, de 75,3 % d'indigènes et de 24,7 % d'étrangers.
- Par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, le nombre total des personnes actives a diminué de 2,2 % (de 1,1 % chez les hommes, de 3,7 % chez les femmes, de 1 % chez les Suisses et de 5,5 % chez les trangers). Par secteurs économiques, l'effectif des personnes actives éccoupées a diminué de 2,8 % dans le secteur secondaire et de 2,7 % dans le secteur tertiaire, et a augmenté de 10 % dans le secteur primaire (ce qui s'explique selon l'Office fédéral de la statistique par le fait qu'en période économique peu propice, nombre de personnes travaillant à titre principal dans le secteur secondaire ou tertiaire et accessoirement dans le secteur primaire ont perdu leur "emploi principal" et n'ont gardé que leur activité secondaire -laquelle devient du coup unique.
- Le taux genevois d'activité (pourcentage de la population résidente âgée de 15 ans ou plus et exerçant une activité rémunérée) était de 66,2 % en 1995 (76,7 % pour les hommes, 56,9 % pour les femmes).
- En 1995, 78,3 % de la population résidente active de Genève était salariée (74,8 % pour les hommes, 82,6 % pour les femmes). 11,9 % était active de manière indépendante (7,5 % des femmes, 15,6 & % des hommes), 3,7 % au titre de la collaboration familiale ou de l'apprentissage (3,4 % pour les femmes, 3,9 % pour les hommes), 6.1 % était au chômage (6,5 % pour les femmes, 5,7 % pour les hommes).
- En 1995, 51,3 % de la population genevoise "en âge d'être active" était salariée. Les autres étaient soit chômeurs, soit indépendants, soit en collaboration familiale, soit en apprentissage, soit sans activité rémunérée.
(OFS juillet 1998) Selon les premiers résultats d'un sondage réalisé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre de l'enquête nationale sur la population active, les femmes continuent à assumer la majeure partie du travail non rémunéré, en assumant l'essentiel des travaux ménavgers, les hommes s'engageant davantage que les femmes dans des activités honoriques ou bénévoles.
- Les femmes (tous ménages considérés) consacrent en moyenne 4,4 heures par jour aux tâches ménagères, et les hommes 2,3 heures. Dans 90 % des ménages de couples ayant des enfants de moins de 15 ans, le travail ménager est avant tout de la responsabilité des femmes, qui consacrent en moyenne 7 à 8 heures par jour, y compris le week-end, aux tâches ménagères et familiales. Seuls 1 % des hommes accomplissent l'ensemble du travail ménager, pendant en moyenne 6 heures par jour. Dans les "ménages d'une personne" (célibataires sans enfants), les femmes consacrent 3 heures par jour aux tâches ménagères, les hommes deux heures.
- Plus d'une personne sur quatre assume en Suisse une activité honorifique ou bénévole dans une société, une institution ou une association, pendant en moyenne 3 heures et demis par mois (4 heures et demie pour les hommes, deux heures et demie pour les femmes). La classe d'âge la plus active dans ce domaine est celle des 40-54 ans, où 39 % des hommes et 27 % des femmes ont une activité bénévole. Près de la moitié du travail bénévole est effectué au service d'associations sportives (52 % du travail bénévole fourni par les hommes, 41 % du travail bénévole fourni par les femmes). Les femmes s'investissent davantage que les hommes dans le bénévolat au service d'institutions religieuses, sociales ou caritatives, et les hommes davantage que les femme dans des associations de défense d'intérêts, des organisations politiques ou des organismes publics.
- Près d'une personne sur trois assure en Suisse au moins une tâche rémunérée en dehors d'une organisation et en dehors de son propre ménage. Ce type de travail bénévole (aide en faveur de parents ou de connaissances, garde d'enfants ne faisant pas partie de son propre ménage, assistance à des voisins) est essentiellement exercé par des femmes (36 % contre 24 % des hommes). 40 % des femmes de 55 à 64 ans accomplissent ce type de travail, et 28 % des hommes de plus de 65 ans. Les femmes y ont consacré en moyenne 16 heures par mois et les hommes 9 heures.
(Berner Tagwacht, juillet 1997) Une enquête effectuée par l'Université de Berne auprès de 900 entreprises de plus de 20 salariés afin d'obtenir un tableau des modèles de flexibilité du temps de travail mis en oeuvre a donné les résultats suivants :
- Environ 70 % des entreprises ont déjà introduit des modèles "flexibles" d'organisation du temps de travail, et 5 % envisagent de le faire.
- Plus l'entreprise compte d'employés, plus il est facile d'y mettre en place des modèles flexibles du temps de travail
- Certains groupes d'employés ou secteurs d'activité sont tenus à l'écart des horaires flexibles, et seules 13,5 % des entreprises appliquent ces horaires à l'ensemble de leur personnel. Nombre d'entreprises revendiquant de tels horaires n'appliquent en outre que des modèles "traditionnels" de flexibilité (travail par équipes, travail sur appel), laissant peu de marge de manoeuvre aux salariés.
- Les formes les plus "ouvertes" et les plus novatrices d'organisation du temps de travail, conférant le plus d'autonomie aux employés,sont encore inégalement et rarement employées. Le temps partagé, les congés de longue durée, par exemple, sont beauvcoup plus fréquents dans les sociétés de service au public (la santé, le secteur social) et les assurances que dans les autres secteurs d'activité.
Les différents modèles d'organisation "flexible" du temps de travail (en % des 691 entreprises les pratiquant, sur 905 entreprises ayant répondu à l'enquête, pour 2869 entreprises interrogées)
Modèles traditionnels : . travail à la carte : 73,4 % . travail à temps partiel (mi-temps et plus) : 66,1 % . travail à temps partiel (moins de mi-temps) : 56,2 % tempsd de travail variable : 45,7 % travail par équipes : 44,7 % retraite "à la carte" : 25,6 % annualisation du temps de travail : 24,5 % allongement de la vie "active" : 21,3 % partage de poste : 20,4 % horaire variable : 20,0 % congés sabbatiques de longue durée : 16,7 % horaires libres avec plage obligatoire : 16,2 % télétravail et travail à domicile : 13,9 % groupes de travail autonomes 5,9 % travail "à la carte" : 4,2 % autres modèles : 6,2 %
Des propositions de réduction de la durée du travail en Ville de Genève
"En Suisse, on connait l'effectif de chaque race de vaches, mais pas le nombre des chômeurs en fin de droits."
(Pierre-Alain Champod)
Le vécu du travail perd de sa spécificité, et tout ce qui le distinguait des autres compartiments de la vie sociale s'estompe. Les trois unités, de lieu, de temps et d'action, qui caractérisaient le travail industriel, volent en éclat. Unité d'action : le travail devient plus autonome, et le rapport de subordination fait place à une contrainte multiforme exercée par les clients, les partenaires, etc. On assiste à une différenciation des formes d'engagement, et à une diversification des rapports sociaux dans le travail. Unité de lieu : l'emploi décline dans les grands ateliers. On travaille dans de petites équipes, on se déplace, à domicile, etc. Unité de temps : on assiste à une synchronisation et à une interpénétration de temps sociaux de moins en moins structurés par l'organisation collective du travail.
(Bernard Perret)
L'éclatement des horaires de travail
Dès les années septante, mais avec une amplitude croissante dès le début de la décennie suivante, l'organisation sociale et individuelle du temps de travail est marquée par la diversification des horaires : temps partiel, annualisation du calcul du temps de travail, travail le week-end, les jours fériés, le soir ou la nuit... Ce phénomène est à la fois producteur d'individdualisation des situations, et produit par l'individualisation des liens sociaux qui marque l'évolution de toutes les sociétés "développées" : rétrécissement quantative du noyau familial et qualitative de son rôle, multiplication des familles monoparentales et des foyers individuels, affaiblissement des institutions, des normes et des liens traditionnels (notamment religieux et scolaires). On se trouve donc devant un phénomène d'atomisation des comportements sociaux, et de définition de plus en plus autonome et individuelle des normes de ces comportements. notamment en matière d'horaire, en même temps que les politiques de déréglementation sociales donnent aux employeurs des moyens nouveaux d'imposer (ou de ré-imposer) aux travailleurs des temps de travail là où depuis les années trente les politiques social-démocrates avaient réussi à imposer des temps de repos, de loisirs, de socialité... ou de consommation.
- Plus de 35 millions de personnes, soit 30 % de l'ensemble des salariés dans l'Union européenne, sont aujourd'hui soumis à des horaires "atypiques" (travail à temps partiel, le week-end, les jours fériés, de nuit etc...)
- La proportion de ceux qui travaillent selon des horaires "décalés" de la norme traditionnelle était déjà de 51,8 % en Grande-Bretagne en 1993.
- En Allemagne, seuls 17 % des actifs pratiquaient des horaires de travail "standards".
Ce changement des comportements individuels se heurte cependant à la persistance des normes sociales, et, s'agissant du temps, au maintien des rythmes horaires comme références de ceux des infrastructures sociales. "Les gens" ont beau travailler de plus en plus hors du cadre habituel du "8 heures-18 heures du lundi au vendredi", ce cadre est toujours celui de l'ouverture des services dont ils ont besoin -les crèches, les commerces, les écoles, les administrations.
L'organisation taylorienne du travail, qui prévalait depuis le début du siècle, avait en effet "contaminé le hors travail" (pour reprendre l'expression du sociologue Jean-Yves Boulin) et "contribué à une homogénéisation des comportements, qu'il s'agisse des départs en vacances, des activités de loisirs, dont les horaires sont calés sur ceux du travail (et même des) grilles de programmes TV". Les activités de service publics (écoles, administrations, services sociaux) et privés (banques, commerces) fonctionnent encore dans leur grande majorité sur le modèle des 40 heures hebdomadaires du lundi au vendredi et de l'aube au crépuscule.
Un changement s'opère cependant -mais dans des conditions de sous-éenchère sociale pour le moins préoccupantes, où le critère du service au public importe bien moins que celui du profit maximum. Un changement, donc, mais qu'il faudra bien que l'on accompagne et maîtrise si l'on éviter qu'il aboutisse à un formidable retour en arrière social. Reste dans dès les années '70, d'abord dans les pays scandinaves puis dans les pays où l'on a déréglementé (dans des proportions variables) les horaires d'ouverture des commerces (Danemark, Pays-Bas, Allemagne... Genève...), il est désormais possible de s'approvisionner la nuit et le dimanche. Mais les administrations restent généralement fermées hors du cadre horaire traditionnel, et les services sociaux continuent à fonctionner en référence à ce cadre. Il est le plus souvent impossible, par exemple, à une mère célibataire travaillant la nuit ou le week-end, de trouver une crèche pour accueillir ses enfants.
Les femmes sont d'ailleurs les premières victimes de ce décalage du temps individuel réel et du temps social normé (et normé en référence au "modèle masculin d'organisation du temps" (J.-Y. Boulin).
Changer le temps
(Jean-Yves Boulin, Libération du 29.9)
La question du temps de travail n'es aujourd'hui envisagée qu'en relation avec la création d'emplois et la flexibilité du travail. De ce fait, il n'y a pas de réflexion sur la nécessité d'accimpagner, par des réformes structurelles, ces changements de rythme et de durée. On n'évoque pas dans les discussions sur la réduction du temps du travail, l'impact qu'elle pourrait avoir sur le rythme des transports. Cette non-réflexion est un des obstacles à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Les horaires des services, des loisirs, ne peuvent plus continuer à fonctionner sur un mode homogène et standardisé. Dans le commerce, les amplitudes horaires en l'espace de dix ans ont déjà totalement explosé. On voit bien ce qui se profils à l'horizon : plus on éclatera les horaires de travail, plus les gens auront des demandes de services en dehors des heures d'ouverture communément admises, plus les prestataires devront s'adapter et plus on entretiendra la dérégulation des horaires et des statuts d'emploi.
(...) c'est pourquoi il conviendrait de penser les politiques du temps de travail en relation avec la vie quotidienne des gens. Cela exige une double évolution. D'une part, à l'instar des pays scandinaves, une prise en compte des modes de vie des salariés lors des négociations sur le temps de travail. D'autre part, à l'image cette fois-ci des Italiens, une action sur l'organisation des temps de la ville, permettant une offre plus immédiate et diversifiée des services.
(Echos 31.3) De 10 à 18 millions de personnes travaillent au noir dans l'Union européenne, où le travail au noir représente de 7 à 16 % du produit intérieur brut. En Grèce, le travail au noir représente entre 29 et 35 % du PIB; il représente de 20 à 26 % du PIB italien, de 12 à 21 % du PIB belge, de 2 à 4 % du PIB finlandais, de 3 à 7 % du PIB danois et de 4 à 7 % du PIB suédois. De 7 à 19 % des chômeurs déclarés dans l'Union européenne effectueraient plus ou moins régulièrement un travail au noir. Ces chiffres proviennent d'une étude réalisée à la demande de la Commission européenne.
Le chômage en Suisse (et ailleurs)
(Source : OIT) Le chômage a atteint en 2003 un niveau record dans le monde, avec 186 millions de personnes sans emploi. "Si la reprise s'essouffle (...) beaucoup de pays ne parviendront pas à réduire de moitié la pauvreté d'ici 2015", a ajouté le directeur général du Bureau International du Travail (BIT), Juan Somavia, en faisant allusion à l'un des "objectifs de développement" pour le Millénaire. Mais même la "reprise" et la croissance ne sont plus des facteurs de réduction du chômage : dans les pays développés, on constate une croissance sans création d'emploi (ce qui d'ailleurs fragilise cette croissance, en raison de la baisse de la demande de biens et de services induite par la montée du chômage). D'ici 2015, il faudrait "absorber" 514 millions de nouveaux travailleurs arrivant sur le "marché du travail", pour ne faire que maintenir le taux de chômage à son niveau (record) actuel.
Le pourcentage de chômeurs à la recherche d'un emploi a atteint en 2003 6,2 % de la population active du globe, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré par le BIT. Les chômeurs étaient 180 millions en 2002, ils sont 6 millions de plus en 2003. En dix ans, leur nombre est passé de 140 millions en 1993 à 186 millions en 2003 (dont 78 millions de femmes).
Le taux de chômage atteint 14,4 % chez les jeunes de 15 à 24 ans (qui sont 88,2 millions à être au chômage).
Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du nord ont connu en 2003 le taux de chômage le plus élevé au monde (12,2 %), du fait des "restructurations" impulsées par les institutions financières internationales dans les secteurs publics, mais également du fait de la forte progression de la population active.
Dans les pays industrialisés, à l'instar des USA, la croissance de l'économie n'a pas compensé la faiblesse de la création d'emplois, et le chômage se situe toujours autour de 6 % aux USA, de 7,9 % en Europe.
En outre, 550 millions de travailleurs dans le monde gagnent moins d'un dollar par jour.
- Le taux national de chômage en Suisse s'est établi en septembre 2007 à 2,5 % selon les chiffres officiels. Le nombre de chômeurs inscxrits a diminué de 18,8 % entre juillet 2006 et juillet 2007 et est passé pour la première fois depuis cinq ans en dessous de la barre des 100'000 personnes. Le nombre de demandeurs d'emploi, chômeurs ou non, frôlait en juillet 2007 les 160'000, en baisse toutefois de 4,3 % en un mois et de 16,4 % en un an. Le nombre de places vacantes restait stable, autour des 13'500. Le taux de chômage, plus élevé en Romandie qu'en Alémanie, a atteint, en septembre 2007, 6 % à Genève (record suisse), 3,8 % dans le canton de Vaud, 3,2 % à Neuchâtel, 3 % dans le Jura, 2,4 % à Fribourg et 2,4 % en Valais. Le taux de chômage des jeunes a atteint 2,7 % en moyenne suisse en juillet (2,9 % le mois précédent).
De 1991 à 1997, le nombre de chômeurs officiellement recensés comme tels en Suisse est passé de 68'000 à 162'000 personnes, ce qui correspond à des taux de chômage de 1,8 et 4,1 %. La hausse du chômage a touché principalement des hommes (taux de chômage de 1,2 % en 1991, 4,3 % en 1997, contre 2,5 % à 3,9 % pour les femmes), la Romandie et le Tessin (de 2,7 % à 5,4 %, contre 1,4 % à 3,7 % en Alémanie) et les jeunes de moins de 25 ans (de 3,2 % à 6 %, contre 1,9 à 4,8 % pour les 25-39 ans et 1,2 à 3,1 % pour les plus de 40 ans. Le part des chômeurs au chômage pendant plus de six mois est passé de 35,3 % en 1991 à 48,8 % en 1997, celle des licenciements de 22,1 % à 29,6 %, celle des non-renouvellement de contrats de 10,3 à 13 %, celles des démissions motivées par la dégradadtion des conditions de travail ou de salaires de 11,8 à 13 %. Pendant la même période, le nombre des personnes travaillant à temps partiel mais cherchant un emploi à plein temps est passé de 64'000 personnes en 1991 à 142'000 en 1997. Le taux de sous-emploi des femmes est passé de 3,3 % à 6,1 %, celui des hommes de 0,5 % à 1,6 %
- Le taux de chômage de longue durée était de 12,5 % de l'ensemble des chômeurs en 2002 (26 % en 2001).
- Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'augmentation du chômage tient à la faiblesse de la conjoncture économique et au "creux saisonnier" de l'hiver. Le secteur de la construction est le plus touché par l'augmentation du chômage, suivi du secteur du "consulting et informatique".
- 9,7 % des chômeurs genevois à fin mars 1999 avaient moins de 25 ans, 21,5 % avaient plus de 50 ans. Ces groupes d'âges représentaient respectivement 4,2 % et 30,5 % des chômeurs de longue durée. En moyenne annuelle, les chômeurs de moins de 25 ans représentaient 13,7 % du total des chômeurs en 1991, 14,6 % en 1993, 13,6 % en 1995, 12,6 % en 1997. Les chômeurs de plus de 60 ans représentaient quant à eux 4,1 % du total des chômeurs en 1991, 4,8 % en 1993, 6,2 % en 1995 et 5,9 % en 1997.
- 48,8 % des chômeurs inscrits à Genève fin mars 1999 étaient des chômeuses et 47,1 % étaient de nationalité étrangère. La proportion des étrangers sur l'ensemble des chômeurs est restée stable entre 1991 et 1997, entre un minimum de 42,5 % en 1994 et 1995 et un maximum de 46 % en 1996. La proportion des femmes était en hausse tendancielle (40,1 % en 1991, 42,4 % en 1993, 46,8 % en 1995, 46.1 % en 1997).
(Courrier, TG 10.4.97) Selon une étude commandée par le Conseil économique et social (CES) de Genève sur "le coût social du chômage", celui-ci se monterait à 1.140 milliard de FS en 1995, ce qui équivaut à la perte causée par le chômage sur le revenu cantonal, perte évaluée à 5,4 % de celui-ci. La "perte salariale de revenu cantonal", c'est-à-dire l'ensemble des pertes de revenus des chômeurs, équivalent à une perte de ressources pour la consommation, l'épargne et l'investissement, mais également à une perte de ressources fiscales (d'environ 25,3 mios pour les communes, le canton et la Confédération), serait de 934,1 millions de francs pour 1995, soit 65'424 FS par personne inemployée et par année -à qui il convient d'ajouter les demandeurs d'emplois sans indemnités de chômage. La perte de production due au chômage est évaluée à 27 mios FS, la "perte du potentiel de croissance" due à la non-progression des revenus des chômeurs à 7,9 millions, le "gaspillage de connaissances accumulées" à environ 8 millions FS et la perte due au "chômage exporté" des frontaliers français à 26,8 mios. En outre, les frais de fonctionnement de l'assurance chômage et le volume de ses prestations se montent en 1995 à 542,5 millions de FS, les dépenses pour les dispositifs cantonaux de lutte contre le chômage à 56,5 mios FS et le revenu minimum cantonal d'aide sociale à 18,5 mios.
(Les Echos 24.9) Un milliard de travailleurs (soit le tiers de la population active de la planète) seront sans emploi ou sous-employés à la fin de 1998, selon le Bureau International du Travail. 150 millions de personnes seront effectivement au chômage, dont 10 millions auront été privée d'emploi en 1998 à cause de la crise financière asiatique. En outre, 60 millions de jeunes de 15 à 24 ans sont à la recherche d'un emploi.
- En France, le nombre des "personnes privées d'emploi" (demandeurs d'emploi, chômeurs en formation, travaux d'utilité sociale, préretraités) est passé de 2,5 millions en 1981 à 5 millions en 1995.
- Trois millions d'emplois ont été perdus en Allemagne de 1981 à 1987, dont 600'000 de janvier 1996 à janvier 1997.
- En 1996, le nombre de personnes privées d'emploi en Grande-Bretagne a atteint 5,7 millions de personnes.
- Avec un mode de calcul identique aux modes européens, le chômage américain s'établissait à 9,3 % en 1989 (au lieu de 6 % officiels) et à 10 % en 1996 (au lieu des 5,2 % officiels).
Le chômage de longue durée en Suisse
- 36,1 % des chômeurs genevois à fin mars 1999 étaient des chômeurs de longue durée (plus d'un an), La durée moyenne du chômage (316,3 jours) croît avec l'âge des chômeurs : de 203 jours pour les 20-24 ans, elle passe à 299 jours pour les 30-34 ans, 329 jours pour les 40-44 ans, 365 jours pour les 50-54 ans et 475 jours pour les plus de soixante ans. 47,7 % des chômeurs de longue durée sont des chômeuses. Un peu moins de la moitié (47,2 %) des chômeurs de longue durée ont moins de 40 ans, la très grande majorité ont une formation : la part des "non-spécialistes est de 22,8 %, dont une majorité (53,6 %) de femmes).
- La durée moyenne du chômage a crû constamment de 1991 (145,5 jours) à 1997 (363,6 jours), que ce soit pour les hommes (de 144,2 jours à 366,5 jours) ou pour les femmes (de 147,3 jours à 360,2 jours) et pour toutes les classes d'âge.
- (OFS octobre 1998) Entre 1991 et 1996, la possibilité pour les chômeurs d'avoir retrouvé un emploi dans un délai maximum d'un an est passée de 53 % à 49,7 % (de 52,5 % à 48,6 % pour les hommes, de 53,4 % à 50,8 % pour les femmes. La probabilité pour un chômeur au début de l'année d'être encore au chômage à la fin de l'année est passée de 22,8 % à 28,9 % (de 22 % à 35 % chez les hommes, de 23,3 % à 22,7 % chez les femmes). Le fait que ce risque soit plus faible statistiquement pour les femmes, et qu'il se soit même réduit, semble tenir essentiellement au fait que de nombreuses chômeuses abandonnent toute recherche d'emploi dans un délai d'une année -et sortent donc des statistiques du chômage. Cette part d'"abandon" est de 23,6 % chez les femmes, et de 12,9 % chez les hommes.
Les chômeurs en fin de droits
La socialisation continuera à produire des individus frustrés, inadaptés, mutilés, déboussolés aussi longtemps qu'elle persistera à tout miser sur l'"intégration sociale par l'emploi", sur l'intégration dans une "société de travailleurs" où toutes les activités sont considérées comme des moyens de gagner sa vie.
(André Gorz)
Une enquête réalisée en 1995 en Romandie et dans la région bâloise par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) sur les chômeurs en fin de droit a abouti aux résultats suivants :
- En 1994, 42'000 personnes au chômage en Suisse avaient épuisé leur nombre maximal d'indemnités (ce chiffre ne tient évidemment pas compte des personnes sans emploi et ne l'ayant pas déclaré).
- Les femmes, les étrangers et les personnes sans formation sont surreprésentés au sein de la "population" des "fin de droits" par rapport à leur poids dans la population active. Cas particulier : Genève, où il n'y a pas de différence significative entre étrangers et Suisses.
- Un chômeur sur dix épuisera ses 400 jours d'indemnités maximum.
- 50 % des chômeurs en fin de droit n'avaient pas trouvé de travail après 14 mois de chômage.
- 13 % des chômeurs en fin de droit n'ayant pas trouvé de travail se retrouvent à l'assistance publique, 15 % à l'assurance-invalidité (ou l'ayant demandé).
- Les handicaps à la recherche d'un emploi les plus souvent cités par les chômeurs en fin de droit sont l'âge (51,6 %), l'insuffisance de la formation (25,4 %), des problèmes de langue (21,7 %, essentiellement des étrangers), des problèmes de santé (21,6 %).
- D'entre les chômeurs ayant retrouvé une activité professionnelle rémunérée, un sur cinq l'ont fait avec un d'indépendant.
- 1060 collaborateurs de l'Etat étaient sous contrat d'"occupation temporaire" des chômeurs en fin de droits
- 902 personnes percevaient le "Revenu minimum cantonal d'aide sociale", dont 582 personnes seules.En moyenne, 45 % des "clients" du RMCAS sont en activité. Le nombre de bénéficiaires du RMCAS qui ont retrouvé un emploi se situe entre 11 et 21 %. Six mois après leur sortie du système, moins d'un tiers de ceux qui avaient retrouvé un emploi étaient à nouveau au chômage. Le taux de réinsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum (que le rapport d'évaluation du RMCAS produit fin 1997 considère d'ailleurs comme "un revenu de survie plus qu'un revenu d'existence") genevois se situe donc entre 7 et 13 % du total.
- Fin mars 1999, 1706 personnes (+ 8) étaient sous contrat d'emploi temporaire, en placement par l'Office cantonal genevois de l'emploi dans des services publics ou parapublics. 1004 personnes (+ 8) touchaient le revenu minimum cantonal d'aide sociale, dont une majorité (631) de personnes seules. Fin janvier 1999 l'Hospice général prenait en charge 924 personnes (+ 49) en fin de droits ou sans droits aux indemnités-chômage.
- En moyenne, 45 % des "clients" du RMCAS sont en activité. Le nombre de bénéficiaires du RMCAS qui ont retrouvé un emploi se situe entre 11 et 21 %. Six mois après leur sortie du système, moins d'un tiers de ceux qui avaient retrouvé un emploi étaient à nouveau au chômage. Le taux de réinsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum (que le rapport d'évaluation du RMCAS produit fin 1997 considère d'ailleurs comme "un revenu de survie plus qu'un revenu d'existence") genevois se situe donc entre 7 et 13 % du total.
Les "programmes d'occupation" temporaire de chômeurs
- De 1990 à 1995, les programmes d'occupation temporaire de chômeurs mis en place pour redonner aux chômeurs en fin de droit un droit aux allocations, et les "réinsérer dans le marché du travail", ont vu le nombre de leurs béféciaires multiplié par par 14 (de 1350 personnes à 18'000) et leur coût passer de 1990 à 1994 de 5,7 millions à 83 millions de FS.
- En 1994, le 40 % de ces programmes étaient spécifiques à la profession du chômeur, 10 % étaient situés dans le domaine de l'environnement, 30 % étaient des programmes d'occupation "d'utilité publique et sociale", 20 % étaient des stages dans l'administration publique.
- En 1994, les programmes d'occupation temporaire de chômeurs ont équivalu à 2400 places de travail à plein temps. Fin mars 1998, 871 personnes étaient sous contrat d'emploi temporaire en placement par l'Office cantonal genevois de l'emploi, dans des services publics ou parapublics.
Un constat (Jean-Pierre Tobin, "La carotte et le bâton", in "Repères", revue romande d'information sociale, no 5, octobre 1995)
Aujourd'hui, on trouve des situations, dans les communes ou dans les organisations d'utilité publique, où se cotoient des salariés ayant une situation stable et des prestations sociales "normales", et des allocataires, moins bien payés, en situation précaire (le travail dure le plus souvent 6 mois au maximum) et ne bénéficiant pas de toutes les prestations sociales de l'entreprise. Ces deux catégoriesd'employés peuvent, le cas échéant, effectuer le même travail. C'est là un exemple frappant de société à deux vitesses, avec le risque d'une pression sur le bas sur les salaires.
En outre, on se met à utiliser les différents programmes de contre-prestation pour seconder (ou remplacer) des travailleurs sociaux.
Ville de Genève: propositions pour la réduction du temps de travail
Les propositions suivantes ont été déposées au Conseil municipal de la Ville de Genève :
1. Motion (M-399) de Pascal Holenweg : "Du bon usage de la taxe pour l'incitation à l'emploi et à la réduction du temps de travail"
2. Arrêté (PA-466) de Pascal Holenweg : "Du bon usage des subventions de la Ville pour l'incitation à la réduction du temps de travail"
3. Arrêté de Pascal Holenweg : "Réduction du temps de travail de la fonction publique municipale"
1. Du bon usage de la Taxe pour l'incitation à l'emploi et à la réduction du temps de travail
Exposé des motifs :
La situation de l'emploi à Genève reste marquée par l'un des taux de chômage les plus élevés de Suisse. Conjoncturellement, plusieurs secteurs économiques, producteurs de biens ou de services utiles à l'ensemble de la population restent sinistrés, ou à tout le moins menacés (tel est le cas notamment du commerce de détail).
Certes, tout " ralentissement de l'activité économique ne peut être présenté a priori comme une catastrophe, puisqu'il est quelques activités économiques dont nous ne pouvons que souhaiter le ralentissement, voire la disparition pure et simple Même dans ces cas là, cependant, se pose le problème de l'emploi, c'est-à-dire de la concrétisation du droit fondamental de toute personne à constituer l'essentiel de son revenu par un salaire rétribuant le temps passé à travailler (si possible utilement).
Or le volume global de travail salarié nécessaire et disponible a tendance à diminuer, au fur et à mesure que le progrès (ou à tout le moins l'évolution) technologique permet l'accroissement de la productivité du travail individuel. En clair : il faut de moins en moins de personnes employées et salariées pour produire un volume constant de biens et de services, et il en faut même de moins en moins pour produire de plus en plus de biens et de services. Dans ces conditions, le partage du travail salarié nécessaire et disponible est à la fois une nécessité sociale et une possibilité économique. Par partage du travail, nous entendons la répartition de la masse de travail entre le plus grand nombre possible de travailleurs, ce qui implique à la fois la réduction du temps de travail salarié moyen et la création d'emplois salariés nouveaux.
Socialement nécessaire, le partage du travail l'est dans la mesure où l'on souhaite éviter que deux société antagonistes se fassent face comme aux premiers temps de la révolution industrielle et du capitalisme : la société des riches et la société des pauvres. Economiquement possible du fait même de l'augmentation de la productivité, le partage du travail est en outre légitime en tant qu'il s'inscrit dans un mouvement séculaire de libération du temps.
Tout ce qui peut aider à ce partage est donc également socialement utile, économiquement possible et politiquement légitime. Or la réduction du temps de travail est le premier moyen et la condition nécessaire du partage du travail. Il importe donc d'user de tous les instruments dont nous disposons pour la favoriser et y encourager.
Reste que l'atteinte de cet objectif n'est pas chose aisée, et que de multiples obstacles sont à franchir, en particulier dans le secteur privé et plus particulièrement encore pour les petites et moyennes entreprises, dont la précarité financière est souvent le premier argument opposé aux propositions de réduction du temps de travail de leurs employés. En réalité, le mouvement de réduction du temps de travail semble s'être complètement arrêté, voire inversé, dans ce secteur, alors qu'il se poursuit dans le secteur public -d'où une inégalité croissante des conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'un et l'autre secteur.
Il est évident qu'un contexte économique défavorable n'est pas seul à expliquer les réticences (pour user d'un euphémisme) patronales à la réduction du temps de travail et au partage de l'emploi, et que moult a priori idéologiques et politiques y jouent un rôle déterminant. Mais quoi qu'il en soit de ces a priori, des mesures d'incitation, notamment fiscales, peuvent être prises pour faciliter le passage d'un mode obsolète d'organisation du travail à des modes plus conformes aux nécessités du moment, et aux droits fondamentaux des travailleurs.
Toute collectivité publique, à quelque niveau institutionnel qu'elle se situe, dispose d'instruments pour faciliter le partage du travail. La commune n'est certes pas dotée de capacité législative, mais elle n'en est pas pour autant dépourvue de moyens d'action. Elle peut en particulier user de sa capacité de lever l'impôt et de percevoir des taxes, et d'en user de manière incitative à l'embauche et à la réduction du temps de travail.
Une taxe s'offre à pareil usage : la taxe professionnelle. La modification de sa définition serait d'ailleurs d'autant plus utile que celle-ci est porteuse d'effets pervers, dans la mesure où elle se base notamment sur le nombre d'employés dans les entreprises taxées, ce qui tend à alourdir la taxe lorsque l'on créée ou maintient des postes de travail.
Considérant :
- La situation dans le domaine de l'emploi à Genève
- La nécessité d'offrir aux entreprises toutes les opportunités de développer des modalités de partage du travail et de réduction du temps de travail, dans le respect des droits des travailleurs
- La légitimité de la revendication de réduction du temps de travail, et le mouvement historique continu de cette réduction
- Les difficultés de concrétiser cette revendication dans le secteur privé en général, et les secteurs économiquement fragiles en particulier
- Les effets pervers du mode actuel de définition de la taxe professionnelle communale
- Les possibilités néanmoins offertes par la Loi à la municipalité d'accorder des remises partielles ou totale de taxe à certains contribuables en fonction de circonstances indépendantes de leur volonté, et les interprétations possibles de cette possibilité,
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif :
- De prendre toute mesure, de faire toute proposition et d'entreprendre toute démarche utile, notamment auprès des autorités cantonales, afin que puissent être partiellement ou totalement exemptées de la taxes professionnelles les entreprises introduisant ou ayant introduit des durées de travail hebdomadaires égales ou inférieures à 35 heures par semaine, après accord entre les partenaires sociaux ;
- De prendre toute mesure, de faire toute proposition et d'entreprendre toute démarche utile, notamment auprès des autorités cantonales, afin que des dégrèvements de la taxe professionnelle communale puissent être accordés aux entreprises signataires d'une convention collective de travail et ayant créé des emplois stables durant l'année d'assujetissement, dégrèvement fixés à 1 % du montant de la taxe par emploi stable à plein temps (ou à une fraction de ce pourcentage correspondant au temps d'emploi pour les emplois à temps partiel), et plafonnés à 75 % du montant de la taxe.
2. Du bon usage des subventions de la Ville pour l'incitation à la réduction du temps de travail
Exposé des motifs :
L'incitation à la réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour seules cibles les services publics d'une part, l'économie privée d'autre part, et s'il est un secteur économique et social où de nouveaux modes d'organisation du travail et de répartition des temps d'emploi et de vie personnelle peuvent être développés, voire expérimentés, c'est bien le secteur associatif.
Les secteurs culturels, d'autre part, et qu'il s'agisse du secteur culturel privé, public ou associatif, se prêtent également fort bien à l'introduction ou l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation du travail et de répartition des temps d'emploi et de vie personnelle.
Or le secteur associatif d'une part, les secteurs culturels d'autre part, sont largement subventionnés par la Ville. Des mesures d'incitation à la réduction du temps de travail peuvent donc être envisagées dans ces secteurs, compte tenu du poids qu'y a la politique de subvention.
Ces mesures d'incitation peuvent être envisagées soit comme étant positives (un accroissement des subvention en fonction de la réduction du temps de travail), soit comme étant négatives (une réduction des subventions en fonction de la non-réduction du temps de travail). Compte tenu des limites des ressources financières municipales en ces tristes temps de crise, il paraît périlleux de proposer des mesures d'incitation "positives"; restent donc les mesures "négatives".
Considérant :
- la possibilité d'user des subventions de la Ville comme d'un moyen d'incitation à la réduction du temps de travail;
Le Conseil municipal arrête:
- 1. Dès le 1er janvier 2000, toute subvention accordée par la Ville de Genève à tout groupement, association, service, fondation ou personne morale de quelque nature que ce soit, employant du personnel selon un temps de travail hebdomadaire de plus de 35 heures à temps plein, sera réduite de 2,5 % par heure de travail hebdomadaire en sus de la 35ème heure.
- 2. Aucune subvention ne pourra être accordée à un demandeur employant du personnel pour un temps de travail hebdomadaire de plus de 40 heures à temps plein.
- 3. Le Conseil administratif est chargé de prendre tous les renseignements nécessaires à la détermination des subventions prévues au budget de l'exercice 1998, en fonction des dispositions du §1 du présent arrêté.
3.Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg : Réduction du temps de travail de la fonction publique municipale
Considérant
- La légitimité de la revendication de diminution de temps de travail et de partage du travail
- la possibilité offerte par une réduction du temps de travail, si elle est importante et s'opère en un bref délai, de provoquer à la création d'emplois
- la possibilité offerte par une réduction du temps de travail d'opérer une réduction de l'écart entre les hauts et les bas salaires dans la fonction publique municipale, sans diminution du salaire horaire, mais avec une diminution du salaire mensuel des plus hautes classes de traitement
- la possibilité de prendre une décision permettant d'atteindre en même temps les trois objectifs de réduction du temps de travail, de création d'emplois et d'économies budgétaires,
LE CONSEIL MUNICIPAL vu l'article 30, lettre w) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984
ARRÊTE :
- Article premier - L'article 30 du statut du personnel de l'administration municipale est modifié comme suit :
- La durée normale du travail est de 32 heures par semaine en moyenne, soit 1671 heures par année.
- Article 2 - L'échelle des traitements annuels des fonctionnaires tel que définie par l'article 42 du statut du personnel de l'administration municipale est modifiée de la manière suivante :
a. Les traitements prévus pour les classes 1 à 7 y compris restent inchangés.
b. Les traitements prévus pour les classes 8 à 18 sont réduits au prorata de la moitié de la réduction de la durée normale du travail
c. Les traitements prévus pour les classes 18 et au-delà sont réduits au prorata de la réduction de la durée normale du travail.
- Article 3 - La moitié de la somme correspondant à l'impact du présent arrêté sur la masse salariale prévue au budget 2000 sera affectée à la création de postes de travail et à l'engagement de personnel supplémentaire.
- Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000
Le droit a la paresse
Réfutation du droit au travail de 1848
Paul Lafargue (1880)
Ceci est la copie d'une page du site du CENTRE D'ETUDES POLITIQUES ET SOCIALES
Ce texte est la réponse d'un ouvrage de Louis Blanc qui a paru en 1848 concernant le "droit au travail". La revendication du "droit au travail" fut mise en avant au cours des journées de la révolution de 1848, et bientôt reprise et caricaturée par les socialistes réformistes dont Louis Blanc lui-même dans son ouvrage portant le même nom.
Avant-propos
M. Thiers, dans le sein de la Commission sur l'instruction primaire de 1849, disait: "Je veux rendre toute-puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme: "Jouis"." M. Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite.
La bourgeoisie, alors qu'elle luttait contre la noblesse, soutenue par le clergé, arbora le libre examen et l'athéisme; mais, triomphante, elle changea de ton et d'allure; et, aujourd'hui, elle entend étayer de la religion sa suprématie économique et politique. Aux XVe et XVIe siècles, elle avait allègrement repris la tradition païenne et glorifiait la chair et ses passions, réprouvées par le christianisme; de nos jours, gorgée de biens et de jouissances, elle renie les enseignements de ses penseurs, les Rabelais, les Diderot, et prêche l'abstinence aux salariés. La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d'anathème la chair du travailleur; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci.
Les socialistes révolutionnaires ont à recommencer le combat qu'ont combattu les philosophes et les pamphlétaires de la bourgeoisie; ils ont à monter à l'assaut de la morale et des théories sociales du capitalisme; ils ont à démolir, dans les têtes de la classe appelée à l'action, les préjugés semés par la classe régnante; ils ont à proclamer, à la face des cafards de toutes les morales, que la terre cessera d'être la vallée de larmes du travailleur; que, dans la société communiste de l'avenir que nous fonderons "pacifiquement si possible, sinon violemment", les passions des hommes auront la bride sur le cou: car "toutes sont bonnes de leur nature, nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage et leurs excès [1]", et ils ne seront évités que par leur mutuel contrebalancement, que par le développement harmonique de l'organisme humain, car, dit le Dr Beddoe, "ce n'est que lorsqu'une race atteint son maximum de développement physique qu'elle atteint son plus haut point d'énergie et de vigueur morale". Telle était aussi l'opinion du grand naturaliste, Charles Darwin [2].
La réfutation du Droit au travail, que je réédite avec quelques notes additionnelles, parut dans L'Égalité hebdomadaire de 1880, deuxième série.
I
Un dogme désastreux"Paressons en toutes choses,
hormis en aimant et en buvant,
hormis en paressant."
Lessing.Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes, ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu; hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu; des prédications de leur morale religieuse, économique, libre penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste.
Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur-sang des écuries de Rothschild, servi par une valetaille de bimanes, à la lourde brute des fermes normandes, qui laboure la terre, chariote le fumier, engrange la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail, et regardez ensuite nos misérables servants de machines [3].
Quand, dans notre Europe civilisée, on veut retrouver une trace de beauté native de l'homme, il faut l'aller chercher chez les nations où les préjugés économiques n'ont pas encore déraciné la haine du travail. L'Espagne, qui, hélas! dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes; mais l'artiste se réjouit en admirant le hardi Andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d'acier; et le coeur de l'homme tressaille en entendant le mendiant, superbement drapé dans sa "capa" trouée, traiter d'"amigo" des ducs d'Ossuna. Pour l'Espagnol, chez qui l'animal primitif n'est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages [4]. Les Grecs de la grande époque n'avaient, eux aussi, que du mépris pour le travail: aux esclaves seuls il était permis de travailler: l'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. C'était aussi le temps où l'on marchait et respirait dans un peuple d'Aristote, de Phidias, d'Aristophane; c'était le temps où une poignée de braves écrasait à Marathon les hordes de l'Asie qu'Alexandre allait bientôt conquérir. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l'homme libre; les poètes chantaient la paresse, ce présent des Dieux:
O Melibœ, Deus nobis hæc otia fecit [5].
Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse:
"Contemplez la croissance des lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu [6]."
Jéhovah, le dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale; après six jours de travail, il se reposa pour l'éternité.
Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique? Les Auvergnats; les Écossais, ces Auvergnats des îles Britanniques; les Gallegos, ces Auvergnats de l'Espagne; les Poméraniens, ces Auvergnats de l'Allemagne; les Chinois, ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles sont les classes qui aiment le travail pour le travail? Les paysans propriétaires, les petits bourgeois, les uns courbés sur leurs terres, les autres acoquinés dans leurs boutiques, se remuent comme la taupe dans sa galerie souterraine, et jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature.
Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail.
II
Bénédictions du travailEn 1770 parut, à Londres, un écrit anonyme intitulé: An Essay on Trade and Commerce. Il fit à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand philanthrope, s'indignait de ce que
"la plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mis dans la tête l'idée fixe qu'en qualité d'Anglais, tous les individus qui la composent ont, par droit de naissance, le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats dont elle stimule la bravoure; mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un État commercial comme le nôtre, où, peut-être, les sept huitièmes de la population n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler six jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en quatre".
Ainsi, près d'un siècle avant Guizot, on prêchait ouvertement à Londres le travail comme un frein aux nobles passions de l'homme.
"Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, écrivait d'Osterode, le 5 mai 1807, Napoléon. Je suis l'autorité [...] et je serais disposé à ordonner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail."
Pour extirper la paresse et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de l'Essay on Trade proposait d'incarcérer les pauvres dans les maisons idéales du travail (ideal workhouses) qui deviendraient "des maisons de terreur où l'on ferait travailler quatorze heures par jour, de telle sorte que, le temps des repas soustrait, il resterait douze heures de travail pleines et entières".
Douze heures de travail par jour, voilà l'idéal des philanthropes et des moralistes du XVIIIe siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus ultra! Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant douze et quatorze heures, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants [7]! Et dire que les fils des héros de la Terreur se sont laissé dégrader par la religion du travail au point d'accepter après 1848, comme une conquête révolutionnaire, la loi qui limitait à douze heures le travail dans les fabriques; ils proclamaient comme un principe révolutionnaire le droit au travail. Honte au prolétariat français! Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait vingt ans de civilisation capitaliste à un Grec des temps héroïques pour concevoir un tel avilissement.
Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures de la faim se sont abattues sur le prolétariat, plus nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui qui les a appelées.
Ce travail, qu'en juin 1848 les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l'ont imposé à leurs familles; ils ont livré, aux barons de l'industrie, leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leur foyer domestique; de leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes; les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures tendre l'échine et épuiser leurs nerfs; de leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. - Honte aux prolétaires! Où sont ces commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux contes, hardies au propos, franches de la gueule, amantes de la dive bouteille? Où sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleurs des petits sains et vigoureux? ...Nous avons aujourd'hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux membres alanguis!... Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l'on cassa leur coquille! - Et les enfants? Douze heures de travail aux enfants. Ô misère! - Mais tous les Jules Simon de l'Académie des sciences morales et politiques, tous les Germinys de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un vice plus abrutissant pour l'intelligence des enfants, plus corrupteur de leurs instincts, plus destructeur de leur organisme que le travail dans l'atmosphère viciée de l'atelier capitaliste.
Notre époque est, dit-on, le siècle du travail; il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption.
Et cependant, les philosophes, les économistes bourgeois, depuis le péniblement confus Auguste Comte, jusqu'au ridiculement clair Leroy-Beaulieu; les gens de lettres bourgeois, depuis le charlatanesquement romantique Victor Hugo, jusqu'au naïvement grotesque Paul de Kock, tous ont entonné les chants nauséabonds en l'honneur du dieu Progrès, le fils aîné du Travail. À les entendre, le bonheur allait régner sur la terre: déjà on en sentait la venue. Ils allaient dans les siècles passés fouiller la poussière et la misère féodales pour rapporter de sombres repoussoirs aux délices des temps présents. - Nous ont-ils fatigués, ces repus, ces satisfaits, naguère encore membres de la domesticité des grands seigneurs, aujourd'hui valets de plume de la bourgeoisie, grassement rentés; nous ont-ils fatigués avec le paysan du rhétoricien La Bruyère? Eh bien! voici le brillant tableau des jouissances prolétariennes en l'an de progrès capitaliste 1840, peint par l'un des leurs, par le Dr Villermé, membre de l'Institut, le même qui, en 1848, fit partie de cette société de savants (Thiers, Cousin, Passy, Blanqui, l'académicien, en étaient) qui propagea dans les masses les sottises de l'économie et de la morale bourgeoises.
C'est de l'Alsace manufacturière que parle le Dr Villermé, de l'Alsace des Kestner, des Dollfus, ces fleurs de la philanthropie et du républicanisme industriel. Mais avant que le docteur ne dresse devant nous le tableau des misères prolétariennes, écoutons un manufacturier alsacien, M. Th. Mieg, de la maison Dollfus, Mieg et Cie, dépeignant la situation de l'artisan de l'ancienne industrie:
"À Mulhouse, il y a cinquante ans (en 1813, alors que la moderne industrie mécanique naissait), les ouvriers étaient tous enfants du sol, habitant la ville et les villages environnants et possédant presque tous une maison et souvent un petit champ [8]."
C'était l'âge d'or du travailleur. Mais, alors, l'industrie alsacienne n'inondait pas le monde de ses cotonnades et n'emmillionnait pas ses Dollfus et ses Koechlin. Mais vingt-cinq ans après, quand Villermé visita l'Alsace, le minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait conquis le pays; dans sa boulimie de travail humain, il avait arraché les ouvriers de leurs foyers pour mieux les tordre et pour mieux exprimer le travail qu'ils contenaient. C'était par milliers que les ouvriers accouraient au sifflement de la machine.
"Un grand nombre, dit Villermé, cinq mille sur dix-sept mille, étaient contraints, par la cherté des loyers, à se loger dans les villages voisins. Quelques-uns habitaient à deux lieues et quart de la manufacture où ils travaillaient.
"À Mulhouse, à Dornach, le travail commençait à cinq heures du matin et finissait à cinq heures du soir, été comme hiver. [...] Il faut les voir arriver chaque matin en ville et partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue et qui à défaut de parapluie, portent, renversés sur la tête, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leurs tabliers ou jupons de dessus pour se préserver la figure et le cou, et un nombre plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non moins hâves, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers qui tombe sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont même pas au bras, comme les femmes dont on vient de parler, un panier où sont les provisions de la journée; mais ils portent à la main, ou cachent sous leur veste ou comme ils peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de leur rentrée à la maison.
"Ainsi, à la fatigue d'une journée démesurément longue, puisqu'elle a au moins quinze heures, vient se joindre pour ces malheureux celle des allées et venues si fréquentes, si pénibles. Il résulte que le soir ils arrivent chez eux accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain ils sortent avant d'être complètement reposés pour se trouver à l'atelier à l'heure de l'ouverture."
Voici maintenant les bouges où s'entassaient ceux qui logeaient en ville:
"J'ai vu à Mulhouse, à Dornach et dans des maisons voisines, de ces misérables logements où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches... Cette misère dans laquelle vivent les ouvriers de l'industrie du coton dans le département du Haut-Rhin est si profonde qu'elle produit ce triste résultat que, tandis que dans les familles des fabricants négociants, drapiers, directeurs d'usines, la moitié des enfants atteint la vingt et unième année, cette même moitié cesse d'exister avant deux ans accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers de filatures de coton."
Parlant du travail de l'atelier, Villermé ajoute:
"Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de six à huit ans. [...] C'est ce long supplice de tous les jours qui mine principalement les ouvriers dans les filatures de coton."
Et, à propos de la durée du travail, Villermé observait que les forçats des bagnes ne travaillaient que dix heures, les esclaves des Antilles neuf heures en moyenne, tandis qu'il existait dans la France qui avait fait la Révolution de 89, qui avait proclamé les pompeux Droits de l'homme, des manufactures où la journée était de seize heures, sur lesquelles on accordait aux ouvriers une heure et demie pour les repas [9].
Ô misérable avortement des principes révolutionnaires de la bourgeoisie! ô lugubre présent de son dieu Progrès! Les philanthropes acclament bienfaiteurs de l'humanité ceux qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres; mieux vaudrait semer la peste, empoisonner les sources que d'ériger une fabrique au milieu d'une population rustique. Introduisez le travail de fabrique, et adieu joie, santé, liberté; adieu tout ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue [10].
Et les économistes s'en vont répétant aux ouvriers: Travaillez pour augmenter la fortune sociale! et cependant un économiste, Destut de Tracy, leur répond:
"Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise; les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre."
Et son disciple Cherbuliez de continuer:
"Les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire."
Mais, assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre: Travaillez, travaillez toujours pour créer votre bien-être! Et, au nom de la mansuétude chrétienne, un prêtre de l'Église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie: Travaillez, travaillez nuit et jour; en travaillant, vous faites croître votre misère, et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. L'imposition légale du travail "donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit; la faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants".
Travaillez, travaillez, prolétaires, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles, travaillez, travaillez, pour que, devenant plus pauvres, vous avez plus de raisons de travailler et d'être misérables. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme au vice du travail, ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur misère présente, au lieu de courir au grenier à blé et de crier: "Nous avons faim et nous voulons manger! ... Vrai, nous n'avons pas un rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, c'est nous cependant qui avons moissonné le blé et vendangé le raisin..." Au lieu d'assiéger les magasins de M. Bonnet, de Jujurieux, l'inventeur des couvents industriels, et de clamer: "Monsieur Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses, elles grelottent sous leurs cotonnades rapetassées à chagriner l'oeil d'un juif et, cependant, ce sont elles qui ont filé et tissé les robes de soie des cocottes de toute la chrétienté. Les pauvresses, travaillant treize heures par jour, n'avaient pas le temps de songer à la toilette, maintenant, elles chôment et peuvent faire du frou-frou avec les soieries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont perdu leurs dents de lait, elles se sont dévouées à votre fortune et ont vécu dans l'abstinence; maintenant, elles ont des loisirs et veulent jouir un peu des fruits de leur travail. Allons, Monsieur Bonnet, livrez vos soieries, M. Harmel fournira ses mousselines, M. Pouyer-Quertier ses calicots, M. Pinet ses bottines pour leurs chers petits pieds froids et humides... Vêtues de pied en cap et fringantes, elles vous feront plaisir à contempler. Allons, pas de tergiversations - vous êtes l'ami de l'humanité, n'est-ce pas, et chrétien par- dessus le marché? - Mettez à la disposition de vos ouvrières la fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair de leur chair. Vous êtes ami du commerce? - Facilitez la circulation des marchandises; voici des consommateurs tout trouvés; ouvrez-leur des crédits illimités. Vous êtes bien obligé d'en faire à des négociants que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vous ont rien donné, même pas un verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront comme elles le pourront: si, au jour de l'échéance, elles gambettisent et laissent protester leur signature, vous les mettrez en faillite, et si elles n'ont rien à saisir, vous exigerez qu'elles vous paient en prières: elles vous enverront en paradis, mieux que vos sacs noirs, au nez gorgé de tabac."
Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, crevant de faim, s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier. Avec des figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux, ils assaillent les fabricants: "Bon M. Chagot, doux M. Schneider, donnez-nous du travail, ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente!" Et ces misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout, vendent douze et quatorze heures de travail deux fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et les philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché.
Si les crises industrielles suivent les périodes de surtravail aussi fatalement que la nuit le jour, traînant après elles le chômage forcé et la misère sans issue, elles amènent aussi la banqueroute inexorable. Tant que le fabricant a du crédit, il lâche la bride à la rage du travail, il emprunte et emprunte encore pour fournir la matière première aux ouvriers. Il fait produire, sans réfléchir que le marché s'engorge et que, si ses marchandises n'arrivent pas à la vente, ses billets viendront à l'échéance. Acculé, il va implorer le juif, il se jette à ses pieds, lui offre son sang, son honneur. "Un petit peu d'or ferait mieux mon affaire, répond le Rothschild, vous avez 20 000 paires de bas en magasin, ils valent vingt sous, je les prends à quatre sous." Les bas obtenus, le juif les vend six et huit sous, et empoche les frétillantes pièces de cent sous qui ne doivent rien à personne: mais le fabricant a reculé pour mieux sauter. Enfin la débâcle arrive et les magasins dégorgent; on jette alors tant de marchandises par la fenêtre, qu'on ne sait comment elles sont entrées par la porte. C'est par centaines de millions que se chiffre la valeur des marchandises détruites; au siècle dernier, on les brûlait ou on les jetait à l'eau [11].
Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les fabricants parcourent le monde en quête de débouchés pour les marchandises qui s'entassent; ils forcent leur gouvernement à s'annexer des Congo, à s'emparer des Tonkin, à démolir à coups de canon les murailles de la Chine, pour y écouler leurs cotonnades. Aux siècles derniers, c'était un duel à mort entre la France et l'Angleterre, à qui aurait le privilège exclusif de vendre en Amérique et aux Indes. Des milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont rougi de leur sang les mers, pendant les guerres coloniales des XIe, XVIe et XVIIIe siècles.
Les capitaux abondent comme les marchandises. Les financiers ne savent plus où les placer; ils vont alors chez les nations heureuses qui lézardent au soleil en fumant des cigarettes, poser des chemins de fer, ériger des fabriques et importer la malédiction du travail. Et cette exportation de capitaux français se termine un beau matin par des complications diplomatiques: en Égypte, la France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient sur le point de se prendre aux cheveux pour savoir quels usuriers seraient payés les premiers; par des guerres du Mexique où l'on envoie les soldats français faire le métier d'huissier pour recouvrer de mauvaises dettes [12].
Ces misères individuelles et sociales, pour grandes et innombrables qu'elles soient, pour éternelles qu'elles paraissent, s'évanouiront comme les hyènes et les chacals à l'approche du lion, quand le prolétariat dira: "Je le veux." Mais pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre penseuse; il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les Droits de la paresse, mille et mille fois plus nobles et plus sacrés que les phtisiques Droits de l'homme, concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise; qu'il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit.
Jusqu'ici, ma tâche a été facile, je n'avais qu'à décrire des maux réels bien connus de nous tous, hélas! Mais convaincre le prolétariat que la parole qu'on lui a inoculée est perverse, que le travail effréné auquel il s'est livré dès le commencement du siècle est le plus terrible fléau qui ait jamais frappé l'humanité, que le travail ne deviendra un condiment de plaisir de la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme humain, une passion utile à l'organisme social que lorsqu'il sera sagement réglementé et limité à un maximum de trois heures par jour, est une tâche ardue au-dessus de mes forces; seuls des physiologistes, des hygiénistes, des économistes communistes pourraient l'entreprendre. Dans les pages qui vont suivre, je me bornerai à démontrer qu'étant donné les moyens de production modernes et leur puissance reproductive illimitée, il faut mater la passion extravagante des ouvriers pour le travail et les obliger à consommer les marchandises qu'ils produisent.
III
Ce qui suit la surproductionUn poète grec du temps de Cicéron, Antipatros, chantait ainsi l'invention du moulin à eau (pour la mouture du grain): il allait émanciper les femmes esclaves et ramener l'âge d'or:
"Épargnez le bras qui fait tourner la meule, ô meunières, et dormez paisiblement! Que le coq vous avertisse en vain qu'il fait jour! Dao a imposé aux nymphes le travail des esclaves et les voilà qui sautillent allègrement sur la roue et voilà que l'essieu ébranlé roule avec ses rais, faisant tourner la pesante pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères et oisifs réjouissons-nous des dons que la déesse accorde."
Hélas! les loisirs que le poète païen annonçait ne sont pas venus: la passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d'asservissement des hommes libres: sa productivité les appauvrit.
Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que cinq mailles à la minute, certains métiers circulaires à tricoter en font trente mille dans le même temps. Chaque minute à la machine équivaut donc à cent heures de travail de l'ouvrière: ou bien chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière dix jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-nous? À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l'Ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière!
Pour que la concurrence de l'homme et de la machine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations; ils ont supprimé les jours fériés [13]. Parce que les producteurs d'alors ne travaillaient que cinq jours sur sept, croient-ils donc, ainsi que le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche? Allons donc! Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler; pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant dieu de la Fainéantise. La morose Angleterre, encagotée dans le protestantisme, se nommait alors la "joyeuse Angleterre" (Merry England). Rabelais, Quevedo, Cervantès, les auteurs inconnus des romans picaresques, nous font venir l'eau à la bouche avec leurs peintures de ces monumentales ripailles [14] dont on se régalait alors entre deux batailles et deux dévastations, et dans lesquelles tout "allait par escuelles". Jordaens et l'école flamande les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes.
Sublimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus? Sublimes cerveaux qui encercliez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenus? Nous sommes bien amoindris et bien dégénérés. La vache enragée, la pomme de terre, le vin fuchsiné et le schnaps prussien savamment combinés avec le travail forcé ont débilité nos corps et rapetissé nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité, c'est alors que les économistes nous prêchent la théorie malthusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail? Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens.
Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s'est laissé endoctriner, parce que, avec son impétuosité native, elle s'est précipitée en aveugle dans le travail et l'abstinence, la classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l'improductivité et à la surconsommation. Mais, si le surtravail de l'ouvrier meurtrit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en douleurs pour le bourgeois.
L'abstinence à laquelle se condamne la classe productive oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des produits qu'elle manufacture désordonnément. Au début de la production capitaliste, il y a un ou deux siècles de cela, le bourgeois était un homme rangé, de moeurs raisonnables et paisibles; il se contentait de sa femme ou à peu près; il ne buvait qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui, il n'est fils de parvenu qui ne se croie tenu de développer la prostitution et de mercurialiser son corps pour donner un but au labeur que s'imposent les ouvriers des mines de mercure; il n'est bourgeois qui ne s'empiffre de chapons truffés et de lafite navigué, pour encourager les éleveurs de la Flèche et les vignerons du Bordelais. À ce métier, l'organisme se délabre rapidement, les cheveux tombent, les dents se déchaussent, le tronc se déforme, le ventre s'entripaille, la respiration s'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, les articulations s'ankylosent, les phalanges se nouent. D'autres, trop malingres pour supporter les fatigues de la débauche, mais dotés de la bosse du prudhommisme, dessèchent leur cervelle comme les Garnier de l'économie politique, les Acollas de la philosophie juridique, à élucubrer de gros livres soporifiques pour occuper les loisirs des compositeurs et des imprimeurs.
Les femmes du monde vivent une vie de martyr. Pour essayer et faire valoir les toilettes féeriques que les couturières se tuent à bâtir, du soir au matin elles font la navette d'une robe dans une autre; pendant des heures, elles livrent leur tête creuse aux artistes capillaires qui, à tout prix, veulent assouvir leur passion pour l'échafaudage des faux chignons. Sanglées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à faire rougir un sapeur, elles tournoient des nuits entières dans leurs bals de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre monde. Saintes âmes!
Pour remplir sa double fonction sociale de nonproducteur et de surconsommateur, le bourgeois dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a deux siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d'hommes afin de se procurer des aides.
Voici quelques chiffres qui prouvent combien colossale est cette déperdition de forces productives:
"D'après le recensement de 1861, la population de l'Angleterre et du pays de Galles comprenait 20 066 224 personnes, dont 9 776 259 du sexe masculin et 10 289 965 du sexe féminin. Si l'on en déduit ce qui est trop vieux ou trop jeune pour travailler, les femmes, les adolescents et les enfants improductifs, puis les professions idéologiques telles que gouvernement, police, clergé, magistrature, armée, savants, artistes, etc., ensuite les gens exclusivement occupés à manger le travail d'autrui, sous forme de rente foncière, d'intérêts, de dividendes, etc., et enfin les pauvres, les vagabonds, les criminels, etc., il reste en gros huit millions d'individus des deux sexes et de tout âge, y compris les capitalistes fonctionnant dans la production, le commerce, la finance, etc. Sur ces huit millions, on compte:
- Travailleurs agricoles (y compris les bergers, les valets et les filles de ferme habitant chez le fermier): 1 098 261;
- Ouvriers des fabriques de coton, de laine, de worsted, de lin, de chanvre, de soie, de dentelle et ceux des métiers à bras: 642 607;
- Ouvriers des mines de charbon et de métal: 565 835;
- Ouvriers employés dans les usines métallurgiques (hauts fourneaux, laminoirs, etc.) et dans les manufactures de métal de toute espèce: 396 998;
- Classe domestique: 1 208 648."Si nous additionnons les travailleurs des fabriques textiles et ceux des mines de charbon et de métal, nous obtenons le chiffre de 1 208 442; si nous additionnons les premiers et le personnel de toutes les usines et de toutes les manufactures de métal, nous avons un total de 1 039 605 personnes; c'est-à-dire chaque fois un nombre plus petit que celui des esclaves domestiques modernes. Voilà le magnifique résultat de l'exploitation capitaliste des machines [15]."
À toute cette classe domestique, dont la grandeur indique le degré atteint par la civilisation capitaliste, il faut ajouter la classe nombreuse des malheureux voués exclusivement à la satisfaction des goûts dispendieux et futiles des classes riches, tailleurs de diamants, dentellières, brodeuses, relieurs de luxe, couturières de luxe, décorateurs des maisons de plaisance, etc. [16].
Une fois accroupie dans la paresse absolue et démoralisée par la jouissance forcée, la bourgeoisie, malgré le mal qu'elle en eut, s'accommoda de son nouveau genre de vie. Avec horreur elle envisagea tout changement. La vue des misérables conditions d'existence acceptées avec résignation par la classe ouvrière et celle de la dégradation organique engendrée par la passion dépravée du travail augmentaient encore sa répulsion pour toute imposition de travail et pour toute restriction de jouissances.
C'est précisément alors que, sans tenir compte de la démoralisation que la bourgeoisie s'était imposée comme un devoir social, les prolétaires se mirent en tête d'infliger le travail aux capitalistes. Les naïfs, ils prirent au sérieux les théories des économistes et des moralistes sur le travail et se sanglèrent les reins pour en infliger la pratique aux capitalistes. Le prolétariat arbora la devise: Qui ne travaille pas, ne mange pas; Lyon, en 1831, se leva pour du plomb ou du travail, les fédérés de mars 1871 déclarèrent leur soulèvement la Révolution du travail.
À ces déchaînements de fureur barbare, destructive de toute jouissance et de toute paresse bourgeoises, les capitalistes ne pouvaient répondre que par la répression féroce, mais ils savaient que, s'ils ont pu comprimer ces explosions révolutionnaires, ils n'ont pas noyé dans le sang de leurs massacres gigantesques l'absurde idée du prolétariat de vouloir infliger le travail aux classes oisives et repues, et c'est pour détourner ce malheur qu'ils s'entourent de prétoriens, de policiers, de magistrats, de geôliers entretenus dans une improductivité laborieuse. On ne peut plus conserver d'illusion sur le caractère des armées modernes, elles ne se sont maintenues en permanence que pour comprimer "l'ennemi intérieur"; c'est ainsi que les forts de Paris et de Lyon n'ont pas été construits pour défendre la ville contre l'étranger, mais pour l'écraser en cas de révolte. Et s'il fallait un exemple sans réplique citons l'armée de la Belgique, de ce pays de Cocagne du capitalisme; sa neutralité est garantie par les puissances européennes, et cependant son armée est une des plus fortes proportionnellement à la population. Les glorieux champs de bataille de la brave armée belge sont les plaines du Borinage et de Charleroi; c'est dans le sang des mineurs et des ouvriers désarmés que les officiers belges trempent leurs épées et ramassent leurs épaulettes. Les nations européennes n'ont pas des armées nationales, mais des armées mercenaires, elles protègent les capitalistes contre la fureur populaire qui voudrait les condamner à dix heures de mine ou de filature.
Donc, en se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie condamnée à la surconsommation.
Pour être soulagée dans son pénible travail, la bourgeoisie a retiré de la classe ouvrière une masse d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait consacrée à la production utile et l'a condamnée à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouches inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme du travail, produisent comme des maniaques, sans vouloir les consommer, et sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer.
En présence de cette double folie des travailleurs, de se tuer de surtravail et de végéter dans l'abstinence, le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. Puisque les ouvriers européens, grelottant de froid et de faim, refusent de porter les étoffes qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, les pauvres fabricants, ainsi que des dératés, doivent courir aux antipodes chercher qui les portera et qui les boira: ce sont des centaines de millions et de milliards que l'Europe exporte tous les ans, aux quatre coins du monde, à des peuplades qui n'en ont que faire [17]. Mais les continents explorés ne sont plus assez vastes, il faut des pays vierges. Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac saharien, du chemin de fer du Soudan; avec anxiété, ils suivent les progrès des Livingstone, des Stanley, des Du Chaillu, des de Brazza; bouche béante, ils écoutent les histoires mirobolantes de ces courageux voyageurs. Que de merveilles inconnues renferme le "continent noir"! Des champs sont plantés de dents d'éléphant, des fleuves d'huile de coco charrient des paillettes d'or, des millions de culs noirs, nus comme la face de Dufaure ou de Girardin, attendent les cotonnades pour apprendre la décence, des bouteilles de schnaps et des bibles pour connaître les vertus de la civilisation.
Mais tout est impuissant: bourgeois qui s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la classe productive, nations étrangères et barbares que l'on engorge de marchandises européennes; rien, rien ne peut arriver à écouler les montagnes de produits qui s'entassent plus hautes et plus énormes que les pyramides d'Égypte: la productivité des ouvriers européens défie toute consommation, tout gaspillage. Les fabricants, affolés, ne savent plus où donner de la tête, ils ne peuvent plus trouver la matière première pour satisfaire la passion désordonnée, dépravée, de leurs ouvriers pour le travail. Dans nos départements lainiers, on effiloche les chiffons souillés et à demi pourris, on en fait des draps dits de renaissance, qui durent ce que durent les promesses électorales; à Lyon, au lieu de laisser à la fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse naturelle, on la surcharge de sels minéraux qui, en lui ajoutant du poids, la rendent friable et de peu d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Notre époque sera appelée l'âge de la falsification, comme les premières époques de l'humanité ont reçu les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers, qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. Ces falsifications, qui ont pour unique mobile un sentiment humanitaire, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, si elles sont une source intarissable de gaspillage du travail humain, prouvent la philanthropique ingéniosité des bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers qui, pour assouvir leur vice de travail, obligent les industriels à étouffer les cris de leur conscience et à violer même les lois de l'honnêteté commerciale.
Et cependant, en dépit de la surproduction de marchandises, en dépit des falsifications industrielles, les ouvriers encombrent le marché innombrablement, implorant: du travail! du travail! Leur surabondance devrait les obliger à refréner leur passion; au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une chance de travail se présente, ils se ruent dessus; alors c'est douze, quatorze heures qu'ils réclament pour en avoir leur saoul, et le lendemain les voilà de nouveau rejetés sur le pavé, sans plus rien pour alimenter leur vice. Tous les ans, dans toutes les industries, des chômages reviennent avec la régularité des saisons. Au surtravail meurtrier pour l'organisme succède le repos absolu, pendant des deux et quatre mois; et plus de travail, plus de pitance. Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le coeur des ouvriers; puisque ses exigences étouffent tous les autres instincts de la nature; puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en six mois le travail de toute l'année? Pourquoi ne pas le distribuer uniformément sur les douze mois et forcer tout ouvrier à se contenter de six ou de cinq heures par jour, pendant l'année, au lieu de prendre des indigestions de douze heures pendant six mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain de la bouche; alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse.
Abêtis par leur vice, les ouvriers n'ont pu s'élever à l'intelligence de ce fait que, pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau sur un navire en détresse. Cependant les industriels, au nom de l'exploitation capitaliste, ont depuis longtemps demandé une limitation légale de la journée de travail. Devant la Commission de 1860 sur l'enseignement professionnel, un des plus grands manufacturiers de l'Alsace, M. Bourcart, de Guebwiller, déclarait:
"Que la journée de douze heures était excessive et devait être ramenée à onze heures, que l'on devait suspendre le travail à deux heures le samedi. Je puis conseiller l'adoption de cette mesure quoiqu'elle paraisse onéreuse à première vue; nous l'avons expérimentée dans nos établissements industriels depuis quatre ans et nous nous en trouvons bien, et la production moyenne, loin d'avoir diminué, a augmenté."
Dans son étude sur les machines, M. F. Passy cite la lettre suivante d'un grand industriel belge, M. M. Ottavaere:
"Nos machines, quoique les mêmes que celles des filatures anglaises, ne produisent pas ce qu'elles devraient produire et ce que produiraient ces mêmes machines en Angleterre, quoique les filatures travaillent deux heures de moins par jour. [...] Nous travaillons tous deux grandes heures de trop; j'ai la conviction que si l'on ne travaillait que onze heures au lieu de treize, nous aurions la même production et produirions par conséquent plus économiquement."
D'un autre côté, M. Leroy-Beaulieu affirme que "c'est une observation d'un grand manufacturier belge que les semaines où tombe un jour férié n'apportent pas une production inférieure à celle des semaines ordinaires [18]".
Ce que le peuple, pipé en sa simplesse par les moralistes, n'a jamais osé, un gouvernement aristocratique l'a osé. Méprisant les hautes considérations morales et industrielles des économistes, qui, comme les oiseaux de mauvais augure, croassaient que diminuer d'une heure le travail des fabriques c'était décréter la ruine de l'industrie anglaise, le gouvernement de l'Angleterre a défendu par une loi, strictement observée, de travailler plus de dix heures par jour; et après comme avant, l'Angleterre demeure la première nation industrielle du monde.
La grande expérience anglaise est là, l'expérience de quelques capitalistes intelligents est là, elle démontre irréfutablement que, pour puissancer la productivité humaine, il faut réduire les heures de travail et multiplier les jours de paye et de fêtes, et le peuple français n'est pas convaincu. Mais si une misérable réduction de deux heures a augmenté en dix ans de près d'un tiers la production anglaise [19], quelle marche vertigineuse imprimera à la production française une réduction légale de la journée de travail à trois heures? Les ouvriers ne peuvent-ils donc comprendre qu'en se surmenant de travail, ils épuisent leurs forces et celles de leur progéniture; que, usés, ils arrivent avant l'âge à être incapables de tout travail; qu'absorbés, abrutis par un seul vice, ils ne sont plus des hommes, mais des tronçons d'hommes; qu'ils tuent en eux toutes les belles facultés pour ne laisser debout, et luxuriante, que la folie furibonde du travail.
Ah! comme des perroquets d'Arcadie ils répètent la leçon des économistes: "Travaillons, travaillons pour accroître la richesse nationale." Ô idiots! c'est parce que vous travaillez trop que l'outillage industriel se développe lentement. Cessez de braire et écoutez un économiste; il n'est pas un aigle, ce n'est que M. L. Reybaud, que nous avons eu le bonheur de perdre il y a quelques mois:
"C'est en général sur les conditions de la main d'oeuvre que se règle la révolution dans les méthodes du travail. Tant que la main-d'oeuvre fournit ses services à bas prix, on la prodigue; on cherche à l'épargner quand ses services deviennent plus coûteux [20]."
Pour forcer les capitalistes à perfectionner leurs machines de bois et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures de travail des machines de chair et d'os. Les preuves à l'appui? C'est par centaines qu'on peut les fournir. Dans la filature, le métier renvideur (self acting mule) fut inventé et appliqué à Manchester, parce que les fileurs se refusaient à travailler aussi longtemps qu'auparavant.
En Amérique, la machine envahit toutes les branches de la production agricole, depuis la fabrication du beurre jusqu'au sarclage des blés: pourquoi? Parce que l'Américain, libre et paresseux, aimerait mieux mille morts que la vie bovine du paysan français. Le labourage, si pénible en notre glorieuse France, si riche en courbatures, est, dans l'Ouest américain, un agréable passe-temps au grand air que l'on prend assis, en fumant nonchalamment sa pipe.
IV
A nouvel air, chanson nouvelleSi, en diminuant les heures de travail, on conquiert à la production sociale de nouvelles forces mécaniques, en obligeant les ouvriers à consommer leurs produits, on conquerra une immense armée de forces de travail. La bourgeoisie, déchargée alors de sa tâche de consommateur universel, s'empressera de licencier la cohue de soldats, de magistrats, de figaristes, de proxénètes, etc., qu'elle a retirée du travail utile pour l'aider à consommer et à gaspiller. C'est alors que le marché du travail sera débordant, c'est alors qu'il faudra une loi de fer pour mettre l'interdit sur le travail: il sera impossible de trouver de la besogne pour cette nuée de ci-devant improductifs, plus nombreux que les poux des bois. Et après eux il faudra songer à tous ceux qui pourvoyaient à leurs besoins et goûts futiles et dispendieux. Quand il n'y aura plus de laquais et de généraux à galonner, plus de prostituées libres et mariées à couvrir de dentelles, plus de canons à forer, plus de palais à bâtir, il faudra, par des lois sévères, imposer aux ouvrières et ouvriers en passementeries, en dentelles, en fer, en bâtiments, du canotage hygiénique et des exercices chorégraphiques pour le rétablissement de leur santé et le perfectionnement de la race. Du moment que les produits européens consommés sur place ne seront pas transportés au diable, il faudra bien que les marins, les hommes d'équipe, les camionneurs s'assoient et apprennent à se tourner les pouces. Les bienheureux Polynésiens pourront alors se livrer à l'amour libre sans craindre les coups de pied de la Vénus civilisée et les sermons de la morale européenne.
Il y a plus. Afin de trouver du travail pour toutes les non-valeurs de la société actuelle, afin de laisser l'outillage industriel se développer indéfiniment, la classe ouvrière devra, comme la bourgeoisie, violenter ses goûts abstinents, et développer indéfiniment ses capacités consommatrices. Au lieu de manger par jour une ou deux onces de viande coriace, quand elle en mange, elle mangera de joyeux biftecks d'une ou deux livres; au lieu de boire modérément du mauvais vin, plus catholique que le pape, elle boira à grandes et profondes rasades du bordeaux, du bourgogne, sans baptême industriel, et laissera l'eau aux bêtes.
Les prolétaires ont arrêté en leur tête d'infliger aux capitalistes des dix heures de forge et de raffinerie; là est la grande faute, la cause des antagonismes sociaux et des guerres civiles. Défendre et non imposer le travail, il le faudra. Les Rothschild, les Say seront admis à faire la preuve d'avoir été, leur vie durant, de parfaits vauriens; et s'ils jurent vouloir continuer à vivre en parfaits vauriens, malgré l'entraînement général pour le travail, ils seront mis en carte et, à leurs mairies respectives, ils recevront tous les matins une pièce de vingt francs pour leurs menus plaisirs. Les discordes sociales s'évanouiront. Les rentiers, les capitalistes, tout les premiers, se rallieront au parti populaire, une fois convaincus que, loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les débarrasser du travail de surconsommation et de gaspillage dont ils ont été accablés dès leur naissance. Quant aux bourgeois incapables de prouver leurs titres de vauriens, on les laissera suivre leurs instincts: il existe suffisamment de métiers dégoûtants pour les caser - Dufaure nettoierait les latrines publiques; Galliffet chourinerait les cochons galeux et les chevaux forcineux; les membres de la commission des grâces, envoyés à Poissy, marqueraient les boeufs et les moutons à abattre; les sénateurs, attachés aux pompes funèbres, joueraient les croque-morts. Pour d'autres, on trouverait des métiers à portée de leur intelligence. Lorgeril, Broglie, boucheraient les bouteilles de champagne, mais on les musellerait pour les empêcher de s'enivrer; Ferry, Freycinet, Tirard détruiraient les punaises et les vermines des ministères et autres auberges publiques. Il faudra cependant mettre les deniers publics hors de la portée des bourgeois, de peur des habitudes acquises.
Mais dure et longue vengeance on tirera des moralistes qui ont perverti l'humaine nature, des cagots, des cafards, des hypocrites "et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés pour tromper le monde. Car donnant entendre au populaire commun qu'ils ne sont occupés sinon à contemplation et dévotion, en jeusnes et mascération de la sensualité, sinon vrayement pour sustenter et alimenter la petite fragilité de leur humanité: au contraire font chière. Dieu sait qu'elle! et Curios simulant sed Bacchanalia vivunt [21]. Vous le pouvez lire en grosse lettre et enlumineure de leurs rouges muzeaulx et ventre à poulaine, sinon quand ils se parfument de souphre [22]".
Aux jours de grandes réjouissances populaires, où, au lieu d'avaler de la poussière comme aux 15 août et aux 14 juillet du bourgeoisisme, les communistes et les collectivistes feront aller les flacons, trotter les jambons et voler les gobelets, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, les prêtres à longue et courte robe de l'église économique, catholique, protestante, juive, positiviste et libre penseuse, les propagateurs du malthusianisme et de la morale chrétienne, altruiste, indépendante ou soumise, vêtus de jaune, tiendront la chandelle à s'en brûler les doigts et vivront en famine auprès des femmes galloises et des tables chargées de viandes, de fruits et de fleurs, et mourront de soif auprès des tonneaux débondés. Quatre fois l'an, au changement des saisons, ainsi que les chiens des rémouleurs, on les enfermera dans les grandes roues et pendant dix heures on les condamnera à moudre du vent. Les avocats et les légistes subiront la même peine.
En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales toujours et toujours; c'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. Les généraux, en bottes à l'écuyère, la poitrine chamarrée d'aiguillettes, de crachats, de croix de la Légion d'honneur, iront par les rues et les places, racolant les bonnes gens. Gambetta et Cassagnac, son compère, feront le boniment de la porte. Cassagnac, en grand costume de matamore, roulant des yeux, tordant la moustache, crachant de l'étoupe enflammée, menacera tout le monde du pistolet de son père et s'abîmera dans un trou dès qu'on lui montrera le portrait de Lullier; Gambetta discourra sur la politique étrangère, sur la petite Grèce qui l'endoctorise et mettrait l'Europe en feu pour filouter la Turquie; sur la grande Russie qui le stultifie avec la compote qu'elle promet de faire avec la Prusse et qui souhaite à l'ouest de l'Europe plaies et bosses pour faire sa pelote à l'Est et étrangler le nihilisme à l'intérieur; sur M. de Bismarck, qui a été assez bon pour lui permettre de se prononcer sur l'amnistie... puis, dénudant sa large bedaine peinte aux trois couleurs, il battra dessus le rappel et énumérera les délicieuses petites bêtes, les ortolans, les truffes, les verres de margaux et d'yquem qu'il y a engloutonnés pour encourager l'agriculture et tenir en liesse les électeurs de Belleville.
Dans la taraque, on débutera par la Farce électorale.
Devant les électeurs, à têtes de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois, vêtus en paillasses, danseront la danse des libertés politiques, se torchant la face et la postface avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses, et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France; et les têtes des électeurs de braire en choeur et solidement: hi han! hi han!
Puis commencera la grande pièce: Le Vol des biens de la nation.
La France capitaliste, énorme femelle, velue de la face et chauve du crâne, avachie, aux chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints, ensommeillée et bâillant, s'allonge sur un canapé de velours; à ses pieds, le Capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air; la Banque à museau de fouine, à corps d'hyène et mains de harpie, lui dérobe prestement les pièces de cent sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires décharnés, en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassés par des furies les cinglant avec les fouets de la faim, apportent aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le livre du budget entre les dents, se campe à la tête des défenseurs des biens de la nation et monte la garde. Les fardeaux déposés, à coups de crosse et de baïonnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques; n'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements... Alors le tonnerre éclate, la terre s'ébranle et s'entrouvre, la Fatalité historique surgit; de son pied de fer elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent et ne peuvent plus fuir, et de sa large main elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur.
Si, déracinant de son coeur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les Droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le Droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de trois heures par jour, la Terre, la vieille Terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers... Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile?
Comme le Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du Prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur: depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leurs chairs, tenaille leurs nerfs; depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leurs cerveaux!... Ô Paresse, prends pitié de notre longue misère! Ô Paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines!
Appendice
Nos moralistes sont gens bien modestes; s'ils ont inventé le dogme du travail, ils doutent de son efficacité pour tranquilliser l'âme, réjouir l'esprit et entretenir le bon fonctionnement des reins et autres organes; ils veulent en expérimenter l'usage sur le populaire in anima vili, avant de le tourner contre les capitalistes, dont ils ont mission d'excuser et d'autoriser les vices.
Mais, philosophes à quatre sous la douzaine, pourquoi vous battre ainsi la cervelle à élucubrer une morale dont vous n'osez conseiller la pratique à vos maîtres? Votre dogme du travail, dont vous faites tant les fiers, voulez-vous le voir bafoué, honni? Ouvrons l'histoire des peuples antiques et les écrits de leurs philosophes et de leurs législateurs.
"Je ne saurais affirmer, dit le père de l'histoire, Hérodote, si les Grecs tiennent des Égyptiens le mépris qu'ils font du travail, parce que je trouve le même mépris établi parmi les Thraces, les Scythes, les Perses, les Lydiens; en un mot parce que chez la plupart des barbares, ceux qui apprennent les arts mécaniques et même leurs enfants sont regardés comme les derniers des citoyens... Tous les Grecs ont été élevés dans ces principes, particulièrement les Lacédémoniens [23]."
"À Athènes, les citoyens étaient de véritables nobles qui ne devaient s'occuper que de la défense et de l'administration de la communauté, comme les guerriers sauvages dont ils tiraient leur origine. Devant donc être libres de tout leur temps pour veiller, par leur force intellectuelle et corporelle, aux intérêts de la République, ils chargeaient les esclaves de tout travail. De même à Lacédémone, les femmes mêmes ne devaient ni filer ni tisser pour ne pas déroger à leur noblesse [24]."
Les Romains ne connaissaient que deux métiers nobles et libres, l'agriculture et les armes; tous les citoyens vivaient de droit aux dépens du Trésor, sans pouvoir être contraints de pourvoir à leur subsistance par aucun des sordidœ artes (ils désignaient ainsi les métiers) qui appartenaient de droit aux esclaves. Brutus, l'ancien, pour soulever le peuple, accusa surtout Tarquin, le tyran, d'avoir fait des artisans et des maçons avec des citoyens libres [25].
Les philosophes anciens se disputaient sur l'origine des idées, mais ils tombaient d'accord s'il s'agissait d'abhorrer le travail.
"La nature, dit Platon, dans son utopie sociale, dans sa République modèle, la nature n'a fait ni cordonnier, ni forgeron; de pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent, vils mercenaires, misérables sans nom qui sont exclus par leur état même des droits politiques. Quant aux marchands accoutumés à mentir et à tromper, on ne les souffrira dans la cité que comme un mal nécessaire. Le citoyen qui se sera avili par le commerce de boutique sera poursuivi pour ce délit. S'il est convaincu, il sera condamné à un an de prison. La punition sera double à chaque récidive [26]."
Dans son Économique, Xénophon écrit:
"Les gens qui se livrent aux travaux manuels ne sont jamais élevés aux charges, et on a bien raison. La plupart, condamnés à être assis tout le jour, quelques-uns même à éprouver un feu continuel, ne peuvent manquer d'avoir le corps altéré et il est bien difficile que l'esprit ne s'en ressente."
"Que peut-il sortir d'honorable d'une boutique? professe Cicéron, et qu'est-ce que le commerce peut produire d'honnête? Tout ce qui s'appelle boutique est indigne d'un honnête homme [...], les marchands ne pouvant gagner sans mentir, et quoi de plus honteux que le mensonge! Donc, on doit regarder comme quelque chose de bas et de vil le métier de tous ceux qui vendent leur peine et leur industrie; car quiconque donne son travail pour de l'argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves [27]."
Prolétaires, abrutis par le dogme du travail, entendez-vous le langage de ces philosophes, que l'on vous cache avec un soin jaloux: un citoyen qui donne son travail pour de l'argent se dégrade au rang des esclaves, il commet un crime, qui mérite des années de prison.
La tartuferie chrétienne et l'utilitarisme capitaliste n'avaient pas perverti ces philosophes des Républiques antiques; professant pour des hommes libres, ils parlaient naïvement leur pensée. Platon, Aristote, ces penseurs géants, dont nos Cousin, nos Caro, nos Simon ne peuvent atteindre la cheville qu'en se haussant sur la pointe des pieds, voulaient que les citoyens de leurs Républiques idéales vécussent dans le plus grand loisir, car, ajoutait Xénophon, "le travail emporte tout le temps et avec lui on n'a nul loisir pour la République et les amis". Selon Plutarque, le grand titre de Lycurgue, "le plus sage des hommes" à l'admiration de la postérité, était d'avoir accordé des loisirs aux citoyens de la République en leur interdisant un métier quelconque [28].
Mais, répondront les Bastiat, Dupanloup, Beaulieu et compagnie de la morale chrétienne et capitaliste, ces penseurs, ces philosophes préconisaient l'esclavage. - Parfait, mais pouvait - il en être autrement, étant donné les conditions économiques et politiques de leur époque? La guerre était l'état normal des sociétés antiques; l'homme libre devait consacrer son temps à discuter les affaires de l'État et à veiller à sa défense; les métiers étaient alors trop primitifs et trop grossiers pour que, les pratiquant, on pût exercer son métier de soldat et de citoyen; afin de posséder des guerriers et des citoyens, les philosophes et les législateurs devaient tolérer les esclaves dans les Républiques héroïques. - Mais les moralistes et les économistes du capitalisme ne préconisent-ils pas le salariat, l'esclavage moderne? Et à quels hommes l'esclavage capitaliste fait-il des loisirs? - À des Rothschild, à des Schneider, à des Mme Boucicaut, inutiles et nuisibles esclaves de leurs vices et de leurs domestiques.
"Le préjugé de l'esclavage dominait l'esprit de Pythagore et d'Aristote", a-t-on écrit dédaigneusement; et cependant Aristote prévoyait que "si chaque outil pouvait exécuter sans sommation, ou bien de lui-même, sa fonction propre, comme les chefs-d'oeuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré; si, par exemple, les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aides, ni le maître d'esclaves".
Le rêve d'Aristote est notre réalité. Nos machines au souffle de feu, aux membres d'acier, infatigables, à la fécondité merveilleuse, inépuisable, accomplissent docilement d'elles- mêmes leur travail sacré; et cependant le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé du salariat, le pire des esclavages. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l'humanité, le Dieu qui rachètera l'homme des sordidœ artes et du travail salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté.
Notes
1. Descartes, Les Passions de l'âme.
2. Docteur Beddoe, Memoirs of the Anthropological Society; Ch. Darwin, Descent of Man.
3. Les explorateurs européens s'arrêtait étonnés devant la beauté physique et la fière allure des hommes des peuplades primitives, non souillés par ce que Pæppig appelait le "souffle empoisonné de la civilisation". Parlant des aborigènes des îles océaniennes, lord George Campbell écrit: "il n'y a pas de peuple au monde qui frappe davantage au premier abord. Leur peau unie et d'une teinte légèrement cuivrée, leurs cheveux dorés et bouclés, leur belle et joyeuse figure, en un mot toute leur personne, formaient un nouvel et splendide échantillon du genus homo; leur apparence physique donnait l'impression d'une race supérieure à la nôtre." Les civilisés de l'ancienne Rome, les César, les Tacite, contemplaient avec la même admiration les Germains des tribus communistes qui envahissaient l'Empire romain. - Ainsi que Tacite, Salvien, le prêtre du Ve siècle, qu'on surnommait le "maître des évêques", donnait les barbares en exemple aux civilisés et aux chrétiens: "Nous sommes impudiques au milieu des barbares, plus chastes que nous. Bien plus, les barbares sont blessés de nos impudicités, les Goths ne souffrent pas qu'il y ait parmi eux des débauchés de leur nation; seuls au milieu d'eux, par le triste privilège de leur nationalité et de leur nom, les Romains ont le droit d'être impurs. [La pédérastie était alors en grande mode parmi les païens et les chrétiens...] Les opprimés s'en vont chez les barbares chercher de l'humanité et un abri." (De Gubernatione Dei.) La vieille civilisation et le christianisme vieilli et la moderne civilisation capitaliste corrompent les sauvages du nouveau monde.
M. F. Le Play, dont on doit reconnaître le talent d'observation, alors même que l'on rejette ses conclusions sociologiques, entachées de prudhommisme philanthropique et chrétien, dit dans son livre Les Ouvriers européens (1885): "La propension des Bachkirs pour la paresse [les Bachkirs sont des pasteurs semi-nomades du versant asiatique de l'Oural]; les loisirs de la vie nomade, les habitudes de méditation qu'elles font naître chez les individus les mieux doués communiquent souvent à ceux-ci une distinction de manières, une finesse d'intelligence et de jugement qui se remarquent rarement au même niveau social dans une civilisation plus développée... Ce qui leur répugne le plus, ce sont les travaux agricoles; ils font tout plutôt que d'accepter le métier d'agriculteur." L'agriculture est, en effet, la première manifestation du travail servile dans l'humanité. Selon la tradition biblique, le premier criminel, Caïn, est un agriculteur.
4. Le proverbe espagnol dit: Descansar es salud (Se reposer est santé).
5. "Ô Mélibée, un Dieu nous a donné cette oisiveté", Virgile, Bucoliques.
6. Évangile selon saint Matthieu, chap. VI.
7. Au premier congrès de bienfaisance tenu à Bruxelles, en 1857, un des plus riches manufacturiers de Marquette, près de Lille, M. Scrive, aux applaudissements des membres du congrès, racontait, avec la plus noble satisfaction d'un devoir accompli: "Nous avons introduit quelques moyens de distraction pour les enfants. Nous leur apprenons à chanter pendant le travail, à compter également en travaillant: cela les distrait et leur fait accepter avec courage ces douze heures de travail qui sont nécessaires pour leur procurer des moyens d'existence." - Douze heures de travail, et quel travail! imposées à des enfants qui n'ont pas douze ans! - Les matérialistes regretteront toujours qu'il n'y ait pas un enfer pour y clouer ces chrétiens, ces philanthropes, bourreaux de l'enfance.
8. Discours prononcé à la Société internationale d'études pratiques d'économie sociale de Paris, en mai 1863, et publié dans "L'Economiste français" de la même époque.
9. L.-R. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie, 1848. Ce n'était pas parce que les Dollfus, les Koechlin et autres fabricants alsaciens étaient des républicains, des patriotes et des philanthropes protestants qu'ils traitaient de la sorte leurs ouvriers; car Blanqui, l'académicien Reybaud, le prototype de Jérôme Paturot, et Jules Simon, le maître Jacques politique, ont constaté les mêmes aménités pour la classe ouvrière chez les fabricants très catholiques et très monarchiques de Lille et de Lyon. Ce sont là des vertus capitalistes s'harmonisant à ravir avec toutes les convictions politiques et religieuses.
10. Les Indiens des tribus belliqueuses du Brésil tuent leurs infirmes et leurs vieillards; ils témoignent leur amitié en mettant fin à une vie qui n'est plus réjouie par des combats, des fêtes et des danses. Tous les peuples primitifs ont donné aux leurs ces preuves d'affection: les Massagètes de la mer Caspienne (Hérodote), aussi bien que les Wens de l'Allemagne et les Celtes de la Gaule. Dans les églises de Suède, dernièrement encore, on conservait des massues dites massues familiales, qui servaient à délivrer les parents des tristesses de la vieillesse. Combien dégénérés sont les prolétaires modernes pour accepter en patience les épouvantables misères du travail de fabrique!
11. Au Congrès industriel tenu à Berlin le 21 janvier 1879, on estimait à 568 millions de francs la perte qu'avait éprouvée l'industrie du fer en Allemagne pendant la dernière crise.
12. La Justice, de M. Clemenceau dans sa partie financière, disait le 6 avril 1880: "Nous avons entendu soutenir cette opinion que, à défaut de la Prusse, les milliards de la guerre de 1870 eussent été également perdus pour la France, et ce, sous forme d'emprunts périodiquement émis pour l'équilibre des budgets étrangers; telle est également notre opinion." On estime à cinq milliards la perte des capitaux anglais dans les emprunts des Républiques de l'Amérique du Sud. Les travailleurs français ont non seulement produit les cinq milliards payés à M. Bismarck; mais ils continuent à servir les intérêts de l'indemnité de guerre aux Ollivier, aux Girardin, aux Bazaine et autres porteurs de titres de rente qui ont amené la guerre et la déroute. Cependant il leur reste une fiche de consolation: ces milliards n'occasionneront pas de guerre de recouvrement.
13. Sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient au travailleur 90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l'irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, dès qu'elle fut maîtresse, elle abolit les jours fériés et remplaça la semaine de sept jours par celle de dix. Elle affranchit les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail.
La haine contre les jours fériés n'apparaît que lorsque la moderne bourgeoisie industrielle et commerçante prend corps, entre les XVe et XVIe siècles. Henri IV demanda leur réduction au pape; il refusa parce que "l'une des hérésies qui courent le jourd'hui, est touchant les fêtes" (lettre du cardinal d'Ossat). Mais, en 1666, Péréfixe, archevêque de Paris, en supprima 17 dans son diocèse. Le protestantisme, qui était la religion chrétienne, accommodée aux nouveaux besoins industriels et commerciaux de la bourgeoisie, fut moins soucieux du repos populaire; il détrôna au ciel les saints pour abolir sur terre leurs fêtes.
La réforme religieuse et la libre pensée philosophique n'étaient que des prétextes qui permirent à la bourgeoisie jésuite et rapace d'escamoter les jours de fête du populaire.
14. Ces fêtes pantagruéliques duraient des semaines. Don Rodrigo de Lara gagne sa fiancée en expulsant les Maures de Calatrava la vieille, et le Romancero narre que:
Las bodas fueron en Burgos,
Las tornabodas en Salas:
En bodas y tornabodas
Pasaron siete semanas
Tantas vienen de las gentes,
Que no caben por las plazas...(Les noces furent à Burgos, les retours de noces à Salas: en noces et retours de noces, sept semaines passèrent; tant de gens accourent que les places ne peuvent les contenir...)
Les hommes de ces noces de sept semaines étaient les héroïques soldats des guerres de l'indépendance.
15. Karl Marx, Le Capital, livre premier, ch. XV, § 6.
16. "La proportion suivant laquelle la population d'un pays est employée comme domestique au service des classes aisées, indique son progrès en richesse nationale et en civilisation." (R. M. Martin Ireland before and after the Union, 1818.) Gambetta, qui niait la question sociale, depuis qu'il n'était plus l'avocat nécessiteux du Café Procope, voulait sans doute parler de cette classe domestique sans cesse grandissante quand il réclamait l'avènement des nouvelles couches sociales.
17. Deux exemples: le gouvernement anglais, pour complaire aux pays indiens qui, malgré les famines périodiques désolant le pays, s'entêtent à cultiver le pavot au lieu du riz ou du blé, a dû entreprendre des guerres sanglantes, afin d'imposer au gouvernement chinois la libre introduction de l'opium indien. Les sauvages de la Polynésie, malgré la mortalité qui en fut la conséquence, durent se vêtir et se saouler à l'anglaise, pour consommer les produits des distilleries de l'Écosse et des ateliers de tissage de Manchester.
18. Paul Leroy-Beaulieu, La Question ouvrière au XIVe siècle, 1872.
19. Voici, d'après le célèbre statisticien R. Giffen, du Bureau de statistique de Londres, la progression croissante de la richesse nationale de l'Angleterre et de l'Irlande: en 1814, elle était de 55 milliards de francs; en 1865, elle était de 162,5 milliards de francs, en 1875, elle était de 212,5 milliards de francs.
20. Louis Reybaud, Le Coton, son régime, ses problèmes, 1863.
21. "Ils simulent des Curius et vivent comme aux Bacchanales" (Juvénal).
22. Pantagruel, livre II, chap. LXXIV.
23. Hérodote, t. II, trad. Larcher, 1876.
24. Biot, De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident, 1840.
25. Tite-Live, livre premier.
26. Platon, République, livre V.
27. Cicéron, Des devoirs, I, tit. II, chap. XLII.
28. Platon, République, V, et les Lois, III; Aristote, Politique, II et VII; Xénophon, Économique, IV et VI; Plutarque, Vie de Lycurgue
Les propositions du Parti Socialiste Suisse
Monde du travail et emploi : bref tour d'horizon
Réduire le temps de travail, changer la répartition du travail, libérer le temps
Les propositions d'initiatives populaires
La prise de position des femmes socialistes
De la répartition du travail rémunéré et non-rémunéré
Le double bonus de travailInitiative sur le temps de travail
Initiative contre le chômage des jeunes
Le chômage de masse est devenu le problème majeur en Suisse, et il le restera si les collectivités publiques ne prennent pas des mesures ciblées et efficaces pour lutter contre le chômage et créer de nouveaux emplois. Il ne se passera rien sans pression politique. C'est pourquoi le Congrès du PSS du 2 septembre 1995 (Aarau) a mandaté la direction du parti d'élaborer un projet d'initiative en collaboration avec l'USS. Le Comité central a mis sur pied un groupe de travail ad hoc et a lancé une large consultation auprès des membres du parti.
Le Comité central a discuté le 22 juin 1996 du rapport intermédiaire d'un groupe de travail. En raison des approches controversée contenue dans ce rapport, il a décidé de mener une consultation auprès de toutes les sections du PSS sur les principales orientations quant au contenu et sur les modèles possibles, avant l'élaboration du texte définitif.
Petite ou grande redistribution du travail ?
La première question majeure relative à l'élaboration du texte d'initiative concerne l'importance de la répartition du travail : l'initiative doit-elle se limiter à la "petite" répartition et se limiter ainsi au moins directement à la répartition du travail rémunéré (par exemple par le passage à la semaine de 35 heures) ou doit-elle aussi prendre en considération la question de la répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré ("grande répartition") ? Le modèle suivant figure comme variante de la mise en oeuvre de la grande répartition du travail, à discuter :
"La Confédération prend des dispositions afin que tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler puissent gagner leur vie par un travail rémunéré et afin que le travail non rémunéré nécessaire à la société soit réparti à égalité entre les femmes et les hommes"
Il s'agit d'éclaircir en deuxième lieu la question de savoir si la réduction de la durée du travail rémunéré doit se faire par la fixation de la durée normale du travail (par exemple 32 ou 25 heures hebdomadaires) ou par le biais d'incitations financières destinées à réduire la durée générale du travail. Il faut en outre décider si d'autres revendications spécifiques comme la lutte contre le chômage des jeunes, la retraite flexible, l'instauration de réductions du travail pour les parents de jeunes enfants, l'encouragement du travail à temps partiel pour tous ou la suppression des heures supplémentaires doivent être reprises dans le texte de l'initiative.
Consultation des sections socialistes sur les projet d'initiatives sur le temps de travail et contre le chômage des jeunes
Le chômage de masse est devenu un problème majeur en Suisse et il le restera si les collectivités publiques ne prennent pas des mesures ciblées et efficaces pour lutter contre le chômage et créer de nouveaux emplois. Il ne se passera rien sans pression politique de l'extérieur. C'est pourquoi le Congrès de septembre 1995 à Aarau a chargé la direction du parti d'élaborer un projet d'initiative susceptible de rassembler une majorité, en intégrant l'USS à ce travail. Le Comité central a mis en place un groupe de travail ad hoc.
Le Comité central a débattu du rapport intermédiaire de ce groupe le 22 juin 1996. La discussion au Comité central a montré qu'il n'est pas facile de faire figurer dans une initiative populaire le grand nombre d'exigences justifiées relatives à la réduction de la durée du travail ainsi qu'à la répartition du travail, pour autant qu'on veuille une initiative qui sera couronnée de succès et qui doit par conséquent être formulée simplement. Les réflexions qui sous-tendent différents modèles et points de départ sont partiellement contradictoires ou s'excluent.
C'est pourquoi le Comité central a décidé de mener une consultation auprès des sections du PS avant l'élaboration concrète de textes d'initiatives, de les questionner sur les principales orientations quant au contenu et d'obtenir leur opinion sur les différents modèles. Les sections sont invitées à prendre position en particulier sur les questions suivantes :
1. Question de principe (voir chapitre B)
1.1 Petite ou grande répartition du travail ?
L'initiative doit-elle se limiter à la réduction du temps de travail dans le sens de la petite répartition du travail (par exemple, semaine de 35 heures), ou doit-elle également prendre en considération la question de la répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré (grande répartition ?)
1.2 Quel modèle ?
Avec quel modèle faut-il atteindre l'objectif de la réduction du travail rémunéré ? Faut-il fixer dans la Constitution la durée normale du travail visée (par exemple la semaine de 35 heures) ou l'obligation pour la Confédération de prendre des mesures contre le chômage (par exemple, une politique économique anticyclique et la fixation d'incitations financières) ?
2. Questions particulières relatives au contenu (chapitre C du document)
Outre le souhait d'éclaircir ces questions de principe, le Comité central souhaiterait également connaître les priorités que retiennent les sections pour l'initiative parmi les différentes exigences tout à fait justifiées quant à leur contenu (par exemple, mesures contre le chômage des jeunes, retraite flexible, réduction de la durée du travail pour les parents de jeunes enfants, travail à temps partiel pour tout le monde, suppression des heures supplémentaires). Il n'est pas possible, et en partie pas non plus absolument indispensable, de reprendre explicitement toutes les exigences dans l'initiative.
L'initiative ou les initiatives devront être traitées lors du Congrès extraordinaire de fin juin 1997. C'est pourquoi nous prions les sections de faire parvenir leurs prises de position, leurs suggestions et leurs réflexions au Secrétariat central jusqu'à fin février 1997 au plus tard. Béatrice Pfister, collaboratrice scientifique au Secrétariat central, vous donnera volontiers d'autres informations. (Tel. 031 311.07.44)
Secrétariat central du PSS :
Spitalgasse 34
3011 Berne
Tel. (031) 311.07.44 Fax (031) 311.54.14
Projet d'initiative sur le temps de travail et contre le chômage des jeunes
Depuis le début des années '90, non seulement les salaires réels ont baissé en Suisse, mais des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés, et le chômage de masse croissant est devenu le problème essentiel pour les gens. Sans contre-mesures ciblées, le socle de chômage continuera à s'accroître aussi dans des "temps meilleurs". Ni l'économie, ni l'Etat ne paraissent s'en soucier. Le PS ne l'accepte pas. C'est pourquoi le comité central prépare une initiative populaire contre le chômage, en collaboration avec l'USS, sur mandat du congrès du 2 septembre 1995. Le comité central entend faire participer les sections du PS à la discussion sur l'orientation relative au contenu de l'initiative (ou des initiatives), avant que le ou les projets ne soient formulés à l'intention du Congrès.
Le Congrès du 2 décembre 1995 à Aarau a chargé le comité directeur de lui présenter un projet d'initiative contre le chômage des jeunes en 1996, préparé en étroite collaboration avec les syndicats. Un groupe de travail paritaire PSS/USS a élaboré différentes propositions et idées de projets de décembre 1995 à juin 1996.
Le comité central a débattu du rapport intermédiaire de ce groupe de travail le 22 juin 1996. Un grand nombre d'exigences et de modèles justifiés se sont cristallisés au courant de la discussion, qu'il n'est toutefois pas facile de faire figurer ensemble dans une initiative. C'est pourquoi le comité central a décidé de questionner les sections sur les principales orientations relatives au contenu de l'initiative (ou des initiatives , avant la formulation du ou des textes définitifs.
A. Situation de départ
Près de 350'000 personnes sont actuellement sans activité rémunérée, contre leur gré. Ce sont les 166'409 personnes qui étaient enregistrées en septembre 1996 comme chômeuses et chômeurs auprès des caisses de chômage, ainsi que les personnes arrivées en fin de droit, les personnes en formation, les mères de famille, les personnes retournées dans leur pays d'origine, qui ne peuvent pas trouver de travail rémunéré en Suisse.
L'Etat et l'économie devraient en particulier prendre des mesures d'urgence en faveur des travailleurs âgés et des jeunes, des mères de famille, des personnes peu ou mal qualifiées, des personnes handicapées. Mais l'un et l'autre se comportent de manière passive ou ne font que renforcer la crise sur le marché du travail. Au lieu de mener une politique économique anticyclique pour provoquer un retournement de la conjoncture, les pouvoirs publics aggravent la situation économique par une politique d'économie rigoureuse, le démantèlement des salaires, etc.
L'économie continue à supprimer massivement des emplois. Et si elle en crée de nouveaux, elle le fait de préférence à l'étranger. Au lieu que le volume de travail restant soit réparti sur davantage d'individus, la Suisse est devenue une championne en matière d'heures supplémentaires et de longue durée du travail. En 1994, ce sont 62 millions d'heures supplémentaires qui ont été accomplies, ce qui correspond à environ 84'000 emplois à plein temps !
L'Etat supprime des milliers d'emplois. Il se limite pour l'essentiel à la gestion du chômage, au lieu d'empêcher le chômage de masse avec des mesures dans les domaines de la politique économique, du marché du travail, de l'égalité et de la formation.
Rien ne changera à cela -même si la croissance économique repart- sans pression politique de l'extérieur. Et d'autant moins que la productivité augmentera à l'avenir plus vite que la croissance économique. Le socle de chômage va par conséquent continuer à augmenter si l'on ne prend pas de mesures d'ensemble pour réduire la durée du travail.
Un groupe de travail du PSS a calculé que la durée moyenne hebdomadaire du travail doit être réduite à 36 heures pour un même volume de travail rémunéré, afin que 300'000 femmes et hommes puissent trouver une place de travail dans le pays (=petite répartition du travail).
Le même groupe de travail estime que la durée hebdomadaire du travail doit s'abaisser à 20-30 heures (...),. afin que toutes les femmes et les hommes en Suisse aient un emploi. Mais cela ne suffit pas. Pour que les femmes puissent participer à égalité au marché du travail, il faut répartir le travail rémunéré et le travail non rémunéré à égalité entre les sexes (=grande répartition du travail).
Seules des réductions importantes de la durée du travail ont des effets sur l'emploi. La réduction peut se faire sous différentes formes, entre autres :
- réduction de la durée hebdomadaire, respectivement annuelle, du travail; - suppression des heures supplémentaires; - encouragement des emplois à temps partiel; - abaissement de l'âge de la retraite, respectivement modèles de retraite anticipée flexible.
B. Deux questions de principe sur le concept de l'initiative
Les discussions au Comité central du PSS ont montré que deux questions de principe doivent être éclaircies pour l'élaboration de l'initiative :
1. L'initiative doit-elle se limiter à la réduction de la durée du travail dans le sens de la petite répartition (par exemple la semaine de 35 heures) ou doit-elle traiter en même temps la question de la répartition du travail rémunéré et non rémunéré (grande répartition) ?
Exemple pour l'intégration de la grande répartition : La Confédération prend des mesures afin que tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler puissent gagner leur vie par un travail rémunéré et afin que le travail non rémunéré socialement nécessaire soit réparti à égalité entre les femmes et les hommes.
2. Comment le but de la réduction du temps de travail rémunéré doit-il être ancré dans la Constitution ?
Modèle 1 : Fixation de la durée normale du travail (par exemple la semaine de 35 ou de 32 heures) dans la Constitution
Exemples : La durée normale du travail est de 35 (32) heures par semaine. Les durées du travail plus longue valables actuellement doivent être réduites de deux heures tous les deux ans. Des durées annuelles du travail flexibles peuvent être convenues au moyen de conventions collectives de travail, qui ne contiendront la durée normale du travail introduite progressivement qu'en moyenne annuelle. S'il n'est pas fait usage de la possibilité de la durée annuelle du travail fixée par convention collective, c'est la durée normale du travail introduite progressivement qui est valable. Elle doit être respectée pour tous les travailleurs, sur une période de huit semaines, dans laquelle des compensations sont possibles. Le législateur doit assurer dans tous les cas que le versement du salaire et les autres prestations prévues dans le contrat de travail se fassent sur la base de la durée moyenne du travail, que la durée maximale du travail de 45 heures par semaine ne soit pas dépassée et que les travailleurs à temps partiel soient traités à égalité avec les travailleurs à plein temps.
Modèle II : Obligation faite à la Confédération de prendre des mesures contre le chômage (par exemple, une politique économique anticyclique et des incitations financières pour la réduction du temps de travail.
Exemple : Lorsque plus de 100'000 personnes ou plus de 30'000 jeunes sont au chômage au milieu de l'année, le Conseil fédéral et le Parlement prennent un arrêté fédéral urgent lors de la session de décembre pour combattre efficacement le chômage. Cet arrêté comprend au moins :
1. L'augmentation des dépenses d'investissement de la Confédération pour l'année suivante, ainsi que des contributions financières aux cantons et aux communes qui augmentent leurs dépenses d'investissement pour l'année suivante au-delà des montants planifiés.
2. La réduction de la durée maximale du travail et des heures supplémentaires autorisées ainsi que le soutien financier à des accords conclus par les partenaires sociaux, avec lesquels ces derniers empêchent ou limitent les licenciements, ou créent de nouveaux emplois, au moyen de réductions de la durée du travail, de travail à temps partiel ou de retraites anticipées.
Autre exemple pour une incitation financière (proposition du PS de Genève) :
La Confédération met sur pied un "fonds pour le partage du travail", qui est financé par l'assurance-chômage. Ce fonds est destiné aux entreprises et administrations qui réduisent de manière durable le temps de travail en dessous de la durée légale du travail et qui respectent les conditions suivantes :
1. La réduction du temps de travail doit être compensée par la création d'emplois.
2. La réduction du temps de travail doit être négociée avec les partenaires sociaux.
C. Questions particulières relatives au contenu de l'initiative
Il faudra décider lors de l'élaboration de l'initiative quelles exigences devraient explicitement y être mentionnées. Diverses propositions ont été émises lors de la discussion au Comité central, comme par exemple :
1. Chômage des jeunes/formation professionnelle
Exemples : Lorsque le Conseil fédéral constate qu'il y a une grande insuffisance de places d'apprentissage, il doit introduire une taxe sur la formation professionnelle. Il doit ainsi créer une compensation entre les entreprises qui n'offrent aucune ou qu'un petit nombre de places d'apprentissage, et celles qui offrent des places d'apprentissage qualifiées supplémentaires. Création d'ateliers d'apprentissage, obligation faite aux entreprises de continuer à occuper les jeunes après la fin de leur apprentissage.
2. Mise à la retraite flexible
Exemples : Lorsdqu'il y a plus de 100'000 personnes au chômage en Suisse, les travailleuses et les travailleurs de plus de 60 ans peuvent prendre leur retraite. Les personnes de plus de 55 ans exerçant une activité professionnelle peuvent réduire de moitié la durée de leur tâche, le 70 % du salaire précédent étant alors versé par l'assurance-chômage et les employeurs.
3. Réduction de la durée du travail pour les parents ayant de jeunes enfants
Exemple : Lorsque plus de 100'000 personnes sont au chômage en Suisse, les travailleurs et travailleuses ayant des enfants de moins de cinq ans peuvent réduire leur temps de travail jusqu'à 20 heures hebdomadaires aux frais de l'assurance-chômage.
4. Encouragement du travail à temps partiel pour tous
Exemple : Le Conseil fédéral prend des mesures en faveur de l'encouragement du travail à temps partiel pour tous. La Confédération prélève dans ce but une taxe d'incitation sur la masse salariale, qui est entièrement restituée aux entreprises en fonction des emplois à temps partiel qu'elles auront mis à disposition.
5. Suppression des heures supplémentaires
Exemple : Les heures supplémentaires qui dépassent de 5 % la durée annuelle du travail d'un emploi à plein temps ne peuvent être compensées que par du temps libre.
Résumé des résultats de la consultation auprès des sections du PSS
Une synthèse des réponses reçues est difficile à effectuer, compte tenu des réponses disparates qui ont été données. Quelques éléments peuvent cependant être relevés :
- 57 sections et instances ont répondu à la consultation
- 3 réponses ont considéré que l'initiative populaire n'était pas un bon instrument pour réduire le temps de travail
- Une section a répondu qu'elle soutiendrait n'importe quelle initiative visant à la réduction du temps de travail
- Une section a répondu qu'elle ne pouvait pas répondre, vu l'insuffisance des documents à disposition et du temps laissé pour répondre
- 27 réponses, dont celles des femmes socialistes (sauf celles de Thoune) sont favorables à la "grande répartition", et à une initiative y correspondant, quelques unes des réponses exprimant au surplus une opposition à toute participation à la récolte de signatures au bas d'une autre initiatives.
- 6 réponses s'expriment en principe pour la grande répartition, mais considèrent que le modèle proposé reste peu clair, ou que le moment n'est pas bien choisi pour lancer une initiative.
- 37 réponses expriment un soutien au modèle de la "petite répartition" du temps de travail.
- 19 réponses s'expriment en faveur d'une initiative proposant une réglementation fixe de la durée hebdomadaire du travail; la tendance dominante est favorable à la semaine de 35 heures, les réponses allant de 32 à 37 heures. Quelques réponses expriment un soutien à une réglementation de la durée annuelle du travail.
- 14 réponses vont dans le sens du modèle d'incitation et de mesures conjoncturelles.
S'agissant des éléments supplémentaires à intégrer éventuellement dans une initiative, il est fréquemment mentionné qu'il faudrait éviter une initiative contenant trop d'éléments, quelques réponses proposant plutôt le lancement de plusieurs initiatives reprenant chacune un élément fondamental.
- 30 réponses soutiennent un contenu portant sur le chômage des jeunes, la plupart en faisant une priorité et quelques unes demandant une initiative spécifique. Quelques réponses expriment cependant une opposition à un traitement privilégié du chômage d'une catégorie d'âge.
- 19 réponses sont favorables à une proposition de retraite à la carte.
- 8 réponses sont favorables à des mesures spécifiques pour les parents d'enfants en bas âge.
- 28 réponses sont favorables à des mesures de soutien au travail à temps partiel.
- 23 réponses sont favorables à des mesures de restriction des possibilités d'heures supplémentaires. Plusieurs réponses en font une priorité.
S'agissant du financement des mesures proposées, plusieurs réponses critiquent l'absence de précision des projets soumis à consultation. La même critique est portée contre le "flou" de l'attitude à l'égard d'une baisse éventuelle des salaires, provoquée par la réduction du temps de travail salarié.
Plusieurs réponses demandent un travail commun du parti socialiste et et des syndicats (voire d'autres partis) pour la conception et le lancement de toute initiative.
La prise de position des Femmes socialistes
Jusqu'à fin février, les sections du PS peuvent prendre position au sujet des initiatives prévues concernant le partage du travail et le chômage des jeunes. Le comité des Femmes socialistes a déjà profité de cette possibilité lors de sa session du 7 décembre 1996.
Il est évident pour les Femmes socialistes suisses qu'une initiative sur la répartition du travail est depuis longtemps nécessaire. Mais il faudra aussi s'attaquer efficacement, à long terme, à la répartition inégale des ressources matérielles. Les Femmes socialistes saluent néanmoins comme un premier pas un projet d'initiative qui se limite au sujet du temps de travail. La discussion dans l'opinion publique sur la répartition du travail devra démarrer aussitôt que possible compte tenu des profonds changements socio-économiques en cours. Une initiative sur le temps de travail s'y prête parfaitement.
Une répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré est depuis des décennies une des exigences fondamentales des organisations féminines. Les chiffres sont connus depuis la Conférence des femmes de Nairobi, organisée par l'ONU : les femmes accomplissent dans le monde les deux tiers de l'ensemble du travail; elles gagnent un dixième de la masse salariale totale et elles possèdent un pour-cent de l'ensemble de la fortune. En Suisse, les hommes avcvcomplissent 66 % du travail rémunéré et seulement 12 % du travail non rémunéré, alors que les femmes accomplissent 34 % du travail rémunéré et 88 % du travail non rémunéré. La part des hommes aux revenus du travail est en Suisse environ trois fois plus élevée (74 %) que celle des femmes (26 %). Les femmes socialistes suisses refusent tout retard supplémentaire s'agissant du projet d'initiative dans le domaine du temps de travail, qui est annoncé depuis longtemps.
Pour les Femmes socialistes, il faut une initiative populaire pour la grande répartition, c'est-à-dire la répartition du travail lucratif et du travail non rémunéré. Mais la semaine semaine de 35 heures ne suffit pas pour la grande répartition. Il faut passer pour ce faire à une réduction de la durée du travail à 25 heures par semaine. Les Femmes socialistes suggèrent d'élaborer d'autres projets d'initiatives, qui s'orienteront entre autres vers le temps de travail durant la vie. Il est important de prendre en considération la multiplicité des réalités de vie et de travail des femmes et des hommes. Quant au texte d'initiative, les Femmes socialistes proposent que l'exigence de l'égalité se rapporte tant aux emplois à plein temps qu'aux emplois à temps pertiels. Cette question sera importante pour une durée normale du travail de 25 heures par semaine.
Les Femmes socialistes saluent tous les investissements qui devraient servir à relancer l'emploi -donc pas uniquement dans le secteur de la construction, où ce sont surtout des hommes qui sont occupés. Une initiative populaire n'est pas nécessaire, s'agissant du bonus à l'investissement. Cette mesure est à réaliser beaucoup plus rapidement par la voie de la loi.
Un document en 8 points sur la répartition du travail rémunéré et non rémunéré
On continue à confondre la notion de travail avec celle de travail rémunéré -c'est-à-dire le travail recouvrant l'activité qu'accomplissent les personnes occupées salariées ou indépendantes. C'est en raison de cette confusion qu'on méconnaît l'importance sociale, politique et économique du travail non rémunéré. Le travail non rémunéré est à bien des égards fortement désavantagé par rapport au travail rémunéré.
Les deux types de travail sont aussi importants et nécessaires l'un que l'autre, et ils se conditionnent mutuellement. On esquisse dans ce document l'objectif d'une répartition égale du travail rémunéré et non rémunéré, à atteindre au moyen d'incitations économiques. La société devrait en retirer des avantages importants : la réduction du chômage, une véritable égalité de l'homme et de la femme.
Situation de départ : la société à deux vitesses
1. Le travail nécessaire à la société se compose de travail rémunéré et de travail non rémunéré
On accorde dans notre société une très grande valeur au travail lucratif. C'est par lui que les gens gagnent leur vie, c'est par lui que les biens et les services sont mis à la disposition de notre société basée sur la division du travail.
Le travail rémunéré ne serait pas concevable sans le travail dit "de reproduction" qui englobe d'une manière générale le travail éducatif et les tâches d'assistance ainsi que le travail ménager. Le travail non rémunéré ou travail de reproduction constitue la base de la vie sociale et économique. Mais dans une société à forte division du travail, le travail non rémunéré est lui aussi dépendant du revenu du travail rémunéré.
2. Le travail rémunéré et le travail non rémunéré ainsi que le revenu sont répartis inégalement entre les femmes et les hommes: les femmes sont désavantagées.
Contrairement à son importance sociale et économique, le travail non rémunéré est fortement désavantagé par rapport au travail rémunéré. Cela a des effets négatifs avant tout pour les femmes; ce sont elles qui accomplissent presque exclusivement le travail non rémunéré. Les femmes
. accomplissent la plus grande part du travail
(55 % du travail total, lucratif et non lucratif, soit 88 % du travail non lucratif -tâches ménagères et soins à la famille- et 34 % du travail lucratif)) . en obtiennent une faible part du revenu.
(26 % des revenus du travail) De plus, les femmes
. obtiennent des salaires inférieurs pour un travail égal, . sont plus mal placées dans la sécurité sociale, . ont un accès plus difficile à un travail hautement qualifié, . ont des chances de promotion plus faibles, . ont également des chances moins grandes dans le domaine socio-politique.
3. Le développement du travail à temps partiel "personnalisé" indique bien la voie à suivre, mais ne conduit ni à l'égalité ni automatiquement à la répartition de l'ensemble du travail.
Dans les conditions actuelles, le travail à temps partiel est souvent la seule possibilité pour beaucoup de femmes d'exercer un travail rémunéré. Mais le travail à temps partiel ne conduit pas à l'égalité, car :
. Les chances de promotion et de développement sont extrêmement faibles dans les emplois à temps partiel; . on s'exclut de futures possibilités d'avoir de bons salaires et un travail qualifié, si l'on a perdu l'accès au monde du travail ou si on y a accès seulement au travers d'un emploi à temps partiel. Le danger est grand de ne plus trouver d'accès à un marché du travail qui se restreint. . Le travail rémunéré suscite du prestige social; si l'on travaille beaucoup (à titre rémunéré), on a aussi le plus souvent davantage de possibilités dans la vie extra- professionnelle (par exemple en politique). Il continue d'en être ainsi. . Les assurances sociales sont toujours encore fondées sur le travail à plein temps. Les personnes occupées à temps partiel sont par conséquent désavantagées en matière de sécurité sociale. . Le travail à temps partiel signifiera toujours une déviation de la "normalité du plein temps", qui est fortement marquée par les biographies masculines.
Il est donc clair qu'en dépit du boom du travail à temps partiel, une action politique est nécessaire, car :
. Une offre d'emplois à temps partiel, même bien développée, n'aura pas pour conséquence une répartition du travail non rémunéré; elle pourrait même constituer un handicap dans certains emplois à temps partiel, en raison des horaires fixés. . Toutes les charges liées à une autre répartition tant du travail rémunéré que du travail non rémunéré demeurent à la charge des individus. L'incitation à changer leur situation pour ceux qui ne font que du travail rémunéré ou qui travaillent à plein temps sera par conséquent faible. . Peu de gens peuvent se permettre un emploi à temps partiel (quelques couples, des individus qui gagnent bien leur vie ou qui sont soutenus autrement). Le travail à temps partiel comme seule condition à une répartition du travail rémunéré resterait un modèle valable pour les classes moyenne et supérieure.
En résumé
Lorsque les emplois à temps partiel offrent du travail inintéressant, des possibilités de promotion inexistantes et une rémunération proportionnellement plus mauvaise, ils conduisent à la société à deux vitesses.
4. On ne pourra pas résoudre le problème croissant du chômage sans répartition du travail
Le chômage élevé est un des plus grands fardeaux de notre société. L'offre de travail sur le marché recule et les phases de rétablissement et de relance se produisent actuellement sans baisse correspondante du chômage.
Il est positif et souhaitable qu'une société consacre moins de temps de travail rémunéré pour couvrir ses besoins, en raison du gain de productivité. La question est uniquement de savoir comment le travail restant doit être réparti. Il est clair que le chômage est la répartition la plus injuste et la moins économique du travail rémunéré qui subsiste.
Le taux de chômage atteint déjà actuellement près de 8 % (y compris les personnes en fin de droit et les personnes prêtes à travailler, mais non acconcées) en Suisse. Cela signifie qu'il y a, dans la population prête à travailler, environ une personne sur dix qui est obligée de renoncer à exercer une activité lucrative. Les neuf autres sont tenues à des horaires de travail qui ne leur laissent pas suffisamment de temps pour d'autres activités.
5. Sans répartition du travail, nous aurons une société à deux vitesses et une situation de pauvreté pour beaucoup.
Si on ne prend pas de mesures pour favoriser la répartition du travail, l'évolution vers une société à deux vitesses ne pourra pas être corrigée. Les signes de cette évolution sont déjà évidents maintenant :
. Il y a d'une part une majorité de gens travaillant à plein temps et d'autre part une importante minorité du point de vue du nombre qui n'a plus accès au travail et au revenu de celui-ci. . La part de population exclue du travail rémunéré est complètement dépendante sur le plan financier de celle qui a une activité rémunérée intégratrice. Une partie de la population capable de travailler a le statut d'assisté-e. . La chance de retrouver un emploi se réduit avec la durée du chômage, car le savoir acquis à un certain moment perd de sa valeur en raison des changements rapides dans le domaine du travail. . La seule possibilité pour la part de population désavantagée dans la vie économique et sociale d'obtenir des revenus propres consiste en activités de domestiques pour ceux et celles qui travaillent à plein temps. La sécurité sociale pour les désavantagé-e-s est maintenue à un niveau su faible que ceux-ci sont obligés de recourir aux gains supplémentaires les plus précaires.
Conséquence
Seule une répartition et donc une réduction radicale de la durée normale du travail apporte la solution. Les femmes pourraient tout aussi bien que les hommes occuper un emploi à plein temps mais beaucoup plus court qu'actuellement. Personne ne serait désavantagé par une durée du travail réduite : le salaire, la carrière, le prestige et les possibilités de développement ne seraient pas davantage amoindries que les possibilités de participation sociale en dehors du travail.
L'objectif : Une répartition équilibrée du travail rémunéré et du travail non rémunéré
6. Une répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré est nécessaire pour parvenir à l'égalité des sexes. La semaines de 2 x 25 heures est un modèle dans ce sens.
Une répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré signifie concrètement :
. Une durée générale du travail abaissée et flexible : des durées du travail rémunéré nettement plus courtes doivent déterminer la nouvelle normalité du travail à plein temps. Le temps devenu libre et qui deviendra libre en raison des progrès de la productivité est réparti entre tous. La société n'y perd aucune heure de travail rémunéré ni aucune capacité de production, puisque davantage de gens qu'aujourd'hui peuvent être intégrés dans le travail rémunéré. . La répartition du travail non rémunéré en parts aussi égales que possible entre les deux sexes : une durée hebdomadaire du travail plus courte est ici beaucoup plus importante que d'autres formes de réduction du travail (temps de travail annuel ou durant la vie). Une durée hebdomadaire du travail plus courte tient compte au mieux des exigences en temps pour le travail non rémunéré et offre ainsi la meilleure condition pour sa répartition. La charge pour le travail rémunéré correspond dans l'ensemble à peu près à la charge pour le travail non rémunéré, elle s'accroît même alors que le besoin en travail rémunéré recule.
Conséquences
Tout cela conduit finalement à la logique de la semaine des 2 x 25 heures.
On entend par là une semaine qui part d'une occupation à temps complet d'environ 25 heures de travail rémunéré. Un engagement hebdomadaire d'environ 25 heures de traavail non rémunéré va également de soi. On n'entend pas par là une dictature du temps : l'accent est mis sur le concept de "normalité". Nous avons actuellement la normalité d'une durée hebdomadaire du travail de 42 heures pour un emploi rémunéré à plein temps, et en même temps la normalité d'un travail non rémunéré réparti de manière très inégale. Des divergences avec la logique de la semaine des 2 x 25 heures doivent certes être possibles, mais elles doivent avoir un coût.
La répartition de tout le travail nécessaire à la société est finalement un élément important d'une politique sociale conçue comme un tout. La grande répartition tient compte par exemple des revendications suivantes :
. Elimination de la discrimination à l'encontre du travail non rémunéré et des femmes; . lutte contre le chômage et son effet stigmatisant; . possibilité d'intégration dans tous les processus sociaux et économiques; . grande indépendance financière de la plupart des gens, qui parviennent à couvrir leurs besoins eux-mêmes grâce au travail rémunéré.
Le partage du temps devrait pouvoir être conçu en général de manière plus flexible. Ainsi, chacun, chacune, a du temps pour gagner sa vie, s'occuper de ses parents, faire le ménage, se former, se cultiver, faire de la politique, etc, et finalement avoir du temps libre.
La voie à suivre : Créer des incitations
7. La voie vers la répartition passe par des incitations, et non par la contrainte
Comme la surexploitation de la nature, la forme actuelle de la répartition du travail entraîne également des coûts et des désavantages. Si les coûts pour la répartition actuelle du travail apparaissent dans les "coûts provoqués", la société se dirigera automatiquement en direction de la répartition : personne ne peut se payer plus longtemps l'actuelle répartition du travail. Les coûts que doivent supporter la société et particulièrement les femmes et les chômeurs et chômeuses sous forme d'inconvénients, doivent devenir les coûts de ceux qui continuent à défendre l'actuelle répartition (ceux qui offrent et demandent des durées plus longues du travail, ceux qui ne se préoccupent pas le moins du monde du travail non rémunéré).
On parle donc ici d'un système d'incitations économiques comme moyens de parvenir à une grande répartition du travail. Des incitations économiques existent déjà, mais elles vont dans le mauvais sens. Ces incitations sont telles qu'elles provoquent des inconvénients économiques pour les personnes professionnellement actives qui réduisent leur durée du travail à titre individuel, bien que cela soit profitable à l'ensemble de la société (chômage plus faible) et rende possible également un autre partage du travail non rémunéré. Il s'agit donc d'un système qui invertit le système actuel : un système d'incitations qui fait des coûts et des avantages sociaux des coûts et des avantages individuels.
Une durée hebdomadaire du travail rémunéré entre 20 et 30 heures et une durée correspondante de travail non rémunéré maximalise l'utilité sociale. Un modèle d'incitations économiques doit être taillé sur ce modèle d'utilisation du temps. On doit établir ainsi une nouvelle normalité du travail à plein temps et de la répartition du travail. Des différences sont possibles dans ce modèle (par ex. des durées du travail rémunéré plus longues), mais elles sont liées à des coûts et à des désavantages. Cela va exactement dans le sens contraire de ce que l'on fait aujourd'hui, où la réduction de la durée du travail par exemple est liée à des coûts, resp. des désavantages.
Le "bonus pour travail miyte", qui est décrit en détail dans l'annexe (ci-dessous), constitue un modèle qui correspond largement aux exigences de ce nouvel ensemble d'incitations.
Le fait de résoudre la répartition du travail par des incitations économiques changées comporte d'autres avantages majeurs :
a) Ce sytème laisse fondamentalement à tous la liberté de répartir au choix leur temps.
Il y a ici des besoins très différents selon les circonstances. Il ne peut donc pas y avoir de modèle unique. Les coûts pour les divergences avec la normalité en durée et en répartition du travail sont pris en compte, si l'utilité individuelle de la divergence est considérée comme suffisamment élevée. Les diverses brancges et les différents processus de fabrication ont aussi des besoins divers en temps; ces différences avec la normalité actuelle doivent être payées. Cela signifie qu'un nouveau système d'incitations privilégie une certaine répartition de la durée et du travail, mais maintient par ailleurs toute la palette des divers besoins. Des durées du travail fixées de manière rigide ne permettent justement pas cela et elles ne devraient par conséquent plus guère persister.
b) On fait souvent valoir l'argument que tel ou tel processus de travail ne serait pas compatible avec une durée du travail réduite ou que tel ou tel poste ne pourrait pas être partagé.
Dans un système d'incitations avec la nouvelle normalité proposée, des divergences seront pratiquées dans de tels cas aussi longtemps que leur utilité est considérée comme grande. Mais cela ne durera probablement pas. La pression sur les coûts conduit finalement à ce que les procédures et les emplois soient structurés de telle sorte qu'ils correspondent à la nouvelle normalité de la durée et de la répartition du travail. On met ainsi en marche un changement structurel qui s'adapte à la nouvelle normalité.
8. Il faut aussi un environnement social et économique qui favorise ou rend possible la répartition,à côté des incitations directes.
Pour engager la grande répartition décrite ci-dessus, il faut d'autres changements à côté des mécanismes d'incitations, comme par exemple :
. une harmonisation des systèmes fiscal, d'assurances sociales et des caisses de pension avec la nouvelle normalité de durée du travail rémunéré et de répartition du travail; . une meilleure infrastructure du domaine non rémunéré (ainsi par exemple un développement des écoles à horaire continu et des crèches); . un système d'éducation et de formation permanente largement développé, ouvert à tous.
Quant à savoir quels sont les effets de la réduction de la durée du travail sur les revenus individuels, cela dépend s'ils sont liés ou non à l'évolution de la productivité :
1. Les gains de productivité indiquent dans quelle mesure les salaires peuvent augmenter sans provoquer des charges plus élevées pour les entreprises.Le gain de productivité peut être payé sous forme d'une augmentation de salaire (avec une durée du travail restant la même) ou sous forme d'une réduction de la durée du travail (avec un salaire restant le même). Si l'on part de l'idée que le gain de productivité se situe à 2 % par année (ce qui devrait être réaliste), la durée hebdomadaire du travail se situerait en moyenne déjà à 28,3 heures en l'an 2015, et ceci avec un salaire réel 1995 de 42 heures de travail rémunéré par semaine.
2. Si la répartition du travail et les réductions de la durée du travail qui y sont liées ne devaient pas tenir compte des gains de productivité, il faudrait alors trouver d'autres mécanismes qui amortiraient au besoin des pertes de revenus.Si les augmentations de salaire sont à l'avenir "payées" en réductions de la durée du travail, les gains de productivité accroissent de toute façon la marge de manoeuvre à moyen terme. Le bonus pour travail mixte présenté en annexe montre quelques mécanismes de compensation possibles.
On peut en imaginer d'autres :
. Meilleure compensation des charges de famille :
dans la logique de la semaine de 2 x 25 heures, il est important que le montant des allocations familiales couvre les frais effectifs pour les enfants au moins dans les ménages à revenus modestes. On aubmenterait ainsi considérablement la marge de manoeuvre nécessaire à une répartition égalitaire du travail. Le bonus pour travail mixte contient à vrai dire déjà des éléments importants d'une compensation améliorée des charges familiales, mais des réformes fondamentales du système actuel de compensation des charges familiales sont en plus nécessaires.
. La garantie d'une assurance de base complémentaire pour toutes les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle :
L'intégration dans la société est tout aussi importante que la sécurité matérielle de l'existence; c'est pourquoi la répartition du travail a la priorité sur le RMG (Revenu minimum garanti). Mais il faut les considérer comme complémentaires. Un RMG perd certes de son importance si l'on réalise la semaine des 2 x 25 heures, mais il reste une partie importante d'une sécurité sociale d'ensemble. Même une répartition égalitaire du travail ne pourra pas empêcher que certains ne parviendront pas à garantir leur existence avec le travail rémunéré et qu'ils tomberont au travers des mailles du système des assurances sociales, orienté selon le principe de la causalité.
La répartition obtenue au moyen d'une réduction de la durée du travail rémunéré a finalement des effets d'économie importants :
Ils consistent en une diminution des coûts du chômage. Les coûts de l'assurance-chômage se réduisent massivement dans l'immédiat, de même que ceux de l'aide sociale (ou de l'assistance), de l'assurance invalidité comme également les coûts pour les programmes de soutien à l'emploi. A plus long terme, ce sont aussi tous les coûts indirects du chômage (comme par exemple du système de santé, de l'agitation sociale et de l'instabilité politique) qui tendent à diminuer.
Conclusions
Les heures de travail à accomplir dans la société ne diminuent guère au moyen des réductions générales de la durée du travail. Les heures qui échappent au travail lucratif à cause de la réduction peuvent alors être accomplies par d'anciens chômeurs et chômeuses et par des gens qui veulent travailler à nouveau. L'ensemble du travail lucratif de la société ne diminue pas, mais il est réparti sur davantage de gens. Il n'en résulte donc aucun préjudice pour la capacité de production de la société -au contraire.
Annexe : Le double bonus de travail
(résumé repris du rapport final)
1. La bonification pour travail lucratif
Principe
(...) on prélève une même taxe en % sur la masse des salaires AVS auprès de toutes les entreprises. La somme totale est entièrement restituée aux entreprises, mais la rétrocession est mesurée d'après la réduction de la durée du travail réalisée dans les faits. Ce qui est important, avec l'idée de l'incitation, c'est que les prix relatifs entre les durées du travail les plus courtes et les plus longues doivent être modifiées en faveur des durées les plus courtes; le travail dans l'ensemble devait cependant rester aussi cher pour les entreprises. Le bonus pour travail lucratif disparait lorsque la durée moyenne habdomadaire du travail de l'ensemble de l'économie a atteint 30 heures.
Application
Le bonus pour travail lucratif peut être conçu de manière transparente et peu coûteuse sur le plan administratif. Cela signifie que chaque acteur particulier peut le calculer sans frais. Les différenciations doivent intervenir dans toute la mesure du possible lors de la rétrocession, car les frais administratifs pour les entreprises qui n'ont pas droit à la rétrocession sont ainsi minimisés, alors qu'on peut attendre de celles qui ont droit à une rétrocession qu'elles assument ces frais.
Réglementation du prélèvement : un pourcentage fixe de la masse des salaires AVS doit être versé à la "caisse du bonus" sur la base de la comptabilité de l'entreprise, comme c'est le cas pour l'AVS.
Réglementation de la rétrocession : chaque entreprise qui veut obtenir une rétrocession du bonus annonce à la fin de l'année la durée habituelle du travail, les durées du travail fixées par contrat particulier ainsi que le nombre total d'heures supplémentaires accomplies. On peut à partir de là calculer facilement le nombre d'heures donnant droit au bonus; chaque contrat de travail avec une durée du travail contractuelle fixée au-dessous de la durée normale du travail dans l'ensemble de l'économie fournir le nombre d'heures donnant droit au bonus en fonction de la différence avec la durée normale du travail. Toutes les heures donnant droit au bonus sont additionnées et le nombre d'heures supplémentaires multiplié par deux est déduit. La somme totale des taxes est divisée par la somme totale des heures donnant droit au bonus et le montant correspondant par heure donnant droit au bonus est rétrocédé.
Différenciations possibles dans la réglementation de la rétrocession : le groupe de travail considère que les différenciations suivantes sont rationnelles, pour atteindre un effet aussi ciblé que possible :
- Si des heures donnant droit au bonus proviennent du fait que la durée normale du travail de l'entreprise est inférieure à la durée normale moyenne du travail, elles seront comptées à double. On peut ainsi promouvoir plus fortement la réduction générale de la durée du travail dans l'entreprise que celle qui est pratiquée individuellement (par l'extension d'emplois à temps partiel).
- Le bonus ne s'accroît plus au-dessous de 20 heures de travail hebdomadaires. On veut empêcher avec cette réglementation que le bonus récompense des contrats pour de petits travaux.
- Pour qu'un contrat de travail donne droit au bonue, il doit remplir des conditions minimales (concernant le salaire horaire et la sécurité sociale), afin qu'on n'encourage pas des emplois précaires. D'une manière générale, on devrait faire en sorte que le droit au bonue dépende du fait que le contrat de travail est protégé par convention collective (dans l'économie privée). Les contrats de travail temporaire n'ont pas droit au bonus. Pour des contrats de travail qui n'ont pas duré toute l'année, on calcule le nombre d'heures donnant droit au bonus pro rata temporis.
- Les entreprises dont le nombre habituel d'heures de travail est supérieur de plus d'une heure à la durée normale moyenne du travail n'ont d'une manière générale pas droit au bonus. On veut éviter avec cette réglementation que des entreprises ne divisent leur main d'oeuvre en deux catégories, l'une travaillant à plein temps avec une durée du travail supérieure à la moyenne et l'autre formée de travailleur-euse-s à temps partiel (pour s'assurer la rétrocession).
Traitement des très petites entreprises : les très petites entreprises (jusqu'à 4 employé-e-s) sont à traiter différemment, puisque leurs possibilités de réduire la durée du travail (par exemple par le partage d'un poste de travail) sont limitées. De telles entreprises peuvent soit être totalement exclues du système du bonus de travail lucratif, soit être libérées du versement des taxes.
Taux de taxation et montant du bonus
2. Le bonus pour travail mixte

Taux de taxation et montant du bonus
Un bonus de travail lucratif de 1 % de la masse salariale rapporte environ 2 milliards de francs pour l'ensemble de l'économie. Si l'on ne tient pas compte des différenciations (bonus différencié pour réduction générale du nombre d'heures habituelles ou réduction individuelle, déduction des heures supplémentaires, contrats de travail non calculables), il en résulte un bonus d'environ 150 francs par heure y donnant droit.
Deux considérations sont importantes pour une fixation optimale du taux de taxation :
- Il faut première qu'eucune entreprise ne soit menacée. Nous partons de l'idée qu'une charge supplémentaire de 3 % de la masse salariale AVS est supportable (les charges supplémentaires qui résultaient ces derniers temps du cours élevé du franc suisse représentent un multiple de cela).
- Il faut deuxièmement créer une incitation suffisante pour la réduction de la durée du travail. Nous considérons comme un ordre de grandeur raisonnable l'attribution d'une décharge de 20 à 30 % aux entreprises qui passent complètement à la semaine des 25 heures.
Ces considérations parlent en faveur d'une fixation du bonus de travail lucratif à environ 3 % de la masse salariale. Cela signifierait qu'une rétrocession de 450 francs serait faite par heure donnant droit au bonus (si nous faisons abstraction des différenciations). La charge supplémentaire maximale pour les entreprises sans heures donnant droit au bonue se situe à 3 %. Pour une entreprise qui a complètement réalisé la semaine des 25 heures, le bonus net peut être évalué à environ 25 %.
Ces considérations chiffrées sont naturellement des données très provisoires. De manière générale, la fixation préalable correcte sera difficile. Mais le bonus de travail lucratif représente à ce titre le grand avantage qu'il peut être amené progressivement sans grand problème à une hauteur optimale.
2. Le bonus pour travail mixte
Comme l'ont montré les considérations sur la forme de la régulation du travaul lucratif et du travail non lucratif, il sera beaucoup plus difficile d'entreprendre des régulations ciblées dans le domaine du travail non lucratif. Compte tenu de la diversité des situations dans les ménages et des différences dans les possibilités de prendre des décisions, il n'est pas possible de trouver un mécanisme efficace visant de manière continuelle à la semaine des 25 heures, et valable pour tous les ménages. Il faut le courage d'une forte simplification; un appui n'interviendra au début que pour un groupe relativement petit, qui correspond déjà à l'idéal de la semaine de 25 heures.
Principe
De manière analogue au bonus pour travail lucratif, on prélèvera une taxe auprès des ménages avec le bonus pour travail mixte. Afin d'obtenir un effet de compensation sociale et de rendre réellement possible le modèle des 25 heures pour les personnes à bas revenus, la taxe ne devrait pas être uniforme, mais calculée sous la forme d'une majoration de l'impôt fédéral direct. Nous sommes partis d'une majoration de l'ordre de plus de 15 % sur le montant de l'impôt fédéral direct, ce qui conduit à un rendement d'environ un milliard de francs. Cette somme est payée en parts égales à toutes les personnes qui vivent dans le cadre du modèle des 25 heures (entre 20-30 heures de travail lucratif, au moins 20 heures de travail non lucratif). Si le nombre d'ayant-droit augmente, il faut augmenter le taux de taxation de telle sorte que la fonction de compensation pour les faibles revenus puisse être remplie de manière suffisante. Le bonue pour travail mixte disparait lorsque la durée hebdomadaire moyenne du travail atteint 30 heures.
Application
Réglementation du prélèvement : le prélèvement se fait en même temps que le prélèvement de l'impôt fédéral direct par les autorités fiscales, qui remettent le montant à la "caisse du bonus".
Règlementation de la rétrocession : les personnes qui y ont droit doivent demander le versement auprès de la "caisse du bonus" (caisses de compensation AVS). Les ayant-droit sont
- Les personnes seules qui accomplissent au maximum 30 heures hebdomadaire de travail lucratif et qui ont ou bien un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, ou qui exercent une activité non lucrative calculable et externe à la famille d'au moins 20 heures hebdomadaires (activités reconnues selon un catalogue à établir);
- Chaque membre d'un couple, lorsque chacun d'eux a au maximum 30 heures hebdomadaires de travail lucratif et qu'ils ont des enfants de moins de 16 ans. S'il n'y a pas d'enfants, le droit aux prestations est personnel comme c'est le cas pour les personnes seules lorsqu'elles peuvent prouver qu'elles exercent une activité non lucrative calculable et externe à la famille d'au moins 20 heures hebdomadaires.
Cette façon d'apporter une preuve présente l'avantage de se fonder uniquement sur l'importance du travail lucratif (qui découle du certificat de salaire complété du taux d'occupation) et sur le travail gratuit accompli à l'extérieur de chez soi (qui peut être confirmé par des tiers). Pour les couples où tous les deux ont une activité lucrative é temps réduit, ils sont soumis à la condition qu'ils se répartissent le travail de garde. La pression à une répartition égale pourrait être renforcée par le fait qu'il serait possible de réclamer la restitution du bonus aux personnes dont on pourrait prouver après coup qu'elles n'ont pas accompli leur part du travail de garde (une certaine pression préventive peut ainsi s'exercer en vue d'éventuels divorces).
Montant du bonus
Nous partons pour nos calculs de 140'000 ayant-droit et d'un montant total de bonus d'un milliard de francs par année. Un bonus pour travail mixte représente ainsi environ 600 francs par mois (le double pour un couple).
Sur la base de Jobin (1995) et de l'OFS (1994), nous parvenons aux ordres de grandeurs suivants pour les groupes de personnes qui auraient actuellement droit au bonus : personnes élevant seules des enfants (environ 100'000), personnes seules sans enfant qui accomplissent du travail non lucratif calculable (un très petit nombre actuellement), ménages de couples dans le cadre de la logique des 25 heures (au maximum 20'000 couples, c'est-à-dire 40'000 ayant-droit).
Conséquences
Dans cette conception du bonus pour travail mixte, la perte de salaire devrait plus ou moins être compensée pour les personnes à faibles revenus; dans certains cas particuliers (personne seule élevant des enfants et travaillant à temps partiel), elle serait même plus que compensée. On dédommagerait ainsi également une part des charges dues aux enfants, la société participant aux coûts de garde sous la forme du bonus pour travail mixte. Concernant le taux du prélèvement sur l'impôt fédéral direct, celui-ci devra être relevé peu à peu, afin de continuer à remplir la fonction de compensation du revenu alors que le nombre d'ayant-droit au bonus s'accroîtra. Il faut ici tenir compte que le nombre de personnes élevant seules des enfants ne va guère changer à la suite de l'introduction du bonus pour travail mixte. Si le nombre de couples ayant droit au bonus se multiplie par cinq, le maintien du même montant de bonus nécessiterait au moins une taxe double, c'est-à-dire au moins 30 %. Comme la durée normale du travail (avec le même salaire réel) devrait continuellement diminuer, en raison du bonus pour travail lucratif, la perte de revenu du travail devra s'amoindrir au fur et à mesure qu'on passera à la semaine de 2 x 25 heures. Malgré tous les impondérables des futurs développement, on peut donc s'attendre à ce que le taux de prélèvement ne dépasse pas 30 %.
Monde du travail et emploi : bref tour d'horizon
Informations relatives à la problématique abordée dans le document "Travail et pouvoir d'achat pour toutes et tous", soumis au congrès du PSS de 1999
Salaires et revenus
Les années 90 ont été marquées par une redistribution massive du revenu et de la fortune au profit des classes les plus aisées, qui s'est accompagnée pour une grande part de la population d'une perte de pouvoir d'achat. Il faut ajouter à cela le fait que le taux de consommation des personnes à revenus élevés est plus faible que celui des personnes modestes et que les personnes aisées placent en bourse une proportion de leurs revenus qui va croissant. La retenue des consommateurs a ainsi représenté un frein supplémentaire pour le développement conjoncturel.
Durant cette période, les salaires réels moyens ont stagné, quant ils n'ont pas légèrement reculé, même si l'on observe par ailleurs une légère amélioration des salaires des femmes par rapport à ceux des hommes. Mais, simultanément, on note un nouvel accroissement de l'écart entre les hauts et les bas revenus. Ce sont surtout les cadres qui profitent de la forte tendance à individualiser les salaires (salaire au mérite, bonus etc.). En 1999 également, malgré une croissance de la masse salariale estimée à un pour cent, cette tendance ne faiblira pas. L'évolution de la situation est cependant très différente d'une branche à l'autre. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le tableau apparaît encore plus sombre lorsque l'on prend en considération le fait que les primes d'assurance-maladie, qui ces dernières années ont littéralement explosé, ne sont pas prises en compte dans l'indice des prix à la consommation et que, pour ces trois dernières années, on a ainsi sous-estimé le renchérissement, qui en réalité a dépassé de 2,3 % les indices officiels.
(Facts 2/1999) Ce sont au moins 5 milliards de FS que l'on a ainsi soustrait aux rentiers et aux salariés ! Il faut ajouter à cette somme 11,2 milliards de francs qui auraient dû être rendus aux locataires à la suite des baisses des taux hypothécaires et qui leur ont été confisqués depuis 1990. En 1998 seulement, grâce à un taux d'intérêt réel qui, sur le marché des hypothèques, n'a jamais été aussi élevé, les banques ont fait un bénéfice supplémentaire d'environ 8 milliards de FS (cf SonntagsZeitung du 13.12.1998).
Il est vrai que c'est le système de calcul qui entraîne cette sous-évaluation, puisque l'indice mesure l'évolution des prix et non pas les dépenses effectives des ménages.
En parallèle, l'augmentation massive de la productivité et des gains ne profite pratiquement plus à la grande partie des salariés, même pas sous la forme de réductions du temps de travail. Seulement depuis 1996, les gains sur les entreprises cotées en bourse ont doublé, atteignant 36,1 milliards de FS, et ils devraient encore dépasser le niveau des 50 milliards d'ici l'an 2000. Depuis 1991, la valeur des actions suisses a quadruplé. En 1997, la croissance de la capitalisation des entreprises cotées en bourse a, pour la première fois en Suisse, dépassé le revenu de l'ensemble des salariés en atteignant près de 300 milliards de francs et, entre janvier et novembre 1998, cette croissance s'est encore élevée à 100 milliards de francs, malgré les crises financières. Cette situation correspond à une tendance qui se manifeste au niveau mondial, à la stagnation des revenus du travail accompagnée d'une croissance des revenus du capital. Mais il faut encore ajouter que les bénéficiaires de ces derniers -contrairement aux salariés- disposent d'une large palette de procédés, légaux ou illégaux,, leur permettant de se soustraire à l'impôt (voir par exemple l'absence d'une imposition des gains en capitaux).
C'est aussi au chapitre de l'accroissement de l'écart entre hauts et bas revenus* qu'il faut mentionner les "travailleurs paupérisés" (working poor) qui, bien qu'ils travaillent à plein temps, reçoivent un salaire qui ne leur permet pas de vivre décemment et dépendent donc eux aussi de l'aide sociale : en Suisse, plus de 200'000 personnes sont dans cette situation. Face à la revendication d'un salaire minimal assurant les besoins de vase, les partis bourgeois et les employeurs proposent un postulat en faveur de salaires combinés : l'Etat complèterait ainsi les salaires les plus bas jusqu'à ce qu'ils atteignent le minimum vital. Mais un tel modèle, qui généraliserait les mesures d'assistance, conduirait certainement à une vaste sous-enchère salariale, qui produirait une chute constante des salaires et érigerait en règle le subventionnement des entreprises au moyen des revenus du fisc.
* D'après une étude effectuée part le Professeur Flückiger de l'Université de Genève, sur mandat de l'USS, la proportion de salaires extrêmement bas (moins de 30'000 FS par année) est demeurée pratiquement constante de 1991 à 1997. En revanche, dans la m'eme période, les salaires annuels situés entre 30'000 et 40'000 FS, qui restent très modestes, se sont multipliés. A l'autre bout de l'échelle, le nombre des hauts salaires a augmenté.
Le marché du travail en Suisse et le chômage dans les années 90
Les années 90 ont amené en Suisse une croissance du chômage d'une rapidité surprenante. Dans la dernière décennie, 17,8 % des personnes actives ont été inscrites au moins une fois auprès d'un office du travail. Bien que, ces derniers temps, le nombre des chômeurs enregistrés comme tels ait considérablement reculé (en novembre 1998, il ne se montait plus qu'à 188'500 personnes) et bien que la Suisse, comparée aux autres pays européens*, fasse encore relativement bonne figure, on ne saurait proclamer la fin de l'alerte. Ainsi, cette année et l'année prochaine ce seront chaque mois entre 3000 et 3500 chômeurs qui perdront leur droit aux prestations. La proportion de personnes en quête d'emploi s'élevait encore, en septembre 1998, à 6 % avec 218'000 personnes. De plus, les différentes régions du pays continuent d'être touchées par le chômage de façons très différentes.
* A la fin novembre 1998, le taux de chômage de la Suisse s'élevait à 3,3 %. Il se situait en moyenne à 9,8 % dans l'UE et à 10,8 % dans la zone euro. On trouvait les taux les plus bas au Luxembourg (2,1 %), aux Pays-Bas (3,6 %), au Danemark (4,2 %) ainsi qu'en Autriche et au Portugal (4,4 %). Le taux était de 10,2 % en Allemagne et c'était en Espagne qu'il était le plus élevé avec 18,2 %. En tout, on comptait dans l'UE 16,5 millions de chômeurs recensés par les statistiques.
Les causes principales
Entre 1991 et 1996, la récession a entraîné une croissance pratiquement nulle du produit intérieur brut réel. De plus, avec une augmentation moyenne de la productivité de 1 à 2 %, on a besoin d'un travail toujours moindre pour le même niveau de production. A ceci s'est ajoutée une modification structurelle de l'importance respective des secteurs et des branches de production. Enfin, contrairement à ce qui s'est passé durant la récession des années '70, on ne peut plus aujourd'hui exporter une partie aussi importante du chômage en renvoyant chez eux les travailleurs étrangers.
Les principales tendances
Le taux d'emploi global a connu entre 1991 et 1997 une baisse de 3 %. Quant au nombre d'heures de travail fournies (le volume de travail), il a diminué d'environ 4 %; cet écart s'explique par une plus grande proportion de personnes employées à temps partiel, en particulier parmi les femmes. Le recul de l'emploi a particulièrement frappé le secteur secondaire (industrie et bâtiment), les hommes, les personnes de nationalité étzrangère, les jeunes de 15 à 24 ans, de même que la Suisse romande et le Tessin. La part des salariés peu qualifiés a légèrement augmenté par rapport à l'occupation globale.
Dans l'ensemble, on peut dire que la moitié de l'augmentation des personnes en quête d'emploi constatée entre 1991 et 1997 ne provient pas d'une hausse du nombre des chômeurs, mais de l'apparition sur le marché du travail de nouvelles personnes, en quête d'une occupation rémunérée. Il y a parmi elles surtout des femmes, des personnes de nationalité étrangère et des personnes entre 40 et 54 ans. En revanche, les hommes, les résidants de la Suisse romande et les jeunes de 15 à 24 ans se sont retirés du marché du travail.
Depuis 1997, avec le redressement conjoncturel et la croissance économique qui l'accompagne, la situation s'est quelque peu détendue. Même si le nombre des sans-emploi dépasse encore la cote des 200'000, le nombre des personnes actives ne se situait, en automne 1998, que très peu au-dessous du niveau de 1991, ce qui montre encore qu'une partie considérable des personnes en quête d'emploi est arrivée récemment sur le marché du travail.
Dans ces dix dernières années, la structure de l'économie suisse, considérée du point de vue de ses différentes branches, s'est fortement modifiée. Des branches traditionnelles telles que l'industrie des machines ont subi des pertes d'emplois considérables, alors que des branches de service telles que les secteurs de la santé, du social et de l'enseignement ont connu une forte croissance. En liaison avec cette évolution, on observe aussi une tendance à aller vers des entreprises plus petites. C'est ainsi qu'en 1995, 99,6 % des entreprises comprenaient moins de 250 postes complets et que 75 % de l'ensemble des personnes employées travaillaient dans ces entreprises. C'est d'ailleurs surtout dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME), et non pas chez les "acteurs globaux" avides de fusions, qu'ont été créées de nouvelles places de travail.
Avec la loi sur l'assurance-chômage actuellement en vigueur, on a créé des instruments nouveaux pour réinsérer les chômeurs dans le marché du travail : les mesures actives relatives au marché du travail et les offices régionaux de placement (ORP). On ne dispose cependant pas encore d'enquêtes approfondies sur leur efficacité.
Perspectives*
D'ici l'an 2000, l'emploi devrait progresser de 0,9 %, soit de 36'000 places de travail, et ce presque exclusivement dans le secteur des services. Le nombre des chômeurs devrait en m'eme temps diminuer de 35'000 personnes. Selon toute probabilité, ce seront presque exclusivement les Suissesses (Romandes et Tessinoises mises à part) qui en profiteront. Le nombre des personnes en quête d'emploi devrait se réduire à 189'000 personnes d'ici l'an 2000. Le problème des chômeurs de longue durée et de ceux qui n'ont plus droit aux prestations devrait encore s'aggraver.
*Etude de l'institut de recherches conjoncturelles KOF, de l'EPFZ, sur mandat de l'OSEO, du 16.11.1998
Chômeurs, personnes sans emploi et demandeurs d'emploi
Outre la statistique des chômeurs de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) qui recense les chômeurs enregistrés auprès des offices du travail, on dispose d'une statistique des sans-emploi établie par l'Office fédéral de la statistique.
D'après les normes internationales, les sans-emploi sont des personnes qui : a) n'exerçaient pas d'activité professionnelle dans la semaine de référence, b) avaient recherché activement un travail dans les quatre semaines précédentes et c) étaient en mesure de commencer une activité rémunérée dans les quatre semaines suivantes. Les chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations en font donc partie, de même que les femmes au foyer qui souhaitent reprendre une activité professionnelle après s'être consacrées à leur famille. Les chiffres correspondant à cette définition sont rassemblée chaque trimestre dans l'Enquête suisse sur la population active (ESPA). Dans le deuxième trimestre de 1998, 142'000 personnes étaient sans emploi selon cette définition, représentant un taux de 3,6 %.
Cependant, même cette statistique des sans-emploi ne tient pas compte des personnes qui vivent de "petits boulots" ou d'un travail provisoire, de celles qui travaillent dans le cadre d'un programme d'occupation (il y a environ 34'000 places de travail dans le cadre des programmes d'occupation) ou suivent un programme de perfectionnement. Si l'on tient compte de ces personnes, le taux des demandeurs d'emploi s'élevait en 1998 à 6 % de la population active, soit 218'000 personnes. En août 1997, ils étaient 250'000, soit 6,9 % de la population active.
Le travail non rémunéré
On sait qu'à côté du travail rémunéré, il existe un travail non rémunéré, qui est en grande partie accompli par les femmes. Une étude de la "Wochenzeitung" (l'étude a pris en considération la population entre 18 et 61/64 ans) estime (pour 1996) qu'en Suisse les femmes fournissent en moyenne 31,9 heures par semaine de travail gratuit et les hommes 10,9. Si l'on additionne ce travail au travail rémunéré, on constate que pour le travail nécessaire au fonctionnement social chaque femme effectue en moyenne annuelle 1580 heures de travail, alors que chaque homme en fournit 2339. Converti en monnaie, le travail gratuit accompli par les femmes représente bien 120 milliards, ce qui correspond à un tiers du PIB, celui des hommes se montant à 42 milliards de francs.
Une autre enquête de l'Office fédéral de ls statistique, "Unbezahlte Arbeit im Rahmen der Schweizerischen Arbeitkräfteerhebung 1997 / Unpaid Work within the framework of the Swiss Labour Force Survey 1997" (juillet 1998) distingue différents types de travail non rémunéré et tient encore compte des différents groupes d'âge, mais il n'est pas possible de comparer directement ses résultats chiffrés avec ceux de l'enquête de la WoZ. Elle montre que dans le domaine des travaux ménagers et du travail non institutionnel et dehors du ménage, les femmes fournissent un temps de travail nettement plus important que les hommes. On est dans la situation opposée en ce qui concerne les activités honorifiques et bénévoles qui sont souvent accompagnées d'un plus grand prestige.
Les personnes actives*
Entre l'été 1991 et l'été 1997, le nombre des personnes actives a diminué de 117'000 unités, soit près de 3 %. Les Suisses ont été touchés par ce recul à raison de 2000 unités, alors que parmi les étrangers on compte 115'000 personnes actives en moins (surtout des travailleurs saisonniers ou frontaliers). Le secteur secondaire a encore perdu une partie de ses travailleurs (-208'000). En revanche, le secteur tertiaire s'est accru de 85'000 unités, alors que les chiffres des personnes employées dans le secteur primaire sont pratiquement demeuré stables (+ 6000. cette légère croissance est une réaction à la récession. A long terme, le taux d'occupation dans le secteur primaire tend à baisser).
On a atteint le creux de la vague en 1994, avec 3'789'000 personnes actives. Au troisième trimestre 1998, on avait déjà atteint le niveau de 3'878'000 personnes actives, soit presque autant que le record de 1991, à savoir 3'891'000.
* Sont ici prises en compte toutes les personnes actives dans le pays qui ont une activité lucrative d'au moins 6 heures par semaine.
Les personnes actives par catégories socio-professionnelles
Entre 1997 et 1998 ce sont les cadres qui ont connu la croissance la plus forte (plus de 20 %), suivis par les universitaires et les professions analogues (plus de 7 %). En ce qui concerne les employés de bureau et les employés de commerce, les hommes ont perdu du terrain (environ - 8 %), alors que les femmes ont légèrement progressé (à peine - 2 %). Les professions techniques ont connu un léger recul (environ - 2 %). Dans le personnel agricole qualifié, les femmes ont avancé de 8 %, alors que les hommes ont légèrement reculé (environ - 2 %). Ces chiffres montrent que les personnes bien ou très bien qualifiées sont fortement demandées sur le marché du travail.
La durée du travail
On sait que l'horaire de travail hebdomadaire moyen des entreprises est en Suisse un des plus élevés de l'OCDE et que, dans ces 5 dernières années, il est resté stable, à près de 41,9 heures*. En ce qui concerne l'horaire de travail moyen, en Europe seule la Grande-Bretagne dépasse (avec 1949 heures) le niveau de la Suisse (1848 heures)**. Du fait des taux de chômage élevés, il y a longtemps que, dans toute l'Europe, on a commencé à discuter de la réduction du temps de travail légal; dans ce domaine, la France fait manifestement figure de pionnière avec l'introduction de la semaine de travail de 35 heures. Il existe en outre une multitude de modèles et de projets de réduction du temps de travail, dont la nouvelle initiative populaire des syndicats. Mais les propositions de réduction générale du temps de travail continuent de se heurter à des résistances extrêmement fortes. Dans la pratique, on se dirige plutôt, en Suisse en particulier, vers une flexibilisation de l'horaire de travail -en partie individualisée- et vers un développenment du travail à temps partiel.
* Ces données sont rassemblées par le Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents (SSAA).
** Pour comparaison : Suède 1803 heures, Italie 1800 heures, France 1730 heures, Autriche 1721 heures, Allemagne 1687 heures et Pays-Bas 1661 heures.
Le volume du travail
Ces tendances sont confirmées par la statistique du volume du travail (Office fédéral de la statistique). Par rapport à 1991, on a effectué en 1996 207 millions d'heures de travail en moins (- 3.1 %). Pour cette période, on peut expliquer ce recul par la diminution des emplois à plein temps (- 153'000) et par l'augmentation des postes partiels (+ 56'000). En 1996, la proportion du volume général de travail fourni par des personnes travaillant à temps partiel a été de 14,5 %. La croissance du nombre des personnes actives parmi les femmes est à expliquer par le fait que le temps de travail moyen par personne employée s'est réduit plus fortement (- 4,2 %) que le volume du travail (- 3,6 %).
Les heures supplémentaires
Le volume actuel des heures supplémentaires a aussi légèrement reculé. Le sommet a été atteint en 1994, avec 174 millions d'^heures. En 1996, on comptait encore 148 millions d'heures supplémentaires : 127 millions ont été fournies par les salariés et 18 millions par les indépendants, qui ont aussi des horaires de travail annuels plus élevés que les salariés. Un calcul approximatif nous montre que les heures supplémentaires effectuées représentent environ 75'000 postes de travail à plein temps.
Qualification et capital humain
La globalisation et l'introduction de nouvelles technologies ont entraîné un développement de la demande de travailleurs qualifiés. Avec l'accès aux nouvelles technologies, la qualification des travailleurs est le facteur décisif qui détermine le succès de l'économie d'un pays. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail a consacré à ce thème son rapport sur le travail 1998-99. Elle recense six raisons essentielles qui expliquent pourquoi l'investissement dans l'éducation et la formation a une telle importance :
- La libéralisation politique et la démocratisation des sociétés nécessitent un fondement solide.
- L'accélération des changements technologiques exige une formation toujours meilleure et un constant perfectionnement.
- Du fait de la globalisation et du durcissement de la concurrence, un pays n'a de chances de succès que si sa population est dotée des connaissances requises par cette situation.
- Une éducation de qualité et une bonne formation empêchent que des personnes soient exclues de la société.
- L'absence de qualifications représente un goulot d'étranglement pour la création de nouvelles places de travail (c'est par exemple déjà le cas, en Suisse, dans la branche des télécommunications).
On peut constater à quel point le "destin" individuel dépend de la qualification professionnelle en observant les différentes interdépendances qui se manifestent dans la croissance économique. Dans 19 pays de l'OCDE, un recul de 1 % du produit intérieur brut (PIB) a entraîné un accroissement du chômage des travailleurs non qualifiés de près de 23 %. En revanche, le taux d'emploi des personnes qualifiées est demeuré stable. Lorsqu'au contraire le PIB a augmenté, le chômage a baissé de 4,8 % chez les personnes non qualifiées et de 2,1 % chez les travailleurs qualifiés. Ces résultats ne sont pas fondamentalement différents chez les femmes et chez les hommes. Les travailleurs non qualifiés ne sont donc pas seulement exposés au danger de tomber plus rapidement au chômage : d'une façon plus générale, ils sont plus exposés aux fluctuations conjoncturelles. On le constate également en observant la proportion de population active : en Suisse, celle-ci s'élevait en 1995 à 73 % pour les personnes sans formation postscolaire, à 83 % pour les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et à 90 % pour les titulaires d'un diplôme d'une haute école.
En général, les entreprises investissent aussi davantage pour la formation continue et le perfectionnement des travailleurs qualifiés. Pour ceux-ci, cet avantage est encore renforcé par la sûreté relative de leur place de travail. Au contraire, les personnes mal qualifiées ne sont pas seulement davantage exposées au chômage : elles risquent en plus de se déqualifier encore durant leur chômage. Il s'agit d'un sérieux problème, qui touche surtout les chômeurs de longue durée, ceux qui n'ont plus droit aux prestations, les travailleurs d'un certain âge, ainsi que les jeunes se trouvant au seuil de leur vie professionnelle, qui connaissent un taux de chômage nettement au-dessus de la moyenne et se voient ainsi dépossésés de leurs perspectives d'avenir, en n'ayant pas l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle.
Dans les entreprises, la nouvelle organisation du travail (îlots de production, groupes de travail autonomes, rotation des tâches, contrôles de qualité globaux, etc.) qui est souvent liée à un travail requérant des connaissances importantes, entraîne des exigences nouvelles en matière de qualification. Les travailleurs doivent être qualifiés dans les domaines-clés, polyvalents et plus indépendants qu'auparavant. Aux Etats-Unis, plus de la moitié des entreprises et des personnes actives travaillent déjà d'une façon ou d'une autre dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail.
Les Etats membres de l'OCDE ont donc entrepris de transformer et de développer massivement leurs systèmes nationaux de formation. L'OCDE observe que depuis 1990 la demande de formation va croissant. Le temps moyen de formation s'est élevé de deux ans. En parallèle, l'enseignement supérieur gagne en importance : dans la moitié des pays de l'OCDE, le nombre des étudiants inscrits dans une haute école ou dans une haute école spécialisée s'est accru de plus d'un tiers entre 1990 et 1996. Par ailleurs, la plupart des Etats ont augmenté leurs investissements dans le système de formation : la part des dépenses de formation par rapport au PIB est en croissance.
Mais en Suisse, une telle dynamique est grande partie absente. Certes, notre situation de départ est bonne : les 80 % de la population ont au moins fait un apprentissage ou terminé une école secondaire supérieure. En 1996, la Suisse a dépensé 6,76 % de son PIB pour la formation, se plaçant ainsi à la 3ème position derrière le Canada et le Danemark. Pourtant, le temps moyen de la formation est stagnant et, pour ce qui est des diplômes de l'enseignement supérieur, la Suisse se situe en comparaison internationale en milieu de peloton. Dans les conditions actuelles, ni les hautes écoles, ni les hautes écoles spécialisées ne seront en mesure d'augmenter substantiellement le nombre de leurs étudiants. Les dépenses réelles consenties par la Confédération pour la formation et la science sont en effet depuis quelques années pratiquement stagnantes. Ceci est d'autant plus incompréhensible que, depuis des décennies, les spécialistes suisses de la politique de la formation ne cessent d'insister sur le fait que pour notre pays -qui possède peu de richesses naturelles- la formation est la "matière première" la plus importante. Certes, quelques réformes sont en cours ou en préparation (réforme des heutes écoles, réforme de la formation professionnelle, réformes dans le domaine scientifique*), mais on est en droit de se demander si, avec l'actuelle obsession des économies, elles pourront apporter les innovations nécessaires.
On constate aussi dans le domaine de la formation professionnelle à quel point la situation est explosive. Il y a actuellement chaque année entre 8000 et 9000 jeunes qui ne commencent pas un apprentissage ou une autre formation postscolaire et la tendance est la hausse. Aujourd'hui, à 25 ans, 35 % des personnes actives ne travaillent déjà plus dans la profession qu'elles ont apprises. A 45 ans, on compte déjà 50 % de gens qui ont changé au moins une fois de profession. Or le système suisse de formation professionnelle n'est pas armé pour faire face à ces problèmes. Il est trop rigide et réagit trop lentement aux nombreuses évolutions du profil des professions, en particulier dans le secteur en croissance des services (problème de la "société de l'information"). D'une part, on forme des professionnels dont les qualifications ne sont déjé plus demandées sur le marché du travail et, d'autre part, on dispose de beaucoup trop peu de places de formation pour des professions où l'on constate un manque important de spécialistes (voir le domaine de l'informatique). De plus, en l'absence de programmes spéciaux de motivation et d'encouragement, les femmes se tiennent le plus souvent éloignées de ces professions d'avenir. Par ailleurs, alors que l'on exige aujourd'hui des travailleurs qu'ils ne cessent d'apprendre, tout au long de leur vie, il n'existe pas d'offre modulaire de formation continue et de perfectionnement qui corresponde à cette exigence. Dans ce domaine, la situation est souvent chaotique et embrouillés et on manque de diplômes garantis par la Confédération. Mais la situation des travailleurs non qualifiés, qui représentent près de 70 % des chômeurs de longue durée, n'est pas un défi de moindre importance. Il faut développer des projets pour une formation de rattrapage. La prochaine révision de la loi sur la formation professionnelle nous offre ici une grande chance à saisir.
Il est clair que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui de dormir sur nos lauriers. Même si, en comparaison des efforts fournis par l'UE, la Confédération n'est pas encore bien réveillés, elle a, elle aussi, élaboré des programmes d'action spécifiques pour préparer le passage à la société de l'information.
* Cf aussi le Message du Conseil fédéral relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2000 à 2003, du 25 novembre 1998. On prévoit jusqu'en 2001 une croissance réelle de niveau zéro.
Conclusions
Il est à prévoir que les problèmes et les défis que nous venons de décrire ne diminueront en rien, ni en nombre, ni en importance. On s'en persuade en particulier si, audelà de la Suisse et de l'Europe, on étend son regard au contexte global. Garantir un accès suffisant à un travail rémunéré couvrant les besoins de base et exercé dans des conditions dignes de l'homme : voilà qui restera des exigences fondamentales ! A long terme, une redistribution du travail lucratif et du travail non lucratif relève également de telles exigences. Un large accès au travail est une condition nécessaire de la sûreté de la société et de la participation des personnes -femmes et hommes- à la vie sociale, culturelle et politique; il détermine ainsi le développement de la démocratie et de la stabilité politique.
Promouvoir la répartition du travail lucratif entre toutes les personnes qui se présentent sur le marché du travail demeure donc une tâche primordiale pour tous ceux qui s'engagent pour plus de justice sociale. L'expérience montre qu'une croissance minimale de l'économie est nécessaire pour venir à bout du chômage. Il faudra qu'une telle croissance aille de pair avec une transformation de l'économie, la rendant compatible avec l'écologie, pour que nous laissions aux générations à venir un monde vraiment vivable. Sur ce point, nous n'en sommes qu'aux balbutiements.
En Suisse aussi, nous avons le devoir de renverser la distribution des revenus et des fortunes qui s'exerce actuellement au profit des plus riches. Pour que soient créées assez de places de travail, il faut en effet que la demande de biens et de services soit suffisante.
En même temps, il faudra changer les conditions-cadre et modifier les incitations fiscales, de telle façon qu'il soit de nouveau rentable d'investir dans l'économie réelle.
C'est dans le cadre du processus d'intégration européenne que les Suissesses et les Suisses pourront faire l'expérience la plus directe de l'intégration mondiale, dans toute sa diversité. Il faudra que la procédure de consultation sur les négociations bilatérales tienne compte des craintes réelles de la population, si l'onm veut que l'issue du scrutin populaire soit positive. Mais la notion de mesures d'accompagnement montre justement que, malgré les processus d'intégration et de globalisation, les Etats conservent, même dans leur politique de gestion du marché du travail, une marge de manoeuvre qu'il faut utiliser en corrélation avec la libre circulation des personnes. Cette dernière ouvrira des perspectives nouvelles également aux Suisses et Suissesses, qui auront ainsi la possibilité d'acquérir des qualifications dans de nouveaux contextes et d'élargir avec souplesse leur horizon : ils n'y trouveront pas seulement un enrichissement personnel, mais aussi des qualités qui sont toujours plus demandées sur le marché du travail.
L'introduction de l'euro représente un défi nouveau pour la politique de la Banque nationale. Il est aujourd'hui difficile de faire des pronostics clairs ; on peut cependant mentionner deux principaux dangers.
Premièrement : si l'euro est faible ou si l'on assiste à d'importantes variations des cours entre lui et les autres monnaies importantes, le franc suisse deviendra inévitablement une valeur-refuge. L'appréciation du franc qui en résulterait renchérirait nos produits d'exportation, freinerait la conjoncture et entraînerait une dégradation de la situation sur le marché du travail.
Secondement : si la Banque nationale réagissait en essayant de lier le franc à l'euro, les taux d'intérêt modestes de la SDuisse ne tarderaient pas à s'aligner sur les taux élevés de l'UE. Il en résulterait un renchérissement des hypothèques (et donc des loyers) et des crédits d'affaire, ce qui, au niveau économique, ne serait pas supportable. Mais la Banque nationale a une marge de manoeuvre suffisante pour combattre avec succès ces deux scénarios, au moyen d'une politique monétaire plus souple.
Il faudra aussi, à l'avenir, prendre un soi particulier à réintégrer les personnes qui ont été exclues du marché du travail -et, du même coup, de la société- et à leur offrir de nouvelles perspectives. Les expériences faites dans presque tous les pays montrent que ce ne sera pas une tâche aisée. Mais la stabilité sociale de la société de demain dépend du succès de cette intégration et peut-être même le fonctionnement de notre démocratie. Porter remède à cette situation signifie aussi briser une tendance qui, sous la pression de l'économie en voie de globalisation, conduit à la fracture sociale, avant que ne soient exclues d'encore plus larges couches de la population.
Bibliographie
*** Du travail, mais pas de salaire Le temps consacré aux tâches domestiques et familiales, aux activités honorifiques et aux activités d'entraide Office fédéral de la statistique, Neuchâtel. 1999 *** Evaluation monétaire du travail non rémunéré Une alanyse empirique pour la Suisse Office fédéral de la statistique Neuchâtel, 1999 Yann Moulier Boutang De l'esclavage au salariat PUF, Paris, 1998 Claude Bovay, Jean-Pierre Tabin Les nouveaux travailleurs : bénévolat, travail et avenir de la solidarité Labor et Fides, Genève, 1998 Claude Bovay, Jean-Pierre Tabin, Roland J. Campiche Bénévolat. Mode d'emploi Réalités sociales, Lausanne, 1994 Robert Castel Métamorphose de la question sociale : une chronique du salariat Fayard, Paris, 1995 Daniel Cohen Nos Temps modernes Flammarion, Paris, 2000 Viviane Forrester, L'horreur économique, Fayard, Paris, 1996 André Gorz, Misères du présent, richesse du possible Galilée, Paris, 1997 Mark Hunyadi, Marcus Mänz Le Travail refiguré Georg, Genève, 1998 Jacques Kergoat, Josiane Boutet, Henri Jacot, Danièle Linhart Le monde du travail La Découverte, Paris, 1998 Pierre Larrouturou La semaine de quatre jours La Découverte, Paris, 1999 Claude Leleux Travail ou revenu ? Editions du Cerf Béatrice Majnoni d'Intignano L'Usine à chômeurs Plon, Paris, 1998 Dominique Méda Le travail : une valeur en voie de disparition Aubier, Paris, 1995 (rééedition Flammarion) Parti socialiste genevois Le Partage du travail : une utopie ? PSG, Genève, novembre 1993 Parti socialiste suisse Une redistribution du travail Rapport du groupe de travail "Nouvelle répartition du travail" PSS, Berne, 1994 Parti Socialiste Suisse Travail et pouvoir d'achat pour toutes et tous Monde du travail et emploi : bref tour d'horizon PSS, Berne, 1999 Dominique Schnapper Contre la fin du travail Textuel, 1997 Union Syndicale Suisse Réduire le temps de travail : comment ? pourquoi ? Revue syndicale suisse, No 4, 1993
Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions

Cliquez ici pour participer à la liste Forum SocialisteCe site fait partie du Struggle, Solidarity, Socialism Webring dont la maintenance est assurée par
Socialist Sid .
Voulez-vous rejoindre le Struggle, Solidarity, Socialism Webring?[Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
 Votez
pour nous
Votez
pour nous