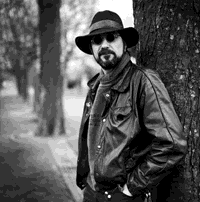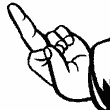

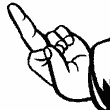

Les socialistes suisses entre Hausamann et Guisan

Le rôle de Hans Hausamann
Le Mouvement national de la Résistance
Haro sur la presse
Une économie de guerre pour gérer la pénurie
1940 : l’encerclement de la Suisse
La Suisse face à l’Allemagne : collaboration
ou vassalisation ?
Un pétainisme suisse
L’ « Organisation de fortune »
L’ « Aktion
nationaler Widerstand »
Les conciliabules entre le patronat et l’extrême-droite
Le Manifeste socialiste du 1er août 1940
1944 : Le Parti du Travail dresse l’acte
d’accusation
de la politique du Conseil fédéral
Les socialistes purent se targuer d’avoir joué un rôle essentiel dans la fondation d’un consensus « national », duquel seule l’extrême-droite sera finalement exclue puisque les communistes, malgré les interdictions qui les frappèrent, et malgré la proscription politique de leurs militants, rejoignirent ce « front républicain à la suisse » dès l’invasion de l’URSS par l’Axe.
Au lendemain de la défaite française de 1940, un groupe d’officiers et de personnalités civiles, dont des socialistes et des syndicalistes, constituèrent autour du capitaine Hans Hausamann, expert militaire indépendant auprès du PSS, un « Mouvement national de la Résistance » afin de « sauvegarder et défendre l’intégrité spirituelle et politique de la Confédération suisse ». En 1932, Hausamann avait été l’un des rares officiers à dénoncer le danger, pour la Suisse, du nazisme (alors même que les nazis n’étaient pas encore parvenus au pouvoir, et que la gauche, trop occupée à en découdre avec elle-même –la politique du Comintern aidant- sous-estimait gravement le péril). Dès la prise du pouvoir par Hitler, Hausamann organisera un véritable réseau d’espionnage, qu’il mettra, la guerre ayant éclaté, au service du général Guisan. Lorsque le PSS le mandera comme expert militaire en 1937, il acceptera à condition que « la défense du pays ne (soit) pas mêlée à des palinodies politiques » (cité par J.-B. Mauroux, Du bonheur d’être suisse sous Hitler, op.cit.biblio p. 140). Cette condition rencontrait le PSS au tournant, et fut acceptée avec d’autant moins de réticences que le parti avait déjà accepté de reconnaître la défense nationale comme un instrument possible de lutte contre le fascisme et le nazisme.
Le Mouvement national de la Résistance, créé le 7 septembre 1940, ralliera donc des socialistes notoires (Hans Oprecht, W. Allgower, E.-P. Graber), des intellectuels antifascistes (Karl Barth, William Rappard) et des militaires démocrates (ce que n’était pas, foncièrement Guisan) et « patriotes » (le pléonasme « officier patriote » n’est qu’apparent, ainsi que l’illustre le cas du colonel Wille et de ses amis), comme le major Robert Frick ou le capitaine Waibel. L’engagement pris par les membres du mouvement –un mouvement soutenu de facto par les deux plus grandes organisations ouvrières du pays- est à lui seul l’expression de la politique qui sera suivie par le PSS et l’USS durant les années de la « grande menace ». Cet engagement et cette politique contrastent fortement avec les hésitations, les prudences, les compromissions même d’une partie non négligeable de la droite, tous partis et toutes organisations patronales confondues, envers les régimes autoritairement réactionnaires qui de 1922 à 1939 couvrirent l’Europe d’une « toile d’araignée brune » ; le Mouvement national de la Résistance déclare :
ü (Nous prenons l’engagement) de défendre l’indépendance de notre pays, de lutter pour la liberté et le respect de la personne humaine, pour la sécurité de la communauté helvétique érigée sur des principes chrétiens, pour assurer du travail et du pain à chacun et de combattre chaque défaitiste, quel qu’il soit et où qu’il se trouve.
Des socialistes qui s’engagent à défendre les fondements « chrétiens » de la Suisse, des conservateurs qui s’engagent à mener une politique assurant le droit au travail : c’est bien d’un « esprit de la Résistance » dont il s’agit, avec tout ce que cela suppose d’œcuménisme politique, et ces « résistants » vont dès lors « s’attacher à fortifier l’esprit de résistance du peuple suisse », jusqu’au moment où, la défaite de l’Axe apparaissant inéluctable, apparaîtront les inévitables « résistants de la onzième heure », et où s’évanouiront les complaisances philonazies et philofascistes de la Suisse officielle.
Ainsi la Guerre Mondiale est-elle ce moment où le mouvement ouvrier suisse, s’engageant dans une nouvelle « Union Sacrée » (sans les erreurs de l’ancienne, et en répondant à une situation d’une toute autre nature), fait se rejoindre la Raison d’Etat (la défense de l’indépendance nationale) et la Raison solidaire du moment (l’antifascisme), pour finalement se retrouver « du côté de Guisan » contre « les capitulards ». Roland Ruffieux :
ü (En 1940) quelque chose d’ancien a fini, quelque chose de nouveau a commencé (…) Aussi l’année 1940 clôt-elle l’entre-deux guerres helvétique non par une défaite militaire mais par une espèce de mutation en profondeur (…) c’est bien à la solidité de la machine étatique, aux institutions de milice –y compris l’armée- que la Suisse doit d’avoir résisté finalement aux pressions de l’extérieur (…). Enfin, la neutralité a résisté aux formes, même les plus insidieuses, de la guerre totale. (…) la démocratie helvétique a résisté au millénarisme de l’ « ordre nouveau » qui paraissait s’imposer irrésistiblement en 1940. Le confort de l’égoïsme national est revenu après, avec le rétablissement d’un équilibre entre les belligérants, puis avec la suprématie croissante des adversaires du Reich (…) Alors la Suisse put retrouver le marginalisme confortable (de sa) neutralité.
Vision naïve, conformiste, alignée sur le discours officiel (celui d’une Suisse restée démocratique et résistant sans déchoir à la pression de ses voisins fascistes et nazis), certes : la réalité n’est pas si glorieuse, et l’un des secrets de la pérennité suisse entre 1940 et 1944 est sans doute à trouver dans les compromis passés avec les plus puissants –l’Axe jusqu’en 1943, les Alliés ensuite. Il n’empêche que l’Union Sacrée version 1940 a fonctionné jusqu’en 1945, et qu’elle a bien mieux fonctionné que celle de 1914.
L’année 1940 s’était ouverte, en pleine « drôle de guerre », sur une harangue patriotique de Guisan qui, le 1er janvier, au micro de la radio nationale, avait incité les Suisses à « tenir ». Pendant les cinq années qui vont suivre, le discours officiel sera tenu, alternativement, consécutivement, conjointement et parfois contradictoirement, par le gouvernement et par le Général : séparation des rôles, division du travail ? La postérité retiendra (elle sera d’ailleurs vigoureusement incitée à le faire) ce qui l’arrangera : l’image d’un général « résistant », d’un « De Gaulle suisse », face à un Conseil fédéral dont plusieurs membres étaient complaisants (des « Pétain suisses »). C’est ici, « à la suisse », la réussite de ce qui échouera (fort heureusement, du point de vue de la vérité historique) en France : la fabrication du mythe de « l’épée » (Guisan) et du « bouclier » (le Conseil fédéral). En France, le développement de la Résistance, le génie propre de De Gaulle, l’incompétence des « collabos » et la sénilité de Pétain réduisirent à néant la tentative de présenter De Gaulle et Pétain comme les deux faces d’une même médaille : le premier avait pris trop de risques pour accepter d’être en quoi que ce soit lié au second, qui avait trop accepté de l’occupant nazi, jusqu’à devancer ses désirs supposés en matière d’antisémitisme. Mais en Suisse, l’image perdurera –et perdure- d’un général porte-drapeau de la Résistance, de connivence avec un Conseil fédéral apparemment compromis avec les Etats voisins, mais rusant avec eux pour défendre l’indépendance nationale et la démocratie.
Pour le gouvernement fédéral, le temps de la guerre mondiale est d’ailleurs un temps de mutations, dont la moindre ne sera pas l’entrée d’un socialiste au sein du collège gouvernemental. Le 23 juillet 1940, Giuseppe Motta, maître de la politique étrangère de la Confédération et inspirateur de ses choix internationaux depuis un quart de siècle, meurt. On aurait pu s’attendre à ce que la Suisse fût orpheline de celui qui avait incarné durant l’entre-deux-guerres la conception conservatrice, neutraliste et anticommuniste de ses relations extérieurs, mais sa succession sera assurée en un mois, et son héritage répudié (au moins formellement) en quatre ans. Les socialistes présentèrent la candidature de Canevascini : candidature encore proclamatoire que celle du vieil adversaire tessinois du ministre défunt : le temps n’est pas encore tout à fait venu de l’accession du PS au gouvernement fédéral –mais il ne s’en faut que de trois ans. Les catholiques-conservateurs tessinois, qui n’ont nullement l’intention de « lâcher » le siège occupé par Motta, présentent la candidature d’Enrico Celio, qui sera élu le 22 février. Mais le Conseil fédéral tient alors de l’alignement de dominos : quatre mois après l’élection de Celio, le Conseiller fédéral Obrecht, malade, démissionne, et le 18 juillet W. Stämpfli lui succède. En septembre, les Conseillers fédéraux Minger (artisan de la modernisation de l’armée) et Baumann démissionnent. Le 10 décembre, leurs successeurs sont désignés : von Steiger sera élu par 130 voix contre 56 au socialiste Bratschi, et Kobelt par 117 voix contre le Valaisan Crittin.
Cette recomposition du gouvernement central s’opère en pleine « année terrible » -mais la « drôle de guerre » avait été mise à profit par Minger et Guisan pour adapter la structure militaire aux tâches qu’on craignait devoir lui confier. Cette adaptation toucha particulièrement le service de renseignement militaire (le « cinquième bureau »). La Guerre Mondiale fut aussi une guerre de l’ombre, particulièrement en Suisse où se croisaient et parfois se rencontraient les services et réseaux de tous les protagonistes du drame international. D’entre ces services et ces réseaux, donc, le service suisse et les réseaux dont il usa. Dès 1936, sous la direction du futur colonel Masson (politiquement fort à droite), le SR helvétique développe son autonomie et ses moyens d’action : en 1939 est installée à Lucerne une centrale de renseignements dirigée par le colonel Weibel et disposant d’une centaine de collaborateurs. Le SR de Masson travaillera également avec le Büro Ha, le service de renseignement autonome mis sur pied par Hans Hausamann, et bénéficiera de renseignements recueillis par les réseaux de alliés pendant toute la durée de la guerre –y compris de renseignements recueillis par les réseaux soviétiques, comme celui de Rudolf Roessler, dès l’été 1940.
Le dispositif militaire proprement dit sera lui aussi revu pendant la « drôle de guerre » : sans jamais que cela soit proclamé, la menace allemande est perçue comme le menace prioritaire, et le front potentiel (sur la frontière nord de la Suisse) renforcé en conséquence. Le principe selon lequel « l’ennemi de notre ennemi peut être notre allié » conduira à envisager dans le détail une coopération avec le haut commandement allié dans l’hypothèse d’une agression allemande –et avec le haut commandement allemand dans l’hypothèse d’une agression alliée. Certes, « la neutralité interdisait de passer des conventions militaires avec les belligérants » (Ruffieux, op.cit. p. 377), comme le rappellera le rapport du Général Guisan à l’Assemblée fédérale après la guerre, mais, en-deçà des « conventions militaires » s’étendait une « zone grise » que les responsables militaires ne renoncèrent pas à explorer, et de véritables pourparlers militaires eurent lieu avec la France, sur l’ordre de Guisan lui-même (dont la francophilie, si elle était moins plastronnante que la germanophilie de Wille en 1914-1918, n’était pas moins réelle), et en accord avec le Conseiller fédéral Minger. Un projet de convention militaire fut même préparé, qui prévoyait en cas d’agression allemande contre la Suisse, une aide française (l’engagement de deux armées françaises aux côtés de l’armée fédérale) et un plan commun d’opérations sur le Plateau ; il ne s’agissait pas d’une alliance « automatique » (la France ne devait intervenir que sur demande de la Suisse), encore moins d’une alliance du type de celle passée entre la Pologne et la France, mais la coopération envisagée allait tout de même assez loin, puisque « le terrain, les ouvrages et les troupes seraient utilisés à battre un adversaire devenu commun » (ibid. p. 378). La défaite française du printemps 1940 rendit évidemment cette convention inopérante avant même que d’avoir été réellement approuvée par les deux parties, mais la découverte par les Allemands des documents la présentant posera plus tard un problème assez considérable. Le 15 mai 1940, malgré tout, des troupes françaises se présentèrent à Lucelle pour entrer en Suisse, sur la foi de « renseignements » leur assurant que l’Allemagne s’apprêtait à occuper Bâle…
Autre réforme mise sur pieds pendant la « drôle de guerre » : celle de l’ « action psychologique » ; en fait de réforme, il s’agit là d’une véritable « invention » (pour la Suisse) de la « guerre psychologique ». La crise de confiance de la Grande Guerre (fossé linguistique, coupure entre le peuple et l’armée, entre les ouvriers et les paysans, scandales divers) fut de quelque enseignement : il ne fallait pas renouveler l’expérience. La tâche politique de l’ « information » et de son contrôle avait été confiée à l’été 1939 au commandement de l’armée, conformément à la conception traditionnelle de la préservation des « secrets militaires », mais les temps avaient changé et la « guerre de l’information » était devenue une affaire pleinement politique, en Suisse comme ailleurs. La Division « Presse et radio » était, institutionnellement, placée sous l’autorité directe du Général ; le contrôle de l’information aurait donc dû se faire dans le cadre de la structure militaire, mais il apparut assez vite que ce mode d’organisation était inopérant, et des tensions surgirent dès que la Division « presse et radio » se mit à vouloir gérer, avec des idées simples de militaires, une situation qui exigeait pour le moins la capacité de saisir sa complexité politique.
Le 6 janvier 1940, la Division « presse et radio » publia des directives destinées à intégrer le contrôle de la presse dans le champ de ses compétences ; la presse protesta, à la fois contre le principe même de ces contrôles militaires (et la suspicion dont ils témoignaient) et contre le fait qu’il allait être confié à « des juristes sans attaches directes avec la presse, alors que des journalistes (…) étaient confinés au rôle de simples lecteurs dans les bureaux territoriaux » (Ruffieux, op.cit. p. 380). En même temps, la propagande allemande déclencha une véritable campagne de presse contre la Suisse, une campagne à laquelle il fallait répondre par les media –ce qui supposait qu’on ait quelque compétence à leur usage et que l’on soit capable d’en user efficacement, ce qui ne semblait guère être le cas de la Division »presse et radio » de l’armée. Le 8 février, Marcel Pilet-Golaz demande au journaliste Jean-Rodolphe de Salis de tenir à la radio alémanique une chronique régulière exprimant un « point de vue suisse » sur la situation internationale. Le journaliste René Payot assurera un service comparable sur les ondes de la radio romande. La Division « presse et radio » n’était pas préparée à la guerre des nerfs entretenue par la propagande allemande ; elle n’en affirmait pas moins sa prétention à exercer elle-même le contrôle de l’information « civile ». Le 23 février 1940, le Conseil national entérina cette prétention, malgré l’opposition virulente des socialistes et, quoique moins virulente, de quelques « bourgeois », conscients les uns et les autres de la nécessité d’opposer un « contre-feu » à la propagande allemande, et de l’incapacité de la structure militaire à maîtriser un tel exercice –n’est pas Goebbels qui veut.
« La Division avait incontestablement fait du zèle depuis le début de la guerre », constate Roland Ruffieux (op.cit. pp 381, 382) : le 28 décembre 1939 encore, elle avait obtenu l’interdiction de deux journaux « extrémistes », la Neue Basler Zeitung « germanophile » et la Freiheit « prosoviétique ». L’un des responsables de la Division, le colonel Fürer, adjoint du colonel Hasler, ne cessait de s’en prendre à la presse ; de plus, la « ligne politique » de la Division ne semblait pas clairement définie, et aucun journal, si prudent, si « bourgeois » soit-il, ne pouvait se considérer comme abrité des foudres de la censure militaire. Le 20 mars 1940, la très « bourgeoise » Schweizerische Handelszeitung fut ainsi frappée d’un avertissement public pour avoir exprimé rien de plus que ce qu’elle pensait être la position de la Division « presse et radio » : la presse « trahit le pays » en se livrant à des « provocations inutiles » contre l’Allemagne. Ce faux pas entraîna la démission de Hasler mais ne rendit pas possible ce qui eût été nécessaire : la décision de rendre le contrôle de la presse autonome du commandement de l’armée.
Outre les domaines spécifiquement militaires et médiatiques, un autre terrain s’offrit aux réformes en 1939-1940 : celui de l’économie : « la mise sur pied anticipée d’une économie de guerre (devint) une pièce maîtresse de la politique de neutralité », écrit Ruffieux, qui précise :
ü Alors que le régime de l’offre et de la demande, à peine freiné par des contrôles, avait caractérisé la période 1914-1916, la phase 1939-1941 fut marquée par une lutte impitoyable pour les produits stratégiques –et presque tout l’était devenu (…). Durant le premier conflit mondial, la valeur des échanges globaux de la Suisse avait constamment dépassé le seuil de 1913 ; on considéra comme une « prouesse » de le maintenir à 55 % environ du niveau de 1938 au cours du second. (…) A partir de 1944, de plus, on se trouva dans une situation de pénurie. C’est dire que les précautions d’Obrecht, le zèle de Wahlen et les efforts de l’énorme machine administrative (…) permirent seulement de gérer une pénurie, non de ramener l’abondance.
S’instaure ainsi quelque chose comme un « socialisme de guerre » (à la suisse), un étatisme feutré, un début de planification, même, dont le PSS et l’USS n’auraient pu que se féliciter si d’énormes lacunes ne subsistaient ; l’Etat fédéral interviendra certes, et souvent, dans l’économie, mais il laissera pratiquement entier le pouvoir économique privé, et n’entravera guère les relations commerciales, financières et mercantiles avec l’Allemagne nazie.
L’Allemagne avait un intérêt évident à la poursuite, voire au renforcement, de ses relations avec la Suisse. Elle reconnut donc, du moins dans un premier temps, que « la neutralité impliquait pour la Suisse la continuation du trafic normal des marchandises et du transit » (Ruffieux, op.cit. p. 384). Par la suite, la situation économique de l’Allemagne se dégradant, les autorités nazies tentèrent d’utiliser la Suisse comme « poumon » : la Suisse avait besoin de charbon et de fer (entre autres matières premières dont elle ne disposait pas), l’Allemagne les lui fournit, contre l’or et une devise forte (le franc suisse) dont elle avait besoin, et accepta même de suppléer aux défaillances de fourniture de la France, mise en coupe réglée par l’Allemagne. On reviendra sur les aspects économiques des relations germano-helvétiques entre 1939 et 1945, et sur ce qu’elles impliquèrent de complaisance : au fur et à mesure que la victoire alliée se profilera, ces relations et ces complaisances feront de plus en plus problème. Avant même le grand ébranlement de mai-juin 1940, les Alliés s’étaient inquiétés des échanges entre la Suisse et l’Allemagne, et y avaient mis des limites. Le War trade agreement signé le 24 avril 1940 excluait que la Suisse pût réexporter vers l’Allemagne des marchandises non transformées en Suisse. Le contrôle des échanges restait néanmoins de la compétence des autorités suisses, et l’accord d’avril 1940 laissait les portes largement ouvertes entre la Suisse et tous les belligérants. L’effondrement franco-britannique de mai-juin 1940, en laissant craindre une victoire rapide des Allemands sur le terrain européen, allait « bousculer bientôt cet édifice fragile » (ibid.) et contraindre la Suisse à réviser sur tous les plans ses stratégies et ses dispositions de défense militaire, politique, sociale, culturelle et économique.
A l’été 1940, la Suisse est encerclée et n’a plus de frontières qu’avec  l’Allemagne
nazie, l’Autriche annexée, la France vassalisée et l’Italie fasciste. S’élabore
à ce moment la doctrine du « réduit national », dans une ambiance de
menaces, d’hostilité, parfois de provocation : « l’étalage
vaniteux de la force allemande et la disproportion des moyens suisses posent
(…) en termes crus l’alternative : adaptation ou résistance »
(Ruffieux, op.cit. p. 385). Des deux termes de cette alternative, chacun
sera en réalité pratiqué, la Suisse « s’adaptant » et des Suisses
« résistant », en même temps –certains acteurs du temps, comme
Guisan, étant au surplus porteurs des deux attitudes. Une certaine
« division du travail » se fit jour entre les prédicateurs de l’adaptation
(tel Pilet-Golaz) et ceux de la «résistance (tels les militaires du
« mouvement national de Résistance ». La tentation d’étiqueter les
uns, « à la française » comme « collaborateurs » et les
autres comme « résistants » est évidente ; Roland Ruffieux, par
exemple, y cède, prudemment :
l’Allemagne
nazie, l’Autriche annexée, la France vassalisée et l’Italie fasciste. S’élabore
à ce moment la doctrine du « réduit national », dans une ambiance de
menaces, d’hostilité, parfois de provocation : « l’étalage
vaniteux de la force allemande et la disproportion des moyens suisses posent
(…) en termes crus l’alternative : adaptation ou résistance »
(Ruffieux, op.cit. p. 385). Des deux termes de cette alternative, chacun
sera en réalité pratiqué, la Suisse « s’adaptant » et des Suisses
« résistant », en même temps –certains acteurs du temps, comme
Guisan, étant au surplus porteurs des deux attitudes. Une certaine
« division du travail » se fit jour entre les prédicateurs de l’adaptation
(tel Pilet-Golaz) et ceux de la «résistance (tels les militaires du
« mouvement national de Résistance ». La tentation d’étiqueter les
uns, « à la française » comme « collaborateurs » et les
autres comme « résistants » est évidente ; Roland Ruffieux, par
exemple, y cède, prudemment :
ü Le clivage entre partisans d’une adaptation –le terme de collaborateurs ne s’applique vraiment qu’à une toute petite minorité- et protagonistes de la résistance se dessine (…) au cours de l’été (1940). Mais (…) il subsiste un « marais » d’indécis qui ne choisissent pas leur camp.
Ce « marais d’indécis », qui sera « guisanien » comme en France les « indécis » seront pétainistes jusqu’au 6 juin 1944 et gaullistes dès le lendemain, formera en quelque sorte le soubassement, la « base sociale » de la légende patriotique née de la Guerre Mondiale et de la singulière situation d’une Suisse à la fois encerclée par la « peste brune » et préservée de la tourmente, au prix de compromis multiples et de compromissions nombreuses avec les puissants du moment (les puissants changeant avec les moments), et contrainte de s’inventer une guerre qu’elle ne fit pas, une résistance à laquelle elle ne prit part que marginalement, et des souffrances qui, comparées à celles du reste de l’Europe, ne furent que des gênes.
Le tourmente éclate en avril 1940, le 9, lorsque l’Allemagne déclenche contre le Danemark et la Norvège l’opération Weser, opération surprise qui combine « le mécanisme raffiné de la subversion politique (et le) coup de poing militaire » (ibid.). De la rupture militaire du printemps 1940, Guisan tirera la conclusion qu’il est indispensable de raccourcir le délai entre l’ordre de mobilisation et l’entrée effective en service des soldats mobilisés. Le recrutement d’auxiliaires militaires féminines commencera (par coïncidence) le lendemain du déclenchement de l’opération allemand contre la Norvège et le Danemark –opération qui incita par ailleurs le Conseil fédéral et le Général à édicter des « instructions en cas d’attaque par surprise » et à affirmer leur refus de toute « capitulation » (la constitution fédérale ne leur laissant d’ailleurs pas le choix). « En l’absence de chefs, les simples soldats devraient agir de leur propre initiative, avec la plus grande énergie », précise-t-on même. Le 7 mai 1940, le Conseil fédéral crée les gardes locales : « le thème du peuple en arme retrouvait toute son actualité » (Ruffieux, op.cit. p. 386) –encore qu’il faille se garder de toute identification avec ce que ce thème pouvait signifier lors de son « invention » moderne par les révolutionnaires français de l’An II : dans la Suisse de 1940, il s’agissait moins d’efficacité militaire (les « gardes locales » en étaient totalement dépourvues), et pas du tout de messianisme politique, que d’effet psychologique –d’un effet psychologique non sur l’adversaire mais sur l’opinion publique du pays lui-même.
Le 10 mai, l’offensive allemande surprend la Suisse autant que les pays qui en sont, immédiatement, les victimes : la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Ces pays, l’Allemagne en avait solennellement garanti la neutralité (par la voix de Hitler lui-même), et promis de la respecter ; pour la Suisse officielle, pour la plupart de ceux qui jusque là tenaient les nazis pour des gouvernants respectables, à la parole et aux engagements de qui l’on pouvait croire, le choc est rude. Le matin même du déclenchement de l’offensive occidentale de l’Allemagne, la seconde mobilisation de l’armée suisse est décrétée : elle doublera le volume des forces militaire « sur pied ». L’éventualité d’une attaque allemande contre la Suisse pour prendre la France à revers était à prendre au sérieux : « les derniers préparatifs d’une coopération avec la France furent poussés à l’extrême limite du licite » (op.cit), mais furent inutiles : la France s’effondra si vite que les Allemands eux-mêmes en furent surpris, et que l’utilité d’un contournement des défenses françaises par la Suisse devint rapidement nulle. Les Allemands n’avaient d’ailleurs probablement pas sérieusement songé à ajouter la Suisse à leur tableau de chasse, tant elle leur était plus utile en restant ce qu’elle était qu’en devenant pays occupé : Hinterland neutre et quelque peu complaisant à leur égard, elle était plus confortable que comme pays occupé, hostile par le fait même d’être occupé (comme la Belgique), annexé (comme l’Autriche) ou dépecé (comme la Tchécoslovaquie). L’incroyable rapidité de l’effondrement de la France achèvera donc de rendre dérisoires les plans d’entraide franco-suisse en cas d’invasion allemande. Le 17 juin 1940, la Suisse n’a plus aucun adversaire de l’Allemagne à ses frontières.
La « guerre éclair » menée avec succès par les Allemands, l’effondrement successif de la Pologne, du Danemark, de la Norvège, de la Belgique, de la Hollande et, finalement, de la France, provoquèrent au sein de l’opinion publique helvétique un véritable traumatisme, qui se mua dans certains milieux « bourgeois » en panique pure et simple : pendant la débâcle française, du nord et de l’est de la Suisse, « des colonnes de voitures chargées de civils, aux toits protégés par des matelas » (op.cit. p. 387) se dirigèrent vers la Romandie ou les Alpes : la bourgeoisie bâloise et schaffhousoise, paniquée, se livre à un étrange exode vers la stations touristiques –un exode socialement très délimitable, qui suscite au sein des « couches populaires » ouvrières et paysannes voyant passer ce lamentable cortège une réaction où le mépris le dispute à la colère, et qui ranime le vieil antagonisme de 1918 –ceux qui n’avaient que le patriotisme à la bouche lorsque le mouvement socialiste exprimait son antimilitarisme traditionnel ou son internationalisme fondateur, sont les mêmes qui à la première alerte prenaient la fuite toute honte bue et tout « patriotisme » oublié sur le bord du chemin…
Le 14 mai, les forces allemandes s’engouffrent dans une brèche du dispositif français, entre Sedan et Dinant, sur la Meuse ; le 15 mai, Guisan édicte un « ordre d’armée » et parle de « résistance à outrance ». Mais de résistance contre qui, contre quoi ? Les Allemands n’ont plus besoin de contourner par la Suisse un front français qui s’effondre, et les Français ne sont plus en état d’attaquer qui que ce soit. Sur les voies de pénétration en Suisse, l’armée installe tout de même des barricades et des barrages antichars. Le 5 juin commence la dernière phase de la première « bataille de France » (la seconde commencera en juin 1944, à front renversés), qui voit les Allemands briser toutes les résistances sur la Somme et l’Aisne ; le 10 juin, l’Italie entre en guerre contre la France déjà vaincue –mais les premiers et seuls combats entre Italiens et Français tournent rapidement à l’avantage des seconds et à la confusion des premiers, et il faudra la capitulation de fait, sous apparence d’armistice, de la France de Pétain devant l’Allemagne pour que Mussolini profite quelque peu de son engagement tardif et évite l’humiliation de voir les Français entrer en Italie. Pour la Suisse, la défaite française, si elle est traumatisante, réduit le risque d’une invasion : le seul protagoniste de la bataille qui soit en état de tenter une opération contre la Suisse, l’Allemagne, n’y a plus intérêt. Les moyens prévus pour une éventuelle coopération franco-suisse sont donc affectés à des tâches plus utiles : le renforcement de la défense du Jura et de celle des Alpes, tandis qu’une partie des troupes de l’aile droite du dispositif français entre en Suisse, mais pour s’y faire désarmer et interner. Le 17 juin, Pétain adresse à l’Allemagne une demande d’armistice ; le 22 juin, l’armistice est signé. Il est léonin : il consacre l’occupation de la moitié de la France et la vassalisation de l’autre moitié par le vainqueur, mais il ne scelle pas un encerclement complet de la Suisse : « Entre Chamonix et le pays de Gex subsiste une chatière qui permet à la Suisse de communiquer avec la France non-occupée, et surtout avec l’Angleterre » (Ruffieux, op.cit. p. 389). Cette « chatière » dont la frontière genevoise est la charnière –et Genève la clef- permettra aussi le contact avec la Résistance française et le passage clandestin de milliers de réfugiés dès 1940, et de centaines de résistants « en mission », surtout dès 1941, et jusqu’en 1944. Paradoxalement, la calamiteuse entrée en guerre de l’Italie, par le « don » (ou l’aumône) qui lui fut fait d’une zone d’occupation spécifique en France alors qu’elle avait été battue sur le terrain, affaiblira le dispositif allemand. En outre, la petite zone d’occupation italienne (le piémont français des Alpes) deviendra jusqu’à son occupation par les Allemands une zone de refuge pour les juifs français, y compris ceux restée en zone française non occupée. Ainsi verra-t-on les dimanches de 1940 à 1942 de braves promeneurs suisses s’en aller, d’un bord à l’autre de la frontière, contempler à Annemasse les militaires italiens puis à Meyrin les militaires allemands (et entre deux, peut-être, les français à Saint-Julien). Cela étant, que les Allemands aient laissé s’établir la « chatière » genevoise, par oubli ou par désinvolture (à moins qu’il y aient eux aussi trouvé quelque intérêt) indique assez clairement que la Suisse n’était pas, pour reprendre l’euphémisme dont use Roland Ruffieux (op.cit. p. 390), « au centre des préoccupations du Reich »…
La France hors-course, et l’Angleterre restant presque seule (avec derrière elle le Commonwealth, et avec elle les premières forces « libres » issues de la France, de la Belgique, de la Hollande, de la Norvège, du Danemark, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie occupées) face à l’Axe, jusqu’en 1941, l’Allemagne va peser de tout son poids sur la Suisse afin de l’amener à une collaboration (et nous n’usons pas ici de ce terme sans en mesurer la connotation historique) aussi large et profonde que possible, et de l’amener aussi loin que possible sur la voie de la vassalisation. Les critères de la politique allemande sont foncièrement utilitaires : il s’agit d’économiser la charge d’une opération militaire (la guerre contre l’Angleterre continue, celle contre l’Union Soviétique se prépare, et un front de plus serait un front de trop), et d’une occupation, tout en obtenant un maximum de coopération de la part des autorités helvétiques. Le 11 juin 1940 déjà (la France n’a pas encore capitulé), l’Allemagne suspend ses livraisons de charbon à la Suisse, qui en a grand besoin ; elle ne les reprendra que le 9 août, après qu’un nouvel accord ait été signé entre les deux pays. La Suisse se trouvera priée de participer, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, mais en sachant pertinemment de quoi il retourne, à l’effort de guerre allemand ; elle devra ainsi rendre au Reich 90 avions Messerschmitt 109 qui lui avaient été livrés, sur sa commande, les mois précédents ; elle devra en outre freiner ses échanges avec la Grande-Bretagne et s’engager à en faire autant avec la France ; elle dut enfin accorder un crédit de 200 millions de francs suisses à l’Italie, de 24 juin 1940. En même temps, la Suisse dut se plier à une étrange exigence allemande : s’excuser d’avoir abattu ou contraint à l’atterrissage sur territoire suisse d’appareils militaires allemands ayant violé l’espace aérien suisse… Durant toute la campagne de France, en effet, les violations de ce genre furent nombreuses, et des appareils allemands furent abattus en vol ou contraint d’atterrir en Suisse. Le 8 juin 1040, l’Allemagne exigea de la Suisse des excuses après un engagement aérien au-dessus du Jura, dans l’espace aérien suisse, mettant aux prises une dizaine d’appareils suisses et une trentaine d’appareils allemands, avec des pertes semble-t-il équilibrées pour les deux adversaires. Le 19 juin, l’Allemagne revenait à la charge. La Suisse céda, libéra dix-neuf aviateurs allemands internés, restitua à l’Allemagne les appareils saisis et, le 1er juillet, présenta au Reich ses excuses pour avoir cru bon, et de son droit, de défendre son propres espace aérien. Une quinzaine de jours auparavant, une dizaine de saboteurs allemands avaient été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à agir sur des aérodromes suisses…
L’écroulement de la France provoqua une véritable « dépression » de l’opinion publique suisse (de son « marais », du moins, c’est-à-dire de ceux qui n’avaient pas clairement et définitivement choisi leur camp, et souhaitaient parfois que les forces en présence s’équilibrassent en laissant ainsi la Suisse tranquille) ; une partie de la presse « bourgeoise » témoigna de cette « dépression » en se mettant à plaider pour une « régénération », une « adaptation » au nouvel ordre européen. « Le défaitisme se répandait partout », constate Ruffieux :
ü La presse suisse se livra à une cure d’autocritique : on avait fait preuve d’incompréhension envers le Troisième Reich ; la démocratie devait se réformer profondément pour affronter l’avenir. Les thèmes de rénovation nationale, tellement prisés dans les mois qui suivirent l’avènement du nazisme, reparurent même dans les journaux qui s’étaient fortement opposés aux entreprises hitlériennes depuis 1936.
De cette « dépression politique », le célèbre discours du président de la Confédération, Marcel Pilet-Golaz, prononcé le 25 juin 1940, rendra parfaitement compte, au point de passer à la postérité comme la manifestation d’une sorte de « pétainisme suisse », d’autant qu’il fut prononcé le même jour qu’un discours de Pétain lui-même, ce qui eut a posteriori l’évidente utilité politique de faire apparaître le discours que tiendra Guisan un mois plus tard, le 1er août, comme un discours « gaulliste », c’est-à-dire la manifestation d’un « esprit de résistance » mis en valeur par l’ « esprit de collaboration » de Pilet-Golaz, comme la lumière par l’ombre.
Le discours de Pilet-Golaz devait en principe être l’expression d’une position commune du Conseil fédéral (que la démission d’Obrecht avait réduit à six membres). Ses grandes lignes avaient été tracées lors d’une réunion tenue le 24 juin, en liaison avec la division « presse et radio » de l’armée, représentée par le Capitaine Gut : Pilet devait évoquer la démobilisation partielle de l’armée, la remise du peuple au travail… Le Président de la Confédération prit sur lui de broder très personnellement sur ce canevas « collégial », mais le texte de son allocution fut néanmoins soumis au Conseil fédéral et accepté par lui. Le « pétainisme » de Pilet-Golaz fut donc le fait collectif du gouvernement helvétique, et l’on peut même douter que le Général Guisan en ait été « innocent », tant il apparaît improbable qu’une allocution de cette importance, en un pareil moment, ne lui pas été communiquée avant que d’être prononcée.
Pilet, au nom du Conseil fédéral, embouche donc les trompettes de l’ « adaptation » : l’Europe doit trouver « un nouvel équilibre, très différent de l’ancien, à n’en pas douter », et la Suisse devra consentir à de « douloureux renoncements » et de « durs sacrifices » pour assurer son « redressement indispensable » : « Ne pas palabrer, concevoir ; ne pas disserter, œuvrer ; ne pas jouir, produire ; ne pas demander, donner » (cité par Ruffieux, op.cit. p. 392). Et de poursuivre sur les thèmes de l’altruisme, de l’effort, de l’ordre (« inné chez les Suisses ») qui ne sera maintenu que si le peuple suit docilement un gouvernement fort, à qui il faut faire confiance, et d’une mission inspirée par « les grandes civilisations européennes » et soumise à la Providence divine.
La gauche fut seule, dans un premier temps, à dénoncer les ambiguïtés du discours présidentiel, mais le clivage, à droite, entre partisans de l’ « adaptation » et « résistants » ne tarda pas à ressurgir. Roland Ruffieux :
ü Avec un peu plus de recul, les salles de rédaction observèrent que le mot de démocratie n’avait pas été prononcé, mais que sa forme libérale avait été condamnée indirectement. (…) D’autre part, l’armée n’avait été citée qu’en passant, à propos de la démobilisation ; elle n’avait été ni remerciée, ni confortée.
Roland Ruffieux relève également, comme nous venons de le faire ici, les « points communs » du discours de Pilet-Golaz et de l’appel coïncidant de Pétain (sans, évidemment, que les deux se fussent concertés) :
ü On doit constater la volonté des deux hommes de se rattacher au même courant idéologique. Celui de la droite nationaliste à la fois culpabilités par les événements et décidée à en tirer des moyens d’agir. (…) la palabre intellectuelle a été nocive, (la) démocratie a été source d’erreurs, (les) vraies valeurs sont dans l’ordre, le travail et le sacrifice.
On ne s’étonnera donc pas que le discours de Pilet-Golaz, avec son poids « collégial » de discours prononcé au nom du Conseil fédéral ait été favorablement accueilli par les Allemands. Ceux-ci ne tardèrent pas à tenter de profiter de la situation –ils auraient eu grand tort de s’en priver- pour tenter, à nouveau, d’obtenir de la Suisse qu’elle muselât sa propre presse.
Le 31 mai 1940 avait été promulgué un arrêté du Conseil fédéral modifiant le régime de surveillance de la presse et de la radio, en créant une commission mixte chargée de traiter des cas « graves » et en élargissant les possibilités de recours. Le Conseil fédéral attendait de cette (petite) réforme un surcroît d’efficacité dans la maîtrise de l’information dispensée à la population, et sans doute aussi qu’elle calmât quelque peu les ardeurs des représentants en Suisse. Ceux-ci avaient multiplié les démarches de protestation auprès des autorités suisses contre les libertés prises par les media helvétiques avec l’image que l’Allemagne voulait donner d’elle-même (il eut 20 de ces démarches en 1940, adressées au Département politique fédéral). Mais d’autres pressions s’exercèrent, qui celles-là usaient de voies plus détournées : c’est ainsi que le 9 juillet 1940, l’éditeur du Bund de Berne se vit demander par l’attaché de presse de l’Ambassade d’Allemagne, G. Trump, la tête de son rédacteur en chef, E. Schürch. Trump ne faisait pas mystère de ses intentions et voulait également que l’on épurât l’Agence Télégraphique Suisse afin d’en faire une sorte de succursale du Deutsches Nachrichtenbüro. Des démarches analogues à celles effectuées auprès du Bund furent tentées auprès de la Neue Zürcher Zeitung, dont le correspondant berlinois, R. Caratsch, avait été expulsé d’Allemagne et dont « on » suggéra la démission du Rédacteur en chef, W. Bretscher. Dans le cas du Bund comme dans celui de la NZZ, les représentants allemands s’en prenaient à des journaux « bourgeois » (radicaux, en l’occurrence) : la presse ne gauche ne semble pas avoir été perçue par les nazis comme particulièrement dangereuse, ce qui ne les empêchait évidemment pas d’en souhaiter la mise au pas, mais les dissuadait de consacrer à pareille entreprise des efforts plus utiles au musellement d’une presse plus dangereuse, parce que politiquement plus influente, et au tirage plus élevé. Les représentants allemands s’activèrent également auprès de la National Zeitung et des Basler Nachrichten ; ces pressions multiples finirent par inquiéter sérieusement les milieux de la presse, qui réussirent à faire réagir les autorités fédérales et à tempérer, pour un temps, les ardeurs allemandes (qui se réveillèrent en 1941).
La défaite française consommée, la Suisse dut, ou crut devoir, réorienter sa politique sur tous les plans. Le dispositif militaire n’y échappa pas, la « donne » stratégique étant bouleversée par la chute de l’ultime démocratie frontalière de la Confédération. C’est la naissance du « réduit national », présenté le 24 juin 1940 par le Chef de l’état-major, et donc conçu avant l’effondrement de la France. Il ne s’agit pas seulement d’un choix stratégique au sens restrictif (militaire) du terme : le « réduit » est la manifestation la plus tangible et la plus exemplaire d’une véritable idéologie nationale à laquelle vont adhérer presque toutes les forces politiques, sociales et culturelles du pays, et où se mêlent (et se confrontent) « esprit de résistance » et « esprit d’adaptation ».
De Saint Maurice à Sargans fut ainsi constituée une forteresse militaire, « troisième échelon » (celui de l’ultime résistance) d’un dispositif dont la frontière était le premier échelon et le Plateau, du lac de Constance au Léman, le second. Le Gothard était le centre de ce « Réduit », occupant une part importante de la surface territoriale du pays mais où ne vivait qu’une très faible part de sa population ; c’est dire que la fonction même du « Réduit » était au moins autant symbolique que stratégique, et qu’il s’agissait non d’empêcher l’invasion de la Suisse, mais de maintenir au « cœur » du territoire helvétique –son « cœur » géographique et historique, son espace le plus facilement défendable et le plus symboliquement identifiable- une « zone libre » où puisse s’ancrer le maintien d’une souveraineté : un coin de terre où planter le drapeau. Mais cette Suisse « maintenue » ne correspondrait évidemment plus à la Suisse réelle, et n’avait d’ailleurs même pas l’ambition d’y correspondre. Dans le « Réduit » ne trouve place aucune des « grandes » villes suisses, aucune des grandes zones agricoles, aucune des grandes industries : ça n’est pas un pays, mais le symbole d’un pays qu’il s’agit de défendre. Roland Ruffieux :
ü Le facteur psychologique était presque aussi important que les mesures militaires proprement dites. L’ordre d’armée du 2 juillet avait déjà proposé au peuple la résistance militaire, non le travail pacifique selon les vues de Pilet-Golaz. Il restait à convaincre l’armée (…) le commandement militaire adopta une solution originale, celle du rapport d’armée. (…) La réunion de quelques 650 officiers, commandant jusqu’à l’échelon du bataillon ou du groupe (…) rappelait l’antique Kriegsrat de la vieille Confédération.
On est donc en pleine bataille symbolique, et en plaine mythologie helvétique : la Suisse redécouvre la « guerre psychologique », et le « camp patriote » va s’y illustrer avec une assez surprenante maîtrise. Pour le Kriegsrat qui se tiendra le 25 juillet 1940, un lieu s’imposa naturellement : le Grütli…
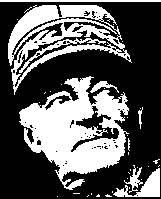 Ce 25 juillet, donc, le Général Guisan
adresse (en allemand) un discours d’une demie-heure à ses subordonnés (ses « compagnons »,
écrit Ruffieux, usant pour l’occasion d’une terminologie gaullienne et
gaulliste). Ce discours va rester dans l’histoire,. Ou dans son imagerie, comme
la manifestation exemplaire d’un « esprit de résistance » dont Guisan
lui-même deviendra le personnage emblématique : à
l’ « ombre » du discours de Pilet-Golaz s’opposerait ainsi la
« lumière » de celui de Guisan… on sait ce que l’histoire emprunte
aux mythes : il y a du mythe dans cette dichotomie trop commode, et trop
utile, pour être réaliste. Reste que le discours de Guisan du 25 juillet 1940 a
pris dans la mythologie suisse la place prise par l’appel de De Gaulle du 18
juin précédent dans la mythologie française.
Ce 25 juillet, donc, le Général Guisan
adresse (en allemand) un discours d’une demie-heure à ses subordonnés (ses « compagnons »,
écrit Ruffieux, usant pour l’occasion d’une terminologie gaullienne et
gaulliste). Ce discours va rester dans l’histoire,. Ou dans son imagerie, comme
la manifestation exemplaire d’un « esprit de résistance » dont Guisan
lui-même deviendra le personnage emblématique : à
l’ « ombre » du discours de Pilet-Golaz s’opposerait ainsi la
« lumière » de celui de Guisan… on sait ce que l’histoire emprunte
aux mythes : il y a du mythe dans cette dichotomie trop commode, et trop
utile, pour être réaliste. Reste que le discours de Guisan du 25 juillet 1940 a
pris dans la mythologie suisse la place prise par l’appel de De Gaulle du 18
juin précédent dans la mythologie française.
Guisan lui-même ne manque pas de relever le poids du symbole géographique : « J’ai tenu à vous réuni, en ce lieu historique, terre symbolique de notre indépendance, pour (…) vous parler de soldat à soldat », annonce-t-il en préambule ; puis :
ü Nous sommes à un tournant de notre histoire. Il s’agit de l’existence même de la Suisse. Ici, soldats de 1940, nous nous inspirerons des leçons et de l’esprit du passé pour envisager résolument le présent et l’avenir du pays, pour entendre l’appel qui monte de cette prairie.
« L’appel qui monte de cette prairie », Guisan le traduit en l’expression d’une volonté de résistance « à toute agression, d’où qu’elle vienne », et de confiance en cette résistance. Mais d’où pourrait venir une « agression », à l’été 1940, si ce n’est d’Allemagne ? L’Italie est déjà hors d’état d’agresser qui que ce soit (elle s’y est essayé contre la France déjà vaincue, et ce sont les Italiens qui ont été défaits…), l’Autriche est annexée, la France est vaincue, l’Angleterre est trop loin… quant à la « menace soviétique », elle n’est qu’un fantasme. Le lendemain de l’ « appel du Grütli », un ordre d’armée est lu à la troupe, qui reprend l’essentiel du discours de la veille. 34 ans après, Roland Ruffieux exprime ce qui lui semble rester de ce texte et de ce discours, c’est-à-dire moins leur contenu que leur ton, moins leur réalité que leur symbolique :
ü Les formules (sont) nettes, tranchantes parfois, contrastant avec le style byzantin de Pilet : faire respecter l’indépendance du pays jusqu’au bout ; les sacrifices consentis n’ont pas été vains puisque les Suisses restent « maîtres de leur destin » ; ils ne doivent pas écouter ceux qui les incitent au doute.
Toujours « Guisan contre Pilet », la clarté de la « résistance » contre l’ombre de l’ « adaptation » (et les formules « nettes » du soldat contre le style « byzantin » du politique… « byzantin », vraiment ? ni plus, ni moins après tout que celui de tous les discours conservateurs de l’époque…). On est en plein dans le mythe, et on y reste. Cela étant, le Kriegsrat du Grütli, ce « Conseil de guerre à l’ancienne » lors duquel le Chef exhorte ses lieutenants à ne pas perdre de vue leur mission et à transmettre l’ « esprit » à la troupe, semble avoir eu grand effet psychologique (l’effet recherché, précisément) : « L’armée y puisa une nouvelle vigueur et (…) la consigne passa jusqu’à l’homme du rang », affirme Ruffieux (ibid.), non sans reconnaître toutefois que la coterie « germanophile » (et la germanophilie de 1940 était d’une toute autre perversité que celle de 1914, même eu surtout lorsqu’elle ne voyait pas de différence entre l’Allemagne wilhelminienne et la Germanie hitlérienne), dont le « pivot » était le Chef de l’Instruction, le Colonel Wille, affecta de n’entendre dans le discours du Général qu’un « bruit de sabre » dont elle se plaignit. La grande presse, la radio et les actualité cinématographiques donnèrent à l’événement l’ampleur qu’en espéraient ses auteurs, et que craignaient les partisans de l’ « accommodement » avec l’Allemagne.
Les autorités allemandes ne tardèrent d’ailleurs pas à réagir, entraînant derrière elles leurs alliés italiens (de plus en plus vassaux et de moins en moins alliés, si l’on veut bien admettre qu’il faille quelque égalité dans une alliance. L’Ambassadeur allemand Köcher prétendit, non sans raison, que son pays avait été directement visé par les allusions à d’éventuelles agressions « d’où qu’elles viennent » et exigea comme signe de bonne volonté de la Suisse qu’elle allégeât sans tarder son dispositif militaire ; Pilet-Golaz justifia ce dispositif pour des raisons intérieures plus ou moins fantaisistes (menace communiste, chômage…). Le 13 août 1940, les représentants allemands et italiens remirent aux autorités suisses une « note verbale » et un mémorandum rendant le Conseil fédéral responsable des « écarts de langage » de Guisan, à quoi le Conseiller fédéral Etter répondit en précisant que le Général avait parlé « en soldat à des soldats ». Roland Ruffieux suggère que les protestations allemandes avaient pour but d’obtenir « l’éloignement des « Jeunes Turcs » de l’entourage immédiat de Guisan et peut-être la démission de celui-ci » (op.cit. p. 399).
Il est vrai que le discours du Grütli, loin de n’être qu’une initiative personnelle, « gaullienne », de Guisan, correspondait à l’émergence au sein de l’armée et de ses « cadres moyens » (lieutenants, capitaines, majors) d’un « courant » fort inquiet des « dérapages » dont témoignait le discours de Pilet-Golaz, et refusant « l’adaptation » au nouvel ordre européen qui semblait s’imposer comme la ligne politique majoritaire du Conseil fédéral. Guisan était de toute évidence le meilleur porte-parole qui se puisse trouver pour une ligne de « résistance » à ce projet d’adaptation : insoupçonnable politiquement (nul ne pouvant lui reprocher quelque inclination de gauche, et ses sentiments démocratiques étant même assez improbables), intouchable hiérarchiquement (puisque Général, Chef de l’armée, élu par le Parlement fédéral comme le sont les Conseillers fédéraux), Guisan était le meilleur allié possible de ces « Jeunes Turcs » à la fois patriotes et démocrates, refusant la démobilisation de l’armée et craignant une « satellisation » de la Suisse par l’Allemagne –« satellisation » déjà à l’œuvre, mais que la démobilisation de l’armée et le démantèlement du dispositif militaire eussent rendu plus facile). « Les conjurés, qui appartenaient pour la plupart au (Service de Renseignement) étaient également bien placés pour connaître les intentions réelles des dirigeants du Reich », ajoute Ruffieux (ibid.).
Le 21 juillet 1940, quelques jours avant le discours du Grütli, l’Organisation de fortune était fondée à Lausanne par trois capitaines, dont Hans Hausamann. Elle groupe une trentaine d’officiers, pour la plupart liés à l’état-major général, et se donna pour but l’organisation de la résistance militaire à une invasion, au cas où le Conseil fédéral y renoncerait, voire arriverait à imposer ce renoncement au Général et à l’armée. « Le projet de se battre malgré les ordres donnés constituant une mutinerie au sens du Code pénal militaire, Guisan ne pouvait être mis dans le secret » (Ruffieux, op.cit. p. 400), lors même que la Constitution fédérale excluant explicitement toute capitulation, les mutins se trouveraient du côté du droit et les « capitulards » hors-la-loi. Ce réseau de résistance « marchait sur des œufs », entre l’hypothèse d’une insubordination qu’il envisageait et la nécessité, pour que cette insubordination soit couronnée de succès, de préserver les positions de ses membres dans l’appareil militaire :
ü Par un système d’hommes de confiance recrutés dans les unités, la ligue entendait empêcher les licenciements excessifs de troupe et, à la limite, déclencher une résistance sauvage. Le nom de code, « Nidwalden », choisi pour en donner le signal, indiquait bien* qu’on ne se faisait guère d’illusion sur ses chances : périr certainement, mais avec courage. (…) le commandement de l’armée se saisit de l’affaire. On croyait d’abord à une conjuration frontiste, ce qui explique les arrestations ordonnées le 3 août 1940. L’enquête clarifia les intentions et le général prononça des peines légères contre huit des conjurés.
* Nidwalden
, c’est-à-dire une référence (à peine moins mythologique que celle
du Grütli) à la résistance désespérée (et réactionnaire,
« vendéenne ») opposée par les Waldtsätten aux troupes de la
révolution française envahissant la Suisse pour y imposer une République
jacobine.
Il faudra attendre la fin de la guerre pour que Guisan, dans son rapport à l’Assemblée fédérale, approuve « moralement » ce plan de résistance ; il lui eût été difficile de le faire avant, quand l’ « Organisation de fortune » se plaçait explicitement sur une hypothèse d’insubordination, voire de mutinerie : il est en effet assez rare de voir un Général approuver ce type de comportement (à moins qu’il ne s’appelle Charles de Gaulle et qu’il l’adopte lui-même). Il est tout aussi vrai, cependant, que le rapport du Général à l’Assemblée fédérale tient à la fois du constat et de la relecture : constat de ce qui a été fait durant les six années de mobilisation, relecture des événements de ces six années à la lumière de leur conclusion (l’écrasement de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste, du Japon impérialiste et de leurs alliés et vassaux), avec tout ce que cela suppose de « gommage », de « lissage » et de « vernissage »…
La « conjuration » de l’ « Organisation de fortune » témoigne bien des inquiétudes qui saisirent en 1940 les forces « patriotiques » et démocratiques suisses ; au-delà du milieu militaire, et bien plus largement que lui, dans l’ensemble du corps social se diffuse un sentiment d’alarme et d’urgence qui pousse à un repli sur les valeurs les plus traditionnelles de la mythologie helvétique –mais à un repli conçu comme une utilisation de ces valeurs au profit d’une « résistance » à l’hégémonie allemande : après tout, que les antifascistes suisses se saisissent de Guillaume Tell et de Winkelried n’est pas plus absurde que l’usage que firent des figures de Jeanne d’Arc ou de Vercingétorix les résistants français, ou de Brutus les révolutionnaires montagnards.
Tout l’ « arc démocratique », de la gauche à la droite, de la Neue Zürcher Zeitung à La Sentinelle, se tend :
ü Il se produisit un (…) pullulement de formations éphémères qui disparurent, une fois menée à terme la tâche qu’elles s’étaient assignées. Dans le sillage du Forum Helveticum et de Res Publica (…) se multiplièrent appels, regroupements, conférences, cours et meetings visant à lutter contre le défaitisme et la passivité.
Certains acteurs de ce contre-feu généralisé au « défaitisme » étaient apparus sur la scène politico-sociale lors de la Grande Guerre ou des années qui la suivirent immédiatement : tel était le cas de la Nouvelle Société Helvétique dont l’annuaire de 1941 présenta l’ « héritage patriotique (de la Suisse) et ses engagements à l’heure présente » du point de vue « démocratico-patriotique » qui était en train de devenir une sorte d’ « idéologie de la résistance » -mais d’une Résistance sans contenu révolutionnaire : si la majorité des forces de la Résistance française se reconnaissaient, globalement, dans ce qui fut la devise du quotidien Combat, « de la Résistance à la Révolution », la « proto-résistance » suisse s’en serait plutôt tenue à une devise du genre « de la Résistance à la Restauration » (de l’indépendance nationale et de la démocratie « bourgeoise »). D’autres mouvements étaient le produit immédiat de la Guerre Mondiale en train de ravager l’Europe et l’Asie : ainsi de la « Ligue du Gothard », qui rassemblait des mouvements allant du « Redressement National » à l’Alliance des Indépendants de Gottlieb Duttweiler, en passant par les syndicats catholiques et les personnalistes regroupés autour de Denis de Rougemont. La Ligue du Gothard publia de nombreuses annonces dans la presse, qui furent autant d’appels à une résistance « spirituelle » aux séductions de l’adaptation à l’ordre nazi.
Quant aux socialistes, ils rallièrent l’Aktion nationaler Widerstand (Action de Résistance nationale) fondée en septembre 1940 par l’incontournable Hans Hausamann, et qui tint à la fois du service de renseignement, du réseau de résistance, de la conjuration patriotique, du réseau antinazi et du service d’action psychologique, alternant la « surveillance étroite (des) faits et gestes de personnages fédéraux les plus importants » (Ruffieux, op.cit. p.403) et l’inspiration d’entreprises de propagande à faire mener par la « Division Armée & Foyers » en direction de la population civile.
La Bataille d’Angleterre, commencée sitôt la chute de la France consommée, représenta un premier tournant de la guerre, et un nouveau changement d’état d’esprit de la population. La résistance opiniâtre, et couronnée de succès, de la Grande-Bretagne, renforça le camp des « anti-défaitistes », alors que rares étaient ceux qui, début juillet, eussent parié un penny sur ce premier succès des adversaires de l’Allemagne nazie : on ne donnait alors pas cher de la « peau des Anglais » dans les milieux partisans de l’accommodement avec les triomphateurs de la Blitzkrieg du printemps ; « l’automne 1940 marque le passage de la guerre de mouvement à la guerre d’usure », constate Roland Ruffieux (la « guerre de mouvement reprendra en 1941 dans un sens, qui s’inversera en 1943). Ruffieux poursuit :
ü Le contrecoup sur la Suisse est perceptible. A la phase d’effervescence provoquée par la chute de la France (…) succède une période de lassitude (…) qui durera jusqu’à l’agression contre l’Union Soviétique.
Cette « lassitude » de l’opinion publique, chacun des deux courants contradictoires qui se partent désormais le « monde politique » (au sens le plus large du terme : l’ensemble des « décideurs » et des « leaders d’opinion » de Suisse, y compris les étrangers actifs en Suisse) va tenter de la mettre à profit pour prendre l’avantage sur l’autre. Les hostilités sont ouvertes par la droite frontiste, en l’occurrence le Volksbund für die Unabhängigckeit der Schweiz, à la faveur d’une maladresse du Président de la Confédération, Pilet-Golaz : le 1er août 1940 (le Premier août…), Pilet-Golaz reçoit en audience les dirigeants du Volksbund et les laisse dans l’impression qu’ils ne font « pas fausse route » (Ruffieux, op.cit. p. 404). Le 10 septembre suivant, le même Pilet-Golaz remet les couverts, cette fois pour les dirigeants du Mouvement national suisse, puis à nouveau, quatre jours plus tard, avec l’un d’eux, M.-L. Keller, en partance pour l’Allemagne. L’ambiance du moment semble porteuse d’espoir pour l’extrême-droite helvétique –des espoirs attisés encore par les ambiguïtés de Pilet-Golaz, alors même que dans les semaines qui avaient précédé l’effondrement de la France avaient successivement disparu le Mouvement fasciste suisse (dont le chef, Fonjallaz, fut emprisonné le 25 janvier) et le Pilori de « Geo » Oltramare (le journal fut interdit en avril, Oltramare s’enfuit à Paris où il rejoignit les « collaborateurs » pétainistes). La »divine surprise » des dernières semaines du printemps 1940 effacera ces déconvenues, au point de pousser le Volksbund, originellement ultra-neutraliste, isolationniste et conservateur (comme l’indique son nom de « Ligue populaire pour l’indépendance de la Suisse ») dans les bras des services allemands, qu’il intéressait en raison même de sa respectabilité conservatrice. Le Volksbund avait combattu avec acharnement l’ « esprit de Genève » et tout ce qui pouvait, de près ou de loin, ressembler ou inciter à une adhésion de la Suisse à ce que cet « esprit » signifiait. Germanophile sans être nazi, le Volksbund avait pris distance d’avec les « fronts » dès 1933 mais, l’échec du frontisme, sa marginalisation, l’incompétence de ses dirigeants et l’inconsistance de leurs conduites politiques finirent par convaincre les Allemands qu’il fallait trouver ailleurs, et un peu moins à droite, un partenaire digne d’un minimum de confiance : le Volksbund sera ce partenaire. En 1940, alors que la guerre avait signifié la mort de la SdN, le Volksbund en était encore à agir afin que la Suisse rompe avec une institution en état de mort clinique et dont le palais genevois n’avait plus qu’une valeur architecturale. En juillet 1940, le Volksbund rédige une « adresse » au Conseil fédéral, dans laquelle il demande un contrôle renforcé de la presse dans le domaine des affaires étrangères, la fin de toute répression des activités oppositionnelles de droite et une réforme globale, antiparlementaire, des institutions politiques. Ce sont les porte-paroles de cette « adresse » que le Président de la Confédération reçoit le 1er août. Ce faisant, Pilet-Golaz n’agit pas en solitaire : il est mandaté par ses collègues. Encore une fois s’avère la responsabilité collégiale de la politique d’ « adaptation » défendue par celui dont on voudra faire, après la défaite de l’Axe, une sorte d’activiste isolé, pour mieux faire ressortir la figure de Guisan et la politique dont on la rendra symbolique. En réalité, Pilet-Golaz, soumettant à ses collègues le texte de son discours du 15 juin, fut aussi mandaté par eux pour rencontrer les dirigeants du Volksbund, c’est-à-dire des hommes qui désormais défendaient les thèses de l’ « adaptation » au « nouvel ordre européen ». Ce qui apparaît, soixante ans plus tard, comme une manifestation de connivence entre la droite « bourgeoise » et l’extrême-droite « philofasciste », le Volksbund servant d’interface, symbolise en tous cas une tentation largement répandue, probablement partagée par la plupart des Conseillers fédéraux, et signale une incertitude encore plus largement répandue sur la politique à adopter après la défaite française, et dans l’attente de celle de la Grande-Bretagne. Lors de leur entrevue avec Pilet, les dirigeants du Volksbund (A. von Sprecher, fils d’un ancien chef d’état-major de l’armée, H. Amann, Heinrich Frick, l’industriel glaronnais C. Jenny, le directeur de l’agence de la presse moyenne suisse, S. Haas) ajoutèrent à leur programme l’exigence du limogeage de Robert Grimm de la direction de la section « énergie et chaleur » de l’économie de guerre, ainsi que celle de rapports plus étroits avec l’Allemagne, ce qui souligne le paradoxe de la mutation des isolationnistes : c’est d’alignement, à tout le moins d’adaptation aux exigences du plus fort, dont il s’agit désormais, et non plus de neutralité, et l’organisation conservatrice des années trente se mue en lobby pro-allemand. En même temps, les services allemands déploient une intense activité auprès de toutes les instances officielles suisses utiles, notamment celles qui touchent aux domaines de l’information et à son contrôle politique. C’est ainsi que Klaus Hügel, représentant de l’Alemannischer Arbeitkreis (et agent de la Gestapo) noue des contacts avec la division « presse et radio » et avec le Département politique fédéral. Le 19 mai, l’Alemannischer Arbeitkreis avait mis la dernière main à un plan très détaillé, sur le modèle de ce qui se produisit en Autriche avant l’Anschluss, de contrôle de la presse helvétique et de « nazification » de la Suisse alémanique, en préalable sans doute à son annexion pure et simple à la Grande Germanie.
Enfin, parallèlement à cette « réactivation » de l’extrême-droite après la défaite française, se développe un mouvement visant à la « réorientation » des rapports et des échanges extérieurs de la Suisse et à un apaisement des tensions avec l’Allemagne –un « apaisement » prenant la forme d’un alignement, et des « tensions » provoquées par l’Allemagne elle-même. Les milieux d’affaire sont en première ligne sur ce « front »-là : le 1er juin déjà, l’ancien Conseiller fédéral Schulthess s’était déclaré prêt à contribuer à un accroissement des rapports germano-suisses. Une « politique d’apaisement systématique envers l’Allemagne » (Ruffieux, p. 408) était évidemment le prix à payer pour la poursuite des affaires avec un « grand voisin » qui, désormais, encerclait presque totalement la Suisse (la moitié, puis dès 1941 la totalité, de la France étant occupée, l’Italie étant vassalisée, l’Autriche ayant été annexée). Que Schulthess se soit fait l’avocat d’une telle politique, alors qu’il n’avait rien d’un « philonazi », n’a rien de surprenant : le même Schulthess avait pris position dans les années trente pour la reconnaissance du « fait soviétique », pour les mêmes triviales raisons économiques : s’assurer des débouchés, des marchés, des sources d’approvisionnement extérieurs. Mais si, pour un Schulthess, le pragmatisme économique est de règle, pour d’autres il s’agit bel et bien d’alignement idéologique.
Le 29 août 1940 se tint chez l’industriel zurichois Franz Meyer une réunion à laquelle participent à la fois des hommes d’affaires, des journalistes et publicistes, des responsables d’organisations d’extrême-droite, ainsi que le Conseiller fédéral Wetter. Objet du conclave : « jeter un pont entre les intérêts matériels et les mobiles idéologiques » (ibid.) ; on ne saurait mieux dire la connivence qui s’instaurait entre ceux qui songeaient à « nazifier » la Suisse et ceux qui voulaient faire le plus d’ « affaires » possibles avec l’Allemagne. Le 23 septembre, nouvelle réunion du même genre, dans la banlieue de Winterthur ; cette fois se retrouvent le « gestapiste » Klaus Hügel (en tant que représentant de l’Alemannischer Arbeitkreis), des représentants du Volksbund et un représentant du grand patronat, Jenny, membre du Vorort. Le résultat politique de ces conciliabules, on le trouve dans la pétition remise le 15 novembre 1941 au Conseil fédéral, munie de 195 signatures, par le Volksbund. A ces 105 signatures s’en ajoutèrent 45 en décembre, puis 23 au printemps suivant :
ü On y trouvait une très large majorité d’Alémaniques appartenant aux carrières libérales, aux affaires et revêtant souvent des grades à l’armée, ainsi que quelques parlementaires. Le Volksbund avait fourni le gros des troupes, et la Suisse romande y apparaissait par quelques hommes qui ne cachaient pas leur sympathie envers l’extrême-droite.
Que demandait la pétition du Volksbund ? Elle reprenait les revendications émises en juillet 1940 (contrôle de la presse –revendication prioritaire-, fin de la répression des activités politiques de l’extrême-droite, réforme globale des institutions dans un sens corporatiste) et y ajoutait l’exigence d’une « épuration » du personnel politique, épuration à effectuer évidemment à gauche et à commencer par Robert Grimm, ainsi que la « réhabilitation » de ceux qui, à l’extrême-droite, avaient eu à « souffrir » de quelque répression de leurs activités. Pour faire bon poids, le Volksbund demandait enfin le développement des relations culturelles avec les « peuples voisins » (en fait, surtout avec l’Allemagne, et un peu avec l’Italie) et, sans oublier d’enfoncer une porte déjà brisée en exigeant la sortie de la Suisse de la SdN, réclamait le retour à une « neutralité intégrale » que la satisfaction des autres revendications de la pétition eût rendu illusoire, puisque toutes concouraient à la vassalisation de la Suisse par l’Allemagne nazie.
Le Conseil fédéral refusa la pétition, mais avec une certaine gêne, en se gardant bien de rendre son refus public (il le communiqua oralement au premier des signataires, von Sprecher). Attitude ambiguë, d’autant qu’il aurait été facile de répondre aux auteurs de la pétition que leurs demandes, dont la plupart étaient illégales, voire anticonstitutionnelles, ne pouvaient être satisfaites par un gouvernement dont la fonction était de maintenir l’ordre constitutionnel et légal existant. La pétition elle-même ne fut même pas rendue publique par ses auteurs, et il faudra attendre 1946 pour qu’elle soit publiée –par la gauche. Elle soulèvera une vive indignation, guère surprenante un an après la chute du Reich, quand on ne prenait plus guère de risque à s’indigner. Qu’en aurait-il été en cet hiver 1940-1941, ou à l’automne 1941, lorsque les nazis semblaient avoir partie gagnée ? La démarche des pétitionnaires n’en fut pas moins significative de l’état d’esprit de la droite « collaborationniste » du moment, persuadée qu’une « pichenette » pouvait désormais abattre un système (la démocratie représentative, toute bourgeoise qu’elle fût) dont elle ne voulait plus, et qu’elle pensait pouvoir, à brève échéance, remplacer par l’autoritarisme conservateur, corporatiste et répressif dont elle rêvait : en somme, une sorte d’ « helvéto-fascisme » comme il y eut un « austro-fascisme »…
La pétition dite « des 200 » (qui n’étaient en réalité que 173( fut adressée au Conseil fédéral avec l’assentiment des services allemands, continuellement informés de sa préparation, de son élaboration et de ses effets. En même temps, ces services continuaient de tenter une coordination, voire d’impulser un regroupement, des diverses organisations d’extrême-droite suisses, le Volksbund n’étant pas leur seul partenaire. Ils ne renonçaient donc pas à voir émerger en Suisse une grande force politique qui leur fût acquise. C’est ainsi qu’après avoir encouragé la création en 1939 du Führerkreis, le SD (Service de sécurité) de Stuttgart et le Consulat allemand de Zürich encouragèrent en juin 1940 la fondation du Mouvement national suisse, et la campagne d’ « agit-prop » lancée le mois précédent par l’Aktionskomitee für die eidgenössische Erneuerung.
Le Mouvement national suisse, qui ne cachait pas son intention d’instaurer un régime de type national-socialiste en Suisse, ni sa volonté de l’aligner sur le « grand frère » allemand, était organisé sur le modèle du NSDAP, mais un NSDAP sans Führer, faute de personnalité charismatique et faute des circonstances qui poussèrent Hitler sur le devant de la scène politique allemande. Ce modèle, répétons-le, est une caricature du modèle bolchevik, léniniste : structure hiérarchisée, direction politique forte, organisation paramilitaire (la « Jeunesse nationale suisse »), formation des adhérents. La stratégie du MNS fut en réalité fixée par les Allemands, et son projet se réduisit finalement à l’Anschluss de la Suisse au Reich. Restait à déterminer les voies et les méthodes d’un tel projet ; or, entre le « putschisme » préconisé par l’Alemannischer Arbeitkreis et le « grignotage » suggéré par le SD et les diplomates allemands, il y avait pour le moins contradiction stratégique –une contradiction résolue, faute sans doute de moyens pour un putsch, par le choix du « grignotage » : l’ « esprit de résistance » à l’Allemagne n’apparaissait en effet pas tel à celle-ci qu’elle ne pût concevoir de le contourner ou le surmonter petit à petit, en faisant se succéder des démarches partielles, des mesures en apparence prudentes et raisonnables, mais dont l’accumulation produirait finalement un effet considérable –un « saut qualitatif », en langage léniniste. Des petits pas, certes, mais des petits pas de l’oie, tout de même. Les contacts avec les milieux dirigeants suisses et les pressions exercées sur eux entraient évidemment dans le cadre d’une telle stratégie.
Le 10 septembre 1940, Pilet-Golaz accorda une nouvelle fois audience à des représentants de l’extrême-droite helvétique –ceux, cette fois, du Mouvement national, non sans que le Conseiller fédéral Wetter et le colonel Wille ne l’y aient vivement incité. Les représentants du MNS (Schaffner, Hoffmann, Keller) jurèrent leurs grands dieux que le MNS était indépendant de l’étranger et dénué de toute intention subversive ; ils affirmèrent par la suite que Pilet-Golaz leur avait assuré que les activités du MNS serait reconnues comme légales. Les dirigeants du mouvement consignèrent dans une lettre au président de la Confédération, qui lui fut adressée après l’entretien comme s’il ne s’agissait que d’en confirmer les termes, les points essentiels de leur « catalogue de revendications » : légalisation du mouvement, liberté de publication, réhabilitation des militants « victimes » de mesures répressives. Le 12 septembre, la radio allemande rendit public un communiqué du MNS qui révélait l’audience obtenue de Pilet et la présentait comme le début de l’ « assainissement » de la situation politique suisse. Comme on s’en doute, la gauche protesta avec véhémence contre cette nouvelle compromission du Président de la Confédération (et, au-delà de lui, du Conseil fédéral) avec l’extrême-droite « philonazie » ; elle ne fut pas seule à élever la voix : avec un bel ensemble, tous les membres de la commission des pouvoirs extraordinaires protestèrent contre le geste du gouvernement, d’autant que la veille Pilet-Golaz s’était illustré par un discours très « anglophobe » (tropisme pétainiste…), qui avait suscité une réplique très « anglophile » des socialistes. Le 18 septembre, Pilet doit devant le Conseil national subir la critique non seulement des socialistes, mais aussi de nombreux députés de droite, notamment de radicaux. Roland Ruffieux :
ü L’autorité du gouvernement est ébranlée par les pourparlers engagés avec le MNS. D’autre part (…) l’impression est que le Conseil fédéral incline à composer avec des gens qui ne font pas mystère de leur admiration pour l’Allemagne nazie.
Les audiences accordées en 1940 par le Président de la Confédération à des représentants de l’extrême-droite semblent, avec le recul, d’autant plus surprenantes que cette extrême-droite patauge dans la division, se révèle incapable de tirer le moindre parti d’une situation internationale qui devrait lui être favorable et n’arrive pas à surmonter les rivalités et les concurrences qui la traversent et la frappent d’une sorte de scissiparité compulsive qui la condamne à l’impuissance (et à quoi l’on ne peut guère comparer que la situation du « gauchisme » finissant de la fin des années septante…). Les Allemands ont beau s’en désoler et inciter leurs disciples helvétiques à l’unité et à la fusion, rien n’y fait. Au bout du compte, l’extrême-droite « philonazie » (et sa version « philofasciste » tessinoise) n’eut jamais la crédibilité, l’efficacité et l’implantation suffisantes pour représenter une réelle menace, « à l’autrichienne », pour la Suisse ; bien plus dangereuses furent, motivées le plus souvent par des intérêts fort peu idéologiques, les connivences entretenues avec l’Allemagne par une partie du grand patronat et, autour des Wille, de la hiérarchie militaire. Un début de coordination des divers groupements d’extrême-droite fut toutefois mis sur pieds le 22 octobre 1940 : le Mouvement national suisse recueille sur ce point l’adhésion des chefs de deux autres organisations d’extrême-droite, l’ESAP et le BTE, mais les autres groupes (la « Société des amis de la démocratie autoritaire, SGAD, et l’Eidgenossische Sammlung, notamment) refusent. Cette allergie à l’unité et cette inconsistance politique n’empêcheront nullement le MNS de réitérer, dans une lettre au Conseil fédéral le 12 novembre 1940, les exigences déjà formulées deux mois auparavant. Mais l’opinion publique avait été alarmée par les rencontres précédentes ; le Volksrecht socialiste, en publiant les statuts du MNS, avait mis en évidence leur gémellité avec ceux du parti nazi et, le 19 novembre, le Conseil fédéral dut se résoudre à prononcer l’interdiction d’un mouvement dont il avait quelques semaines auparavant rencontré les chefs (Pilet-Golaz étant en ces rencontres le représentant du Conseil fédéral). Les Allemands eux-mêmes ne virent en cette interdiction nul prétexte à taper du poing sur la table : ils avaient sans doute fait leur deuil du « grand mouvement national-socialiste suisse » à la création duquel ils avaient tenté d’œuvrer et qui, décidément, s’avérait impossible. Après tout, les pressions directes sur le gouvernement fédéral étaient encore le moyen le plus efficace d’obtenir de la Suisse qu’elle ne fît rien qui pût gêner le IIIe Reich, ou qu’elle fît ce qui pouvait lui complaire, ainsi qu’on le verra à propos de la politique d’asile. Les services allemands ne renoncèrent évidemment pas être actifs en Suisse, mais l’action individuelle se substitua aux tentatives d’actions collectives, les activités d’espionnage et de sabotage à la subversion politique. Et c’est finalement de la droite la plus traditionnelle, la moins « philonazie » que provint l’ « ultime vague de révisionnisme » -et l’alarme qu’elle suscita, à gauche, ne fut pas moindre que lors des précédentes tentatives d’ « alignement » de la Suisse sur l’Allemagne.
A la fin de l’été 1940, les radicaux genevois demandent la suppression de la représentation proportionnelle, coupable de donner à la gauche (et, à Genève, à la « gauche de la gauche « , même interdite) un poids politique et parlementaire correspond à son poids électoral, et donc excessif aux yeux de forces politiques se concevant comme les détentrices naturelles du pouvoir. Les libéraux vaudois font un pas supplémentaire, et ^proposent l’instauration en lieu et place de la démocratie semi-représentative et semi-directe d’un système corporatiste (la « représentation professionnelle », dont le faîte serait une sorte de Landamann. Cette poussée de fièvre « révisionniste » au sein de la droite traditionnelle, bien dans la ligne de la Ligue Vaudoise, succédait donc aux démarches du Volksbund et du Mouvement national suisse. Le « révisionnisme » de la droite va susciter une vigoureuse contre-offensive, des socialistes d’une part, de l’Alliance des Indépendants de Gottlieb Duttweiler, alors allié des « nicolistes », d’autre part.
Le 1er août 1940, le Parti socialiste suisse lance un « Manifeste au peuple suisse » : il y clame sa volonté de « résistance » -une volonté évidemment totalement contradictoire des tentatives de droite d’ « adaptation » de la Suisse à l’ « ordre nouveau » et de remise en cause de la démocratie et du pluralisme politique. Le manifeste socialiste insiste au contraire sur la défense et l’extension des droits démocratiques, le soutien à l’armée (et à la mobilisation générale) en tant qu’elle peut être un rempart contre les tentatives d’agression allemandes, et sur la protection des travailleurs. Il exprime également le vœu d’un gouvernement représentatif de « toutes les couches de la population » (Ruffieux, op.cit. p. 416), manière de reposer la candidature d’un socialiste au Conseil fédéral, après le dépôt en 1939, par les socialistes, d’une initiative populaire demandant l’élection du Conseil fédéral par le peuple (l’initiative sera rejetée).
Quant aux Indépendants de Duttweiler, ils se lanceront dans une contre-offensive encore plus hardie que celle des socialistes, contre le gouvernement fédéral –auquel eux n’aspirent pas à participer, ce qui contribue certainement à expliquer la plus grande radicalité de leur opposition au Conseil fédéral et à la majorité « bourgeoise », électrice dudit Conseil. Au Conseil national, Duttweiler exige rien moins que la démission de Pilet et, entraînant avec lui le PSS et les « Jeunes paysans », refuse de souscrire à une déclaration d’apaisement concoctée par les parlementaires « bourgeois » ; pour sa « mise en accusation » du Président de la Confédération, Duttweiler utilisa des informations dont il disposait en tant que membre de la Commission parlementaire des pouvoirs extraordinaires, ce qui lui valut d’en être exclu le 3 octobre 1940 pour violation du secret de fonction, en réponse à quoi il claque avec fracas la porte du Conseil national. Le 24 septembre 1940, le congrès (Landestag) de l’Alliance des Indépendants (Landesring) avait élargi l’angle d’attaque et proposé deux réformes des institutions : d’abord, en réponse à la proposition socialiste d’élection du Conseil fédéral par le peuple, le congrès propose de soumettre au peuple la réélection des Conseillers fédéraux désireux d’exercer un second (au moins) mandat après celui, initial, qui leur aurait été confié par l’Assemblée fédérale ; ensuite, les Indépendants proposent de réduire le nombre des Conseillers nationaux de moitié (de 200 à 100), de limiter à trois mandats successifs leur droit à être réélus et de leur imposer l’obligation de déclarer leurs liens économiques : on reconnaît, dans ces trois propositions une conception finalement assez « social-démocrate » du parlement –une conception qui sera rejetée par les citoyens le 3 mai 1942, dans une proportion de deux « non » pour un « oui ».
Le débat politique est à ce moment d’autant plus tendu qu’il se déroule sur fonds de successions gouvernementales : en juillet 1940, Rudolf Minger avait été brillamment élu à la vice-présidence de la Confédération alors que déjà circulaient des bruits sur sa prochaine démission ; le Conseiller fédéral Baumann était lui aussi donné partant, et la position politique du Président de la Confédération, le désormais très controversé Pilet-Golaz, était plus que vacillante. En décembre 1940, une double élection est rendue nécessaire par la double démission de Minger et de Baumann. Le siège agrarien (celui de Minger) est attribué au premier tour à von Steiger, contre le socialiste Bratschi (130 voix contre 56) ; le siège radical (celui de Baumann) est plus incertain, et la bataille plus confuse : six candidats se présentent (cinq radicaux et un libéral neuchâtelois), et il faudra cinq tours de scrutin pour que le Saint-Gallois Kobelt soit élu ; ça n’est pas une crise gouvernementale, mais c’est tout de même la manifestation d’une incertitude politique évidente, et d’une faiblesse de la classe politique majoritaire dans une situation qui exigeait des choix clairs et des volontés fermes. La seule fermeté dont fit alors preuve la majorité « bourgeoise » du parlement fut celle du refus d’entrer en matière sur le « manifeste » socialiste du 1er août 1940, au nom d’une orthodoxie financière et budgétaire que la mise en œuvre des aspects sociaux et économiques du manifeste (pourtant placé sous le signe de la défense nationale, mais la concevant comme celle des Suisses et de leurs droits fondamentaux, politiques et sociaux, et non comme celle de « la Suisse en soi ») remettrait évidemment en cause. Cet attentisme social, s’ajoutant aux inconstances politiques du gouvernement et à la force, en son sein, des tentations d’adaptation à l’ Europe « nazifasciste », nourrira la dénonciation par la gauche du manque de courage des gouvernants de l’ « Helvétie encerclée ».
En 1944, le tout récent Parti du Travail qualifiera de « profasciste » la politique de la majorité bourgeoise depuis les années trente, et fournira à l’appui de cette accusation un vaste catalogue d’actes et de discours (de « faits » et de « documents ») plus ou moins explicitement « fascisants » ou « philonazis ». Au point où nous en sommes, nous pouvons rendre compte de cet acte d’accusation (univoque comme tout acte d’accusation, mais pas injuste) :
ü Depuis l’avant dernière guerre, le gouvernement fédéral a mené une politique qui –fatalement- devait nous conduire à l’isolement dans lequel se trouve aujourd’hui notre pays. (…) Depuis plus de vingt ans, nous répétons inlassablement : Reconnaissez l’Union Soviétique, le grande république ouvrière et paysanne. Le fascisme, c’est la guerre et la ruine de l’Europe. Eloignez-vous du fascisme. Eloignez-le de chez nous. Nous n’avons pas été entendus, hélas ! Du moins, pas assez tôt. On a voulu ignorer la puissance russe. On l’a couverte de sarcasmes et d’injures. On a acquitté des assassins, tel Conradi. On s’est opposé à l’entrée de l’URSS dans la SdN. On a saboté les sanctions. On a soutenu et reconnu Franco. On a reconnu l’empire * d’Ethiopie. (…) On a interdit successivement le Parti communiste, le Fédération socialiste suisse, leurs journaux, toute activité de leurs membres. On a voulu en faire des parias. On a brimé les prisonniers russes et yougoslaves. On a ignoré la Résistance française, serbe ou croate… « On » ? Qui, « on » ? Le Conseil fédéral tout entier, et non point tel ou tel de ses membres.
* c’est-à-dire l’imperio italien
Désormais, ou à nouveau (puisqu’ils le
furent dans la Fédération Socialiste Suisse) réunis (pour quelques années
encore), communistes et socialistes de gauche accusent le gouvernement dans son
ensemble : Motta et Pilet-Golaz ne sont pas plus « coupables »
que leurs collègues, s’ils furent plus explicites ; il y a une continuité
et une collégialité dans la politique du Conseil fédéral, et elle est, au moins
jusqu’en 1943, « profasciste ». Le PdT a beau jeu, en 1944, de
rappeler les errements passés de ses adversaires en commençant la longue
litanie de citations qu’il produit par celle d’un discours de Motta au Conseil
national, le 24 juin 1927 déjà, lors duquel le ministre des Affaires étrangères
de la Confédération réitère son refus –et celui du gouvernement- de reconnaître
de jure le gouvernement soviétique ; suit une autre référence à un
autre discours du même Motta -la gauche « socialo-communiste »
ayant la rancune tenace-, tenu sept ans plus tard, le 17 septembre 1934 à la
SdN et exprimant l’opposition de la Suisse à l’admission de l’URSS à la
SdN : « le communisme soviétique combat l’idée religieuse et la
spiritualité sous toutes ses formes. (…) Le communisme dissout la
famille ; il abolit les initiatives individuelles ; il supprime la
propriété privée (…). Le communisme russe aspire à s’implanter partout. Son but
est la révolution mondiale. (…) il devient l’ennemi de tous, car il nous menace
tous ».
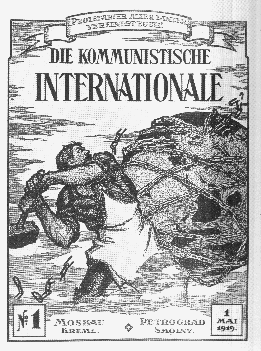 Motta, encore, le 10 juin 1936, dans un discours auquel on ne
pourra pas aujourd’hui dénier quelque sagacité, quoique cette sagacité soit
politiquement hémiplégique :
Motta, encore, le 10 juin 1936, dans un discours auquel on ne
pourra pas aujourd’hui dénier quelque sagacité, quoique cette sagacité soit
politiquement hémiplégique :
ü Staline est le secrétaire général du Parti communiste russe, le membre le plus influent du Comité directeur de la Troisième Internationale, et il est en même temps membre du gouvernement central soviétique. Rien d’important ne peut se faire en Russie sans son consentement. Il est l’incarnation de la dictature moscovite. Il y a donc, entre le gouvernement soviétique et le parti communiste, identité partielle de personnes et solidarité inextricable d’idées et d’intérêts *. C’est bien cette solidarité matérielle et morale que l’on vise lorsqu’on parle de l’influence de Moscou, influence qui, pour les amateurs de métaphores, se concrétise dans l’image de la main de Moscou.
* Nous aurions quant à nous plutôt
parlé d’une « identité inextricable de personnes » et d’une
« solidarité partielle d’idées et d’intérêts »…
Qu’un tel discours ne soit pas du goût du Parti du Travail en 1944 –un parti formé des « prosoviétiques » exclus du PS avec Léon Nicole et des communistes interdits- n’a rien de surprenant ; ajoutons que, tenu par Motta en 1936, avant la grande purge de l’Armée Rouge, le pacte germano-soviétique, l’assassinat de Trotski et l’invasion de l’URSS par les forces de l’Axe, un tel discours ne pouvait plus être tenu en 1944 ; non que l’URSS ait changé de nature ou que la droite fût subitement séduite par elle : il se trouve, plus trivialement, que l’URSS a en 1944 le « vent en poupe » et l’Allemagne le naufrage en vue, et que le gouvernement suisse a pris depuis 1939 la girouette pour modèle –et l’on sait, avec Edgar Faure, que « ce n’est pas la girouette qui tourne, mais le vent »…
Le document du Parti du Travail égrène ainsi les extraits de discours de Motta, non sans insister sur les faveurs accordées à Hitler, comparées à l’opprobre dont Staline est frappé. Motta choisit son ennemi (le communisme) à défaut de pouvoir choisir ouvertement son camp (le fascisme), et rend compte favorablement de l’entrevue Schulthess/Hitler de 1938 :
ü L’interlocuteur suisse s’est loué de la franchise et de la hauteur de vue que manifesta l’éminent personnage qui lui avait accordé audience (…) Les déclarations que M. Adolphe (sic) Hitler, Chancelier du Reich, porte-parol,e légitime et autorisé d’un régime nouveau issu d’un des plus grands mouvements de l’histoire, a faites à l’ancien Conseiller fédéral, M. Edmond Schulthess, le 23 février (…) sont venues, pour ainsi dire, parfaire le cercle amical de nos quatre * voisins.
* La Suisse a encore, mais seulement
pour quelques mois, quatre voisins. D’ci peu, le « régime nouveau issu
d’un des plus grands mouvements de l’histoire » annexera l’Autriche… Puis
il vassalisera l’Italie. Et finalement envahira la France. De « quatre
voisins » à, de fait, un seul…
Toujours Motta, à Lugano, le 2 octobre 1938, et parlant cette fois de Mussolini :
ü Lasciatemi salurare, con umana riverenza, il grande capo del paese vicino, Benito Mussolini, che (…) per meravgliosa intuizione della mente e per sovrana potenza della volontà, (…) si è acquistato titoli insigni di benemeranza incancellabile che solo i miopi o i fanatici dalla mente torbida oserebbero ancora di contestare.
Motta n’est pas la seule cible des attaques du Parti du Travail en 1944 –d’autant que, mort depuis quatre ans, il n’est plus guère qu’un adversaire symbolique. Le nouveau parti s’en prend à tous ceux qui tinrent des discours comparables, voire plus clairement encore « profascistes », et en particulier à ceux qui appelèrent à l’alignement sur le fascisme et le nazisme. Ainsi des Conseillers nationaux Vallotton et Gorgerat, ce dernier déclarant :
ü S’il fallait abandonner la neutralité, je pencherais beaucoup plus du côté de l’Italie, berceau de notre civilisation latine et occidentale, plutôt que du côté de l’Ethiopie, pays de sauvages, même s’ils sont dirigés par de prétendus descendants de la reine de Saba.
Ainsi, également, du Conseiller aux Etats et futur Conseiller fédéral Etter, en 1934 :
ü Je considère qu’il n’est pas exclu que le fascisme, dans ses éléments sains, puisse conduire à renforcer l’autorité et l’ordre, et à une meilleure organisation de l’Etat. La démocratie est d’autant meilleure qu’elle se rapproche de l’aristocratie dans sa constitution intérieure.
Le Parti du Travail va s’attacher ensuite à relater les activités de Théodore Aubert et de ses ligues anticommunistes. Aubert est en effet un personnage dont la rage « antisoviétique » ne se démentira jamais –mais dont le PdT surestime peut-être l’influence. Conseiller national libéral, Aubert fonde vers 1935 un Institut International d’Action Antibolchéviste ; il avait été en novembre 1923 le défenseur de Polounine, co-accusé de Conradi. Sa comparaison entre Conradi et Guillaume Tell avait suscité l’approbation enthousiaste des Basler Nachrichten :
ü Tous deux ont tué un tyran. Le bolchévisme est le plus grand crime de l’histoire mondiale. Quel soulagement ce serait dans les cœurs de l’humanité tout entière si, un beau jour, on pouvait annoncer que d’autres chefs bolchévistes ont été assassinés.
Inutile sans doute d’ajouter qu’on attendra vainement pareil éloge du meurtre politique, sous la même plume ou dans le même journal, et dans les mêmes milieux, lorsque se posera la question du « tyrannicide » de nazis… A la suite du procès Conradi, Théodore Aubert fonda l’Entente Internationale contre la Troisième Internationale, ou Entente Internationale Anticommuniste, dite « Ligue Aubert », dont le but était non seulement de combattre toute reconnaissance du gouvernement soviétique mais aussi le « renversement définitif du gouvernement bolchéviste » et l’institution d’un « Conseil pour la reconstruction de la Russie ». Aubert déploya de grands efforts pour faire reconnaître son organisation, n’hésitant ni à faire un « tour d’Europe » peu après la prise du pouvoir par Hitler, ni à participer en qualité de président de sa Ligue à un grand meeting « antibolchéviste » organisé par sa filiale allemande (il en existait une autre, dans la Hongrie de Horthy). La « Ligue Aubert » disposait d’un Comité financier (ou comité de patronage) au sein duquel siégeaient de nombreux représentants de la droite traditionnelle : le Conseiller d’Etat neuchâtelois Béguin, le banquier bâlois Brugger, les colonels Guillaume Favre et de Goumoëns (ce dernier étant au surplus vice-président de l’entreprise Oerlikon), l’industrie zurichois Hurlimann, le Conseiller d’Etat fribourgeois Perrier et son collègue bernois (et futur Conseiller fédéral) von Steiger.
L’essentiel de l’activité de la « Ligue Aubert » se déroulait à découvert, et consistait en un combat « antisoviétique » public, sur les terrains politique et économique, par la publication de brochures et d’articles dans les journaux « bourgeois », par l’organisation de conférences et l’invite constante à se prononcer par les voies électorales contre les candidats et les propositions « prosoviétiques ».
Le 8 juin 1932 naquit une sorte de succédané confessionnel de la « Ligue Aubert » : la « Ligue pour le Christianisme », dite « Ligue Champod » du nom de son fondateur. Base idéologique comparable, mais discours différent (ici, la défense des « martyrs » chrétiens victimes des persécutions du pouvoir soviétique) et « cible » différente : La « Ligue Aubert » s’adressait aux milieux dirigeants de la politique et de l’économie, la « Ligue Champod » à l’opinion publique dans son ensemble. Ainsi recueillit-elle 200'000 signatures au bas d’une pétition protestant contre les persécutions religieuses (anti-chrétiennes : peu lui chalaient les persécutions dont étaient victimes les juifs, les musulmans et les animistes). Le premier signataire de l’appel de lancement de la « Ligue Champod » fut le Conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz ; son nom fut suivi de celui de son collègue Minger et de ceux des Conseillers d’Etat vaudois Dubuis, Fazan et Bujard, genevois Moriaux et Naef, neuchâtelois Borel et Béguin, du Bâlois Dürrenmatt et du vice-président de la Croix-Rouge suisse, Dunant. La « Ligue Champod » était particulièrement active dans les milieux protestants, d’où elle était issue ; les catholiques, eux, étaient « travaillés » par le vicaire Ackermann, sur un ton où l’antisoviétisme le disputait à l’antisémitisme et à l’anti-maçonnisme, le tout sur fond de francophobie.
Dans le tableau peint en 1944 par le Parti du Travail, et dont le sujet était la droite helvétique, les lignes de l’antisoviétisme se mêlent constamment à celles du « philofascisme » : c’est de l’entrelacs de ces lignes qu’émerge la politique « profasciste » que dénonce la gauche « socialo-communiste ». A la « Ligue Aubert » et à la « Ligue Champod » s’ajoute encore, dans le décor du tableau, Jean-Marie Musy et ses « réseaux d’influence », dont l’Action Suisse contre le communisme, qui avait pour secrétaire un pur et simple nazi, Franz Riedweg (Sturmbahnführer SS, affirme le PdT), ancien secrétaire privé, et gendre, du Feld-maréchal von Blomberg : ce double citoyen allemand et suisse fut privé de sa nationalité suisse par le Conseil fédéral… en 1944. Quant à Musy, Conseiller fédéral de 1919 à 1934, catholique réactionnaire fribourgeois, éditeur et directeur du journal La Jeune Suisse, il fut l’un des adversaires les plus acharnés de tout ce qui pouvait ressembler à une quelconque reconnaissance du fait soviétique. Cet acharnement, ajouté à son fonds politique catholique « intégriste » (pour user d’un qualificatif anachronique) le fit progressivement glisser vers l’acquiescement au fascisme.
Le Parti du Travail ne manquera évidemment pas de dénoncer les tendances à l’accommodement avec le nazisme, telles qu’exprimées par Pilet-Golaz dans son fameux discours du 25 juin 1940 (tenu en un moment où la ligne communiste, pacte germano-soviétique régnant, renvoyait dos à dos les « impérialismes concurrents » allemand et anglo-saxons). Le PdT attribuera à l’influence fasciste les mesures prises par le Conseil fédéral, de contrôle des assemblées et d’interdiction de partis et de journaux de gauche (la Freiheit) de Bâle, le Travail de Genève, le Droit du Peuple de Lausanne), et mettra en relation la réception des « frontistes » du MNS par le Conseil fédéral en septembre 1940 et l’interdiction du PC en novembre, puis de la Fédération socialiste suisse, le 27 mai 1941. A toutes ces décisions, le PdT trouvera une origine commune : l’antisoviétisme. L’argumentation développée par le Conseil fédéral dans son arrêté du 5 juillet 1940 (interdiction du Travail et du Droit du Peuple) confirme d’ailleurs cette hypothèse :
ü Les deux journaux appuient sans réserve le mouvement bolchéviste (…). Ils reproduisent littéralement un grand nombre d’articles de journaux communistes étrangers (…). Par cette propagande, en particulier par leur apologie sans réserve des fins véritables du bolchévisme et par les articles excitateurs susmentionnés, ils compromettent, dans les circonstances actuelles, tant la sûreté intérieure que la sûreté extérieure du pays.
Cet anticommunisme viscéral du Conseil fédéral se trouve comme justifié par celui de la grande presse suisse (presse socialiste comprise, à l’exception des journaux « nicolistes »), en plus d’être évidemment encouragé par l’Allemagne et l’Italie. C’est le Bund de Berne qui, le 12 novembre, compare Conradi à Guillaume Tell, et donc les diplomates soviétiques aux baillis des Habsbourg ; ce sont les Basler Nachrichten qui, le 21 juin 1941, prévoient une victoire allemande en Russie dans un délai d’un mois et demi, et la Neue Zürcher Zeitung du surlendemain qui exprime son absence de toute sur la victoire allemande ; c’est le Journal de Genève du 30 novembre 1940 qui définit les communistes comme les « hôtes nés des camps de concentration » ; c’est la Tribune de Lausanne du 9 août qui croit pouvoir annoncer que le « facteur russe » ne sera pas l’une des données déterminantes de l’ « Europe nouvelle », et la Gazette de Lausanne du 11 juillet 1941 qui proclame fièrement qu’en ce qui concerne la lutte contre le communisme, « la Suisse mérite d’être citée au premier rang ». Du côté socialiste « officiel », on ne fait pas non plus dans la dentelle : E.-P. Graber qualifie la révolution bolcheviste (qu’il avait pourtant à l’époque saluée) d’ « espérance burlesque et tragique » (tragique, certes, mais pourquoi, et en quoi, burlesque ?) et de « nourriture pour minus habens » (Le Peuple du 14 mai 1941), et Paul Golay, puis André Oltramare, tous deux dans Le Peuple (18 mai 1941 et 31 juillet 1941) renvoient dos à dos, ou côte à côte, fascisme, nazisme et stalinisme…
Cette énumération pourrait être interminable ; après tout, aucune tendance politique, aucune organisation, aucun acteur institutionnel, aucun journal ne fut entre 1917 et 1945 préservé de la myopie ou d’une passagère cécité politiques, ni de quelque hémiplégie idéologique –les communistes et les socialistes de gauche pas plus que leurs adversaires. La victoires des Alliés et la part considérable qu’y prendra l’Union Soviétique donneront en 1944 des ailes aux « proscrits » de 1941 ; à l’inverse, elles plongeront dans un silence assourdissant et consterné ceux qui, dès juin 1940, se sont sentis appelés par l’histoire et les victoires allemandes à un destin national, ou qui, plus trivialement, se sont rangés publiquement du côté des plus forts du moment, et n’ont pu (ou voulu) retourner assez rapidement leur veste pour sembler ensuite s’être toujours vêtus d’atours démocratiques. On verra ce qu’il en fut des forces politiques qui se firent ouvertement les chantres de l’alignement sur l’Allemagne, et des hommes politiques qui cédèrent à cette tentation (ainsi du malheureux Pilet-Golaz, à qui l’on fera payer non seulement ses propres imprudences, mais aussi les inconséquences du Conseil fédéral in corpore et quelques ambiguïtés du Général par dessus le marché) ; on verra aussi le travail de « mythification » de la figure de Guisan, qui ne fut ni le dernier ni le moindre à céder aux tentations autoritaires –s’il les a exprimées, fonction oblige, plus discrètement que d’autres. Il vaut la peine, avant cela, d’évoquer ce qu’il en fut de certains « intellectuels » et de certains « cercles » culturels.