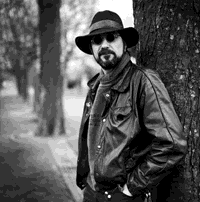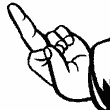

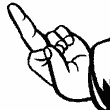

Le combat culturel
et politique contre les compromissions de la droite suisse

La xénophobie et l’antisémitisme de la
corporation littéraire suisse
Une Intelligentsia pusillanime, conservatrice,
antisémite et xénophobe
Staline : « Les Suisses sont des
porcs »
Dès la prise du pouvoir par les nazis en 1933, la chasse aux intellectuels s’était ouverte en Allemagne : juifs, « cosmopolites », « décadents », « dégénérés », communistes, socialistes, « asociaux », les créateurs sont pourchassés, privés de leurs emplois, privés des moyens de communiquer leur travail, et leurs œuvres souvent sont détruites, réellement ou symboliquement. Certes, l’avènement du fascisme en Italie, onze ans plus tôt, avait été accompagné de mesures semblablement régressives dans tous les domaines du champ culturel (une régression d’ailleurs assez souvent opérée au nom d’un certain « modernisme »), mais là encore, le nazisme surenchérit dans la démesure : c’est toute l’Intelligentsia allemande qui est visée, parce qu’elle est l’Intelligentsia, que ses membres soient nous non oppositionnels, qu’ils soient Untermenschen ou « aryens ». Des milliers d’enseignants, de chercheurs, de créateurs, sont contraints au silence, à la misère ou à l’exil. Nombreux sont ceux qui, se trouvant à l’étranger, décident d’y rester ; nombreux aussi sont ceux qui décident d’y fuir la vague d’analphabétisme raciste qui déferle sur l’Allemagne. D’entre ces exilés, nombreux aussi sont ceux qui choisissent la Suisse pour refuge (pour les mêmes raisons linguistiques qui poussèrent nombre d’intellectuels italiens à se réfugier au Tessin). Mais si l’accueil réservé par les intellectuels tessinois aux intellectuels antifascistes italiens fut, dans l’ensemble, marqué par la solidarité et l’entraide, telle ne fut pas la règle de l’accueil réservé par les milieux culturels alémaniques aux intellectuels allemands –réserve faite, évidemment, de l’Intelligentsia suisse de gauche. Ainsi des écrivains :
ü De 1933 à 1942, voire encore plus tard, la Société des écrivains suisses (SSE) a collaboré avec la Police fédérale des étrangers lors de l’examen de procédures d’asile d’écrivains allemands fuyant la répression nazie et les camps de concentration. Emettant des préavis (53 au total durant la période évoquée), parfois favorables mais aussi restrictifs, la SES a ainsi sauvé certains auteurs allemands mais en a condamné d’autres (Robert Musil par exemple) en les empêchant de vivre de leur plume en Suisse. Sans oublier ceux qu’elle a contraints à un exil aussi désespéré qu’improbable. Origine première de cette attitude : un corporatisme crispé mais aussi un fonds d’antisémitisme assez ouvertement exprimé.
Claude Chuard, Les affres du corporatisme, Le Courrier (Genève), 20 juin 1987
La société suisse des écrivains n’a pas attendu longtemps avant d’illustrer sa pusillanimité face au nazisme : en mai 1933 déjà, son Assemblée générale refuse d’adresser au gouvernement allemand une protestation contre les exactions dont les écrivains allemands antinazis (ou tout simplement non-nazis) sont victimes. La SES recommande bien à la Police fédérale d’accorder permis de séjour et permis de travail aux écrivains allemands persécutés pour des raisons politiques, mais c’est en donnant de la persécution politique une définition su restrictive qu’elle exclut, par exemple, ceux qui sont persécutés pour des raisons « raciales » -à commencer par les juifs ; et la SES de recommander la « fermeté » à leur égard : il faut « veiller à ce qu’ils n’inondent pas le marché suisse avec leurs produits ». La solidarité, même corporatiste (d’écrivains à écrivains) n’est certes pas la marque dominante d’une telle position, ni la qualité de la « production » culturelle le critère principal d’une sélection qui, finalement, s’opèrent en fonction de l’origine et par un réflexe éminemment protectionniste.
Le nazisme imposera un véritable monopole idéologique de publication et de diffusion de la création littéraire, en Allemagne d’abord, puis en Autriche, enfin dans tous les Etats contrôlés par le IIIe Reich. C’est toujours le modèle léniniste dont on s’inspire ici, mais un modèle caricaturé (peut-être même ne s’agit-il d’ailleurs plus que d’une « caricature de la caricature », puisque entre le léninisme et le nazisme sont passés à la fois le stalinisme et le fascisme, et que c’est peut-être le premier que le nazisme caricature, en poursuivant sur la lancée du second…). Le Reichsverband Deutscher Schriftsteller va fonctionner comme une « Union des Ecrivains » à l’allemande, et c’est avec lui qu’en automne 1933 les responsables de la Société suisse des écrivains (qui n’est, elle, qu’une association sans monopole légal d’aucune sorte) vont négocier l’ouverture du « marché » allemand aux écrivains suisses de langue allemands, juifs exceptés fussent-ils suisses).
Pendant la décennie qui suivra l’avènement du nazisme, la direction du SSE sera consultée par la police fédérale chaque fois qu’un écrivain allemand (puis, dès l’Anschluss, autrichien) demandera un permis de séjour ou sollicitera l’octroi de l’asile politique. De la SES, les autorités policières fédérales attendent qu’elle se prononce sur les qualités littéraires du candidat ; la corporation des écrivains suisses se transforme ainsi en instance de vérification de la valeur des écrivains allemands et autrichiens, et pour se faire « se fonde sur un annuaire allemand qui recense l’œuvre et la vie des gens de lettre germanophones. (…) Autant dire que les avis de la SES sont souvent sujets à caution » (Claude Chuard, art.cit.) dès lors qu’ils se fondent sur un annuaire édité par les nazis, en fonction de leurs propres critères et de leur propre conception de la « valeur » des écrivains allemands et autrichiens : on imagine ce qu’un tel annuaire pouvait écrire de « l’œuvre et la vie des gens de lettres » dont les nazis avaient brûlé les œuvres… La SES se trompant souvent, il lui arrive cependant parfois de le faire à l’avantage de certains réfugiés : ainsi Lisa Tetzner, qualifiée d’artiste « sérieuse » parce qu’on ignore son engagement à gauche, ou Raoul Hausmann, pourtant dadaïste et subversif. L’erreur, cependant, est plus souvent à charge qu’à décharge, et ne profite que rarement aux réfugiés antinazis –quand il arrive qu’elle permette à des partisans, ou des amis, du nazisme de se faire passer pour le contraire de ce qu’ils sont, ou de le cacher : tel fut le cas, par exemple, de B. von Brentano, qui demeura en Suisse de 1937 à 1949 et entretint durant toute la guerre d’étroits contacts avec les nazis…
Certes, la SES ne pourra, ni sans doute ne voudra, s’opposer à venue en Suisse (ou au passage par la Suisse) de quelques uns des plus grands écrivains antinazis : Thomas Mann n’aura rien à craindre d’elle… mais son fils, Golo Mann, aura moins de chance : en 1939, la SES s’oppose à son établissement en Suisse au prétexte que sa sœur, Erika Mann, avait provoqué un « scandale » en 1934 à Zurich lors d’un spectacle de son cabaret littéraire « Le Moulin à Poivre » ; le « scandale » fut en fait provoqué par des groupes d’extrême-droite au nom de la lutte contre la « canaille émigrée », mais la SES n’aime pas le désordre, et le craint autant que le « concurrence » des auteurs allemands pour les auteurs alémaniques.
La « corporation littéraire » alémanique intervint donc fréquemment auprès des services fédéraux (la Police des Etrangers, dirigée par Heinrich Rothmund) et cantonaux, voire municipaux, pour protéger le « marché du travail » littéraire suisse contre la « concurrence » des auteurs étrangers, et tenter d’empêcher les écrivains allemands d’occuper des postes de chroniqueurs et de feuilletonistes dans la presse alémanique. Ce corporatisme protectionniste n’est pas, dans les milieux culturels, le fait de la seule SES. En 1934, lorsque le grand éditeur allemand Fischer, poursuivi en Allemagne pour sa « judaïté », tente de s’installer à Zurich, il doit faire face à l’hostilité de la Société des libraires du canton et de l’Association suisse des libraires & éditeurs : « Il n’est pas souhaitable que les juifs étendent leur influence en Suisse, aussi bien sur le plan économique que culturel » -ou : de la rencontre du protectionnisme et de l’antisémitisme… Quant à la SES, si elle soutient la demande de Fischer, compte tenu de l’importance de l’éditeur pour la littérature de langue allemande (y compris, donc, la littérature de Suisse alémanique), elle propose de telles conditions à cette installation que celle-ci se révélera impossible : l’obligation pour Fischer de confier la moitié au moins de ses travaux à des imprimeurs suisses ne posait guère de problèmes, dès lors que les imprimeurs allemands n’auraient de toutes façons pas accepté, et pas pu, travailler pour lui), mais celle de n’employer que du personnel de nationalité suisse était totalement dissuasive. Finalement, Fischer ne pouvant s’établir en Suisse tentera de le faire en Autriche, en sera chassé par l’Anschluss et aboutira en Suède.
La SES ne se contente pas de donner des préavis à la police, elle s’en fait l’auxiliaire ; la SES dénonce ; elle dénoncera notamment le poète Bruno Schönlank, au prétexte qu’il publie en Suisse sous pseudonyme :
ü Ne faudrait-il pas exiger de tous les émigrés qu’ils signent leurs œuvres de leur nom ou de leur pseudonyme habituel ? Il est quelque peu choquant que ces Messieurs s’arrogent des noms à consonance suisse afin de tromper le public sur leurs origines. Nous les autorisons à publier chez nous, qu’ils soient donc au moins reconnaissables en tant qu’étrangers !
Cité par Otto Böni, in Société des Ecrivains Suisses, Ecrire pour vivre, Sauerländer, Aarau, 1987
S’agissant de l’écrivain Max Hochdorf, la SES fera un pas de plus, de la xénophobie (les étrangers doivent être « reconnaissables » comme tels, par leur nom) à l’antisémitisme : « Hochdorf appartient à ces polygraphes juifs qui écrivent sur n’importe quoi et n’importe qui suivant les courants de pensée à la mode » (cité par Claude Chuard, art. cit.). De même, lorsque Walther Victor, réfugié au Tessin, demande un permis d’établissement pour pouvoir s’occuper d’une revue touristique locarnaise, le secrétaire de la SES, Karl Naef, dénonce « l’émigrant juif » et les écrivains tessinois protestent contre cette « mainmise étrangère » (l’étrangeté, ici, réside-t-elle dans la nationalité de l’écrivain ou dans sa langue ? Victor est-il étranger parce qu’Allemand en Suisse, ou parce que germanophone au Tessin ?).
Il faudra attendre 1942-1943, c’est-à-dire les premières grandes défaites allemandes, pour que la SES commence à remettre en cause le protectionnisme xénophobe et le corporatisme antisémite dont elle s’était fait porteuse les années précédentes. Lors de l’assemblée générale de 1942 de la SES, le pasteur Rudolph Schmid dénonce la « clause de la concurrence », autrement dit la défense obsessionnelle du « privilège national » sur le « marché du travail » littéraire suisse, et proclame que la SES « ne peut en aucun cas reconnaître dans la police l’ange gardien de la littérature suisse » (cité par Otto Böni, in Ecrire pour vivre, op.cit.). La guerre terminée, « certains membres de la SES tourmentés par une tardive mauvaise conscience proposèrent que quelques écrivains étrangers particulièrement éprouvés dans leur santé puissent venir en Suisse se rétablir » (Claude Chuard, art.cit.). Le danger que fuyaient ces écrivains était pour la Suisse écarté, sans que la Suisse elle-même y fût pour grand chose. Une petite « épuration » suivra, qui ne concernera que quelques lampistes et ne touchera pas les dirigeants de la SES. Treize auteurs alémaniques seront entendus dans le cadre d’une enquête menée sur les sympathisants nazis e/o fascistes dans le milieu littéraire. John Knittel, particulièrement compromis, devra démissionner de la SES, Gonzague de Reynold et Fernando Chiesa échapperont de justesse à une enquête, d’ailleurs inutile puisque leurs sympathies fascistes étaient de notoriété publique, et ne subiront aucune sanction –le premier cité poursuivant une confortable carrière de « conscience » du conservatisme catholique. L’examen de conscience de la Nomenklatura littéraire suisse s’arrêtera là, et il faudra attendre 1987, année de la publication par la SES d’un ouvrage (Ecrire pour vivre ») faisant le point sur cette période douteuse de son histoire pour qu’une autocritique un peu plus sérieuse, et un peu plus sincère, soit faite.
Les errances politiques du « milieu » littéraire officiel suisse ne furent en réalité que symptomatiques des incertitudes idéologiques face au nazisme. Tout s’était passé comme si la Suisse officielle et ses majorités politiques, sociales et culturelles n’avaient cessé d’attendre de Hitler, du IIIe Reich et du national-socialisme, ce qu’ils n’avaient aucune intention d’offrir à qui que ce soit –et pas plus à la Suisse qu’à d’autres : des garanties de paix, des certitudes de respect de l’indépendance nationale et de non-traduction en actes de leurs discours paranoïaques. Sans doute Hitler était-il prêt à ne pas entrer en guerre contre la France et la Grande-Bretagne, du moins en 1939, mais à la condition qu’elles restassent neutres et impassibles pendant que l’Allemagne assurait à son profit presque exclusif (contre l’Italie même, le « presque » renvoyant au deal passé avec l’Union Soviétique entre 1939 et 1941) la « réorganisation » de l’Europe par tous les moyens utiles : annexion de l’Autriche, démantèlement de la Tchécoslovaquie, destruction (avec l’Union Soviétique) de la Pologne, vassalisation )partagée avec l’Union Soviétique) de l’Europe slave, de la Hongrie et de la Roumanie… Et de la Suisse, que voulait faire le IIIe Reich, qui à vrai dire pouvait en faire ce qu’il voulait ? La vassaliser aussi, sans doute, et il y réussira en partie, ou, au pire, la dépecer et la partager entre la « Grande Allemagne », l’Italie vassalisée et la France réduite à l’impuissance (ce projet de dépeçage, toutefois, ne semble pas avoir pris forme précise, concrète, exécutable : il était certes dans la logique de l’ « ethnisme » raciste des nazis, mais non dans leurs priorités, ni même dans leur intérêt.
Reste que, littéraire ou politique, la Suisse officielle ne fit preuve ni de plus de discernement, ni de plus de courage que le reste de l’Europe démocratique jusqu’en 1939, et de moins encore qu’elle de 1940 à 1943. Son Intelligentsia officielle est, de ce point de vue, la plus fidèle de ses images : pusillanime, conservatrice, quelque peu antisémite et surtout foncièrement xénophobe. La résistible ascension du nazisme la saisit d’une sorte de stupeur, qu’aggrava encore la certitude qu’il n’y aurait aucune opposition allemande efficace à Hitler tant que la défaite du Reich ne serait pas à l’horizon –et cette défaite, l’opposition allemande au nazisme, qui fut réelle quoi qu’en crurent les « observateurs » suisses, se refusera toujours à la favoriser, alors qu’elle était la seule solution à son problème. Pour autant, le milieu politique helvétique fut-il tout uniment aveugle et couard ? Non pas : la Guerre Mondiale fut même l’occasion d’une assez paradoxale et incertaine rencontre entre patriotes conservateurs, voire réactionnaires (dont Guisan fut un exemple) et la grande majorité des organisations et des militants du mouvement ouvrier.
S’il est évident que l’histoire de la Suisse pendant la Guerre Mondiale ne peut être analysée isolément des principaux aspects de la guerre, s’il est excessif de dire, comme Jon Kimche, que « la Suisse est Guisan furent des éléments essentiels du panorama européen », et s’il est finalement assez dérisoire de vouloir faire du général suisse le jumeau de tel Général (de brigade à titre temporaire) français, il n’en reste pas moins que l’action du PSS et de l’USS pour la constitution d’un véritable « front politique de résistance » dans le dernier Etat de l’Europe continentale qui ne soit ni occupé ni totalement vassalisé par le IIIe Reich fut un élément de la résistance européenne au nazisme –et l’on sait quelle part y prit, malgré de tragiques erreurs et quelques errances, le mouvement ouvrier, communistes compris dès 1941.
Face à la menace nazie, face aussi aux tentations « collaborationnistes » de secteurs importants de la droite politique et culturelle, du patronat et de la caste militaire, le PSS, « purgé » de sa propre gauche, fit donc bloc (autant qu’il lui était décemment possible) derrière un général dont tout le séparait politiquement en 1939. Ce n’est pas tant la personnalité de Guisan qui « séduisit » les socialistes, et moins encore ses convictions politiques (franchement réactionnaires, mâtinées de corporatisme, teintées de xénophobie, et saupoudrées d’antisémitisme), que son rôle, la place qu’il occupait, la tâche qui lui avait été confiée. Guisan n’était pas sympathique à la gauche, mais il lui était nécessaire. Il devait incarner, parce que telle était sa fonction, une résistance nationale qui, pour les socialistes (mais pas pour lui) se confondait avec l’antifascisme et l’antinazisme. Ce militaire maurrassien devenait ainsi, malgré lui, emblématique d’une résistance politique autant que militaire –d’une résistance à ce que Maurras avait considéré comme une « divine surprise ». C’est ici sans doute que peut se justifier un début de comparaison entre Guisan et De Gaulle : le général suisse et le général français n’étaient ni l’un, ni l’autre, progressistes (De Gaulle le devint cependant, à sa manière, mais Guisan jamais), et il s’en fallait même, au début de la guerre, de beaucoup. L’un et l’autre cultivaient des valeurs dont le moins que l’on puisse écrire est qu’elles n’étaient pas celles de la gauche, et que résume au fond assez bien la devise de l’Etat français de Vichy : Travail, Famille, Patrie… L’un et l’autre, d’ailleurs, furent de fervents admirateurs de Pétain, quoique cette admiration fût singulièrement critique chez de Gaulle dès la fin des années vingt, pour laisser place à de la commisération dès juin 1940, et du mépris ensuite.
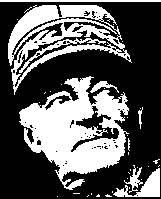 A 25 ans de distance, l’attitude du PSS à
l’égard du Général commandant l’armée fédérale en temps de guerre a donc changé
du tout au tout, de 1914 et Wille à 1939 et Guisan. C’est que le PSS lui-même a
changé, et que la situation est toute autre –parce que l’ennemi est tout autre-
et que, truisme point si innocent qu’il paraît, Guisan n’est pas Wille :
politiquement, le général romand est certes assez proche de Wille, plus proche
en tous cas de son prédécesseur que de la gauche, mais il est francophile quand
le danger est allemand, alors que les Wille sont d’autant plus germanophiles
que l’Allemagne est puissante et dangereuse.
A 25 ans de distance, l’attitude du PSS à
l’égard du Général commandant l’armée fédérale en temps de guerre a donc changé
du tout au tout, de 1914 et Wille à 1939 et Guisan. C’est que le PSS lui-même a
changé, et que la situation est toute autre –parce que l’ennemi est tout autre-
et que, truisme point si innocent qu’il paraît, Guisan n’est pas Wille :
politiquement, le général romand est certes assez proche de Wille, plus proche
en tous cas de son prédécesseur que de la gauche, mais il est francophile quand
le danger est allemand, alors que les Wille sont d’autant plus germanophiles
que l’Allemagne est puissante et dangereuse.
Quant aux communistes, leur attitude à l’égard de Guisan, de l’armée et de la « défense nationale » en tant que telle sera marquée par la succession de deux lignes contradictoires ; jusqu’en 1941, dénonciation de la « guerre impérialiste » ; dès 1941, appel à la résistance au fascisme. Les communistes vont donc attendre 1941 pour cesser de dire que la guerre n’est une « guerre entre impérialismes concurrents » dont le prolétariat n’a que faire, à l’instar de la Grande Guerre telle que l’analysait Lénine, et pour la comprendre comme une guerre pour la survie de l’Europe elle-même, de ses peuples et de leurs libertés, le dos au mur et face à la « bête immonde » dénoncée par Brecht. Au surplus, Moscou (c’est-à-dire Staline) ne se faisait pas de la Suisse une très haute idée, la Suisse elle-même s’ingéniant d’ailleurs à le conforter dans ce mépris. Une lettre de Churchill au Foreign Office, datée du 3 décembre 1944, témoigne de ce mépris stalinien, la Suisse ayant à ce moment là déjà changé d’attitude à l’égard de l’URSS, dès lors qu’elle apparaissait de plus en plus clairement comme le grand vainqueur probable de la guerre en Europe continentale : « J’ai été étonné de la sauvagerie (du ton de Staline à l’égard de la Suisse) et malgré tout mon respect pour cet homme grand et bon (sic), je n’ai pas été influencé du tout par son attitude. Il a (traité les Suisses) de Swine (porcs) et il n’a pas l’habitude d’employer un tel langage sans y croire » (cité par Jon Kimche, Un général suisse contre Hitler, Fayard, Paris, 1961).
L’attitude des communistes à l’égard de Guisan pesa finalement fort peu, l’instrumentalisation des partis communistes par le « centre » moscovite les ayant tenu éloignés pendant deux ans (de 1939 à 1941) des fronts de résistance aux occupations, aux invasions ou aux menaces nazies. La marginalité du PC suisse fit le reste : les communistes n’échappèrent à l’insignifiance qu’en « collant » aux socialistes de gauche, mais leur voix, leurs choix et leurs discours restèrent de bien peu de poids avant la création du Parti du Travail.
La gauche helvétique, politique ou syndicale, n’eut pas le « coup de foudre » pour celui qui allait, malgré tout ce qu’il était politiquement, et grâce à tout ce qu’il était institutionnellement, incarner la résistance militaire au fascisme et au nazisme, et dont la Suisse officielle fera un véritable mythe sitôt la guerre terminée. La gauche se ralliera à Guisan par Realpolitik, alors que, le 30 août 1939, lorsque les Chambres fédérales eurent à élire le Général, ce furent des voix socialistes qui pour l’essentiel se portèrent sur le concurrent de Guisan (le colonel Borel), qui n’obtint d’ailleurs que 21 voix, contre les 204 de Guisan. Les socialistes, qui ne ménagèrent pas leur soutien à Guisan pendant les années qui suivirent, se méfiaient de lui : ce militaire de carrière, ce « paysan d’origine bourgeoise » (un koulak, en somme) n’avait rien pour leur être sympathique, et ce que l’on savait de ses idées politiques ne plaidait guère en sa faveur à gauche. Quelques socialistes votèrent donc contre lui, d’autres s’abstinrent, et ceux qui soutinrent sa candidature le firent à contre-cœur. Mais dès son élection, pour des socialistes qui s’obligeaient à « penser suisse » même lorsqu’ils étaient tentés d’échapper au poids des traditions et des conformismes politiques, et qui « pensaient suisse » parce que l’ « étranger » menaçant était nazi, Guisan ne fut plus Guisan mais « le Général » : il était, par fonction, le seul homme dont le statut institutionnel laissait espérer qu’aux côtés d’un Conseil fédéral tenté par la « conciliation » à l’égard du Reich, il pût tenir un discours de résistance (qu’il tint en effet), parce qu’on l’avait désigné pour cela et parce que l’on pouvait supposer que le rôle lui convenait –non par antifascisme, mais par francophilie et par patriotisme suisse. Les socialistes jouèrent donc Guisan contre le Conseil fédéral, et gagnèrent à ce jeu, avant que de réussir, après moult tentatives infructueuses, à s’immiscer dans la coalition gouvernementale.
Guisan, cependant, ne fut pas ce monolithe patriotique, emblème d’une résistance inaccessible au doute, en quoi la mythologie nationale d’après-guerre réussit à le transformer (par nécessité de jeter un voile pudique et opaque sur les compromissions de la guerre). A la fin du printemps 1940, Guisan subit, comme Pilet-Golaz, le choc de l’effondrement de la France, et comme Pilet-Golaz cède à la tentation de l’ « adaptation » au nouvel ordre européen –un « nouvel ordre » que ses propres convictions politiques ne portaient pas à condamner a priori. Le 14 août 1940, il écrit au Conseiller fédéral Minger pour lui suggérer d’envoyer à Berlin l’ancien Haut Commissaire de la SdN à Dantzig, Carl-J. Burckhard, afin de tenter un « apaisement » et de proposer une « collaboration » dans le domaine de la presse, c’est-à-dire de négocier la mise au pas de la presse antinazie éditée en Suisse. Quant au fameux discours de « résistance » du Grütli, le mois précédent, le premier projet de texte qu’en fit Guisan contenait de virulentes attaques contre la gauche socialiste et les communistes, et s’en prenait nommément à la « bête noire » du général (et cela dès la grève générale de 1918), Robert Grimm. Guisan, en effet, partageait les « sentiments foncièrement antimarxistes de l’establishment helvétique » (Alec Plaut, Le mythe Guisan, Construire 10 juillet 1985) ; cet « antimarxisme » ne serait après tout que péché véniel, si encore péché il y a, si le texte du projet de l’allocution de Guisan ne ressemblait sur plus d’un point à celui, franchement défaitiste, de l’allocution précédente de Pilet-Golaz à laquelle la légende historico-patriotique l’opposa. Comme Pilet, Guisan était convaincu, et s’apprêtait à le dire, que « le sens des anciens partis a vécu » (cf Au Rütli, 25 juillet 1940, Etudes et Sources No 10, Archives fédérales suisses, Berne, 1985) ; ça n’est donc pas un militaire « progressiste » (ils n’étaient, il est vrai, pas très nombreux) et au-dessus de tout soupçon de sympathies fascisantes que les socialistes se résignèrent à soutenir, mais un « patriote », fût-il corporatiste, méfiant à l’égard de la démocratie et marqué par l’antisémitisme traditionnel de la droite réactionnaire :
ü Guisan, libéral vaudois de droite, corporatiste, n’aimant ni la démocratie ni les juifs, mais foncièrement et honnêtement attaché à son pays : on le savait et on l’acceptait ainsi, y compris ceux des socialistes qui votèrent pour lui aux Chambres fédérales.
Alec Plaut, Le mythe Guisan, in Construire No 28, 10 juillet 1985
Réactionnaire, le Général était aussi francophile ; admirateur de Mussolini et de Pétain, il l’était plus que du fascisme : en 1934, après avoir assisté à des manœuvres italiennes, Guisan dira du Duce que « c’est à lui et non pas au fascisme que l’Italie doit sa transformation complète, totale, qui tient du prodige » (Alec Plaut, art. cit.), et poursuit ce panégyrique sur le ton d’un Motta en qualifiant Mussolini d’ « homme de génie ». De Pétain, qu’il connaissait, Guisan put dire qu’il était une sorte d’incarnation des « valeurs éternelles de la France ». A quoi s’ajoute le fait que Guisan entretenait avec l’armée françaises des rapports qu’une stricte observance de la neutralité intégrale eût conduit à condamner. Enfin, la droite romande à laquelle appartenait Guisan fut au moins aussi profondément pétainiste que sa « grande sœur » française, si elle le fut avec moins de conséquence, et des conséquences moins dramatiques.
Reste à évoquer le moins avouable, le plus nauséabond : l’antisémitisme. Certes, Guisan n’adhéra jamais, ne fût-ce que de loin, à quoi qui ressemblât au projet exterminateur fomenté par les nazis, mais, en cela bien de son époque et de son milieu, il « n’aimait pas les juifs », exécrait le « cosmopolitisme » qui leur était attribué, craignait la dissolution des « valeurs traditionnelles », la remise en cause des situations acquises et l’ « intellectualisme subversif » que la tradition antisémite attribue aux « juifs ». Guisan n’aimait pas non plus les réfugiés (juifs ou non, mais il les aimait encore moins lorsqu’ils étaient juifs), « parce qu’il ne voulait pas de réfugiés là où il y avait de la troupe. Or il y avait de la troupe partout » (Alec Plaut). De là à ne vouloir de réfugiés nulle part, à clamer avec les loups et les bureaucrates que « la barque est pleine », à refouler en Allemagne les persécutés qui la fuyaient et, les refoulant, les condamner à mort, il n’y avait qu’un pas : ce pas, le Général le franchit, avec le Conseil fédéral, dans l’indifférence ou avec la connivence d’une bonne partie de l’opinion publique. Le 28 décembre 1940, la section « Armée et Foyers » diffusa un « plan de causerie » assez franchement antisémite (elle dut d’ailleurs faire amende honorable) ; le 31 janvier 1941, c’est Guisan lui-même qui, dans une lettre à l’Adjudant général de l’armée, affirme être en possession de « rapports dignes de foi (lui présentant) sous un jour menaçant la mainmise de personnalités et d’organisations étrangères sur le cinéma suisse », en citant comme exemple le service cinématographique de l’armée, et les « israélites » Grossfeld, Rotschild et Zikendraht ; à quoi l’Adjudant général répond que, oui, l’industrie suisse du film est bel et bien « envahie par la juiverie internationale » mais que le seul « israélite » employé par l’Armeefilmdienst est le Genevois Georges Grossfeld, qui n’est au surplus employé que « de temps en temps ». Or pendant que Guisan s’inquiétait de la « présence juive » dans le cinéma suisse, celui-ci courait un tout autre danger, bien plus réel : celui de la mainmise nazie. Et c’est un immigré, juif de surcroît, et Polonais pour tout arranger, qui sera le plus efficace acteur de la « résistance » du cinéma suisse à cette mainmise étrangère, nazie : Lazare Wechsler, fondateur et directeur de la société de production cinématographique Praesens, soutenue par Gottlieb Duttweiler, sa Migros et son Alliance des Indépendants.
La gauche savait donc à quoi s’en tenir avec Guisan ; avant la guerre, il s’était déjà fait remarquer d’elle par ses interventions anticommunistes et ses « philippiques contre les ennemis intérieurs » (Alec Plaut), qu’il avait d’ailleurs l’intention de prolonger en juillet 1940 dans son discours du Grütli, dont le projet contenait une attaque en règle contre la gauche (mais aucune condamnation de l’extrême-droite, hormis une vague allusion aux « évolutions copiées de l’étranger ». La presse antifasciste fera l’objet de plaintes répétées du Général, soucieux de préserver l’Italie (« seul pays qui nous témoigne sa bienveillance et nous aide » selon Guisan) des attaques de la gauche suisse et des antifascistes italiens réfugiés en Suisse. Enfin, Guisan réagit violemment à un discours prononcé par Robert Grimm au printemps 1940, lors duquel le socialiste bernois qualifia les hiérarques fascistes et nazis d’ « anciens lansquenets et aventuriers, sans culture, brutaux, jouisseurs ». Guisan demandera à Minger de désavouer officiellement Grimm, ce que Minger ne fera pas, au grand dam d’un Général qui plus souvent qu’à son tour s’aventurait sur le terrain politique.
Car Guisan, finalement, est un général politique (comme De Gaulle), en ce sens qu’il a de la « résistance », quelque définition qu’en en donnât, une vision politique au moins autant que stratégique, et que ses choix stratégiques eux-mêmes (le « réduit national », notamment) avaient une dimension politique et symbolique. La vision politique de Guisan n’est certes pas caractérisée par son contenu démocratique, ni ses conceptions stratégiques par beaucoup d’originalité, mais, nécessité faisant loi, les socialistes firent mine de s’y rallier, lors même que leurs raisons de le faire étaient totalement contradictoires de celles de Guisan de les proposer. Le chantre, en juillet 1940, de la « rénovation nationale » (une « rénovation passant « éventuellement par le système corporatif ») avait, et de longue date, fait des choix politiques totalement contradictoires de ceux de la gauche ? N’importe : il est le général, et l’instrument militaire qu’il commande est « objectivement » un instrument de résistance au fascisme et au nazisme. Et puis, entre Wille et Guisan, la comparaison est à l’avantage du second : au moins, lui, si francophile qu’il soit, n’est pas aux ordres d’une coterie inspirée, voire manipulée, par une puissance étrangère, de surcroît ennemie mortelle de la démocratie et du mouvement ouvrier.
Les tentations corporatistes de Guisan, sa méfiance à l’égard de la démocratie (« le sens des anciens partis a vécu »), sa xénophobie, son obsession de l’ordre, tous sentiments renforcés par l’échec apparent des démocraties face au fascisme, Guisan les conjuguait au « patriotisme impératif » : la gauche lui pardonnera donc son corporatisme, son pétainisme, sa xénophobie, parce que son patriotisme la servait dans le combat antifasciste. Même la xénophobie pouvait, en temps de guerre et de menace étrangère, être politiquement utile dans la mesure où, tournée contre l’Allemagne, elle l’était contre le nazisme. Anticommuniste et antisocialiste par choix, Guisan se retrouvait antinazi par nécessité, et même antifasciste par alliance, alors même qu’il était admirateur de Mussolini. Toute idéologie, quelle qu’elle soit, le rebutait d’ailleurs (un trait qu’il partageait, paradoxalement, avec Léon Nicole) : « Les doctrines idéologiques, qu’elles s’appellent fascisme, national-socialisme ou bolchevisme, nous sont foncièrement étrangère et répugnent à l’idée fédérative helvétique » (cité par Oscar Gauye, op. cit.).
Un résumé cynique et quelque peu caricatural des rapports que la gauche entretint avec Guisan pendant toute la guerre, de la vision qu’elle eut du personne (et de celle qu’il avait d’elle) et de son rôle, pourrait le définir comme un adversaire politique et un allié historique toute à la fois. Partisan de l’ordre traditionnel et pourfendeur de la gauche, séduit par le corporatisme et Mussolini, méfiant à l’égard de la démocratie, xénophobe et parfois quelque peu antisémite (si l’on peut être « quelque peu » antisémite sans l’être tout à fait), Guisan n’était certes pas le général dont rêvaient les socialistes (à supposer que les socialistes rêvassent de généraux), mais il était « le Général » et il fallait « faire avec », faute d’en trouver un meilleur ; on « fit donc avec », pour ne pas risquer de tomber sur pire –et pire il y avait. Son patriotisme, même réactionnaire, et sa francophilie, même pétainiste, offraient des garanties dont on avait cruellement manqué un quart de siècle auparavant avec Wille. Le mariage du parti socialiste et du général Guisan n’était certes pas un mariage d’amour, mais un mariage de raison qui se défit lorsque sa raison ne fut plus.