



Guisan et le mythe d'un « gaullisme suisse »
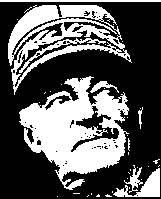
Une politique extérieure et de sécurité schizophrénique
Karl Barth dénonce la « pharisaïsme » de la politique
étrangère suisse
La mise hors-jeu de la gauche prosoviétique
Mettre le socialisme en sourdine pour cause
d’antifascisme ?
« Dès le printemps 1939, les coups de forces se succédèrent » en Europe, rappelle Roland Ruffieux (in La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit.biblio p. 363). C’est, d’abord, la fin de la Tchécoslovaquie : le Président Hacha, convoqué (« cité », écrit Ruffieux) à Berlin par Hitler, se voit intimer l’ordre de confier le sort de son pays au IIIème Reich, sous peine de voir Prague bombardée. La Tchécoslovaquie éclate : la Slovaquie forme un Etat indépendant, cléricalo-fasciste, la Bohème et la Moravie deviennent des protectorats allemands. Après l’annexion de l’Autriche, l’Allemagne nazie annexe, de fait, la Tchécoslovaquie. En Suisse, l’alarme est considérable et la presse réagit violemment, de la gauche nicoliste à la droite démocratique (il n’y eut guère que la presse d’extrême-droite pour croire, ou en faire mine, à la thèse allemande des « provocations » tchécoslovaques. Un « arc patriotique » se forme, et tout uniment condamne l’invraisemblable passivité « munichoise » des démocraties occidentales, sous l’influence de la « diplomatie du parapluie » de l’Angleterre. Le 16 mars, le Conseiller fédéral Obrecht ira jusqu’à adresser une mise en garde directe à l’Allemagne, lors d’une réunion bâloise de la « Nouvelle Société Helvétique » : Etter proclame que ceux qui attaqueraient la Suisse (et cela ne peut faire allusion qu’à l’Allemagne, éventuellement à l’Italie) devront s’attendre à la guerre, car « nous autres Suisses, nous n’irons pas d’abord en pèlerinage à l’étranger » (sous tendu : comme les Tchèques). Le Président de la Confédération lui-même, Philippe Etter, réitérera l’avertissement le 20 mars, à la radio. Cette posture de résistance surprend :
ü Après de nombreux gestes conciliants de la part de Motta, qui pouvaient même laisser supposer une résignation à l’ordre nouveau, le gouvernement adoptait ouvertement le langage de la résistance. A partir du thème « plutôt mourir libres que vivre en esclavage » se développa un ultime débat sur la défense totale et même sur la possibilité d’une « guerre populaire ». Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit.biblio pp 363-364L’ »affaire tchécoslovaque » fut l’ultime alarme : la guerre parut désormais inévitable (on faisait mine de ne pas voir qu’elle avait déjà commencé : en 1936, en Espagne), et l’on douta de plus en plus que la Suisse pût en être préservée. Après que le Président français Lebrun se soit rendu à Londres, avec Georges Bonnet, on annonça que la France et la Grande-Bretagne (dont les yeux semblaient enfin s’ouvrir sur la réalité « post-munichoise ») avaient pris des engagements d’assistance mutuelle s’appliquant même en cas d’agression contre des Etats tiers, et neutres : la Belgique, la Hollande, certes, alliés traditionnels… mais aussi la Suisse. L’Allemagne s’en indigna, et fit mine de prendre pour une alliance militaire franco-suisse ce qui n’était que l’expression d’une préoccupation purement française, la France n’ayant en tête que sa propre sécurité, et voulant se garder de l’Allemagne sur la frontière Suisse comme sur la frontière belge. Le 14 avril, le président américain Roosevelt entre dans la danse et, s’adressant directement à Hitler (qui a fait occuper Memel le 23 mars) et à Mussolini (qui a envahi l’Albanie le 7 avril), leur demande de renoncer explicitement à toute tentative d’agression contre 29 Etats d’Europe et du Proche-Orient. Au nombre de ces 29 Etats : la Suisse… Le 18 avril, le Conseil fédéral précise qu’en ce qui la concerne, la Suisse s’en tient aux assurances déjà données par les uns et les autres (y compris l’Allemagne et l’Italie) quand au respect de sa neutralité, et s’en remet pour le reste à la volonté du peuple suisse : le quotidien socialiste Volksrecht approuve : « Pas un mot de trop, pas un mot de pas assez ».
La politique étrangère et la politique de sécurité de la Suisse, en cette période, semblent étrangement schizophréniques : d’un côté se poursuit la politique de Motta (qui, malade, a perdu le contrôle absolu qu’il exerçait depuis vingt ans sur la politique étrangère de la Suisse), aussi clémente à l’égard du fascisme et du nazisme qu’intransigeante face au « bolchevisme » ; de l’autre côté, on assiste à la naissance d’une politique (ou plutôt d’une attitude) de résistance patriotique , renforcée par l’adhésion du PSS à la défense nationale, attitude qu’exprimeront bien un Obrecht ou un Minger, et qu’incarnera le général Guisan (ou plutôt : qu’on fera incarner par Guisan, malgré –ou à cause- de ses convictions politiques maurrassiennes (version Ligue Vaudoise).
Lorsque le 22 août 1939 éclate la nouvelle de la signature à Moscou d’un pacte d’ « amitié et de non-agression » entre l’Allemagne nazie et l’Union Soviétique stalinienne, nul ne doute que ce bouleversement de l’ « échiquier politique » européen présage d’une guerre continentale. La plupart des commentateurs s’accordent à penser que l’Union Soviétique est la grande bénéficiaire de cette incroyable alliance, dont on aura tout juste le temps de vérifier que la grande perdante est la Pologne : en dix jours, tout sera consommé ; les préparatifs militaires allemands, les manœuvres diplomatiques, la guerre de propagande avaient déjà commencé, depuis des mois. Après ses succès rhénan, autrichien et tchécoslovaque, le pacte ouvrait à Hitler la voie d’une victoire sur la Pologne –mais d’une victoire qui, cette fois, n’ira pas sans guerre avec la France et la Grande-Bretagne, et dont il faudra au surplus payer tribut à Staline. La crise tchécoslovaque était trop proche pour que la Suisse ait réellement eu le temps de se remettre à espérer n’être pas menacée, même si Carl Burckhardt avait reçu de Hitler de nouvelles « assurances » quant au respect de la neutralité helvétique. Le 26 août, quatre jours après la signature du pacte germano-soviétique, six jours avant le déclenchement de la guerre, l’Allemagne prévenait la Suisse qu’elle se chargerait elle-même de défendre la neutralité de la Confédération si celle-ci s’en révélait incapable… La menace était précise, et face à elle le Conseil fédéral était divisé sur la conduite à tenir : Motta conseillait d’attendre, Minger voulait que l’on décrétât la mobilisation générale immédiate. On transigea : réuni en séance extraordinaire le 27 août, le Conseil fédéral décida pour le lendemain l’appel des troupes de « couverture frontière » et la convocation pour le 30 août de l’Assemblée fédérale, les deux Chambres réunies, pour le « grand rituel de guerre » (Ruffieux) : déclaration de neutralité adressée à tous les Etats, vote des pleins pouvoirs au Conseil fédéral, élection d’un Général. Dans la matinée du 30 août, le groupe parlementaire socialiste obtint la mise au place de commissions permanentes auxquelles le Conseil fédéral devra soumettre ses projets ; l’expérience de la Grande Guerre doit porter enseignement : les pleins pouvoirs ? soit, puisque la situation l’exige, mais pas à n’importe quel prix, et pas en l’absence de tout contrôle…
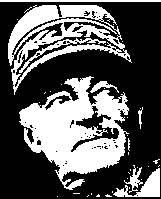
La délégation de compétence au Conseil fédéral fut votée à la quasi unanimité, et le Général élu, en la personne du Vaudois Henri Guisan, par accord de tous les groupes politiques et par 202 voix sur 229 (21 voix, presque toutes socialistes, allant au colonel Borel, jugé moins réactionnaire que Guisan –ce qui à vrai dire n’était pas difficile. On verra plus loin le rôle, au moins autant symbolique que réel, que jouera Guisan –et que l’on fera jouer à Guisan- dans la mise en place d’un « esprit de résistance » (patriotique, à défaut d’être clairement antifasciste) rompant avec les connivences germanophiles de la coterie des Wille, qui persistait à jouer (depuis avant 1914…) la carte allemande. Les socialistes prirent leur part de cet exercice : là encore, l’expérience à tous points de vue désastreuse de 1914-1918 sert de repoussoir : il n’y aura pas, entre 1939 et 1945, de « fossé », de « déchirure », de « röstigraben » entre les opinions publiques romandes et alémaniques, comme il y en eut entre 1914 et 1918. L’Allemagne sans doute était plis inquiétante, et le nazisme fut, assez paradoxalement, une sorte d’antidote (ou de vaccin) contre la germanophilie ; mais surtout, les « élites » politiques, sociales et culturelles suisses avaient appris de la première guerre ce qu’il ne fallait pas faire lors de la seconde. De cet apprentissage naquit aussi une « conscience nationale », qui elle-même se traduisit en la construction d’un début d’Etat social : la première guerre mondiale s’était achevée par la Grève Générale –après la seconde, on créera l’AVS…
Lors de cette même séance du 30 août 1939, l’Assemblée fédérale autorisa le Conseil fédéral à publier une déclaration de neutralité qui fut notifiée le lendemain à quarante Etats, l’Allemagne étant la premier à y répondre en donnant toutes garanties de respect de cette neutralité. Le 31 août, Guisan reçut ses instructions du Conseil fédéral : il avait pour tâche de sauvegarder l’indépendance du pays et l’intégrité de son territoire (ce à quoi il se consacrera sans état d’âme) ; il devait aussi, tant que la Suisse ne serait pas agressée, respecter la neutralité, ce qu’il se permettra par contre d’ « interpréter » avec beaucoup plus de souplesse, politique autant que stratégique. En cas d’agression, il lui serait accordé par le Conseil fédéral de pouvoir conclure des conventions limitées avec des forces accourues au secours de la Confédération. Le 1er septembre, la mobilisation générale fut ordonnée pour le lendemain, sitôt connue la nouvelle de l’invasion allemande de la Pologne, et en même temps que la France déclarait la guerre à l’Allemagne.
La Suisse se trouvait à nouveau dans la situation de 1914, avec ses deux principaux voisins en guerre l’un contre l’autre (l’Autriche était alliée à l’Allemagne en 1914, annexée à l’Allemagne en 1939 ; l’Italie était encore « neutre » en 1914 et en 1939). La Suisse craignait deux types d’intervention militaire : la première par l’Allemagne sur le mode de l’agression pure et simple, la seconde par la France sur le mode de la « prévention » ou de la riposte, mais toutes deux avec le même objectif stratégique : prendre l’adversaire principal à revers en passant à travers le territoire helvétique. La crainte d’une intervention allemande fut accrue en novembre 1939 par les accusations portées en Allemagne contre la Suisse, après qu’Hitler eût échappé à Munich à un attentat dont la presse allemande (nazie par définition) affirma qu’il avait été mis au point en Suisse. Dans les jours qui suivirent, le service de renseignements de l’armée signala d’inquiétants mouvements de troupe dans le sud de l’Allemagne, notamment en Forêt Noire, auxquels répondaient de non moins mouvement de troupes sur l’est du dispositif militaire français. La « drôle de guerre » s’installant, le sentiment de menace immédiate disparut (il renaîtra, avec une force accrue, confinant en certains milieux à la panique, au printemps 1940). Les autorités militaires en profitèrent pour parfaire leur dispositif : instruction des troupes mobilisées, travaux de fortification et, le 3 novembre, création de la section « Armée et Foyers », instrument de « guerre psychologique » et de « cohésion nationale » (entre le « front potentiel » et l’arrière, entre les régions linguistiques et entre les classes sociales). Enfin, le 20 décembre, un arrêté du Conseil fédéral réglera le régime des allocations pour perte de gains aux travailleurs mobilisés : là encore, la leçon de la Grande Guerre porte, et l’on prend bien garde de négocier avec les syndicats les mesures d’accompagnement social de la mobilisation. On aboutit ainsi, constate Roland Ruffieux, « à une version militaire de la paix du travail » (op.cit. p. 370)
De quelle politique étrangère, de quelle diplomatie, de quelle politique de sécurité extérieure, les décisions de l’automne 1939 sont-elles la conclusion –et, sur bien des points, la contradiction, et peut-être le constat d’échec ? En mars 1939, un député fit remarquer aux Chambres qu’on ne pouvait plus parler depuis 1815 d’une diplomatie helvétique (il n’y en avait pas avant, faute d’Etat fédéral, ce qui revient à faire dire au député en question que la Suisse en réalité n’a jamais eu de diplomatie). Karl Barth, interrogé en 1936 par des étudiants hongrois sur la « position du chrétien dans la Cité », ajoutait à ce constat d’absence d’une politique étrangère suisse, l’accusation de pharisaïsme, et pour lui ce n’est pas depuis 1815 que la Suisse n’a pas de politique étrangère, mais depuis Marignan (1515) :
ü Les Suisses, depuis 400 ans, ne sont en réalité que les hôtes et les spectateurs de l’Histoire. Ce sont, par nature, des pharisiens de la politique (…). Le Suisse est assis dans sa petite maison et il regarde par sa petite fenêtre, et se réjouit de voir les étrangers venir chez lui pour admirer la belle et libre Helvétie. Peut-être lui plaît-il aussi d’entreprendre quelque œuvre de secours, d’adopter en temps de guerre un enfant allemand, un enfant français, et de devenir ainsi, par dessus le marché, un bienfaiteur de l’humanité.Ce « pharisaïsme sera peut-être la marque la plus prégnante de la politique extérieure (ou, pour mieux dire, de la politique de relation avec l’extérieur, cet « autre monde » incompréhensible, peuplé d’étrangers, et menaçant) de la Suisse dans la période qui va de l’accession de Hitler au pouvoir à la chute du nazisme. Un choix a été fait par la Suisse officielle, au moins implicitement, des « bons » et des « méchants » Etats. D’entre les seconds, le principal sera évidemment l’Union Soviétique ; l’identité des premiers variera, au fil du temps, des rapports de force et de l’évolution de la guerre, mais avec une préférence assez constante pour les deux puissances « anglo-saxonnes », les USA et la Grande-Bretagne (quoique le New Deal rooseveltien se soit attiré les foudres des commentateurs de droite, et que les sympathies pour l’Allemagne nazie et l’Italie furent, on l’a vu, fort agissantes). Quant à la France, celle du Front Populaire inquiéta fort la Suisse officielle, qui en revanche s’arrangea fort bien de celle de Vichy.
L’Union Soviétique fit problème –et c’est peu dire- à la Suisse, qui refusera longtemps d’accepter de la reconnaître, pour des raisons (idéologiques, voire éthiques, qui auraient également dû l’empêcher de reconnaître l’Allemagne nazie, voire l’Italie fasciste). Le 1er juin 1936, au Conseil national, Paul Graber (pourtant solidement anticommuniste) exprime face au Conseiller fédéral Motta et à l’ancien Conseiller fédéral Musy, redevenu Conseiller national, le refus socialiste de cette attitude face à l’URSS :
ü La Suisse doit-elle, lorsqu’elle veut reconnaître un Etat, faire dépendre cette reconnaissance du régime intérieur de cet Etat ? Dans ce cas, il faudrait chercher à savoir si le Japon, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Uruguay et d’autres encore, ont un régime intérieur qui soit digne du régime suisse. Car dans notre modestie nationale, nous nous haussons de temps en temps jusqu’à admettre que nous sommes presque au faîte de la splendeur, de la noblesse des régimes politiques et économiques, et qu’à côté de nous, Suisses, il n’y a plus guère de gens qui méritent notre attention.Paul Graber parlait de principes et, dans un élan assez rare en Suisse, faisait la critique de l’ethnocentrisme très particulier de ce pays, de sa propension constante à se définir comme un modèle dans mener une politique étrangère à la hauteur de cette prétention. Le 23 juin 1939, Le Travail se placera, lui, sur un plan plus « utilitaire », celui de la défense de l’indépendance de la Suisse, pour défendre la reconnaissance par la Suisse de l’Union Soviétique :
ü Notre neutralité ne saurait supporter plus longtemps que, pour répondre aux vœux des deux Etats totalitaires qui menacent notre sécurité et notre indépendance, nous persistions à n’entretenir aucune relation diplomatique avec un grand pays qui, par le jeu des forces en Europe, nous protège contre nos agresseurs éventuels.
Le choix, implicite, d’une certaine « Suisse officielle » en faveur du fascisme et du nazisme dès lors qu’ils paraissent prendre la tête du combat face au bolchevisme, correspond, au plan intérieur, à la mise hors-jeu de la gauche prosoviétique. Cette mise hors jeu culmine le 26 novembre 1940 avec un arrêté du Conseil fédéral interdisant le Parti communiste et ses organisations, assimilant la gauche socialiste, regroupée dans la Fédération socialiste suisse de Léon Nicole, à une organisation communiste et, à ce titre, l’interdisant également. Le 17 décembre, Léon Nicole, Jacques Dicker, Eugène Masson et Ernest Gloor sont exclus du Conseil national. Cette répression qui frappe l’ »^ »extrême-gauche » (toute l’extrême-gauche, puisque les anarchistes et les trotskistes en seront également la cible) ne sera jamais que très partiellement, et sous la pression de circonstances internationales commandant à l’action gouvernementale une posture d’équité factice, « équilibrée » par une répression équivalente de l’extrême-droite. La balance entre les « extrêmes » ne sera jamais tenue égale par les autorités fédérales (et cantonales), tant que le nazisme dominera l’Europe continente ; on ne réprimera réellement l’extrême-droite suisse qu’à partir du moment où, reculant sur tous les fronts, les Allemands apparaîtront comme les futurs vaincus de la guerre (et a contrario les Soviétiques au nombre des futurs grands vainqueurs). Jean-Baptiste Mauroux dira des « mauvais socialistes » (nicolistes) exclus du Conseil national qu’ « en dépit de leurs excès de langage et de leurs outrances, ils furent vrais de courage et fascinants de lucidité ») (op.cit. p. 64) -ce qui, s’agissant de la lucidité, est quelque peu excessif, si l’on se souvient de leur aveuglement prosoviétique, mais ce qui, étant excessif, n’est pas pour autant faux, si l’on tient compte par exemple de ce que Nicole écrivit après Munich et après la crise tchécoslovaque, et de sa perception des grands enjeux internationaux. Mauroux conclut justement (au sens dérivé de « justice » plus que de « justesse ») qu’ « il faut peut-être avoir recours à certaines formes sculptées de Giacometti pour exprimer le visage de ces personnages tragiques » (ibid..).
Les adversaires politiques de ces « personnages tragiques », y compris à l’intérieur du mouvement ouvrier, ne brillèrent d’ailleurs pas toujours par un discernement supérieur. L’opportunisme politique et commercial a plus souvent que la cohérence démocratique guidé les choix de la Suisse officielle, et « joué le rôle de succédané à un programme politique » (Mauroux, op.cit. p. 68), ce qui eût pu être très dangereux si des forces de résistance politique (antinazie et antifasciste) et nationale (anti-allemande et anti-italienne) n’avaient finalement pris le dessus : forces de résistance politique en grande partie issues du mouvement ouvrier et socialiste, et incarnées par lui, ainsi que par de nombreux intellectuels atterrés par le crétinisme frénétique en quoi se résorbait la culture allemande (Karl Barth sera de ces intellectuels) ; forces de résistance nationale incarnées souvent par de farouches conservateurs que leur patriotisme empêchera de glisser vers la soumission au fascisme et au nazisme un temps triomphants, et que rejoindra finalement la composante majoritaire du mouvement ouvrier suisse (USS et PSS), formant dès lors avec la droite démocratique une « union sacrée » que finira par personnifier un homme dont le moins que l’on puisse écrire est qu’il était peu suspect de sympathies socialisantes : le Général Guisan.
L’adhésion du mouvement ouvrier à l’Union Sacrée, version Guerre Mondiale, se fit moins cependant par patriotisme que par antifascisme et antinazisme. De 1922 à 1939, de la Marche sur Rome à la déclaration de guerre de l’Angleterre et de la France à l’Allemagne après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne et l’Union Soviétique, le mouvement du PSS et de l’USS (de l’USS d’abord…) vers l’acquiescement à la défense nationale –en tant qu’instrument de la défense de l’indépendance du pays et de la démocratie, ne fût-elle que bourgeoise- sera aussi constant que constamment prudent. Les communistes, eux, attendirent pour rompre avec leur attitude de condamnation de tous les protagonistes de la « guerre impérialiste » que l’URSS y soit à son tour plongée. Et dès 1941, tout le mouvement ouvrier suisse fera de la défense de l’indépendance nationale et de la démocratie bourgeoise l’axe principal de sa stratégie, lors même que cette indépendance est constamment menacée par diverses « facilités » accordées aux Etats de l’Axe (du moins tant qu’ils apparaissent comme vainqueurs), que la démocratie subit les vicissitudes de l’état de guerre et que la Suisse officielle exprime depuis des années d’inquiétantes complaisances à l’égard de ses agresseurs potentiels.
Ainsi de l’Italie : le 3 octobre 1935, Mussolini envahit le royaume d’Ethiopie (d’Abyssinie) ; le 5 octobre, la Société des Nations décide d’appliquer l’article 16 de son pacte constitutif et de sanctionner économiquement l’agresseur italien ; sous la pression de Motta, trop italophile pour être antifasciste, la Suisse refuse de rompre ses relations économiques et commerciales avec Rome et s’en tient à une politique de sanctions très relatives et de boycott très symbolique. Le 23 décembre 1936, la Suisse est l’un des premiers Etats à reconnaître la souveraineté italienne (l’ « Empire ») sur l’Ethiopie. La gauche, unie au-delà des divergences d’appréciation et des différences de langage, tonne. Sa condamnation est, cette fois encore, portée au nom de l’antifascisme avant que de l’être au nom du droit des Ethiopiens à l’autodétermination, tant l’idée est ancrée dans la conscience des porte-parole de la gauche (et plus encore, sans doute, de sa base) que ces « Abyssins » sont malgré tout des barbares, et qui plus est des «esclavagistes. En fait, il est plus que douteux que la gauche eût condamné l’agression si l’agresseur n’avait pas été fasciste.
La gauche, donc, condamne et se retrouve (malgré elle) aux côtés du Négus qui, le 21 janvier 1937, dans une lettre pathétique adressée au Secrétaire général de la SdN, Avenol, dénonce l’attitude de la Suisse :
ü Le Conseil fédéral de la République helvétique donne ainsi son approbation à la violation la plus cynique et la plus horrible des traités, et à l’écrasement d’un petit peuple luttant héroïquement contre un agresseur tout-puissant (…) c’est le gouvernement d’un pays qui a accepté d’être le siège de la SdN qui porte ce coup terrible à un peuple martyrisé par un agresseur puissant. Existe-t-il encore une morale internationale ? Que reste-t-il de la civilisation occidentale ?Magnanime, Haïlé Sélassié souhaitera à la Suisse d’échapper à l’asservissement promis à l’Ethiopie. Il devra malgré tout subir de la part de la Suisse une ultime avanie : le refus de l’asile politique. « Existe-t-il encore une morale internationale ? », demandait-il ; « Non », lui répond en substance la majorité « bourgeoise » du Parlement, par la voix du Conseiller national Gorgerat : « Neutralité d’abord, Société des Nations ensuite, tant qu’il s’agit par exemple de réglementer la pèche à la baleine ». Le même Gorgerat exprimera ensuite son soutien personnel à l’Italie fasciste en reprenant l’argument de la lutte de la civilisation contre la barbarie :
ü S’il fallait abandonner la neutralité, je pencherais beaucoup plus du côté de l’Italie, berceau de notre civilisation latine et occidentale, plutôt que du côté de l’Ethiopie, pays de sauvages même s’ils sont dirigés par de prétendus descendants de la Reine de Saba. Ibid.A l’égard de l’Italie, la complaisance sera la règle de la politique extérieure de la Suisse tant que Motta en sera le grand responsable (jusqu’à sa mort, en 1940) et que le fascisme régnera sans partage (jusqu’en 1942). Le 28 septembre 1938, le communiste Jules Humbert-Droz fait à la tribune du Conseil national le procès de cette politique :
ü Notre gouvernement est tenté de céder aux chantages des Etats totalitaires, en vue d’éviter tout conflit et de maintenir de bonnes relations. Livré à ses propres forces, un petit Etat tel que le nôtre risque de devoir céder aux pressions exercées par les Etats totalitaires. Or, en en revenant à la neutralité intégrale, la Suisse s’est dégagée de tous ses devoirs à l’égard des autres membres de la SdN et lorsque le Conseil de la SdN a pris acte de la décision du Conseil fédéral, il a souligné que les membres de la SdN n’avaient plus de devoir de solidarité à l’égard de la Suisse. Il serait du reste extraordinaire de compter sur la solidarité d’Etats auxquels nous refusons la nôtre (…) la politique extérieure de la Suisse, au lieu de se replier sur elle-même, au lieu de revenir à la neutralité intégrale, devrait chercher, dans le cadre de la SdN, à renforcer le pacte plutôt que de l’affaiblir et à garantir notre indépendance par le système de la sécurité collective. La Suisse a contribué à la démolition de la SdN (…) les votes et l’attitude de la délégation suisse au sein de la Société des Nations ont été (…) de façon conséquente et systématique, un affaiblissement de la SdN en ce qui concerne les sanctions contre les agresseurs. Je tiens simplement à rappeler que la Suisse a été fondée non pas sur le principe de la neutralité, mais sur celui de la sécurité collective, de la solidarité des peuples pour la défense de leurs libertés. Cité par J.-B. Mauroux, op.cit. pp 96-98Au plaidoyer déjà social-démocrate de l’encore communiste Humbert-Droz, défendant l’indépendance du pays, la démocratie bourgeoise et la souveraineté des Etats menacés par le « totalitarisme » (fasciste et nazi), Motta répond en affirmant d’une part que douter de la volonté des Etats voisins de la Suisse d’en respecter la neutralité est rendre un mauvais service au pays, et d’autre part que, pour défendre la liberté du pays, il faut que la presse évite désormais les « excès de langage » dans la condamnation du nazisme et du fascisme, et s’abstienne de tout ce que Motta lui-même (et le Conseil fédéral par sa bouche) considère comme des « injures adressées aux gouvernements et aux chefs d’Etat étrangers » (à quelques exceptions près, sans doute : les injures adressées à Staline ou au Négus ne gêneront guère Motta et ses pairs). Léon Nicole répliquera à Motta :
ü Ah, Messieurs ! C’est un bien mauvais moyen de défendre l’intégrité du pays, que de demander aux citoyens du pays d’abdiquer leur droit de critique. Je prétends que la presse suisse a droit non pas aux menaces du Conseil fédéral, mais aux remerciements de l’autorité fédérale pour la façon dont elle comprend sa tâche et facilite celle des autorités. Ibid.La gauche, jusqu’à Léon Nicole (qui ne fut pourtant pas le moins récalcitrant à toute idée d’unité avec la bourgeoisie démocrate contre l’adversaire fasciste) exprime donc ici la politique qui sera la sienne dans les années qui suivirent (parenthèse posée, pour les communistes et les nicolistes, entre 1939 et 1941) et que le PSS et l’USS avaient déjà décidé de mener depuis quelques années : tout faire, avec tous ceux qui veulent le faire, pour barrer la route à l’Allemagne nazie et à l’Italie fasciste ; défendre à la fois l’intégrité territoriale, l’indépendance nationale et la démocratie politique ; mettre, en somme, la revendication proprement socialiste –la volonté de changement social- en sourdine jusqu’à l’écrasement de la « Bête immonde » (écrasement par d’autres que les Suisses, mais auquel quelques Suisses, tout de même, contribueront –certains jusqu’au sacrifice de leur vie). La démocratie politique y trouvera le renfort nécessaire à son sauvetage, mais la volonté de changement social, d’un changement social profond et global, s’y dissoudra, et ne renaîtra plus vraiment des cendres accumulées par la Guerre Mondiale (peut-être parce que la Suisse, finalement, préservée de ses effets et de ses conséquences les plus dramatiques, n’en connut guère l’atroce et n’en tira pas la conviction d’un changement nécessaire).
Le mouvement ouvrier suisse mise sur la Suisse. Le PSS et l’USS, tout en exprimant une critique de fond du mode d’organisation de la défense nationale, tout en appelant de leurs vœux une « défense nationale populaire » qui sera partiellement mise sur pieds sans qu’ils soient pour grand chose, voteront les crédits militaires et soutiendront les mesures de défense nationale, l’antifascisme se confondant dès 1939 (dès 1941, pour les communistes) avec la volonté de défense nationale. C’est l’aboutissement, en particulier pour le PSS, d’un profond changement d’attitude à l’égard de l’armée. Le fascisme, puis le nazisme, la constitution de l’Axe et le développement des menaces extérieures, auront raison des réticences que l’usage constant de l’armée comme moyen de répression des mouvements sociaux de contestation (et donc du mouvement socialiste) avait fait naître.
L’armée suisse s’était constamment renforcée depuis 1933. En novembre de cette année-là, celle de la prise du pouvoir par les nazis, le Conseil fédéral demandait et obtenait un crédit militaire extraordinaire de 82 millions de francs. En février 1935, les citoyens acceptaient la prolongation des écoles de recrues. En juin 1936, le Conseil fédéral sollicitait un nouveau crédit militaire de 235 millions de francs, un emprunt à 3 % étant lancé en septembre 1935 –il produira 100 millions de plus que ce qu’on en attendait. A la veille de la guerre, 825 millions de francs avaient été votée en faveur de la défense nationale, pour l’adaptation de son outil militaire aux nouvelles donnes stratégiques, et pour sa modernisation. Le congrès de Zurich du PSS sanctionnera en 1937 le changement de politique annoncé deux ans auparavant par le congrès de Lucerne, et l’adhésion du parti au principe de la défense nationale. A Zurich, pour la première fois depuis 1917, le PSS prônera une intensification de la politique de défense du pays. Il soutiendra pendant toute la guerre, au nom de la défense de l’indépendance nationale et par antifascisme, les efforts de Guisan pour renforcer la volonté de défense, sans pour autant renoncer à son droit de critique et sans ignorer tout ce qui, politiquement, le sépare de Guisan. L’adhésion des deux organisations hégémoniques de la gauche à la défense nationale, dans ses aspects les plus concrets, permit ainsi d’éviter que réapparaisse le fossé de 1914-1918 entre Romands et Alémaniques d’une part, gauche et droite d’autre part, internationalistes et « patriotes » enfin. La « patrie » était menacée par l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste : les antifascistes se firent donc patriotes…


