



1939-1945 : La patrie en danger, le socialisme en veilleuse
La baisse des effectifs du PSS entre 1933 et 1941
L’appel du PSS de 1939
Le programme de « La Suisse Nouvelle »
La presse socialiste, seule presse antivichyssoise romande
1941 : les socialistes saluent l’entrée de l’URSS dans la guerre
–et du bon côté
En 1939, le PSS compte un peu plus de 37'000 membres (37'129) ; ses effectifs n’ont cessé de baisser depuis 1933, année où ils avaient atteint le chiffre record (qui ne sera battu qu’en 1958, avec 57'677 membres) de 57'227 adhérents. Les effectifs du principal parti de la gauche suisse ne cesseront ensuite de baisser, pour « plancher » à moins de 32'000 membres (31'742) en 1941, avant que de remonter pour atteindre 47'695 membres en 1946. La crise économique, qui empêche nombre de travailleurs de payer leurs cotisations au parti (en plus de celles dues au syndicat), la mobilisation, qui rompt leur insertion politique, l’exclusion de la gauche du parti, enfin, qui « casse » en deux le mouvement socialiste romand, et qui équivaut à Genève et, dans une moindre mesure, dans le canton de Vaud, à une véritable « saignée », tout cela explique cette fulgurante régression des effectifs socialiste ; la « reprise » de 1942 et des années suivantes est plus difficile à analyser : le PSS gagnera de nouveaux membres et en « récupérera » d’anciens alors même que, sur sa gauche, s’organise la fusion et la recomposition de l’extrême-gauche jusqu’à la fondation en 1944 du Parti du Travail. Sans doute l’optimisme né des victoires alliées dès la fin de 1942, après des années de reflux devant le fascisme et le nazisme, est-il pour quelque chose dans ce renforcement de la gauche, mais ces victoires portent aussi aux nues le prestige de l’Union Soviétique, payé du sacrifice de millions de soldats et de millions de civils, quant bien même l’antistalinisme fait désormais partie intégrante du « bagage » théorique du socialisme démocratique suisse. En pleine guerre, le PSS progresse : la stratégie « patriotique » suivie depuis 1935 porte ses fruits après avoir pendant six ans provoqué un équarrissage du parti sur sa gauche. La guerre, dès lors qu’elle semble pouvoir être gagnée, « récompense » (si l’on peut ainsi s’exprimer sans qu’il y ait cynisme à le faire) ceux qui, mieux que d’autres et plus tôt, l’avaient prévue et en avaient prévu les conséquences et les exigences.
En 1939, le PSS détenait 45 des 187 sièges du Conseil National ; quatre ans plus tard, il détiendra 56 des 194 sièges de la Chambre basse (passant dans le temps de trois à cinq sièges au Conseil des Etats. Il est vrai qu’en 1943 le PSS est seul à gauche, dans le combat électoral : « nicolistes » et communistes sont maintenus hors du combat électoral par les arrêtés d’interdiction et les mesures de privation du droit d’éligibilité infligées à leurs chefs et leurs cadres.
Le 1er septembre 1939, le PSS lance un appel national dans lequel, adhérant à la défense des frontières, de l’indépendance nationale et du système politique suisses, il insiste sur la nécessité d’inclure la justice sociale au nombre des conditions de la défense du pays. Bien que nombre d’entre eux aient voté contre lui, et que tout ou presque les séparait politiquement de cet officier réactionnaire, maurrassien et admirateur de Pétain, les socialistes soutiendront le Général Guisan dès son élection (jusqu’à le soutenir parfois malgré lui), non parce qu’il était Guisan mais parce qu’il était le Général. Ils mèneront une lutte incessante contre le « défaitisme » et approuveront (contre les « nicolistes » de la Fédération Socialiste Suisse) l’institution du service militaire « préparatoire ». Surtout, le PSS situera son action sur le terrain de la démocratie et de sa défense, condamnant par là-même les tentatives autoritaires (de droite ou de gauche, puisque gauche autoritaire il y a), et les tentations d’alignement sur les régimes fascistes et nazis victorieux jusqu’à la fin de 1941 –jusqu’à ce que les Soviétique bloquent les Allemands devant Moscou, et que les Américains entrent en guerre. Ces tentatives et ces actions, une part non négligeable de la classe politique « bourgeoise » s’en rendit coupable (à l’image du Conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz), et plus encore certaine case dirigeante de l’armée, autour des Wille. Le Général lui-même ne fut pas exempt de ces tentations, ce qui n’empêcha nullement le PSS de le soutenir malgré tout ce qui l’en séparait, dès lors qu’il vit en lui une incarnation possible de la volonté de résistance, quelles que fussent ses faiblesses et ses sinuosités. Le PSS combattra ainsi toutes les tentatives de réduction du rôle du parlement ou des partis de l’ « arc démocratique », interviendra pour défendre la liberté de la presse (à commencer, évidemment, par la sienne) et, après y avoir au moins implicitement consenti, pour faire lever les interdictions qui frappent ses « frères ennemis » de la gauche nicoliste, tout en réclamant un contrôle et, le cas échéant, une répression accrus des organisations frontistes, fascistes nazies. Le PSS soutiendra le « Plan Wahlen » de renforcement de l’autosuffisance en biens de première nécessité, luttera pour le contrôle des prix, l’amélioration du pouvoir d’achat et l’indexation des salaires sur la hausse du coût de la vie, la création d’un système d’assurance vieillesse et le droit au travail –bref, pour la transformation de l’économie de guerre en Etat social. En décembre 1942, l’ensemble de ces propositions, articulées autour des choix fondamentaux faits depuis le début des années trente (la démocratie représentative, l’Etat social, l’Etat de droit, la défense nationale), forme l’ossature du nouveau programme du parti, très symboliquement placé sous le signe et le titre de « La Suisse Nouvelle ». La Suisse nouvelle que le PSS appelle de ses vœux, c’est une Suisse libérée de la domination du capital, assurant le bien-être matériel du peuple, élargissant les droits démocratiques et les libertés fondamentales aux droits sociaux (droit au travail et à l’outil de travail, droit à un salaire convenable, droit au logement…), développant la planification. Il s’agit bien d’un changement de société, mais d’un changement à promouvoir par la voie démocratique et la stratégie réformiste, d’un changement qui n’abolit pas la société dont on veut changer, mais la transforme –en pérennisant certains des instruments dont elle s’est dotée dans le cadre de l’économie de guerre et qui, la guerre terminée, ne seraient pas abandonnés mais récupérés pour une « économie sociale de paix ». Le Parti socialiste ne défend plus un projet de socialisation généralisée de l’économie, mais celui d’une économie mixte dans laquelle le Marché et l’Etat sont chacun le contrepoids et le partenaire de l’autre. L’Etat prend une place considérable dans un tel projet : le secteur « socialisé » projeté par le PSS est en réalité un secteur « étatisé », par la nationalisation des grandes banques et des grandes entreprises industrielles monopolistiques et le développement des assurances sociales. Entre l’Etat et le Marché, il semble ne plus rien y avoir : la social-démocratie helvétique tire un trait sur le « tiers-secteur » (qu’elle redécouvrira après 1968 et auquel elle redonnera une place importante dans son programme « autogestionnaire » de 1982), sur le coopérativisme et le mutualisme de ses origines, sur le mouvement associatif et sur le « conseillisme » libertaire des premières années de l’entre-deux-guerres.
La réalisation d’un tel programme suppose la conquête d’une majorité populaire et parlementaire : c’est à cette occasion que se consacrera le PSS, et à la « forge » de son moyen, la constitution d’un « grand mouvement populaire de masse » sur la base d’un programme pouvant « constituer une plate-forme de rassemblement, voire de réunification des forces de gauche et progressistes de notre pays » (Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit.biblio p. 271).
Ce programme sanctionne la scission de 1939 et en tire les conséquences politiques, sans que l’espoir d’une réunification ne disparaisse pour autant. La situation du PS n’est cependant pas brillante dans les bastions de la gauche nicoliste : à Genève, une centaine de membres en tout et pour tout constituent le PS « officiel » pendant toute la période de la guerre, et il faudra attendre 1946 pour que ces effectifs commencent à croître significativement (sans jamais, d’ailleurs, atteindre ni ceux du PS d’avant-guerre ni, jusque dans les années septante, ceux du Parti du Travail). Cette marginalité du PS genevois « officiel » explique le peu de considération en laquelle le tient le PS suisse, à tel point que lorsque la réunification entre PSS et « nicolistes » viendra à l’ordre du jour, en 1943, le PSS s’autorisera à traiter avec Léon Nicole en ignorant superbement le PS genevois. Celui-ci n’est pourtant pas dépourvu de personnalités de valeur (Charles Rosselet, qui présidera le Conseil national en 1942, André Oltramare, Jean Treina, Alexandre Berenstein, Albert Dupont-Willemin…), mais ces personnalités sont seules, sans base : le PS officiel n’a que des têtes, brillantes certes, mais sans corps.
La situation dans le canton de Vaud, autre bastion de la gauche nicoliste, est différente : dès 1940, le nombre d’adhérents du PS officiel croît régulièrement (sauf en 1943, année de création du Parti Ouvrier et Populaire vaudois). La scission de 1939 avait fait tomber les effectifs du parti vaudois de 912 membres à 234 ; en 1946, le PSV aura 594 membres. Le PSV surmonte donc mieux l’amputation de 1939 que le PSG. Le Secrétaire romand du PSS, Pierre Graber, n’y est pas étranger, qui déploie une activité considérable pour « remodeler un parti », comme l’écrit Pierre Jeanneret –qui ajoute que, ce faisant, Pierre Graber a « forgé l’outil qui lui confèrera, après la guerre, un rôle très important et assurera sa brillante carrière politique » (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 273), de la Mairie de Lausanne au gouvernement fédéral.
Après s’être séparé de leur aile gauche, certains partis socialistes romands sont menacés sur leur aile droite, regroupée souvent autour de responsables syndicaux, comme à Neuchâtel avec la fondation d’un éphémère Parti Travailliste ; à Genève, la FOMH et la FCTA envisagèrent de présenter une liste particulière lors de l’élection du Grand Conseil en novembre 1942, alors que le PS officiel, à la limite du quorum, était menacé de disparaître purement et simplement du parlement cantonal et avait un urgent besoin de mobiliser la totalité de l’électorat potentiel de centre-gauche ; dans le canton de Vaud, ce sont d’étranges liens qui se tissent entre le Grütli, pris en main par la très réactionnaire Ligue Vaudoise, et certains syndicalistes proches du PS ; c’est enfin le postulat « social-corporatiste » d’un René Robert sur la « communauté professionnelle ». La droite social-démocrate tombe ainsi dans le même piège que ses adversaires « nicolistes », celui des alliances douteuses, en application du principe –non moins douteux- selon lequel « les ennemis de nos ennemis sont nos amis ».

Après que, dans les premiers temps qui
suivirent la scission de 1939, l’essentiel du discours politique socialiste
« officiel » ait été consacré au règlement des comptes avec le
« nicolisme » (celui-ci se livrant d’ailleurs au même exercice vindicatif),
l’actualité mondiale et nationale (la guerre…) obligera à un élargissement des
thèmes et des perspectives. Le fascisme et le nazisme reprennent leur place
d’ « ennemi principal », que l’on avait un temps pu croire
occupée par le communisme et son succédané « nicoliste ». Ce
« recentrage » (ou ce « regauchissement ») antifasciste du
socialisme officiel romand se constate aisément en mai-juin 1940 : la presse socialiste romande, à commencer par Le Peuple et La
Sentinelle, est à peu près seule jusqu’en 1941), à dénoncer le caractère
totalitaire, corporatiste, foncièrement antidémocratique, et pour tout dire
fasciste, du régime de Vichy, quand la droite le voit avec les yeux de Chimène
et compare Pétain au Chevalier Bayard (quand ce n’est pas à Prométhée), et que
la gauche socialiste et communiste n’a pas encore rompu avec le
« défaitisme révolutionnaire » imposé par le pacte
germano-soviétique. 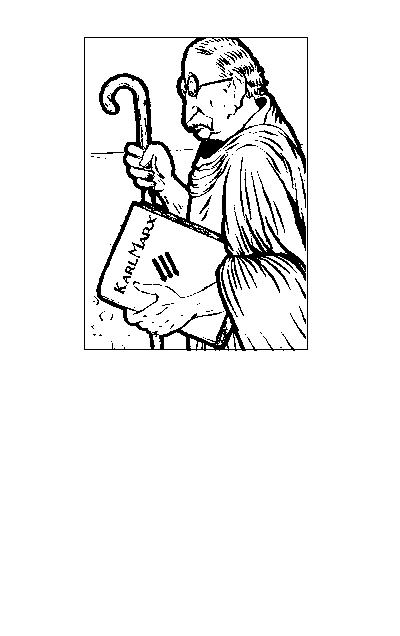 En février-avril 1942, lorsque le « procès de
Riom » est monté par Vichy pour tenter de faire retomber la responsabilité
de la défaite de 1940 sur les leaders de la gauche démocratique française, Le
Peuple rendra un vibrant hommage à Léon Blum, dont l’attitude pendant le
procès fera tourner celui-ci à la confusion de ses organisateurs, au point que
ceux-ci devront se résoudre à l’ajourner ; à l’automne 1940, alors qu’un
vent de pessimisme défaitiste confinant parfois à la panique balayait le centre
et la droite démocratique, et que se scandaient de toutes parts les appels à
l’ « adaptation » au « nouvel ordre européen », Le
Peuple consacrait une série d’articles de fond à la démocratie, à sa
défense et à son illustration.
En février-avril 1942, lorsque le « procès de
Riom » est monté par Vichy pour tenter de faire retomber la responsabilité
de la défaite de 1940 sur les leaders de la gauche démocratique française, Le
Peuple rendra un vibrant hommage à Léon Blum, dont l’attitude pendant le
procès fera tourner celui-ci à la confusion de ses organisateurs, au point que
ceux-ci devront se résoudre à l’ajourner ; à l’automne 1940, alors qu’un
vent de pessimisme défaitiste confinant parfois à la panique balayait le centre
et la droite démocratique, et que se scandaient de toutes parts les appels à
l’ « adaptation » au « nouvel ordre européen », Le
Peuple consacrait une série d’articles de fond à la démocratie, à sa
défense et à son illustration.
Le déclenchement de l’offensive allemande contre l’URSS permettra à la presse socialiste romande d’illustrer clairement le fait que, pour elle, la scission de 1939 est une page tournée –moins de deux ans après avoir été écrite dans la douleur : c’est dire l’accélération de l’histoire en ce temps de guerre. Alors que la presse conservatrice, libérale (et protestante) ou catholique, annonce à grands renfort de satisfaction prématurée la prochaine et inévitable défaite du « bolchevisme », la presse social-démocrate, elle, se réjouit de l’affaiblissement du nazisme et de la puissance militaire du IIIème Reich que cette invasion insensée ne saurait manque de provoquer, et salue la résistance soviétique (sans pour autant réduire la distance prise à l’égard du stalinisme –mais comme le dira, en substance, Churchill : contre Hitler même le diable est un allié possible).
Cela étant, il n’y a, comme on s’en doute, aucune place pour la sympathie « pro soviétique » dans cette attente d’un affaiblissement du nazisme par la guerre contre l’URSS : la presse socialiste « officielle » prend bien soi de toujours distinguer le peuple russe (ou les peuples de l’URSS) du régime stalinien, en même temps qu’elle distingue le socialisme du « communisme ». D’une manière générale, la ligne politique de cette presse est, comme le constate Pierre Jeanneret, « très anglo- et américanophile (…). Les déclarations, communiqués et analyses des gouvernements anglo-saxons constituent les sources privilégiées du quotidien socialisme romand » (op.cit.), alors que les « nicolistes » s’abreuvent, eux, à la source soviétique (dont ils sont parfois aussi les correspondants).

Enfin, la gauche démocratique prend la tête de la dénonciation par voie de presse des crimes de guerre (exécutions d’otages et de prisonniers de guerre) et des crimes contre l’humanité (comme on le disait pas encore) : arrestations, déportations et exécutions massives de civils, notamment de juifs –on ignore, ou veut ignorer, que les Tziganes souffrent des mêmes persécutions, et on ne se préoccupe guère des handicapés, et moins encore des homosexuels, dont le nazisme tente pareillement l’extermination, au nom de la même « logique » purificatrice et raciste. Les refoulements de réfugiés à la frontière suisse, vers leurs bourreaux, seront également dénoncés par la presse socialiste, ce qui lui vaudra d’être non moins régulièrement l’objet de la sollicitude des autorités fédérales : elle accumulera ainsi, tant que la défaite nazie n’apparaîtra pas comme inéluctable, réprimandes et mesures de suspension. Jacques Meurant s’exclame :
ü La Sentinelle ose s’opposer publiquement à la gangrène nazie ; c’est une des rares voix dans cette presse émasculée, dans cette Suisse du silence, qui se fasse entendre de façon catégorique.
Jacques Meurant, La presse et l’opinion de la Suisse romande face à la guerre européenne et à ses répercussions en Suisse (1939-1941), La Baconnière, Neuchâtel, 1976, p. 526
L’éloge de Meurant vaut en fait pour l’ensemble de la presse socialiste, romande, alémanique et tessinoise : La Libera Stampa, le Volksrecht ou la Tagwacht le mérite autant que Le Peuple ou La Sentinelle. Dès l’été 1941, la presse « nicoliste » et communiste, ou les media artisanaux qui en tiennent plus ou moins clandestinement lieu, rejoignent la presse socialiste dans cette expression catégorique d’une différence de conception du rôle et de la place de la Suisse dans le conflit mondial. Lors même que le mouvement socialiste suisse, dans son ensemble et de sa gauche à sa droite, dès l’été 1941, participe de l’union nationale (et patriotique), il en participe avec singularité : rallié au principe de la défense nationale, il lui donne un contenu pour le moins différent de celui qui prévaut et que lui donnent le Conseil fédéral et les chefs de l’armée –à commencer par Henri Guisan-, et cela dans tous les domaines, de la diplomatie à la politique humanitaire.


