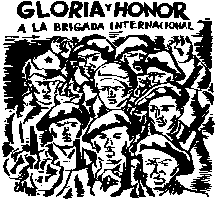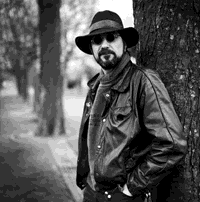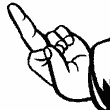

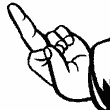

La gauche,le fascisme, la Suisse
La Déclaration de principe du Mouvement des
Lignes directricesLes "
courbettes " de la Suisse devant Mussolini, Hitler et FrancoNous l’avons dit, redit et le redirons encore : la situation internationale pèse, au moment des grands conflits, d’un poids déterminant dans l’histoire du mouvement ouvrier suisse, dont les choix sont alors largement le produit de sa perception des enjeux mondiaux (qui deviennent réellement mondiaux dès les années trente du XXème siècle, quand ils n’étaient guère qu’européens auparavant). La Grande Guerre de 1914-1918 avait poussé à s’ouvrir aux tumultes du monde, de force plutôt que de gré ; la Guerre Mondiale de 1939-1945 élargira l’ouverture : l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, deviennent des champs de bataille où se joue l’avenir de l’Europe, autant qu’en Russie ou en Italie. Les peuples de ces continents ne vont pas tarder à faire à leur tour irruption sur la scène politique visible, en Suisse même.
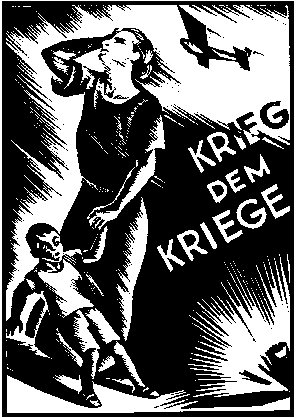 Nous avons, comme l’habitude en a été prise -à tort- daté le début de la Guerre Mondiale de 1939 ; en réalité, cette guerre-là a commencé des années années plus tôt : peut-être dans les expéditions impériales japonaises, en Mandchourie, et italiennes, en Afrique ; sûrement, en tous cas, en 1936, lorsque le pronunciamiento réactionnaire en Espagne impliquera l’Italie et l’Allemagne d’une part, l’Union Soviétique et le Mexique (et, clandestinement, pour ne pas écrire hypocritement, la France) d’autre part dans ce qui, l’échec du putsch proprement dit étant consommé, deviendra une guerre o ?u toutes les méthodes, toutes les tactiques et toutes les stratégies des guerres passées et à venir seront employées, et quelques unes " testées ". La Guerre Mondiale va donc élargir le champ de perception et de définition socialistes de la solidarité internationale à des nations et des peuples dont auparavant on ne se souciait guère ; pour autant, dans les années trente, ce sont les événements européens qui mobilisent les sentiments solidaires de la gauche helvétique, encore fort peu sensible à ce qui se passait " à la périphérie " (quoique les guerres africaines de l’Italie et les guerres asiatiques du Japon ne furent pas sans écho en Suisse). D’ailleurs, si la vision de la gauche ne va guère porter plus loin que l’Europe avant la fin des années quarante, celle de la droite sera encore plus myope. L’impact de la politique internationale sur la politique intérieure est surtout le fait des actions et des discours solidaires des partis de gauche, et dans une moindre mesure des syndicats, et des mouvements " spécialisés " dont les uns et les autres se dotent -du Secours Rouge communiste à l’Entraide Ouvrière socialiste et syndicale.
Nous avons, comme l’habitude en a été prise -à tort- daté le début de la Guerre Mondiale de 1939 ; en réalité, cette guerre-là a commencé des années années plus tôt : peut-être dans les expéditions impériales japonaises, en Mandchourie, et italiennes, en Afrique ; sûrement, en tous cas, en 1936, lorsque le pronunciamiento réactionnaire en Espagne impliquera l’Italie et l’Allemagne d’une part, l’Union Soviétique et le Mexique (et, clandestinement, pour ne pas écrire hypocritement, la France) d’autre part dans ce qui, l’échec du putsch proprement dit étant consommé, deviendra une guerre o ?u toutes les méthodes, toutes les tactiques et toutes les stratégies des guerres passées et à venir seront employées, et quelques unes " testées ". La Guerre Mondiale va donc élargir le champ de perception et de définition socialistes de la solidarité internationale à des nations et des peuples dont auparavant on ne se souciait guère ; pour autant, dans les années trente, ce sont les événements européens qui mobilisent les sentiments solidaires de la gauche helvétique, encore fort peu sensible à ce qui se passait " à la périphérie " (quoique les guerres africaines de l’Italie et les guerres asiatiques du Japon ne furent pas sans écho en Suisse). D’ailleurs, si la vision de la gauche ne va guère porter plus loin que l’Europe avant la fin des années quarante, celle de la droite sera encore plus myope. L’impact de la politique internationale sur la politique intérieure est surtout le fait des actions et des discours solidaires des partis de gauche, et dans une moindre mesure des syndicats, et des mouvements " spécialisés " dont les uns et les autres se dotent -du Secours Rouge communiste à l’Entraide Ouvrière socialiste et syndicale.
Le 19 mars 1933, le PS zurichois organise ainsi -le moment est de toute évidence bien choisi- une grande manifestation antifasciste, c’est-à-dire antinazie, et y invite le vieux leader de l’Internationale, Emile Vandervelde, et le Président du Labour britannique, Compton, aux côtés de Robert Grimm. Le texte de convocation de cette manifestation est exemplaire des raisons invoquées pour justifier, s’il en était besoin, la solidarité internationale en un printemps où naît le IIIème Reich ; raisons où se mêlent la protestation humaniste et la perception d’un danger de plus en plus pressant :
Volksrecht du 18 mars 1933
Dans la quasi totalité des manifestations de solidarité internationale organisées par la gauche politique et syndicale suisse des années trente, le danger fasciste est perçu comme d’autant plus menaçant qu’il n’est pas seulement un danger extérieur. La protestation antifasciste est aussi une protestation intérieure contre tout ce qui, en Suisse même, ressemble au fascisme, ou pactise avec lui, s’en inspire et rêve d’une " régénération " fasciste du système. Les victimes allemandes ou italiennes du nazisme et du fascisme sont proches du cœur et de la raison des militants suisses dans la mesure même où ces militants se savent promis au même sort qu’elles en cas de victoire de leur adversaire commun, en Suisse. La défense de la démocratie, bourgeoise ou non, apparaît dès lors comme la défense de soi-même, de ses propres droits, de ses propres libertés -voire de sa propre vie.
S’ils ne vécurent et ne subirent pas la Guerre Mondiale aussi tragiquement que leurs camarades du reste de l’Europe, les travailleurs suisses n’en payèrent pas moins un prix élevé à la mobilisation nationale ; mobilisation de (et dans) l’armée, certes, mais aussi " mobilisation économique ", et politique. Le service militaire actif, la baisse du niveau de vie (baisse des salaires, rationnement alimentaire), les atteintes aux droits démocratiques, toutes ces conséquences de la guerre furent supportées d’abord, et surtout, par les " classes populaires ". De la manière dont elles les subirent, on tira d’ailleurs argument pour le discours unificateur, patriotique et consensuel qui s’imposa en ces années-là. Jean Möri, membre de l’aile droite de l’Union Syndicale Suisse, en est une bonne illustration :
Jean Möri, Le syndicalisme libre en Suisse, op.cit.biblio pp 31-32
Se fonde ainsi une mythologie de l’unité nationale, dont le Général Guisan est l’une des (sinon la) figures emblématiques, et dont on ne cessera de faire usage, jusqu’à plus soif, dans les années qui suivirent la guerre.
Avant les élections fédérales de 1939 -et avant le déclenchement de la grande conflagration, le Parti socialiste suisse édita une " documentation " qui faisait le point de la situation internationale et nationale du début de l’année, afin d’en tirer les conclusions politiques que le parti entendait faire ratifier par son électorat. Le PSS commence dans ce texte par poser le contexte international et son évolution de 1919 au début de 1939 : d’une " volonté générale de désarmer et d’organiser la paix ", on est passé à un " surarmement effroyable " et à une situation de " menaces de guerre permanentes " (qui ne tarderont pas à devenir réalité). Coupable de cette évolution, le fascisme, le militarisme japonais et le nazisme. L’énumération des provocations qui jalonnent les deux décennies de l’entre-deux-guerres et font sombrer l’ " esprit de Genève " est éloquente :
1923 : Occupation italienne de Corfou
1931 : Invasion japonaise de la Mandchourie
1933 : Le Japon et l’Allemagne se retirent de la Société des Nations
1935 : Invasion italienne de l’Abyssinie
1936 : Effondrement du système des sanctions de la Société des Nations - Putsch militaire (et fascisant) en Espagne - Interventions italiennes et allemande au côté des franquistes en Espagne
1937 : l’Italie se retire de la SdN
1938 : Annexion (Anschluss) de l’Autriche par l’Allemagne - Munich : les démocraties reculent devant Hitler - Invasion de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne
1939 : Invasion de l’Albanie par l’Italie - Annexion de Memel par l’Allemagne - La Hongrie et l’Espagne quittent la SdN
(Le texte du PSS est antérieur au Pacte germano-soviétique et au déclenchement " factuel " de la Guerre Mondiale par l’invasion allemande de la Pologne)
Face à cette montée pourtant résistible du fascisme (ou des fascismes), le Parti socialiste suisse dénonce la passivité, voire la complicité, de l’ " Internationale dorée " :
Parti Socialiste Suisse, Documentation pour l’élection du Conseil national, 1939, p. 3
Le contexte posé, encore faut-il en tirer les conclusions politiques qui s’imposent -et, s’agissant du contexte international, les conclusions nationales. Pour ce faire, le PSS va d’abord procéder par comparaison avec la situation des " petits Etats " du nord de l’Europe (exemples positifs) et, a contrario, avec celle de l’Autriche (exemple négatif). En Finlande (avant l’agression soviétique), un gouvernement de coalition entre socialistes, agrariens et " progressistes ", au pouvoir depuis mars 1937, avait proclamé une politique de neutralité absolue et de défense nationale ; en Norvège, un gouvernement " ouvrier " (socialiste), au pouvoir depuis 1935, bénéficie du soutien des agrariens et accepte le principe d’une coalition avec la droite sur la base de la défense de la démocratie et de la neutralité. Le PSS ne donne pas ces deux exemples au hasard : deux gouvernements structurés autour du Parti socialiste affirment la neutralité de leur pays, reconnaissent la légitimité de la défense nationale et, au surplus, recherche ou acceptent l’alliance avec la droite démocratique -et particulier le parti agrarien, et donc la paysannerie. S’agissant de " petits pays ", on devine que le PSS en cite les exemples (choisis) aux fins de justifier ses propres choix, pour son propre " petit pays " ; l’union nationale de toutes les forces démocratiques, la reconnaissance de la défense nationale par les socialistes, la mise en valeur de la neutralité, cela vaut aussi pour la Suisse et pour les socialistes suisses :
PSS, Documentation pour l’élection…
Pour être plus clair encore, si nécessaire, le PSS précise :
PSS, Documentation pour l’élection…
* " L’ensemble du mouvement ouvrier ", vraiment ? Est-ce dire que les communistes sont, pour les socialistes, hors le mouvement ouvrier, ou est-ce leur reconnaître d’être partie prenante de ce mouvement après qu’ils aient pris le tournant du Front Populaire (avant que de basculer dans le " défaitisme révolutionnaire " en 1939, à la faveur du Pacte germano-soviétique, pour reprendre une ligne " patriotique antifasciste unitaire " en 1941, après l’invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie) ?
Le Parti socialiste va ensuite faire ample usage de l’exemple autrichien pour illustrer, a contrario, la validité de ses choix : " L’annexion de l’Autriche a démontrer qu’un petit peuple divisé intérieurement n’était plus capable d’aucune résistance " : de quelles " divisions intérieures " craint-on ainsi l’effet délétère ? Reprenant la déclaration d’un Conseiller national radical (Hirzel), le PSS affirme qu’un gouvernement " pratiquant une politique de classe n’a pas l’appui nécessaire pour résister politiquement et militairement à la pression d’un puissant voisin " ; s’appuyant sur l’exemple de la Tchécoslovaquie, on ajoute que " les divisions ethniques (peuvent) également saper les forces de résistance d’un pays " (PSS, documentation pour l’élection…). Les exemples étrangers contemporains parlent, pour le PSS, à la Suisse, mais l’exemple le plus présent à l’esprit, quoique le non-exprimé, est peut-être celui de la Suisse elle-même lors du conflit européen de 1914-1918, quand le Conseil fédéral et le Général Wille menaient sans précaution une " politique de classe " d’une dureté telle qu’elle conduisit à la Grève Générale, l’ambiance révolutionnaire continentale aidant, et que s’étaient en outre dangereusement creusées les " divisions ethniques " entre Romands (et francophile, c’est-à-dire " patriotes français ") et Alémaniques (souvent germanophiles, à l’instar de Wille et de sa coterie militaire et familiale).
Le Parti socialiste suisse de 1939 (l’Union syndicale l’ayant précédé dans ce choix stratégique) repousse donc la lutte des classes et les différenciations " ethniques " ; le PSS poussera même son souci de la concorde nationale jusqu’à saluer (positivement) une déclaration de son vieil adversaires, le Conseiller fédéral Giuseppe Motta (dont l’italophilie confinait à la complaisance à l’égard du fascisme), selon qui " un petit peuple ne peut exister que s’il est uni " -de quoi le vieux conservateur tessinois déduisait que " le premier commandement est celui de l’unité et de la concorde " (PSS, Documentation pour l’élection…). Le PSS lui fait écho :
PSS, Documentation… op.cit. p. 12
Le PSS est bien proche ici de tenir un discours " radical-démocratique ", du genre de celui que tenaient, un siècle auparavant, les progressistes bourgeois qui firent la Suisse moderne -et dont les socialistes se séparèrent. Le 21 mars 1938, une déclaration commune de tous les groupes de l’ " arc démocratique " au Conseil national (socialistes compris, évidemment) soulignait ainsi la volonté commune du " peuple suisse de défendre son indépendance ". On est donc en plein consensus démocratique, bien plus fortement que jamais au cours de la Grande Guerre : le fascisme et la nazisme sont des ennemis nouveaux, dont la menace légitime une attitude que les socialistes avaient abandonnées en 1915 -et que les communistes avaient adoptées au terme de leur antépénultième réification idéologico-stratégique. Le PSS s’en explique par une démonstration qui reprend la déclaration de principe du " Mouvement des Lignes Directrices " :
" Dans l’intérêt de l’ensemble du peuple, il convient de passer par dessus toutes les entraves de politique, de partis et autres conceptions (…). Les principes suivants doivent être la base inébranlable d’une nouvelle organisation de la politique (…) :
Le but le plus immédiat consiste à surmonter la crise, c’est là une des conditions primordiales pour le maintien de la démocratie dont les institutions libérales doivent être garanties et développées. Pour atteindre ce but, il faut procurer du pain et du travail, c’est-à-dire créer des possibilités de travail et des conditions d’existence suffisantes pour tous les travailleurs. Il s’agit en outre de donner une solution satisfaisante au problème du surendettement. L’aide de l’Etat ne doit pas être un but en soi, mais s’avérer peu à peu superflue. Le but ultérieur visé consiste à utiliser et à développer les possibilités de production existantes afin de mieux procurer au peuple ce dont il a besoin, et accorder à tous une part équitable du rendement général de l’économie nationale.
PSS, Documentation… op.cit. p. 13
Le 31 janvier 1937, le Congrès du PSS avait voté l’adhésion du parti au " Mouvement des Lignes Directrices ", patriotique et réformiste. En mars 1938, les organisations affiliées à ce mouvement lançaient un vibrant appel au peuple suisse à la suite de l’Anschluss de l’Autriche et à l’Allemagne nazie :
Signé (notamment) par la Communauté de travail des jeunes catholiques, l’Union des démocrates libres de Saint-Gall, le Parti Populaire Démocratique (PDC) des Grisons, la VPOD, les groupements " Esprit " de Genève, Neuchâtel et Sion, les Jeunes Démocrates (libéraux) de Bâle, le Parti libéral-radical démocratique du Tessin, le Parti national paysan (agrarien) vaudois, l’Union Syndicale Suisse et le Parti Socialiste Suisse.
Dans les grandes villes alémaniques, le PSS participera à des manifestations exprimant cette volonté d’unité nationale, aux côtés de représentants des partis bourgeois et d’officiers " patriotes " (en Romandie, la ligne " de gauche " imprimée au PS par Léon Nicole excluait encore ce rapprochement avec la droite démocratique, puisque Nicole privilégiait une stratégie de " front populaire " avec les communistes). Les 21 et 22 mai 1939 se tint à Bâle le congrès du PSS, qui y confirma son choix de l’ " unité patriotique dans la démocratie ", par une résolution exprimant les conditions d’une action commune avec la droite :
Le congrès confirme son appui sans réserve au programme du Mouvement des Lignes directrices et autorise le Comité directeur et le Comité central à poursuivre l’action commune inter-partis dans le sens et l’esprit de la présente résolution.
PSS, Documentation… op.cit. p. 15
Comme manifestation de cette volonté " consensuelle " qui le mènera au Conseil fédéral, le PSS décide la 13 novembre 1939 d’accepter le projet de réforme transitoire des finances fédérales. Reste, et ce sera le plus difficile (on n’y arrivera qu’en 1944) à infléchir la politique extérieure de la Confédération dans un sens aussi nettement antifasciste que possible (mais le possible est modeste) :
PSS, Documentation… op.cit. p. 16
A contrario, le PSS va donner comme exemple de ce qu’il refuse les " courbettes de Motta devant Mussolini ", citant du Conseiller fédéral ce discours de Lugano du 2 octobre 1938 où Motta salue " avec le plus profond respect humain le grand chef du pays voisin, Benito Mussolini, qui, grâce à une merveilleuse intuition de l’esprit et une imposante force de volonté, a rallié les esprits encore déconcertés et s’est acquis par là le titre du plus haut mérite " -à quoi le Giornale d’Italia répond en février 1939 en sauvant Motta (" le seul (membre du gouvernement suisse) qui comprenne la puissance actuelle de l’Italie ") de l’opprobre générale dont les fascistes frappent la Suisse et ses politiciens (à la seconde exception de Etter, " notre ami pour des raisons idéologiques " selon le même journal italien.
La liste dressée par le PSS des " courbettes de la Suisse " devant Mussolini est longue : reconnaissance " précipitée " de la conquête italienne de l’Abyssinie, bienveillance à l’égard de journalistes fascistes italiens expulsés de Genève, désignation d’un admirateur de Mussolini et époux d’une comtesse italienne comme Ambassadeur de Suisse à Rome, défense " molle " des Suisses emprisonnés en Italie pour leurs activités antifascistes, attitude " insuffisamment énergique " à l’égard de l’irrédentisme italien au Tessin et dans les Grisons. A quoi s’ajoutent d’autres " courbettes ", devant Hitler et Franco cette fois : privilèges diplomatiques accordés dès 1937 aux franquistes (alors que le régime espagnol légitime, en fonction de tous les critères du droit international, et de la légitimité démocratique, est toujours celui de la République), intervention auprès de l’Agence Télégraphique Suisse pour que les forces franquistes soient désignées comme " troupes nationales ", arrêtés frappant tous ceux qui apportent une aide à l’Espagne républicaine, condamnations infligées aux volontaires suisses des Brigades Internationales et des colonnes anarchistes, reconnaissance " précipitée ", enfin, du gouvernement franquiste en 1938 déjà, alors que la République est toujours là, qu’elle tient toujours Madrid et Barcelone, que son gouvernement est toujours en place, que son armée combat toujours…). Cette politique de la Suisse est évidemment saluée par le journaliste fasciste de Pampelune Diario de Navarra qui, le 31 juillet 1938, félicite Motta et lui exprime sa reconnaissance. A l’égard de l’Allemagne nazie, les reproches de la gauche sont les mêmes, et les exemples qu’elle cite sont comparables : " passivité " à l’égard des menées nazies en Suisse, excellentes relations entretenues avec les responsables de ces menées, complaisance à l’égard des tentatives allemandes de museler la presse antinazie suisse, envoi à Berlin d’un Ambassadeur acritique à l’égard du nazisme, " absence constante de fermeté " face aux violations de la souveraineté suisse par des douaniers et des policiers allemands pourchassant en Suisse même des fuyards d’Allemagne…
A bout du compte, c’est toute la politique extérieure de la Confédération qui est ainsi dénoncée comme systématiquement favorable aux forces de l’Axe. Un florilège de déclarations de Motta, de citations de la presse allemande, italienne et franquiste espagnole forme argumentaire de cette dénonciation : c’est Motta qui, le 22 décembre 1937, au moment où l’Italie quitte la SdN, se demande si la Suisse ne devrait pas lui emboîter le pas ; c’est le refus suisse de s’associer réellement aux sanctions décidées par la SdN contre l’Italie ; c’est Motta, encore, qui innocente l’Allemagne de tout " mauvais dessein " envers la Suisse ; ce sont, enfin, les arrêtés et les décisions fédérales visant la presse, les pressions sur les journaux de gauche, les poursuites contre les antifascistes…
Dénoncée parce qu’elle est favorable aux totalitarismes réactionnaires, la politique extérieure de la Suisse l’est aussi parce qu’elle viole la " neutralité véritable " qui, pour les socialistes, implique des relations " correctes avec tous les Etats " -y compris, donc, l’Union Soviétique. Le PSS dénonce l’ " irréductible opposition " de Motta à la reconnaissance de l’URSS par la Suisse, et n’hésite pas à brandir l’argument économique pour défendre cette reconnaissance (en la comparant à celle des régimes nazi et fasciste qui, elle, ne posa nul problème à la Suisse officielle :
PSS, Documentation… op.cit. p. 18
" Pas de courbettes devant l’étranger, quel qu’il soit ! L’indépendance et l’honneur à la première place ! " : le PSS fait sienne cette envolée lyrique… de Giuseppe Motta lui-même, et en renvoie la leçon à son auteur en l’accusant précisément de se " courber " devant le fascisme en oubliant " l’indépendance et l’honneur ". Toute l’activité du groupe parlementaire socialiste aux Chambres fédérales, telle que la présente le parti à la veille du renouvellement du Parlement, peut ainsi être lue comme un rappel à l’ordre du Conseil fédéral, et singulièrement de Motta, au nom de l'indépendance nationale, au nom même de la " neutralité ". En juin 1934, Reinhard dénonce l’inégalité de traitement dans les relations de la Suisse avec l’Allemagne d’une part, l’Union Soviétique d’autre part ; en mars 1937, Meierhans s’interroge sur la reconnaissance (" précipitée ") par la Suisse de la souveraineté italienne sur l’Abyssinie, et Huber sur les contacts entre personnalités suisses (dont l’ancien Conseiller fédéral Schulthess) et allemandes (nazies), dont Hitler lui-même ; en septembre 1937, Robert Grimm interpelle le Conseil fédéral au sujet de sa politique à l’égard de l’Espagne et de la faveur en laquelle il semble tenir les franquistes ; en janvier 1939, Giovanoli fait de même au sujet des accointances helvéto-japonaises, et en octobre 1937, Léon Nicole et Robert Grimm interpellent le Conseil fédéral à propos des activités des services nazis en Suisse.
 Sur ce dernier point, le PSS fait également état d’une activité parlementaire importante, constituant en une dénonciation constante des activités nazies en Suisse, l’amenant à exiger des autorités fédérales une politique plus ferme que celle qu’elles mènent :
Sur ce dernier point, le PSS fait également état d’une activité parlementaire importante, constituant en une dénonciation constante des activités nazies en Suisse, l’amenant à exiger des autorités fédérales une politique plus ferme que celle qu’elles mènent :
PSS, Documentation… op.cit. p. 20
Les parlementaires fédéraux socialistes ne se firent en effet pas faute d’exiger inlassablement la répression des menées nazies et fascistes en Suisse. En juin 1935, Welti demande au Conseil fédéral de mettre un terme à la propagande " systématique et intensive de l’étranger au moyen du film " ; en juin 1936, Bringolf invite le Conseil fédéral à dissoudre et à liquider dans les plus brefs délais les organisations fascistes composées d’étrangers ; en janvier 1936, Schneider demande au Conseil fédéral ce qu’il compte faire pour protéger les personnes domiciliées en Suisse (et en particulier les réfugiés politiques antinazis) des agissements de la Gestapo. Cette dernière intervention (une interpellation) faite suite à l’arrestation, grâce à un traquenard qui lui fut tendu en Allemagne, d’une " dame Wermelinger " établie à Bâle. Le 8 septembre 1937, Bringolf intervient pour dénoncer les accointances entre nazis allemands et " frontistes " suisses à l’occasion de la mise en votation, le 28 novembre, de l’initiative " anti-maçonnique " de l’extrême-droite suisse -ces accointances étant d’ailleurs dans l’ordre des choses idéologiques du moment. Bringolf dénonça notamment les activités et les " ingérences dans les affaires de notre pays " du " Service Mondial " du nazi Fleischauer, ainsi que les versements de fonds allemands au " frontiste " Tödli, et posa au Conseil fédéral une question que d’autres lui poseront une dizaine d’années plus tard -mais avec les communistes pour cible : N’êtes-vous pas convaincus que " l’appartenance à une organisation ou à un parti se réclamant du national-socialisme est incompatible avec toute fonction dans l’administration publique ou dans l’armée " ?
Lors de la discussion parlementaire sur la création d’une " Chambre suisse du cinéma " en 1938, Arthur Schmid dénonce la reprise par le programme de la radio suisse alémanique transmise en " télédiffusion " (par lignes téléphoniques) d’une grande partie du programme allemand : il n’y a pas d’autre pays, selon le socialiste, où l’on diffuse de cette manière " une pensée étrangère qui mine la démocratie ". En 1938 toujours, c’est le parti socialiste de Bâle-ville qui lance une initiative populaire, conçue sur le modèle des initiatives anticommunistes mais visant cette fois à l’interdiction des organisations nazies, fascistes et frontistes. Le Conseil fédéral, qui avait laissé faire (et officieusement approuvé) les initiants anticommunistes, mis le holà aux intentions des initiants antifascistes, au prétexte que l’interdiction qu’ils demandaient des organisations étrangères relevait des compétences exclusives de la Confédération. C’est, à nouveau, la pratique du " deux poids, deux mesures ", abondamment dénoncée par la gauche, y compris son aile la plus anticommuniste. Le 6 décembre 1938, Meierhans demande au Conseil fédéral d’agir pour mettre un terme au " flot d’étudiants étrangers einsatzbereit (idéologiquement préparés) qui doit être déversé dans nos universités ". Face à la propagande allemande, dans les dernières semaines de l’Entre-deux-guerres, le PSS réaffirme ses choix : le 1er juin 1939, son Comité central décide d’entreprendre une campagne pour la liberté de la presse, c’est-à-dire contre la censure insidieuse que le Conseil fédéral fait peser sur les publications et les publicistes antinazis et antifascistes.
Jusqu’en 1936, le fascisme et le nazisme étaient combattus parce qu’ils menaçaient les droits et les libertés, chèrement conquis, dont pouvaient disposer les travailleurs et leurs organisations ; dès 1936, le fascisme est aussi perçu (et dénoncé) comme une menace pour la paix en Europe. Que fascisme et nazisme fussent bellicistes, on le savait déjà ; mais on pensait pouvoir circonscrire ces velléités guerrières aux théâtres africains des expéditions italiennes, asiatiques des opérations japonaises. 1936, avec la réoccupation allemande de la Rhénanie et avec la Guerre d’Espagne, c’est le retour du spectre de la guerre en Europe.
Le 7 mars 1936, la Reichswehr se met en marche vers la Rhénanie, territoire allemand démilitarisé par les vainqueurs de 1918 sur cinquante kilomètres de part et d’autre du Rhin. A Locarno, le 15 octobre 1925, le gouvernement républicain allemand avait conclu avec la France et la Belgique un accord par lequel il reconnaissait qu’une éventuelle entrée de l’armée allemande dans la zone démilitarisée de Rhénanie pût être considérée comme " une agression au même titre que le franchissement de la frontière ". Un peu plus de dix ans après, Hitler fait défiler son armée dans Cologne, Trèves, Fribourg et Aix La Chapelle. La France, directement visée, semble privée par la surprise des moyens de réagir, alors que la crise était prévisible, et succédait à une année de tensions et de menaces allemandes. Le 2 mai 1935, la France avait signé avec l’Union Soviétique un pacte d’assistance mutuelle violemment dénoncé par l’Allemagne : ce pacte violerait l’ " esprit de Locarno " (il n’en violait en tous cas aucunement la lettre), et associerait dans une alliance offensive (elle n’était que défensive, et hypothétique) les deux ennemis jurés du national-socialisme allemand : la démocratie " judéo-maçonnique " et le bolchevisme. En réalité, le pacte franco-soviétique n’était qu’une réponse à l’annonce par l’Allemagne, le 16 mars précédent, de son réarmement -mais il sera surtout pour Hitler prétexte au coup de poker rhénan, quoique certains de ses conseillers militaires (notamment les généraux von Blomberg et von Fritsch) l’eussent mis en garde contre les risques d’une riposte militaire française à laquelle l’Allemagne n’était pas encore en état de répondre. Mais Hitler avait parié sur l’inaction française -et il n’eut pas tort.
Le 7 mars 1936, Hitler se lance au Reichstag dans un violent réquisitoire anti-français : s’attribuant la mission de " libérer le peuple allemand des entraves du traité de Versailles ", revendiquant pour l’Allemagne les mêmes droits que ceux dont disposent les autres nations (revendication d’ailleurs curieusement minimaliste, dans la bouche du héraut de l’ " espace vital " et de la mission de la " race aryenne " en Europe), il dénonce l’alliance franco-russe, prédit la " bolchévisation " de la France et justifie la réoccupation militaire de la Rhénanie par le risque de voir des décisions " françaises " être prises à Moscou (ce qui était, il le savait fort bien, surestimer largement l’importance d’une alliance qui fit long feu). Et d’annoncer, dans un délire d’applaudissements, que son gouvernement, " conscient de l’intérêt vital du peuple allemand, a rétabli sa pleine souveraineté en Rhénanie. Des troupes allemandes sont en marche ". Comme l’escomptait Hitler, la France réagir avec une insigne faiblesse à ce qui était, au sens des dispositions de Versailles et de Locarno, une véritable provocation. L’Angleterre se moquant de la Rhénanie, l’Italie étant engagée en Afrique (et donc dégagée pour un temps des enjeux européens, sauf à se sentir menacée sur ses frontières), la France restait seule à pouvoir -et à devoir- réagir (l’Union Soviétique n’en ayant nullement l’intention). Et la France ne réagit pas, faute de gouvernement (Albert Sarraut dirige un gouvernement de transition avant les élections législatives du 26 avril, qui verront la victoire du Front Populaire), mais faute, surtout, de volonté. Le Général Gamelin avait émis, à la grande surprise des Allemands (qui savaient qu’il se trompait complètement) l’opinion que les forces militaires allemandes étaient supérieures à celles de la France. Sarraut eut beau déclarer à la radio que la France n’était pas disposée à " laisser placer Strasbourg sous le eu des canons allemands ", la réoccupation et la remilitarisation de la Rhénanie fut menée sans coup férir. L’événement fut sans doute provocateur d’une inquiétude nouvelle : aux menaces fascistes et nazies sur les libertés s’ajoutait donc le danger pour la paix européenne. L’Ennemi " absolu " le devenait réellement : ennemi du Droit et des droits, ennemi de la paix. L’Espagne le confirmera tragiquement, en suscitant, en Suisse comme ailleurs, un profond mouvement de solidarité de la gauche locale avec la gauche espagnole.