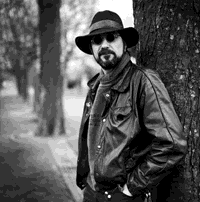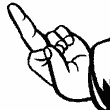

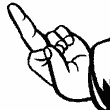

Le fascisme, ennemi principal

La fusion des
thèmes politiques locaux, nationaux et internationauxVingt ans de dénonciation par la
gauche des complaisances du Conseil fédéralChine, Abyssinie : la politique de la
force submerge l’ " esprit de Genève "Le voyage en Allemagne nazie de trois
communistes suisses (1933)La Suisse officielle
prête à s’allier avec l’Italie fasciste contre l’URSS stalinienneDe
Conradi à Frankfurter : les " bons " et les " mauvais " tyrannicidesLes
peuples de la périphérie, remparts ou alliés contre le fascismeLe réseau associatif du fascisme
italien en SuisseL’
Alliance Antifasciste SuisseAu
Tessin, le fascisme italien et l’irrédentisme italianiste se conjuguentLa
concurrence entre fascistes et nazisLe rôle essentiel de " La Libera
Stampa " dans le combat antifasciste au TessinContre le fascisme, " tous les
moyens, même légaux "Le double jeu de
CanevasciniL’
Ambassadeur d’Italie s’inquiète de la radio suisse de langue italienneLa " Marche sur
Bellinzone " des fascistes tessinois (1934)Le "
modéré " Canevascini, moins légaliste que l’ " extrémiste " Nicole ?La "
ligne de partage " entre partisans et adversaires du fascisme passe " au centre de la droite "La division des
catholiquesLe
cousinage de la droite traditionnelle romande avec le fascisme transalpin (puis le pétainisme français) Mussolini docteur honoris causa de l’Université de LausanneLe
syllogisme du " patriotisme antifasciste "La Suisse reconnaît l’ "
Empire " italienLa Suisse, après l’
Autriche ?L’ " Affaire
Gustloff " (ou Frankfurter)La "
diplomatie révolutionnaire " des nazis en SuisseLes illusions de la presse
bourgeoise et de la droite démocratique sur le nazismeLes
virevoltes et les illusions des communistes à l’égard du fascisme et du nazismeLa classe politique suisse et l’
antisémitisme (allemand)Le Conseil fédéral tente de
museler la presse suisse, pour complaire à l’Allemagne1935 : l’ " Affaire
Jacob "La
radicalisation des conflits intérieurs est le moment de l’intégration du PSS à la normalité politique suisseLa gauche suisse, de la volonté de
changement de la société au travail de changement des formes de la sociétéLe choix syndical de la
concertation (La Paix du Travail)Un " auto-
désarmement " des travailleurs ?La " Paix du
Travail " : une méthode, un principe et un symboleL’organisation syndicale (re)devient sa propre
finLe
programme de travail de l’USS et l’ " Initiative de crise " (1934)Le
Mouvement des Lignes Directrices "De la " dictature du prolétariat " au " large front
populaire du travail "L’analyse
trotskiste (1938)Un refus
antifasciste du front uniqueLe PSS admet la légitimité de la
défense nationale (1935)La social-démocratie,
ennemi principal au sein de la classe ouvrière Ramuz et l’URSSL’interdiction du Parti
communiste" Le Parti communiste se porte
garant de la défense spirituelle, économique et militaire du pays "Le Mouvement des
Lignes Directrices, modèle de réformisme social-démocrate, et non-dit de la gauche suisseUn itinéraire socialiste : George-Henri
PointetLe mot d’ordre trotskiste en 1938 : " Ne pas faire
confiance à la bourgeoisie pour assurer la défense du pays "Le " coup de
tonnerre " du pacte germano-soviétiqueLes effets dévastateurs du
pacte sur la gaucheL’
exclusion de Nicole, de ses partisans et de la gauche socialiste, l’éclatement de la gauche romande.Le cas de la
Jeunesse SocialisteL’
Opposition Socialiste (SP-Opposition)Les effets de la scission politique dans les
syndicats3 décembre 1939 : Fondation de la
Fédération Socialiste SuisseLa
tentation fasciste des hommes de gaucheUn "
doriotisme nicoléen "1943 : les "
nicolistes " ressortent de la " semi-clandestinité "L’alliance entre Nicole et
Duttweiler
Si la " question soviétique " fut de celle qui, pendant toutes les années trente, divisèrent les socialistes en opposant leurs ailes gauche et leur direction suisse, et en opposant le PSS au PCS, elle ne fut évidemment pas la seule à " faire débat " dans l’ensemble du monde politique suisse : les régimes autoritaires de droite, eux aussi, suscitèrent affrontements politiques en Suisse. La politique internationale est un thème de politique intérieure -un thème dont la mise en débat se fait avec la participation de plus en plus massive de l’opinion publique. La rigueur des temps et la force des crises internationales " fusionnent " les thèmes politiques locaux, nationaux et internationaux, de telle manière que toute consultation électorale ou référendaire pourra avoir, dans ces années-là, quelque connotation " internationale ", ne fût-elle que symbolique.
L’évolution de la politique étrangère de la Suisse, en particulier dès 1933 et l’arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne pourra donner l’impression d’un renforcement de la tentation autoritaire. A tout le moins, l’antisoviétisme foncier de l’action de la Suisse sur la scène internationale trouvera en Italie et en Allemagne un écho dont la complaisance alarmera la gauche (et l’aile progressiste de la droite démocratique). La volonté de se défendre contre le menace des régimes autoritaires qui entourent progressivement le pays -volonté hautement manifestée par le PSS et l’USS- va ainsi paradoxalement se traduire, de la part du gouvernement fédéral, par moult complaisances à l’égard des récriminations de ces régimes, particulièrement sensibles aux commentaires, aux analyses et aux informations paraissant dans une presse suisse qui, en langues allemandes et italienne, est un refuge " naturel " pour une pensée libre (antinazie et antifasciste) : hors l’émigration, la Suisse est le seul Etat où une presse en langue italienne puis allemande pût paraître à peu près librement -et les quotidiens socialistes tessinois et alémaniques les seuls quotidiens socialistes en allemand et en italien pouvant donner aux antinazis et aux antifascistes une contre-information sur leurs propres pays -cela écrit sans omettre que la presse " bourgeoise " elle aussi put jouer ce rôle.
Les sympathies politiques de Giuseppe Motta, à l’évidence plus " italophile " que " fasciste " (et tout sauf " nazi ") pèsent sur les choix politiques fédéraux. Motta n’est pas fasciste, mais l’Italie l’est, et Motta est italophile, et la conjonction de son conservatisme, de son anticommunisme et de son italophilie explique largement la faveur en laquelle il tint le régime de Rome -même si Mussolini n’avait rien d’un conservateur, même si son " antibolchévisme " souffrait de curieuses éclipses, sa rhétorique anticommuniste s’accompagnant de relations d’Etat à Etat longtemps " convenables " avec l’URSS (du moins jusqu’à la Guerre d’Espagne). Les choix de Motta font polémique depuis l’instauration du fascisme en Italie -polémique en laquelle, naturellement, s’illustre la gauche. Ainsi, en 1924, ce commentaire de Paul Golay :
Mais il y eut, en son temps, une autre tradition. Celle-là nous est chère et nous avons quelque fierté de la rappeler. On se dressait alors devant les rois, la pipe à la bouche et l’air narquois. On aimait les proscrits. Ceux dont la tête était à prix dînaient alors chez les Conseillers d’Etat et l’on se faisait gloire de narguer les aristocrates de France et de Navarre. (…) On (aimait la Suisse) dans son orgueil et sa fierté devant les tyrans. Même ceux qui l’eussent voulue à leurs pieds éprouvaient quelque respect devant son audace et son calme. Et ce respect tissait autour d’elle une protection efficace. Elle était une chose nécessaire parce qu’elle était différente des autres en demeurant un exemple, un asile. Cette force de respect était notre sauvegarde. On s’est plu à la compromettre et à la remplacer par le perfectionnement des institutions militaires. Quelle erreur, et quel crime !
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. biblio, pp 138, 139
L’ire de Golay annonce vingt années de reproches, de dénonciations, de condamnations par la gauche des complaisances du gouvernement fédéral à l’égard des fascismes. S’appuyant sur une vision idyllique de la Suisse radicale des années 1850, il rappelle les gouvernants des années 1920 et 1930 à la fidélité aux principes de la révolution démocratique. Comme Golay en 1924, la gauche démocratique toute entière ne cessera d’inciter la droite démocratique à respecter ses propres codes éthiques. Il en sera ainsi lors de l’ " affaire des sanctions " : décidées par la Société des Nations à l’encontre de l’Italie à la suite de ses expéditions africaines -et précisément de l’invasion, déclenchée le 2 octobre 1925, de l’Abyssinie, ces sanctions (prévues par l’article 16 du pacte de la SdN) seront récusées par la Suisse, qui ne s’y associera pas. A la tribune de la SdN, Motta déclare le 10 octobre que la Suisse ne se sent pas tenue au respect de sanctions qui mettraient en cause sa neutralité. La gauche en tirera la conclusion (logique) que la neutralité compte moins pour Motta et la droite gouvernementale (qui en effet de l’invoquent guère lorsqu’il s’agit de l’Union Soviétique) que les bonnes relations avec le régime romain, lors même que ce régime peut apparaître comme une menace pour l’unité confédérale et pour l’ordre public, références constantes des discours, sinon de l’action, politiques de la droite. Ni l’irrédentisme italianiste au Tessin, ni les incidents réguliers occasionnés par l’activisme fasciste (notamment, mais non exclusivement, au Tessin) ne seront de nature à atténuer le soupçon socialiste de connivence entre la Berne fédérale et la Rome fasciste. Ce n’est pas sur le seul Motta que porte ce soupçon, mais sur une grande partie de la droite bourgeoise. En 1926, Paul Golay dénonce les amitiés compromettantes des partis " nationaux " :
Paul Golay, op.cit. pp 118, 119
Au moment de ce discours, la crise européenne majeure n’est pas encore advenue. Les relations européennes, dominées par les problèmes franco-allemands, paraissent être en voie de constante amélioration : la France va évacuer militairement la Rhénanie. Le répit toutefois sera de bien courte durée : la crise intérieure allemande, présage de la victoire nazie, le changement de la politique étrangère allemande qui s’ensuit, vont mettre fin à l’ " embellie ". En mars 1930, la chute du ministère Müller annonce la fin de la République parlementaire ; Stresemann était mort l’année précédente, et avec lui la volonté de parvenir par la négociation et l’établissement de relations privilégiées avec la France, à une révision du traité de Versailles. En 1931, le projet d’ " union douanière " austro-allemande manifestera clairement la nouvelle orientation de la diplomatie allemande, encore (pour deux ans) entre les mains de " démocrates ", mais de moins en moins fidèles à l’héritage du coupe Stresemann-Briand. Et c’est pour l’ensemble de l’Europe que la dégradation du climat deviendra évidente.
Aristide Briand, au nom du gouvernement français, fait une ultime tentative de "fédération européenne " en envoyant le 1er mars 1930 un projet d’union fédérale à 26 gouvernements. La Suisse reçoit le projet français… et le renvoie (poliment à son expéditeur au nom de la neutralité. La XIème Assemblée de la SdN renvoie quant à elle le projet, pour étude, à une commission : vieille méthode pour enterrer ce à quoi on ne peut officiellement s’opposer. En fait, l’Italie, l’Angleterre et les membres non-européens de la SdN n’avaient nulle envie de voir naître une Confédération Européenne au sein de laquelle la France eût exercé une influence déterminante (d’où le refus des Italiens et des Anglais) et qui pût devenir une force majeure, voire la principale puissance (la " superpuissance ") mondiale, un cran au-dessus des USA (d’où l’opposition des non-européens). La commission d’étude, comme prévu, " frigorifia " le projet, qui fut définitivement abandonné après la mort de Briand, en 1931. Giuseppe Motta faisait partie de cette commission : il y réitéra l’opposition de la Suisse -et la sienne propre- à tout projet qui ferait passer l’ " européisme " de l’état d’idéal à celui de réalité.
La SdN affronte déjà les prémices de la Guerre Mondiale. La montée des fascismes aidant, l’idéalisme wilsonien ou briandiste passe de mode. La Chine et le Japon entre en guerre en 1931 en Mandchourie : l’une et l’autre dont membres de la Société des Nations, comme en seront toutes deux membres, quatre ans plus tard, l’Italie et l’Abyssinie. Ces deux conflits, le chinois d’abord, l’abyssin ensuite (et surtout) vont mettre en pleine lumière l’importance prise par la périphérie dans les rapports de force internationaux. Dans les deux cas, s’il s’agit de conflits échappant au cadre traditionnel du colonialisme, la volonté de puissance d’Etats jusqu’alors relativement " marginaux " (l’Italie et le Japon) fait prendre conscience d’un changement de l’ordre du monde : l’œil du cyclone n’est plus immuablement situé sur la frontière franco-allemande. Dans une conférence faite au Caire en 1939, Georges-Henri Pointet tire un enseignement de gauche de cette recomposition, à la mode fasciste, des relations internationales :
Georges-Henri Pointet, vie, textes, documents, op.cit.biblio p. 30
Le droit des nations à l’indépendance, le droit des peuples à la dignité, étaient du credo " genevois " ; les années trente y substituent une pure logique de force. A gauche, et le discours de Pointet en témoigne, cette substitution provoque elle-même un aggiornamento des références théoriques : par l’antifascisme se fait la découverte des peuples de la périphérie, et plus précisément encore leur reconnaissance : les peuplades deviennent des peuples ; encore un pas, et ces peuples seront reconnus comme des nations (à tout le moins, comme le PC français le dira de l’Algérie, des " nations en formation " ou en devenir). Ce n’est évidemment pas par sympathie pour le régime politique impérial abyssin que la gauche va dénoncer l’entreprise italienne, mais bien plutôt par conjonction de l’antifascisme et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais ce droit ne sera reconnu aux Abyssins que parce qu’il est nié par le fascisme : l’aurait-il été par une puissance " démocratique " que cette reconnaissance eût sans doute été bien plus prudente. Le cas du conflit sino-japonais, s’il diffère en ce que ses deux acteurs sont " périphériques ", permet l’émergence de cette même préoccupation : l’agression japonaise, puis la création de l’Etat " fantoche " du Mandchoukuo, seront condamnées autant pour la parenté du militarisme japonais et du fascisme italien que parce que la politique de l’un et de l’autre manifeste un égal mépris du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en même temps qu’un profond racisme, à l’égard des Ethiopiens comme à l’égard des Chinois (dans ce dernier cas, ce racisme est peut-être nourri de quelque complexe d’infériorité historique du Japon à l’égard d’une Chine à qui il doit beaucoup de sa culture). C’est au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que le délégué chinois (représentant le gouvernement du Kuomintang de Chang Kaïchek) dénonce en mars 1932 à Genève, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la SdN, l’agression japonaise et la création du Mandchoukuo. Au nom de la Suisse, Motta déclare le 5 mars que, s’il faut tout faire pour arriver à une conciliation, il faut tout faire aussi pour éviter le recours aux sanctions. Position que la gauche dénoncera comme mettant sur le même pied l’agresseur japonais et l’agressé chinois, en se rendant ainsi complice de la politique du fait accompli menée par le premier. A nouveau, la SdN créée une commission, manifestant par là son incapacité à faire respecter ses propres principes. Lorsqu’en automne 1932, la victoire japonaise est acquise, la Chine en tire les conséquences, en se rapprochant de l’Union Soviétique, l’alliance du Comintern et du Kuomintang étant depuis longtemps l’un des axes de la politique asiatique de Staline. Il put d’ailleurs se trouver que des Suisses jouassent quelque rôle dans cette politique, par ailleurs chaotique : en février 1932, Jean Vincent est envoyé en Chine pour y défendre deux " présumés suisses " (qui en réalité ne l’étaient pas), condamnés à mort par les autorités chinoises (du Kuomintang) sous leur nom d’emprunt (fourni par le Comintern) de Paul et Gertrud Ruegg. La section suisse du Secours Rouge international et deux comités de soutien, à Paris (avec Henri Barbusse et Romain Rolland) et Zurich (avec Willy Münzenberg et Fritz Platten) avaient pris en main la défense de ces deux secrétaires des syndicats " panpacifiques " et en avaient chargé l’avocat communiste genevois.
La Chine au cœur des préoccupations et de l’action du Comintern, c’est la conséquence de l’échec des révolutions européennes, mais aussi de la nouvelle importance prise par la périphérie sur la scène mondiale. Il faudra attendre la fin provisoire du conflit sino-japonais (par la victoire non moins provisoire du Japon) pour que la SdN condamne l’action japonaise ; le Japon ne risque alors plus rien à manifester son refus d’une " décision " si tardive, et s’apprête à quitter l’organisation genevoise. Auparavant, en plein conflit sino-japonais s’était ouverte la conférence du désarmement de la SdN, réunissant ses Etats membres, les USA et l’URSS en vue de la discussion et de l’adoption d’une convention internationale de réduction des armements. Mais sous cet intitulé, les objectifs des uns et des autres, et leurs conceptions d’une politique de désarmement, divergeaient fondamentalement. Pour la Grande-Bretagne, la désarmement multilatéral était le moyen de prévention des guerres, position paradoxalement partagée par l’Italie mussolinienne. La France demandait quant à elle la création d’une force multinationale sous autorité de la SdN. L’Allemagne, enfin, exigeait d’être traitée sur pied d’égalité avec les vainqueurs de 1918, et l’abrogation des clauses " vengeresses " du traité de Versailles. Quant à la Suisse, participant à la conférence, elle n’était pour sa part que fort tièdement convaincue de la nécessité du désarmement général, et fermement opposée au sien en particulier. Elle refusa en tous cas de cautionner une politique de désarmement multilatéral et général, persuadée qu’elle était (ou se disait) qu’une telle politique affaiblirait ses propres moyens militaires de défense de sa neutralité. Intervenant le 16 mars 1932, Motta n’en proposera pas moins l’interdiction des armes purement offensives. Il tentera durant toute la conférence de créer un " front des neutres " à un moment où les rapports entre les Etats dominants devenaient de plus en plus mauvais, souvent conflictuels et constamment soupçonneux. La situation n’allais pas s’arranger avec l’avènement de nouveaux régimes autoritaires et l’envoi à Genève de délégations de plus en plus nombreuses à professer des conceptions voisines ou inspirées du fascisme.
Le 6 juin 1933, un " pacte à quatre " entre la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie est proposé par Mussolini : il s’agissait de réviser les traités consécutifs à la Grande Guerre en s’inspirant de l’ " esprit de Genève ". Ce projet n’eut guère plus de chance que les précédents, et alarma tout particulièrement les Etats du centre et de l’est de l’Europe, dont la survie et l’indépendance étaient étroitement liées au respect intégral des traités " versaillais " de 1918-1920. La " nouvelle donne " européenne s’affirme ensuite, dès l’automne 1933, par le fait (et les actes) d’une Allemagne désormais en mains nazies. Alors que l’Italie fasciste avait prudemment joué le respect, au moins apparent, des mœurs et des procédures, l’Allemagne nazie rompt avec les règles admises. En septembre 1933, ses représentants se lancent dans un exposé des mérites d’une politique raciste et de la nécessité de la discrimination antisémite, tout en manifestant une agressivité dont les représentants de la République de Weimar, si nationalistes qu’ils pussent être par ailleurs, s’étaient scrupuleusement abstenus. Du coup, la tension entre les grands acteurs de la scène européenne monte brutalement. La France, la Grande-Bretagne et, en coulisses, les USA, imposent un " délai probatoire " de trois ans avant d’accorder à l’Allemagne ce qu’elle exige : l’égalité de traitement en matière militaire. Les représentants allemands quittent Genève le 14 octobre 1933 sur ordre de Hitler : c’en est fini des espoirs, partagés par la Suisse, d’une révision diplomatique et consensuelle des traités de l’Après-guerre. Et c’en est fini aussi de l’ " esprit de Genève ". Quelques mois seulement après l’accession des nazis au pouvoir, la guerre réapparaît comme une possibilité en Europe. Du coup, la candidature soviétique à la SdN se trouve, sur le tard (sur le " trop tard "…) parée de qualités nouvelles, dont celle de représenter un contrepoids au nazisme n’est pas la moindre. L’Italie fasciste elle-même s’inquiète et tende de rejoindre la France (et même la Grande-Bretagne) dans une " ouverture à l’est " -que boudera la Suisse.
Motta, qui " fait " toujours la politique étrangère helvétique, s’en tient aux principes anticommunistes qu’il affirme depuis qu’existe l’Union (et avant elle, la Russie) soviétique. En Suisse, pourtant, le danger nazi fait comprendre à la gauche réformiste l’utilité de l’institution genevoise (à laquelle elle était d’ailleurs, " en principe ", favorable) -une utilité que les communistes lui reconnaîtront aussi lorsque l’URSS aura été admise à la SdN-, alors qu’en réalité, et sans que nul ne s’en soit encore clairement rendu compte, ou l’ait explicitement dit, la Société des Nations est agonisante. L’opposition du mouvement ouvrier suisse à la politique de Motta se trouve donc revigorée : c’est à nouveau la menace extérieure qui pousse à la prise de conscience internationaliste. Parallèlement, les attraits, réels ou illusoires, d’un hypothétique " marché soviétique " pour l’industrie suisse d’exportation, sont suffisants pour convaincre nombre de dirigeants économiques, et de leurs amis politiques, de l’utilité d’établir avec le " géant oriental " (si antipathique qu’il leur soit par ailleurs) de correctes relations. Il y a en fait convergence d’intérêts entre l’antifascisme des uns et le souci des autres de surmonter la crise en s’ouvrant un nouveau marché, précisément préservé de la crise qui ravage les économies capitalistes.
Au plus fort de la terreur stalinienne, l’Union Soviétique perd ainsi de son pouvoir de menace, au fur et à mesure qu’une menace plus claire, plus directe et plus voisine se précise : celle du nazisme. Les plus antistaliniens d’entre les socialistes et les syndicalistes s’en rendent compte : Hitler, qui hait la démocratie " bourgeoise " plus encore que le bolchevisme (et la France plus encore que l’Union Soviétique), et qui le dit, est plus dangereux pour la Suisse que Staline, ne serait-ce que parce qu’il est plus proche, et qu’il manifeste ses intentions avec une totale absence de respect des formes (au contraire de Mussolini, par exemple). Les premiers à s’en rendre compte seront les communistes. En 1933, afin de prendre des nouvelles de Ernst Thälmann, emprisonné par les nazis dès leur prise du pouvoir, trois communistes suisses (dont Jean Vincent) font le voyage de Berlin, pour s’entendre dire par la Légation de Suisse qu’ils n’auraient à compter sur aucun concours des autorités helvétiques en cas de mésaventure, et pour se voir refuser tout droit de visite à Thälmann par les autorités allemandes. Mais les communistes suisses purent tout de même se rendre (en visite, eux…) dans le camp de concentration d’Oranienburg, au début de 1934… Jean Vincent avait par ailleurs sollicité son accréditation comme avocat lors du procès des " incendiaires du Reichstag ", où les communistes Dimitrov, Torgler, Popov et Tanev étaient accusés. Cette accréditation fut refusée à l’avocat communiste genevois, qui ne put ainsi participer à la transformation par Dimitrov de son propre procès en procès du nazisme.
" L’ennemi de notre ennemi est notre allié " : préfigurant Churchill justifiant en 1941 son alliance avec Staline, la gauche réformiste est prêts à s’allier avec un " diable " (soviétique) contre un autre (nazi), dès lors que le second lui apparaît, à raison, comme plus dangereux que le premier. Motta, lui, se refusera jusqu’au bout à un tel choix. Partisan de l’universalité de la SdN, il y fait cependant une exception de taille : celle de l’URSS, dont il craint encore la " diplomatie révolutionnaire " quand elle est déjà devenue objet de nostalgie pour vieux bolcheviks, et qu’il accuse de vouloir transformer l’institution genevoise en tribune de propagande, exercice auquel se livrèrent précisément à Genève tous les régimes autoritaires, à commencer par le fascisme italien. Motta est en retard d’un " tournant " communiste : Staline a depuis des années abandonné, et fait abandonner par l’URSS et le Comintern- tout objectif de " subversion mondiale " au profit de la stabilisation du pouvoir d’Etat soviétique, et de son propre pouvoir sur l’Etat soviétique. Motta lui prête encore des visées et des pratiques léninistes ? Staline n’est plus que stalinien.
Le gouvernement suisse hésitera cependant parfois à suivre son ministre des Affaires étrangères dans son obstination antisoviétique. S’il ne sera pas question de voter en faveur de l’admission de l’URSS à la SdN, malgré les pressions de la gauche en ce sens, du moins pourrait-on s’abstenir… Mais cette abstention, l’extrême-droite la refuse, et avec elle, entraînée par elle, la " droite de la droite " démocratique, l’une et l’autre exigeant une claire position de refus de l’URSS -une position qui fâchera les socialistes et dépitera d’influents secteurs de l’économie, et donc du monde politique bourgeois, qui estiment absurde l’ignorance formaliste en laquelle on veut tenir un Etat (et un marché) de plus de 150 millions d’habitants (et de consommateurs) -un Etat aux énormes besoins infrastructurels, une population aux énormes besoins tout court. Pour cette droite " éclairée " (et intéressée), le pouvoir soviétique, si condamnable que soit son idéologie, fait désormais partie du paysage politique européen, et il est illusoire d’en attendre l’effondrement à court ou moyen terme (nul ne songe à attendre encore plus d’un demi-siècle…). Pour la gauche, en tous cas, le danger nazi prime sur le danger bolchevik, et pour la droite " éclairée ", le raison d’Etat et de l’économie sur les choix idéologiques.
La Suisse, pourtant, s’opposera jusqu’au bout à la candidature soviétique à la Société des Nations. Lorsque le 17 septembre 1934 la commission chargée des admissions propose celle de l’Union Soviétique, Motta intervient pour la combattre. Son discours eut un écho considérable dans le monte entier, réjouissant les uns, indignant les autres (au nombre desquels, outre les Soviétiques qui en tinrent la Suisse en suspicion renforcée pendant près de quinze ans, les socialistes et les forces " bourgeoises " acquises à la " normalisation " des rapports avec l’URSS). Jamais sans doute depuis l’époque de la révolution radicale la voix de la Suisse " officielle " porta si loin, avec une audience si disproportionnée au regard de l’influence et de l’importance réelles de la Confédération sur la scène internationale. En proclamant urbi et orbi (et de Genève) sa certitude des mauvaises intentions d’un Etat " révolutionnaire " soupçonné de n’avoir en adhérant à la SdN d’autre but que celui de miner les " valeurs occidentales " (et chrétiennes), en affirmant que l’URSS à la SdN, c’était le Comintern à Genève, Motta fit du bruit. Du bruit, mais pas la décision. Une majorité écrasante se dessina en faveur de l’admission de l’URSS, conformément au préavis du Français Barthou, soucieux de renforcer la sécurité européenne en faisant entrer à la SdN le plus vaste et le plus peuplé des Etats d’Europe. La Suisse de Motta se retrouva avec le Portugal de Salazar (et, curieusement, avec les Pays-Bas) dans le camp très minoritaire de ceux qui ne voulaient pas de l’URSS dans le forum des Etats reconnus -mais qui ne voyaient aucune objection à ce que l’Italie fasciste y siégeât.
Comme on s’en doute, la prise de position du Conseil de fédéral (Motta ne parlait pas en son nom personnel, mais en celui de la Suisse), et le discours lui-même, provoquèrent en Suisse une formidable polémique. La presse, les partis politiques, les grands groupes de pression prirent part à un débat de politique internationale tel qu’on n’en avait guère vu depuis la Grande Guerre. D’un côté, la droite isolationniste et l’extrême-droite, dénonçant avec virulence la " dérive " de l’institution genevoise vers la " complaisance " à l’égard de Moscou, applaudirent Motta et exigèrent que la Suisse se tînt désormais soigneusement à l’écart de tout engagement international excédant ceux auxquels les impératifs de sa propre sécurité la contraignaient. D’autre part, la gauche et l’extrême-gauche se félicitèrent de la décision de la SdN pour mieux condamner la position de la Suisse, et s’affirmèrent comme les forces les plus acquises à l’ " Esprit de Genève " (au moment toutefois où il ne s’agissait déjà plus d’un " esprit " qu’au sens d’un fantôme). De la part du PSS, il ne s’agissait guère que de confirmer des positions déjà anciennes. De la part de son aile gauche et du PC, en revanche, il s’agissait d’un véritable revirement : de la dénonciation de la SdN en tant qu’instrument de l’ " impérialisme " et de la " contre-révolution ", le PC passage à sa louange en tant qu’ " instrument de la paix ".
La droite " éclairée ", elle, tenta de déborder sur le terrain des relations économiques un gouvernement fédéral dont la prise de position politique était gênante ; jouant les relations commerciales contre les relations diplomatiques, Genève contre Berne, la Société des Nations contre le Conseil fédéral, voire un Conseiller fédéral (Schulthess, puis Obrecht) contre un autre (Motta) et le ministère de l’Economie contre celui des Affaires étrangères, cette droite " éclairée " (éclairée par les séductions du marché soviétique) rendit possible l’arrivée en Suisse, fin 1935-début 1936, d’une délégation industrielle soviétique formée surtout d’ingénieurs industriels, mais dirigée par un haut fonctionnaire du ministère de l’Industrie lourde. A l’issue de cette visite, le Conseiller fédéral Hermann Obrecht chargea le Directeur de l’Office suisse d’expansion commerciale, Albert Masnata, de le renseigner régulièrement sur l’économie soviétique et ses relations extérieures. Simple souci d’information économique ? La démarche n’est pas si innocente qu’il n’y paraît : Obrecht et le grand patronat " progressiste " de l’industrie préparent l’avenir : le " service de renseignement " demandé à Masnata ne porte pas sur un ennemi potentiel ou une menace, mais sur un marché et un client possibles.
Le débat politique " international " va se dérouler sur le mode de la polémique, quel qu’en soit l’objet. Les " retombées " de l’admission de l’URSS à la SdN à peine dissipées, c’est à propos de l’Italie que l’on s’affrontera. Deux points sensibles : la propagande antifasciste menée par la presse socialiste, en particulier par le quotidien tessinois La Libera Stampa, et l’activité des organisations fascistes italiennes (ou contrôlées, ou soutenues, par le fascisme italien) en Suisse. La Suisse officielle, si complaisante qu’elle fut tentée d’être à l’égard de la Rome fasciste, ne pouvait sans se déconsidérer (et déconsidérer son propre discours sur la souveraineté nationale et la neutralité) tolérer l’implantation, le développement et les activités d’organisations fascistes italiennes sur son sol. Ces activités étaient d’autant moins tolérables que l’irrédentisme italien au Tessin s’en trouvait revigoré. L’Italie faisait quand à elle discrètement savoir que les 18'000 Suisses résidant sur son sol pourraient avoir à craindre les conséquences (c’est-à-dire les mesures de rétorsion) d’éventuelles dispositions répressives de la Suisse à l’égard des fascistes italiens actifs en Suisse.
Cet aimable chantage allait rencontrer en Suisse des oreilles plutôt complaisantes, par anticommunisme. La révolution soviétique avait rendu de larges secteurs de la droite favorable à une alliance avec tous les antibolchévismes possibles et imaginables. Pendant vingt ans, l’antisoviétisme fut d’ailleurs la dominante de la politique étrangère de la Confédération -une politique étrangère menée par un homme, Giuseppe Motta, dont l’ " italophilie " culturelle était constamment aux limites du " philofascisme " politique. Il fallut rien moins que la chute du fascisme d’abord, du nazisme ensuite, pour que la Suisse officielle admette que le pouvoir né de la Révolution de février et du putsch d’octobre ne pourra pas être renversé de l’extérieur, qu’il était douteux qu’il le fût de l’intérieur, et qu’il fallait donc en admettre désormais la pérennité (nul ne s’attendait sérieusement à ce qu’il implosât), et donc la légalité au sens du droit international, sinon la légitimité politique. Mais de 1918 à 1943, face au bolchevisme, la Suisse officielle sembla prête à toutes les alliances contre l’URSS, y compris à une alliance de fait avec Rome (voire avec Berlin), pour peu que Rome fût " antisoviétique ".
Le 28 septembre 1934, à la tribune de la SdN, Motta dira du pouvoir soviétique qu’il est " la négation la plus radicale de toutes les idées qui sont notre substance et dont nous vivons " (Claude Cantini, Le fascisme italien à Lausanne, op.cit.biblio p. 7). Il s’en faudra de beaucoup pour qu’un tel discours dût tenu à l’égard du fascisme. Dès son apparition, celui-ci rencontrera en Suisse un terrain favorable : l’antibolchévisme forcené de larges secteurs de la classe (politique et sociale) dominante rendit la Suisse officielle d’autant plus indulgente à l’égard des partisans (suisses ou italiens) de Mussolini -lors même que l’Italie fasciste entretint, jusqu’à la guerre d’Espagne, des relations avec l’Union Soviétique bien plus " correctes " que la Suisse).
Le 10 mai 1923, un Suisse, Conradi, assassine le délégué soviétique, Vorovski, à la conférence de Lausanne. Le 13 novembre, après le procès (et l’acquittement) de l’assassin, la Gazette de Lausanne, extraordinairement convertie aux vertus du tyrannicide, rend le régime soviétique lui-même responsable de la mort de son représentant :
Gazette de Lausanne du 13 novembre 1923
Et le même journal (libéral) de se féliciter de l’acquittement de Conradi. Treize ans plus tard, un autre meurtre politique, parfaitement symétrique, sera commenté pour le moins différemment par le même quotidien ; il est vrai qu’il ne s’agissait plus du meurtre d’un diplomate soviétique par un Suisse, mais de celui d’un responsable nazi allemand par un juif balkanique… Le commentaire de la droite helvétique sur la violence politique sera pour le moins contradictoire, selon que cette violence s’abat sur un communiste (ce qui la rend miraculeusement légitime) ou sur un nazi (ce qui la rend plus logiquement -pour la droite- condamnable). A treize ans de distance, le ton change du tout au tout. Le 5 février 1936, l’étudiant yougoslave (et juif) David Frankfurter abat le Gauleiter nazi de Suisse, Wilhelm Gustloff. Sous la même initiale (GR) et dans le même journal (la Gazette de Lausanne) qui avaient justifié l’attentat de Conradi, on lira la condamnation de celui de Frankfurter :
Cité par Claude Cantini, Le fascisme italien à Lausanne, op.cit. p. 8
" Pour tout être civilisé ", en somme, tuer un nazi est un crime, mais tuer un communiste n’est qu’une " vengeance " d’ " innocent ". Il y a évidemment, spectaculairement, " deux poids, deux mesures " dans cette " économie du crime politique " -mais il y a aussi treize ans d’intervalle, et le fait que Gustloff représente un régime voisin, et menaçant (et accessoirement un régime avec qui l’on commerce), quand Vorovski ne représentait qu’un Etat lointain, encore fragile, face auquel ont peut sans audace faire preuve d’intransigeance politique en prenant d’autant moins de risque que cet Etat n’est pas un marché important pour l’économie suisse.
Si la droite la plus à droite ne tient pas la balance égale entre les deux " totalitarismes " lénino-stalinien et nazi, le socialisme démocratique, lui, s’y essaie -sans y arriver tout à fait. Les socialistes " modérés " n’eurent certes, et assez tôt, guère d’illusions sur le caractère " socialiste " du pouvoir " soviétique ", et moins encore de sympathie pour ses chefs (du moins pour Staline) et leurs méthodes, mais ils n’en considéraient pas moins le nazisme et le fascisme comme des ennemis face auxquels toute alliance pouvait se justifier, y compris (avec prudence, réticence, et tardivement) une alliance de fait avec les communistes. Nous disons bien " alliance de fait ", ou " alliance objective ", puisque toute alliance explicite et officielle fut récusée (cas locaux mis à part). Il n’empêche que l’attitude du mouvement ouvrier démocratique suisse est à l’inverse de celle de la Suisse officielle : quand pour le premier l’ennemi principal est fasciste et nazi, il est communiste pour la seconde. Les heurts entre ces deux conceptions de l’urgence politique seront dès lors constants dès 1922, et se multiplieront à partir de 1933.
L’antifascisme de la gauche va, logiquement, la pousser à défendre les droits nationaux de peuples dont elle s’était jusqu’alors fort peu souciée. Lors de l’invasion de l’Abyssinie par l’Italie mussolinienne, les socialistes demandent l’application par la Suisse des sanctions votées par la SdN : il s’agit d’abord d’antifascisme, mais " objectivement " aussi d’anticolonialisme (ou d’anti-impérialisme). Par ailleurs, le fascisme n’est pas seulement un ennemi extérieur, mais aussi un ennemi intérieur, présent en Suisse même par ses organisations spécifiques (qu’elles fussent indigènes ou émanant directement du fascisme italien). En protestant et en mobilisant sa base contre les entreprises de Mussolini, de Hitler ou de Franco, le mouvement ouvrier suisse a parfaitement conscience de se battre non seulement, ni même surtout, pour les droits des " Abyssins ", des Tchèques ou des Basques à l’autodétermination, mais aussi -et surtout- pour sa propre survie (par celle de la " démocratie bourgeoise " suisse elle-même. Ce sont en quelque sorte les droits démocratiques des Suisses qui sont menacés par les nationalismes réactionnaires dont les victoires se succèdent en Europe. Et le fascisme italien va, très tôt, personnifier cette menace. En 1923, pour la seule ville de Lausanne, quinze sociétés italiennes sont actives, qui toute sont déjà ou vont être contrôlées directement par le fascisme italien, depuis l’Italie : sociétés de secours mutuel, associations d’anciens combattants, organismes culturels deviendront ainsi dans toute la Suisse des instruments et des porte-voix du fascisme romain, de gré (comme la société culturelle Dante Alighieri) ou de force (comme l’association des anciens combattants). Ceux qui résisteront seront infiltrés, majorisés, voire dissous, lorsqu’ils ne pourront être contrôlés : Le comité de la société de secours mutuel Mutuo Soccorso sera ainsi en totalité, et autoritairement, " démissionné ".
Cette progression du fascisme dans les organisations de l’immigration italienne en Suisse est certes le fruit d’une stratégie des autorités italiennes, mais elle correspond peut-être aussi à un réflexe de défense identitaire face à la xénophobie de la " communauté d’accueil " :
Andrea Lorenti, Come sono sorti e come sono morti i fasci italiani in Svizzera, in Emigrazione Italiana, Zurich, 26 avril 1973
La " fusion " de l’ " italianisme " militant du fascisme et de l’irrédentisme au Tessin procède peut-être également du même réflexe, celui de la défense du minoritaire " culturel " placé devant l’inacceptable alternative de l’assimilation et de la marginalisation.
L’Alliance Antifasciste Suisse, à laquelle participent des militant de toutes les organisations de la gauche politique et syndicale, protestera contre l’inégalité du traitement policier et judiciaire appliqué aux militants politiques italiens immigrés en Suisse, selon qu’ils sont fascistes ou antifascistes, et contre les expulsions vers l’Italie d’antifascistes italiens réfugiés en Suisse. Aux portes de l’Italie, l’Alliance organise au Tessin des manifestations antifascistes qui suscitent l’ire des autorités romaines, lesquelles, le 12 janvier 1929, lancent à la Suisse officielle un véritable ultimatum dans l’organe officiel du parti, Il Popolo d’Italia : toute manifestation contre le fascisme est une manifestation contre l’Italie, et sera traitée comme telle. Message bien reçu par le Conseil fédéral (prédisposé, il est vrai, à le bien comprendre), qui 14 jours plus tard interdit par décret les manifestations antifascistes. Pour le reste, les conférences de Gaetano Salvemini, invité par les libéraux luganais de la société culturelle Manzoni, et les quelques manifestations antifascistes qui " passent entre les gouttes " seront systématiquement perturbées par des contre-manifestations fascistes (tel sera le sort, par exemple, des conférences de Luigi Bertoni au Tessin).
Proximité géographique et familiarité culturelle faisant sensibilité, par la frontière et par la langue le Tessin sera le lieu exemplaire de la lutte antifasciste en Suisse. Cette lutte fut rendue à la fois plus urgente et plus compliquée par ses implications régionales et nationales : les menées fascistes en Suisse se conjuguent, au Tessin, à celles de l’irrédentisme " italianiste ". La gauche tessinoise se trouve en première ligne, et donc contrainte plus tôt que le reste de la gauche suisse à envisager la " fusion " du socialisme et du patriotisme, face à l’ " ennemi principal " : la gauche tessinoise sera antifasciste à la fois parce qu’elle est la gauche et parce qu’elle est tessinoise, rétive à ce double titre aux gesticulations chauvines d’une italianità défigurée par le fascisme. Qu’il y eut convergence, pour le moins, entre l’irrédentisme " italianiste " et le fascisme, jusque dans les expressions extrêmes, et racistes, du second, on en trouvera illustration dans un tract irrédentiste de 1925, où le plaidoyer pour la défense de la " race " italienne en Suisse se conclut par le refrain antisémite le plus trivial :
Cité dans Politica Nuova du 17 octobre 1986
Au moment où paraît ce tract paranoïaque, le mouvement " irrédentiste " a déjà, en tant que mouvement organisé, treize ans d’âge. Mouvement d’intellectuels, il émane de l’hebdomadaire Adula, créé à Bellinzone en 1912 avec un demi-millier d’abonnés. L’Adula n’est de toute évidence pas un mouvement de masse, mais plutôt un groupe d’intellectuels activistes, d’entre lesquels on peut noter la forte personnalité du professeur Salvioni, Tessinois naturalisé italien, philologue, académicien milanais, ancien socialiste converti au monarchisme, irrédentiste persuadé que le Tessin n’attend (historiquement) qu’une chose : le retour à la mère patrie italienne. Dirigé pendant plus de vingt ans par deux enseignantes, Teresa Bontempi et Rosa Colombi, L’Adula, " organe tessinois de culture italienne ", se fera le porte-drapeau de l’offensive politico-culturelle de l’Italie en direction du Tessin. Offensive entamée en 1883 lorsque paraît à Milan le livre Svizzeri o Italiani ?, et à laquelle la victoire du fascisme en Italie va donner une forme plus agressive et un fond idéologique plus solide, par la fusion de l’ " italianité " et de l’adhésion au fascisme.
Entre 1921 et 1925, les fasci italiens s’implantent au Tessin (à Bellinzone, Lugano, Chiasso, Locarno) et dans les Grisons (à Pontresina). Dès lors, L’Adula ne cessera d’évoluer vers une adhésion de plus en plus explicite au fascisme. En 1922 se crée à Lugano le mouvement de jeunesse de l’Adula, l’Associazione Giovani Ticinesi, ouvertement fasciste, parrainée par Gabriele d’Annunzio. L’AGT publiera en 1924, à Fiume (symboliquement) un ouvrage (La Questione Ticinese) qui sera saisi à la frontière : les autorités helvétiques, quelque tolérance qu’elles eussent à l’égard des menées fascistes italiennes, ne poussent pas l’abnégation (ou l’aveuglement) jusqu’à accepter de voir remises en cause les frontières de la Confédération. Enfin, un " Comité d’action irrédentiste pour les Grisons, le Tessin et le Valais), plus ou moins lié à l’Adula mais clandestin, se manifestera de manière sporadique en 1923.
C’est dans ce contexte que vont se développer des organisations fascistes spécifiquement suisses, empruntant certes au modèle italien sa symbolique et l’essentiel de son projet politique, mais en les adaptant à ce qu’elles étaient capables de percevoir de la réalité helvétique. Il ne s’agit plus alors de faire glisser la Suisse " italienne " dans l’orbe romaine, mais de " fasciser " la Suisse entière. Là encore, le Tessin se trouvera privilégié par le voisinage : " Un mélange d’idées maurrassiennes et mussoliniennes pénétrèrent, vers les milieu des années vingt, les cercles des jeunes conservateurs tessinois ", note Claude Cantini (La Libera Stampa du 22 juillet 1985), avec comme premier résultat le lancement d’un journal, La Voce, et la constitution en 1923 d’un mouvement, la Guardia Luigi Rossi (ou " Chemises Bleues ", organisation " paramilicienne " faute de pouvoir être paramilitaire, dans le grand style de l’époque (style prégnant à gauche comme à droite, d’ailleurs…). Ces " chemises bleues ", qui publient Il Guardista, sont dirigées par Alfonso Riva et Nino Rezzonico, futur responsable tessinois de la Fédération Fasciste Suisse.
Ces fascistes tessinois vont se retrouver rapidement en concurrence avec des mouvements d’inspiration nazie " germanique ") créés au nord du Gothard et " exportés " au sud. Tel est le cas du Front National, fondé en 1930 et implanté dès 1934 au Tessin. Il devra renoncer à cette implantation trois mois plus tard, la concurrence fasciste lui étant fatale, et invitera ses membres (une centaine au Tessin en 1935, pour environ 9000 dans toute la Suisse) à adhérer à la Ligue Nationale. Le Front sera finalement dissout en 1940, malgré l’opposition de son dirigeant local au Tessin, Hans Oehler, qui pouvait encore compter sur quelques dizaines de membres. Ce petit catalogue des organisations fascistes (et nazies) tessinoises pourra être considéré comme à peu près exhaustif lorsqu’on y aura ajouté le WinkelriedsFront, créé à Locarno en 1933 par des Alémaniques installés au Tessin, et le groupe local du Nationale Bewegung der Schweiz, qui comptait au moment de sa dissolution par le Conseil fédéral au printemps 1940 environ 2200 membres en Suisse. Le NBS préconisait l’annexion pure et simple de la Suisse alémanique à l’Allemagne (nazie), de la Suisse italienne et romanche à l’Italie (fasciste) -bref, la dissolution de la Suisse, la Romandie revenant logiquement, mais faute de pouvoir en faire autre chose, à la France (à une France cependant " régénérée " et " dérépublicanisée ").
Il faut enfin faire ici un sort à deux organisations présentes au Tessin, mais dont l’une (la Lega Nazionale Ticinese) n’est pas à proprement parler fasciste -si elle tissa de nombreux liens avec les mouvements fascistes et leur emprunta quelques unes de leurs références symboliques, l’autre (la Fédération Fasciste Suisse) échouant à s’implanter durablement au sud des Alpes.
La Lega Nazionale Ticinese fut constituée en mai 1933 à Lugano. Elle était le résultat d’une scission de droite du parti catholique conservateur ; une scission corporatiste, mais que ses racines catholiques auraient pu tenir à distance d’un fascisme dont l’alliance avec l’Autel (comme d’ailleurs avec le Trône) relevait du plus pur opportunisme. Pourtant, la LNT s’érigera en décembre 1933 en section cantonale du mouvement " frontiste " alémanique Bund für Volk und Heimat. La Lega resta toutefois moins fasciste que réactionnaire, attirant à elle des " dissidents de droite " de partis bourgeois (catholiques conservateurs et radicaux). Publiant l’hebdomadaire L’Idea Nazionale jusqu’en 1938, participant aux élections cantonales de 1935 (elle n’obtint que 2,5 % des suffrages et deux sièges), la Lega ne tint pas la distance. Lorsqu’en janvier 1939, le ministère italien de la Culture demanda à l’Ambassadeur Tamaro, représentant italien à Berne, s’il était opportun de la subventionner, l’Ambassadeur répondit que, quoique la Ligue pût être considérée comme un mouvement " sincèrement respectueux de l’Italie et de son régime, et donc disposé à défendre l’italianité du Tessin " (cité par Claude Cantini, La Libera Stampa du 22 juillet 1985). elle n’était plus qu’un parti moribond dont le soutien serait pur gaspillage.
Quant à la Fédération Fasciste Suisse, elle avait été fondée directement à Rome, le 17 octobre 1933, par le colonel vaudois Arthur Fonjallaz. Cinq semaines plus tard, une section tessinoise, la Federazione Fascista del Ticino était fondée à Lugano par Nino Rezzonico, lequel sera reçu à Rome par Mussolini le 26 novembre en compagnie de Fonjallaz et sera nommé en décembre 1933 adjoint de ce dernier à la direction nationale du mouvement, lors de son congrès suisse. A l’été 1934, la FFT avait reçu entre 500 et 800 adhésions, certains de ses membres l’étant également d’autres organisations fascistes. En 1934, la FFS se dota d’un embryon de structure syndicale (les Syndicats Fascistes Nationaux) et d’une Agence Fasciste de Presse. Une crise interne survint cette même année au Tessin, à la suite de l’échec pitoyable d’une " marche sur Bellinzone " dont il sera plus loin question ; Nino Rezzonico claque la porte et adhère à la vieille Adula. Alberto Rossi lui succède à la tête de la FFT, mais sera arrêté avec les autres membres de la direction cantonale du mouvement, pour atteinte à la sûreté de l’Etat. En mai 1935, les Fasci tessinois se reconstituent ; en juin, Fonjallaz limoge Rossi et le remplace par Piero Scanzani, directeur de l’hebdomadaire Il Fascista Svizzero, paraissant désormais sous le titre A Noi !. Rossi créera un éphémère Partito Fascista Ticinese doté d’un journal non moins éphémère, Azione Fascista. En décembre 1935, A Noi ! cesse à son tour de paraître en en 1936, la majorité des membres tessinois restants de la Fédération Fasciste Suisse adhéreront au Circolo Italo-svizzero de Lugano, qui va " prolonger de quelques années -grâce à l’aide financière italienne, le rêve obscur d’un Tessin fasciste " (Claude Cantini).
Foisonnement d’organisations, de mouvements, de groupes, de groupuscules : le Tessin fasciste des années vingt et trente nous rappelle, tous contextes et contenus politiques par ailleurs fort différents, la Genève gauchiste des années septante, ses métastases idéologiques, sa scissiparité compulsive… Ce foisonnement, cette agitation fascistes au Tessin vont susciter une ferme riposte de la gauche tessinoise, dominée par le Parti socialiste de Guglielmo Canevascini, qui fera flèche de tous bois pour combattre cet adversaire dangereux. La Libera Stampa, ultime quotidien socialiste de langue italienne paraissant en " terre italophone ", deviendra une tribune antifasciste permanente, passée et diffusés clandestinement en Italie à la fureur des autorités fascistes -lesquelles interviendront constamment auprès de Motta pour qu’il muselât les socialistes tessinois, leur journal et leur chef (les rapports personnels et politiques de Motta et de Canevascini seront d’ailleurs pendant toutes ces années parfaitement désastreux, le second s’offrant même le luxe d’être candidat au Conseil fédéral contre le premier, bien avant qu’un socialiste ait la moindre chance d’être élu au gouvernement, mais pour contester la prétention de Motta à être le représentant du Tessin au gouvernement fédéral).
Il faut ici, avec Domenico Visani, insister sur le rôle central joué par La Libera Stampa dans le combat antifasciste des socialistes tessinois -un combat culturel autant, sinon plus, que restrictivement politique :
Domenico Visani, L’azione dei socialisti del Ticino a favore dei socialisti italiani durante il fascismo, Libera Stampa, 25 avril 1986
Le même Domenico Visani rappelle ensuite le rôle central joué par les socialiste en général, et Canevascini en particulier, dans la lutte contre l’irrédentisme italien, " pendant les années les plus obscures de la domination fasciste ", quand l’Italie mussolinienne considérait le Tessin (à l’instar de Nice ou de la Savoie) comme terre italienne et que les Italiens se préparaient, " sinon avec le consentement, du moins avec la résignation des fascistes tessinois ", à occuper les postes et les lieux de pouvoir au Tessin… Canevascini sera ainsi l’un des fondateurs et des dirigeants du mouvement " secret " (à tout le moins " discret ") Liberi e Svizzeri, mouvement voué à combattre en même temps le fascisme (Liberi…) et l’irrédentisme (… Svizzeri), et qui s’illustrera notamment lors de la tragi-comique " marche sur Bellinzone " organisée par l’extrême-droite locale.
La lutte antifasciste, la gauche tessinoise va la mener en usant " de tous les moyens, même légaux ". prenant place au gouvernement cantonal, le PS et son Conseiller d’Etat, Canevascini, se situent, à l’instar du PSS des années trente, à la charnière de l’opposition et de l’exercice du pouvoir exécutif. Partie prenante d’un " arc constitutionnel " qui rassemble les partis démocratiques, mais en même temps porteur d’un projet de changement, le PST va jouer de cette double qualité dans le combat antifasciste, en assumant parfaitement la part de contradictions et de conflits qu’une telle stratégie implique. De ce point de vue, le socialisme tessinois est à l’image du socialisme helvétique, mais avec une " longueur " (historique) d’avance. L’usage politique, contre le fascisme, de la concordance et des instruments d’action dont elle rend possible le maniement, est sans doute la spécificité des conduites d’un Canevascini. Ce choix, insistons-y, correspond à celui du PSS : parti d’opposition aspirant à être parti de gouvernement, force antifasciste prêts à s’allier avec ses adversaires (la droite démocratique) pour mieux combattre son ennemi (le fascisme), organisation d’un légalisme apparemment sourcilleux mais capable de faire usage de méthodes s’apparentant à celles de la lutte clandestine, pourvu que ces méthodes fussent efficaces et compatibles avec les principes supposés guider l’action politique.
C’est ainsi que depuis 1929, le PSS soutient financièrement et politiquement une petite agence de presse, l’INSA, fondée par le socialiste Otto Pünter, aux fins de fournir à la presse socialiste des informations que les agences traditionnelles ne pouvaient ou ne voulaient fournir, notamment sur le fascisme. Rien là que de très légal… sauf que l’INSA, agence de presse, était aussi l’un des maillions de la chaîne européenne de solidarité avec les antifascistes italiens réfugiés à l’étranger ou tentant encore d’agir en Italie même. On se retrouve ici à cette frontière de la légalité et de la " subversion ", sur laquelle le mouvement socialiste démocratique va camper jusqu’aux derniers jours de la Guerre Mondiale. De cette situation, le PS Tessinois est exemplaire, maintenant constamment des contacts périlleux avec les antifascistes italiens tout en étant, par Canevascini, présent au gouvernement cantonal -en charge à la fois, donc, de la raison solidaire et de la raison d’Etat.
En août et septembre 1926, Canevascini organisme au Monte Generoso une rencontre à laquelle participe le secrétaire de l’Internationale socialiste, Fritz Adler, et les Italiens Carlo Rosselli et Pietro Nenni.. en avertit deux Conseillers fédéraux (mais pas Motta…) : Scheurer, en charge du département Militaire, et Häberlin, en charge du département de Justice et police, dont le moins que l’on sache est qu’ils ne sympathisaient pas particulièrement avec les socialistes. Il est vrai que, pour Canevascini, " Conseiller d’Etat, il était difficile au Tessin de passer inaperçu " lors d’une telle rencontre (Claude Cantini, Fra Roma e Berna, Libera Stampa du 30 avril 1986) et qu’il valait donc mieux prendre les devants. Häberlin s’empressa d’avertir le Conseiller d’Etat tessinois Raimundo Rossi, lequel " n’avait guère de sympathie ni pour le PST ni pour son chef " (Cantini), mais était un adversaire affirmé de l’irrédentisme fascisant. Rossi, chef du département cantonal de Justice et police, n’en surveilla pas moins attentivement son collègue socialiste, avertissant Häberlin (lettre confidentielle du 29 septembre 1926) qu’à la frontière méridionale du Tessin, de fréquentes rencontres se tenaient entre socialistes tessinois et antifascistes italiens entrés frauduleusement en Suisse. Canevascini et le PST jouent ici encore sur deux tableaux : celui de l’engagement militant de socialistes solidaires de leurs camarades italiens, et celui d’un parti dont le chef est l’un des représentants de la puissance publique, usant des moyens qu’elle lui donne pour favoriser cet engagement militant.
D’entre ces moyens, les media comptent évidemment pour beaucoup. Nous avons déjà relevé le rôle joué par le quotidien socialiste Libera Stampa ; il faut aussi faire référence au rôle joué par la radio (la radio d’Etat, puisqu’alors il n’en était pas d’autre) : le 29 octobre 1933 est officiellement inauguré l’émetteur de la radio suisse de langue italienne sur le Monte Ceneri. La station radio tessinoise, arrosant non seulement toute la Suisse italienne, mais aussi l’Italie du nord (et pouvant au surplus être captée, plus ou moins bien, dans une bonne partie de l’Europe occidentale) va elle aussi acquérir, par le seul fait qu’elle est de langue italienne sans être italienne, une audience et une importance en totale disproportion de ce qui eût été le cas… si l’Italie n’avait pas été fasciste (les autres émetteurs de la radio suisse, Beromünster pour la langue allemande dès 1933, Sottens pour la langue française de 1940 à 1944, joueront d’ailleurs le même rôle, pour les mêmes raisons). L’inauguration du Monte Ceneri fait elle-même événement politique, notamment par le discours officiel qu’il prononça Canevascini. Le 28 octobre, la Gazzeta Ticinese et le Corriere del Ticino (deux quotidiens " bourgeois ") annoncent brièvement l’événement à venir pour le lendemain ; la Libera Stampa, elle, publie un long article, présumant à juste titre l’importance de l’enjeu, et le lundi 30 octobre, sous le titre évocateur : " La Radio Svizzera Italiana sarà libera espressione del pensiero dei cittadini ", le quotidien socialiste situait explicitement le rôle de l’émetteur tessinois dans le contexte politique et culturel du moment : une radio " objectivement " antifasciste, parce que la radio d’un Etat démocratique.
Les Italiens comprendront rapidement l’importance de cet événement, et le 2 novembre 1933 l’Ambassadeur Marchi enverra un long rapport au ministère italien des Affaires étrangères, en se référant explicitement aux articles parus les jours précédents dans La Libera Stampa. Pour le diplomate italien, la radio tessinoise est " matériellement dans les mains (…) de Monsieur Canevascini et du Directeur qu’il a nommé, par conséquent un socialiste, Monsieur Vitali " (cité par Pierre Codiroli, Sulla nostra radio l’ombra del Duce, in Quotidiano du 26 octobre 1988). Canevascini posait le problème en termes de liberté de pensée (et de débat) : c’est bien ainsi que l’entend l’ambassadeur italien -et c’est bien ce qu’il craint. Parlant de " governi dittatoriali ", Canevascini et les socialistes tessinois font évidemment référence au fascisme, et celui-ci en est parfaitement conscient. En même temps, Canevascini pose ouvertement la question du contenu et des limites de la " neutralité ", en une situation où celle-ci confine à la connivence. Sa définition de la neutralité, impliquant le pluralisme (la libre expression des pensées) n’est, on s’en doute, pas celle que défendent les autorités fédérales, et surtout pas celle à laquelle se tient Motta (l’expression contenue de la pensée du gouvernement…). Berne aurait d’ailleurs bien voulu imposer à la radio suisse de langue italienne la conception la plus restrictive possible de cette " neutralité ", de manière à s’éviter tout problème avec le voisin fasciste. Pour Canevascini, à l’inverse, une radio " suisse ", c’est-à-dire respectueuse des valeurs proclamées par la Suisse, ne peut que défendre ces mêmes valeurs : la liberté et la démocratie, " racines de la nation et raison d’être de la Suisse " ; et de préciser, s’il en était besoin, qu’il serait " ridicule et vil " de renoncer à sa propre liberté par une " peur exagérée " des réactions d’autrui : " Sarrette ridicolo et vile il rinunciare a una libertà di casa nostra, per l’esagerato timore del risentimento altrui " (cité par Pierre Codiroli).
Cette conception de son rôle, la radio tessinoise pourra l’illustrer et la pratiquer grâce à l’autonomie obtenue du pouvoir fédéral par les autorités cantonales, en ce qui concerne la forme et le contenu des émissions du Monte Ceneri. L’ambassadeur italien s’en inquiète et voit une manœuvre anti-italienne et antifasciste de Canevascini et de ses camarades dans le fait que la radio suisse de langue italienne se soit vue accorder le droit d’organiser des débats sur " des questions à caractère économique et de politique internationale " avec la participation de " personnalités compétentes ", à la seule condition que l’on y évitât toute propagande et que l’on se tienne au thème du débat. Et L’Ambassadeur Marchi de rapprocher cette autonomie de contenu de la radio tessinoise des déclarations de Canevascini, exprimant les principes qui lui paraissent devoir fonder le message diffusé du Monte Ceneri :
Guglielmo Canevascini, cité par Pierre Codiroli, Sulla nostra radio l’ombra del Duce, in Quotidiano du 26 octobre 1988
Réformiste et humaniste, le credo de Canevascini n’en est pas moins subversif pour les autorités italiennes -et sans doute l’est-il d’autant plus qu’il est, précisément, réformiste et humaniste, éloigné en cela de tel ou tel discours " bolchévisant " d’autant plus facilement caricaturable qu’il est déjà caricatural -et que le fascisme est lui-même, déjà, une caricature de bolchevisme. En fait, le diplomate italien comprend la déclaration de principe du magistrat socialiste tessinois comme une " déclaration d’hostilité et d’ingérence propagandistique à l’encontre de l’Italie fasciste " (cité par Codiroli), et invite les autorités de son pays à prendre toute mesure utile pour parer à la menace, notamment dans les provinces du nord où la radio tessinoise trouvera rapidement un auditoire important. L’ambassadeur italien propose donc à Rome de prendre des " contre-mesures " pour empêcher les " Signori Ticinesi " de se " servir de la radio pour tourmenter les oreilles italiennes " avec des discours antifascistes, qu’ils soient tenus par des antifascistes réfugiés à l’étranger où soient les " élucubrations des Tessinois " eux-mêmes -" élucubrations " que l’ambassadeur propose d’étouffer par les moyens techniques adéquats, y compris le brouillage des émissions. Par ailleurs, s’engouffrant dans une brèche ouverte par Canevascini lui-même lorsqu’il avait reconnu dans son discours inaugural la nécessité pour la nouvelle radio tessinoise de conclure un accord de collaboration avec la radio italienne, notamment dans les domaines artistiques et culturels, afin de surmonter la pauvreté et le rareté du " matériel local ", Marchi suggère que l’on utilise l’arme du boycott et du refus de collaboration afin de contraindre les Tessinois à la prudence exigée par l’Italie (et par le gouvernement suisse…) dans les programmes d’information et de commentaire potentiellement subversifs. Et de souhaiter une vigilance accrue des autorités italiennes à l’égard du contenu des émissions du Monte Ceneri, voire leur brouillage, " au cas où elles revêtiraient un caractère subversif anti-italien ", cas dont Marchi convient qu’il ne s’est pas encore produit, mais dont il est à peu près certain qu’il se produira, tant le champ de la " subversion anti-italienne " est vaste puisque la défense des " valeurs démocratiques " et de l’ " humanisme ", proclamée par Canevascini, y trouve place de choix.
Les inquiétudes de l’ambassadeur italien, les déclarations de Canevascini, la possibilité même que la radio suisse de langue italienne pût être une arme dans la lutte contre le fascisme italien, illustre ici une autre donnée des faits tessinois dans les années vingt et trente (de 1922 à 1944, pour être précis…) : une profonde et réciproque méfiance, toute italianità estompée, marque les rapports " culturels " de l’Italie et du Tessin, et définit l’image que le second se fait de la première. Cette méfiance put (et peut encore) aller au Tessin jusqu’à la xénophobie anti-italienne :
Laurent Duvanel, René Lévy, Politique en rase-mottes, op.cit.blbio pp 51, 52
Cette " rancœur " mâtinée d’une xénophobie qui survivra à la guerre -et dont il reste encore quelque chose de nos jours, s’exprimant notamment dans les votes systématiquement " anti-européens " des Tessinois, et dans l’apparition de la Lega populiste et xénophobe, explosera en de véritables émeutes anti-italiennes autant, sinon plus, qu’antifascistes à la fin de la Guerre Mondiale. Mais avant cet ultime défoulement, elle se nourrira de l’opposition aux tentatives tessinoises d’imitation du fascisme (de caricature d’une caricature, donc). D’une certaine manière, l’antifascisme pourra alors se confondre avec l’ " helvéticité ", comme en Alémanie l’antinazisme (identification qui cependant se fera plus mal en Romandie, le rapport à la France -celle de Maurras ou celle de Blum- se posant en d’autres termes, empreints peut-être de moins de méfiance, ou de plus d’attachement culturel, quoi qu’il en soit des oppositions politiques : Gonzague de Reynold n’est pas moins francophile que les intellectuels socialistes, si " sa France " n’est pas le même que la leur). Il y a bien des parallèles à tracer entre l’attitude des Tessinois à l’égard de l’Italie (fasciste, en l’occurrence) et celle des Alémaniques à l’égard de l’Allemagne (nazie, en l’occurrence), attitudes qui au moment où nous écrivons ne sont pas sans héritages politiques -notamment lorsque la participation de la Suisse à la construction européenne est mise en question. Les Romands n’eurent pas le même réflexe à l’égard de la France, malgré l’Etat vichyste ; pourtant, la France ne fut-elle pas le dernier " ennemi " de la Suisse, le dernier Etat à l’avoir envahie militairement ?
Canevascini comprit parfaitement ce qu’il pouvait y avoir d’exploitable dans cette " fusion " tessinoise de l’ " helvétisme " et de l’antifascisme : Liberi e Svizzeri ou Liberi perciò Svizzeri, ou encore Svizzeri perciò Liberi ? Ce qui importe est que le combat contre la fascisme indigène pourra être assimilé à une résistance au fascisme étranger, ce qui rendra plus aisée la riposte à telle ou telle tentative de l’extrême-droite de forcer le cours des choses. Ainsi de la bouffonne " marche sur Bellinzone " de janvier 1934.
Cette " marche sur Bellinzone " du 25 janvier 1934 est, écrit Claude Cantini, " le typique exemple du grotesque qui dominait le fascisme tessinois ". Cette " ridicule imitation " de la marche mussolinienne sur Rome n’en fut pas moins, pour la gauche et les forces démocratiques tessinoises, sinon une sérieuse alarme, du moins l’occasion de " donner une leçon " à l’extrême-droite locale. Les socialistes s’y étaient d’ailleurs si bien préparés qu’ils avaient réussi à infiltrer trois de leurs militants dans le fascio de Lugano. Canevascini fut donc parfaitement informé du " coup " qui se préparait et put en informer ses collègues du Conseil d’Etat. Otto Pünter raconte que le gouvernement tessinois, craignant que les forces de police disponibles ne fussent en nombre insuffisant à Bellinzone au cas où les fascistes arriveraient en masse et en armes, prit la précaution de demander au Conseil fédéral l’autorisation de faire assurer, en cas de nécessité, le service d’ordre par l’école de sous-officiers encasernée à Bellinzone. Un " 9 novembre à l’envers " était-il possible ? un " 9 novembre " où l’armée eût tiré non sur une manifestation antifasciste, mais sur une sédition fasciste ? Le Conseil d’Etat tessinois, contrairement à celui de Genève, ne se laissa pas gagner par la panique, aidé en cela par Canevascini et les socialistes (le cas tessinois, là aussi, est à l’inverse du cas genevois : le PS est parti de gouvernement à Bellinzone et d’opposition à Genève ; son chef joue parfaitement sur le double tableau de la responsabilité gouvernementale et de l’encadrement de la rue, contrairement à un Léon Nicole qui, en 1932, ne disposait que de la seconde -et ne la maîtrisait pas). Canevascini mobilise ses troupes et les jeunes de Biasca, et prépare l’accueil des fascistes, à l’arrivée desquels à Bellinzone la place du gouvernement est noire d’une foule d’antifascistes. Alberto Rossi, chef de la sédition, appelle sa centaine de partisans à serrer les rangs, ponctuant son ordre de coups de pistolets tirés en l’air. La police (et les pompiers, appelés en renfort) doit intervenir… pour protéger les fascistes de la fureur des antifascistes. La " marche sur Bellinzone " s’achève lamentablement dans la fuite de ses figurants et l’arrestation de ses responsables (Alberto Rossi, Remo Cavalli, Aldo Bassetti, Luigi Fanciola, Carlo Guidi et Fernandino Bernasconi).
De quoi témoigne, au-delà de l’épisode burlesque du 25 janvier 1934, le " cas tessinois " ? De la position de combat prise par le mouvement socialiste face à le menace fasciste -une position partagée par l’ensemble des courants et des sensibilités du mouvement socialiste, des " modérés " aux " extrémistes ", le " modéré " Canevascini hésitant d’ailleurs moins que le supposé " extrémiste " Nicole, par exemple, à user de méthodes à la légalité discutable : en réponse à la formation du premier fascio luganais, le 24 avril 1921, c’est Canevascini, pas encore Conseiller d’Etat (et le fascisme pas encore au pouvoir en Italie) qui propose la création d’une " Garde rouge " capable de " répondre par la violence à la violence provocatrice " (Danilo Baratti et alt., Le Parti socialiste tessinois et l’antifascisme italien, in Solidarités, Débats, Mouvements, op.cit.blbio). Dix ans plus tard, le 24 mai 1932, le même Canevascini propose (et met en œuvre) la création de " groupes spéciaux ", armés et clandestins, indépendants du parti, pour " contrer par tous les moyens l’avance fasciste " (ibid.). Et pour ces groupes spéciaux, Canevascini s’en ira à Genève demander des armes à Nicole, lorsque celui-ci, dès 1933, se trouvera en charge du Département de Justice et Police, et donc en mesure de répondre, si peu que ce soit, aux besoins de son camarade tessinois ; l’on verra alors le " révolutionnaire " Nicole refuser ces armes au " modéré " Canevascini, et les lui refuser… au nom de la légalité !
Position de combat, donc, et dans tous les sens du terme, que celle d’un Canevascini, confronté au fascisme et acceptant toutes les conséquences de cette confrontation. La proximité culturelle de l’Italie ne fait ici que préciser, renforcer ses convictions socialistes, et l’attitude du Tessinois est exemplaire de ce que put être l’antifascisme social-démocrate, cette intransigeance d’un réformisme qui n’avait (encore) rien renié de ses choix, de ses racines et de ses principes, et envisageait assez sereinement de devoir les défendre par d’autres moyens que ceux de la légalité " bourgeoise ". L’antifascisme apparaît d’ailleurs, dans les années trente, comme le seul véritable ciment de l’unité socialiste -une unité fragile, instable, constamment menée, et qui sera rompue en 1939, mais une unité tout de même face à l’ " ennemi principal ". La menace fasciste, en fait, rapproche les courants adversaires et les mêle dans une lutte commune, où les plus réformistes ne sont pas forcément les moins décidés, et les rhétoriques révolutionnaristes pas forcément suivies d’effet.
Dans la pratique, toutefois, l’unité fait le plus souvent défaut entre socialistes, communistes et anarchistes, et a bien de la peine à être traduite en actes aussi combatifs que les discours. Le congrès de la FOBB a beau désigner clairement, en 1926, le fascisme comme " l’ennemi du mouvement ouvrier ", un ennemi que ce mouvement doit combattre de toutes ses forces, l’Union Syndicale Suisse n’entend pas pour autant mener la lutte antifasciste, quoi qu’elle y fût rejointe par certains éléments et certains cercles de la droite démocratique (présente, par exemple, cette droite démocratique, dans les Liberi et Svizzeri aux côtés de Canevascini), non seulement contre le fascisme italien et ses prosélytes suisses mais aussi contre les " sympathisants " et les " complices " qui, en Suisse même, expriment leur " compréhension " ou pratiquent la collusion avec l’ " ennemi ". Au nombre de ceux qui " comprennent " le fascisme, Motta, bien sûr, mais aussi l’aile droite du syndicalisme catholique et les " corporations ". Il y a comme une " ligne de partage " entre adversaires et partisans du fascisme, une ligne qui passe " au centre de la droite " et qui parfois sépare même partisans respectifs du fascisme et du nazisme. Cette ligne restera tracée jusqu’à la fin de la guerre, après que le déclenchement de celle-ci en Europe l’eût transformée en mur. La droite est ainsi traversée de courants contradictoires : en 1939, l’Union nationale éclate, les partisans du nazisme se groupant au sein du Mouvement national suisse de Walter Michel. Les libéraux, en principe opposés (par anti-étatisme) au corporatisme et au socialisme, et qui devraient l’être au fascisme et au nazisme pour cette même raison " théorique " , sont parfois tentée de faire alliance avec la droite la plus extrême contre le communisme et la gauche " nicoliste ". Les catholiques sont encore plus divisés : quand l’évêque de Genève, Lausanne et Fribourg, Marius Besson, s’avère francophile, patriote, antinazi et antifasciste, le quotidien catholique genevois Le Courrier est plus qu’à son tour tenté par l’ " ordre nouveau " (celui de Mussolini, pas celui de Gramsci…), ce qui suscite en 1941 la création des " Lettres sociales " dans lesquelles René Leyvraz (futur rédacteur en chef du Courrier après la guerre) et Edmond Ganter fondent leur dénonciation du fascisme sur les valeurs du christianisme. A Genève toujours, les " Jeunes Travailleurs " du syndicaliste Henri Berra, issus des Syndicats Chrétiens, prônent le corporatisme, quand la Jeunesse Ouvrière Chrétienne défend les thèses progressistes du catholicisme social…
Il pourra y avoir d’ailleurs rapprochements, difficiles et éphémères, conflictuels et menacés, entre ce catholicisme social et le socialisme (même le plus " à gauche "). C’est en l’ultime période (celle de son agonie) du gouvernement socialiste de Léon Nicole que se tint à Genève le premier congrès national de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, le 6 novembre 1936. Les dirigeants de la JOC exposèrent à Nicole les objectifs de cette manifestation, et reçurent du leader socialiste l’assurance qu’elle se déroulera dans le calme, contrairement aux craintes parfois exprimées. Une messe solennelle fut célébrée en présence d’une quinzaine de milliers de personnes par l’évêque Marius Besson, un cortège parcourut la ville, puis se tint le congrès, avec de remarquées interventions du Président national de la JOC, August Haab, du " père fondateur " Joseph Cardijn (futur cardinal) et du " propagandiste " français Ferdinand Bouxom. Le mouvement catholique qui se manifeste ainsi est " objectivement " un mouvement antifasciste, même s’il ne l’est pas toujours subjectivement. En France, d’ailleurs, les " jocistes " choisiront massivement la résistance, armée ou non, contre le régime de Vichy. L’antifascisme n’est donc pas l’affaire de la seule gauche, même si la gauche en fut, politiquement, la " citadelle " (toute " citadelle " ayant ses points faibles et ses angles morts).

Les victimes du fascisme, celles ensuite du nazisme et du franquisme, vont devenir des martyrs et des symboles de la gauche. Des milliers d’ouvriers suisses découvrent ainsi les peuples d’Afrique au moment où les massacrent les armées italiennes, et le peuple basque lorsque les avions allemands écrasent Guernica pour le compte de Franco. Par le détour de l’antifascisme, c’est bien la solidarité internationale qui s’affirme -une solidarité internationale renouvelée, élargie à de nouveaux acteurs collectifs, à de nouveaux peuples, à de nouvelles forces politiques.
Cela étant, la lutte contre le fascisme est aussi, et sans doute surtout, une lutte " nationale ", à l’intérieur du pays, contre ceux qui tentent d’y importer le modèle italien -dès lors combattu parce qu’il est fasciste, et parce qu’il est étranger. Dès 1922, des fasci rassemblent les immigrés italiens en Suisse, directement ou par l’intermédiaire des institutions qu’ils vont progressivement contrôler. On compte treize fasci en 1923, coordonnée depuis Lugano. Le 29 janvier 1928, Mussolini les rattache par décret au système consulaire et leur octroie des moyens d’action supplémentaires leur permettant de parfaire leur contrôle des organisations sociales (de jeunes, de femmes, de secours mutuels etc.) qui ne sont pas explicitement engagées dans la lutte antifasciste. La gauche dénonce là un danger pour la Suisse et la souveraineté -mais le danger est aussi patent pour la gauche elle-même, de voir les services officiels d’un Etat étranger, politiquement ennemi et géographiquement voisin, comptant sur une très forte colonie d’immigrés en Suisse, développer une politique dynamique, " à la base ", sur un terrain ouvrier et dans tous les domaines, de la culture (par la Dante Alighieri) à la solidarité. sociale (par le Mutuo Soccorso) en passant évidemment par l’action politique au sens strict, dont les fasci sont l’instrument privilégié. C’est en quelque à une concurrence sur son propre terrain que la gauche doit s’affronter. Les autorités helvétiques faisant pendant les années d’avant-guerre preuve d’une passivité à toute épreuve face aux actions fascistes italiennes, la gauche politique et syndicale va tenter d’y suppléer, aidée en cela par l’immigration antifasciste puis antinazie et, dès 1936, antifranquiste.
Le gouvernement fédéral avait, prudemment, réagi aux manifestations symboliquement gênantes des fascistes, mais ce qui est symboliquement gênant n’est pas forcément ce qui est politiquement le plus dangereux ; les autorités helvétiques s’en prirent surtout à ce que le fascisme italien pouvant, sans déchoir, modérer, sinon abandonner. Le port de la chemise noire fut prohibé dès 1923 -les fascistes suisses se contentèrent de changer de couleurs de chemises et les Italiens d’arborer des signes distinctifs autres, mais aussi démonstratifs que possible. Aux antifascistes, par contre, les autorités fédérales vont prodiguer moult avertissements et mises en demeure, alors même que les incidents frontaliers se multipliaient au Tessin et que les activités des fasci se tournaient de plus en plus fréquemment vers l’espionnage pur et simple. Les expulsions devinrent plu fréquentes, mais avec le constant souci de ne pas " froisser " le voisin du sud, et l’on n’y avait recours que lorsqu’on ne pouvait plus faire autrement. Des membres d’organes policiers et para-policiers italiens chargés de " la chasse aux antifascistes " réfugiés à l’étranger furent ainsi obligés de quitter le territoire suisse, mais cela ne suffisait pas à convaincre la gauche de l’absence de connivence, ou de favoritisme, de la Suisse officielle à l’égard du régime romain. Les adversaires suisses du fascisme usèrent de plus en plus de l’argument " patriotique ". si paradoxal qu’il pût être pour des hommes (et quelques femmes) qui, en des temps pas si lointains, avaient publiquement manifesté leur volonté de dépasser le patriotisme par l’universalime wilsonien ou l’internationalisme révolutionnaire. La patrie devient en ces années sombres l’un des refuges de la lutte contre " la Bête ", l’argument patriotique étant fourni par les agissements et les prétentions du fascisme lui-même. Les Comités pour l’Universalité de Rome, liés à la fois au fascisme suisse et au fascisme italien (donné comme modèle d’une renaissance de l’Europe), les sociétés Dante Alighieri, les organisations Dopolavoro et les Case d’Italia, à des titres divers, participent d’une volonté d’ingérence et de développement en Suisse du mouvement italien -le Tessin étant naturellement le premier terrain d’exercice de cette volonté, qui trouve dans l’irrédentisme de l’Adula un allié privilégié. La presse officielle italienne donne écho à la fois au fascisme suisse et à l’irrédentisme italien au Tessin, et la diplomatie italienne elle-même met parfois la main à la pâte (tout en multipliant les déclarations d’amitié et de respect de la souveraineté nationale helvétique), encourageant et finançant des opérations " subversives " par l’intermédiaire de l’appareil fasciste présent au sein même de la diplomatique (les Ambassades et les consulats étant doublés d’une hiérarchie parallèle, celle du parti, conformément à un " modèle léniniste " dont il se confirme, là encore, que la fascisme n’est qu’une caricature.
De ces opérations fascistes en Suisse, on peut donner ici comme exemple la tentative de prise de contrôle du quotidien libéral genevois Le Journal de Genève ; la cible était intéressante du double point de vue local (genevois), suisse et international, le quotidien étant très lu dans le " milieu internationale " de la ville siège de la SdN, et y ayant quelque influence sur les milieux conservateurs. L’épisode est instructif : on y voit intervenir non seulement les autorités fascistes italiennes, mais aussi, agissant en quelque sorte comme leur mandant, le leader fasciste genevois Georges Oltramare, chef de l’Union Nationale. Oltramare avait à plusieurs reprises fait le pèlerinage de Rome et y avait rencontré Mussolini ; son parti recevait une aide financière importante du pouvoir italien. Parmi les opérations financées par le fascisme italien, et mises en œuvre par le fascisme suisse, il y eut donc en 1935 cette tentative d’achat d’un paquet d’actions de la société éditrice du Journal de Genève. But de l’opération : faire entrer au Conseil d’administration un homme-lige du fascisme (Oltramare lui-même, ou l’écrivain local René Piachaud, fasciste lui aussi) et faire adopter par le quotidien genevois une ligne plus favorable au fascisme. Oltramare se rendra ainsi acquéreur de 250 actions et les fera enregistrer au nom de l’une de ses cousines et de Piachaud. Dans un télégramme envoyé au ministère italien de la Presse, le 23 novembre 1935, Boca Scoppa, délégué italien à la SdN, précise :
Cité dans Le Courrier (Genève) du 28 avril 1988
Les actions ainsi achetées furent remises au gouvernement italien, en échange d’une distinction honorifique (l’Ordres des Saints Maurice et Lazare). Ces 250 actions furent d’ailleurs insuffisantes pour assurer aux fascistes le contrôle du quotidien libéral, dont ils ne purent infléchir la ligne éditoriale. L’épisode ne dissuada pas les autorités italiennes de poursuivre leur soutien financier à Oltramare : Mauro Cerutti évalue à une centaine de milliers de francs au moins (et sans doute plus) le volume du soutien reçu d’Italie par Oltramare entre 1935 et 1938 et estime que " ce soutien au mouvement d’extrême-droite a certainement pesé dans la chute du gouvernement socialiste de Léon Nicole et l’éloignement progressif de la Suisse par rapport à la SdN " (Le Courrier du 29 avril 1988). Quelques mois après la chute du gouvernement socialiste, fin 1936, les Genevois acceptaient au surplus la proposition d’interdiction des mouvements communistes -proposition que soutenait ardemment Oltramare.
En fait, Mussolini avait commencé par soutenir le colonel Arthur Fonjallaz et sa Fédération fasciste suisse, mais l’échec de l’initiative " antimaçonnique " et l’importance internationale de Genève, où la FFS de Fonjallaz était sans influence réelle, firent se tourner le fascisme italien vers Oltramare. La SdN s’était prononcée en faveur des sanctions contre l’Italie à la suite de l’expédition éthiopienne, et il importait de s’assurer à Genève même d’une tribune politique et médiatique. Oltramare en tint lieu jusqu’en 1938, tant que la SdN eut encore quelque capacité de décision et d’influence. Après le refus italien de lui assurer le financement, à raison de 420'000 francs, d’un journal, Oltramare quittera Genève et la Suisse pour Paris (où il s’illustrera quelques années plus tard dans la collaboration avec le nazisme.
A l’instar de son modèle léniniste (il en est la caricature, avec un contenu politique contradictoire), le " mussolinisme " sait user en même temps, ou alternativement, de la diplomatie " classique " et de la diplomatie " révolutionnaire " : d’une main, il subventionne et soutient les mouvements fascistes ou irrédentistes, et de l’autre il signe des accords d’Etat à Etat. La Suisse se retrouve à plusieurs reprises piégée par cette dualité des politiques extérieures italiennes. En 1934, Motta se rend à Rome, incognito, à l’occasion de l’Année Sainte ; il utilisera ce voyage privé pour rencontrer le Roi, le Pape et le Duce. Le traité italo-suisse de conciliation et d’arbitrage de 1934 sera ainsi prorogé pour dix ans ; mais quelques semaines plus tôt, le Popolo d’Italia avait embouché les trompettes de l’irrédentisme et dénoncé la " germanisation " du Tessin. Le 6 octobre, c’est Mussolini lui-même qui, dans un discours milanais, avertis la Suisse que son avenir dépend du respect de l’ " italianité du Tessin ". A chaque occasion du même genre, et le fascisme italien en offrira de multiples, les antifascistes protestent contre les " complaisances " et les " faiblesses " de Motta à l’égard de Rome. Complaisances et faiblesses, sans doute, mais aussi incapacité de sortir du piège de la " double diplomatie " fasciste. A quoi s’ajoute, comme le relève Paul Golay (en 1944), le cousinage de la droite traditionnelle helvétique (en particulier romande) avec le fascisme transalpin (puis le pétainisme français) :
Paul Golay, L’heure du jugement, in Terre de Justice op.cit. biblio pp 161-162
S’il s’exprime ainsi en 1944, Golay n’avait cessé depuis 1922 de dénoncer les complaisances de la droite romande à l’égard du régime fasciste. Une année auparavant, en 1943, au moment de la chute de ce régime, il rappelait sur le même ton ces mêmes complaisances, ne se privant pas de comparer les attitudes des autorités suisses à l’égard de Mussolini, selon qu’il n’était encore qu’un agitateur socialiste ou qu’il était devenu le Duce :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 221-223
N.B. On nous pardonnera sans doute ici, petite notation personnelle, de dire notre plaisir (et notre nostalgie) de lire les imprécations ironiques d’un Golay -plaisir de lecteur et nostalgie de citoyen ou de militant, plaisir " esthétique " plus que politique, qui fait bon marché du contenu du discours pour en savourer la forme et les cadences vétérotestamentaires, et nostalgie du temps passé des polémistes de cette race.
Golay y revient à plusieurs reprises : l’Université de Lausanne décerna à Mussolini en 1937 un doctorat Honoris Causa à l’occasion du 400ème anniversaire de l’Université, et quelques mois après l’annexion de l’Abyssinie par l’Italie. Cet épisode, Golay le considère comme le symbole même de l’ " aplaventrissement " de la droite vaudoise (et romande, et suisse) devant le dictateur italien ; c’est aussi la mise à jour des étranges activités de quelques intellectuels locaux, dont l’Italien Pasquale Boninsegni et le Vaudois Arnold Reymond.
Pasquale Boninsegni est arrivé à Lausanne en 1901. Elève, discipline et collaborateur de Vilfredo Pareto (dont Mussolini dira qu’il fut l’un de ses inspirateurs), il est nommé professeur en 1907. Socialiste, nationaliste pendant la guerre et fasciste ensuite (un parcours tout mussolinien…), il est en 1927 membre du Directoire des Fasci de Lausanne, et semble jouer les intermédiaires entre les autorités vaudoises et les autorités fascistes italiennes, rendant quelques services aux premières et informant les secondes de la situation du mouvement fasciste en pays de Vaud et en Romandie. Boninsegni a sans doute été l’un des artisans de la mise à l’honneur universitaire de Mussolini à Lausanne : " on peut notamment supposer que c’est lui qui avertit Mussolini en 1935 que l’on a songé à lui demander, en tant qu’ancien élève, une contribution pour les fêtes du 400ème anniversaire " de l’Université (Daniel-S. Miéville, Le Journal de Genève, 8 juillet 1987). Mussolini avait en effet suivi pendant quelques mois (de mai à octobre 1904) les cours de Pareto et de Boninsegni à l’Université de Lausanne, après avoir obtenu grâce à l’intervention de députés de gauche genevois et tessinois -il était encore socialiste révolutionnaire, à l’époque- un permis de séjour de six mois.
Le 21 novembre 1936, le Professeur Arnold Reymond défend devant le Conseil de l’Ecole (faculté) des Sciences sociales et politiques la proposition de décerner au Duce au Doctorat Honoris Causa. proposition acceptée, quant à son principe, à l’unanimité moins une voix. Le 30 novembre, Boninsegni avertir Mussolini des intentions de l’Université de Lausanne ; le 2 décembre, la proposition est débattue par la Commission universitaire (décanat), où elle ne suscite guère l’enthousiasme : François Guisan, Doyen de la Faculté de Droit, trouve le moment mal choisi ; Georges Bonnard, Doyen de la Faculté des Lettres, est franchement opposé à la proposition. La décision est finalement ajournée. Boninsegni en avertit Mussolini le 4 décembre. Le 13 janvier, la Commission universitaire, après avoir reçu du Conseil d’Etat l’assurance que celui-ci ne verra aucun inconvénient à ce que l’Université vaudoise fasse à Mussolini l’honneur d’un Doctorat Honoris Causa pour saluer son " œuvre de rénovation sociale ", décide finalement de le lui décerner. Le Doyen Bonnard persiste dans sa dénonciation d’une " très lourde erreur " et, prudente, la Commission ne rend pas sa décision publique (Boninsegni, fidèle épistolier, la communique tout de même à Mussolini) ; cette étrange confidentialité imposée à une décision qui n’a de sens que dans la mesure où elle est rendue publique, puisqu’il s’agit d’un hommage académique à l’œuvre du bénéficiaire et qu’un tel hommage ne saurait être clandestin, ne résista pas longtemps. Le 2 mars, Le Droit du Peuple fit éclater le scandale, après avoir bénéficié d’une " fuite " en provenance de l’imprimerie à laquelle avait été confié le tirage du diplôme et de l’adresse académique du " Docteur " Mussolini. On est alors en pleine campagne électorale pour le renouvellement du Grand Conseil, et les socialistes vont exploiter au maximum ce qu’ils dénoncent comme une nouvelle, et particulièrement insupportable, compromission de la droite " libérale " avec l’extrême-droite fasciste. Mussolini recevra son doctorat à Rome, des mains d’une délégation formée du Recteur Emile Golay, du Chancelier Franck Olivier et de l’inévitable professeur Boninsegni. L’ " affaire " suscitera une grande émotion au sein des milieux universitaires, et dans une moindre mesure dans l’opinion publique ; il est vrai que la synchronie de l’honneur fait au Duce et de l’écrasement de l’Abyssinie sous les bombes et les gaz était de nature à susciter quelque interrogation, à tout le moins sur l’opportunité de la décision universitaire. Et le contenu politique de cette décision, tel qu’il s’exprimait dans l’adresse à son bénéficiaire, le laissa pas d’intriguer les uns, et de scandaliser les autres :
Cité dans Le Journal de Genève du 8 juillet 1987
Etrange discours, qui débute par une protestation de bons sentiments démocratiques et républicains et se conclut par un hommage au fascisme ; discours qui rappelle l’attachement de l’Université lausannoise à des principes tout en faisant l’éloge d’une " œuvre " de négation concrète de ces mêmes principes, et d’étranglement du pluralisme politique en Italie ; discours, enfin, tenu au moment où l’Italie fasciste fête le succès de son expédition " impériale " en Ethiopie… La coïncidence est, pour les auteurs du discours, malencontreuse : l’éloge du fascisme par les autorités académiques vaudoises " sonne " comme l’éloge du stalinisme par Léon Nicole. Les apologies se répondent, mais l’histoire officielle a deux poids, deux mesures : le monde politique suisse jugera différemment ses anciens acteurs selon qu’ils faillirent " à gauche " ou " à droite ", qu’ils se compromirent avec le stalinisme ou avec le fascisme. En 1988 encore, le Grand Conseil genevois refusait de donner à une rue le nom de Léon Nicole au motif de son stalinisme (le Conseil municipal de la Ville de Genève le fera pourtant, quelques années plus tard) : s’était-on souvenu de semblable manière des sympathies de Giuseppe Motta ou des engagements de René-Louis Piachaud, lorsque l’on donna le nom du premier à une avenue, et celui du second à une rue ?
Le 2 octobre 1935, donc, l’Italie avait envahi l’Abyssinie. Cette expédition allait faire découvrir à des milliers de militants socialistes et syndicalistes l’utilité de la solidarité " anticoloniale " dans la lutte antifasciste -des militants qui, en d’autres circonstances, eussent sans doute applaudi à la chute, quelle qu’en soit la cause, du régime féodal du Négus (n’applaudîmes pas nous-mêmes à cette chute lorsqu’elle fut le fait d’un putsch militaire, et n’applaudîmes pas nous-mêmes à la chute des Khmers Rouges, alors qu’elle fut le fait d’une intervention militaire vietnamienne, condamnable en son principe mais fort heureuse en cet effet ?).
Entre la gauche et la droite helvétiques, la polémique va porter essentiellement sur les " sanctions " à imposer à l’Italie en punition d’une violation flagrante des principes de la SdN. L’article 16 du Pacte de la Société des Nations (article sur lequel la Suisse avait d’ailleurs, au moment d’adhérer à l’institution genevoise, fait d’importantes réserves au nom de sa " neutralité "), imposait aux membre de la Société la participation aux sanctions votées contre un membre coupable de rupture du pacte. L’Italie, en envahissant l’Abyssinie, membre de la SdN, se trouvait précisément et cette situation de " culpabilité ", d’autant plus indiscutable qu’elle avait clairement manifesté son mépris des initiatives de conciliation internationale entreprises, et parfaitement ignoré une démonstration de force de la flotte britannique en Méditerranée (non exempte de pusillanimité, cependant, puisque les Britanniques en étaient restés à la démonstration, présage de la volontaire impotence franco-britannique pendant la Guerre d’Espagne). L’Assemblée de la SdN avait logiquement désigné l’Italie comme "fautrice de guerre et avait constaté qu’elle violait le pacte auquel elle avait adhéré ; c’est tout aussi logiquement qu’elle décida de lui appliquer les sanctions prévues par l’article 16 de ce pacte. Sous peine de devoir quitter la SdN, ce à quoi ils ne se résignaient pas, Motta et le Conseil fédéral durent suivre le mouvement. C’est peu dire qu’ils le firent de mauvaise grâce, et cette absence de bonne volonté fut précisément au centre des condamnations portées par la gauche et quelques bourgeois progressistes contre la politique du Conseil fédéral.
Le 10 octobre 1935, Motta déclarait à l’Assemblée de la SdN que la Suisse n’était (de son point de vue à lui, et de celui du Conseil fédéral) pas tenue " à des sanctions qui, par leur nature et leurs effets, exposeraient (sa) neutralité à un danger réel ", et qu’elle entendait apprécier ce danger " dans la plénitude de (sa) souveraineté " (cité par Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit.biblio p. 266). Motta ajoute, à l’intention de l’opinion publique suisse, que la Confédération ne peut sans risques graves mécontenter deux puissants voisins (l’Italie et l’Allemagne), que les décisions genevoises n’impressionnent nullement. C’en était trop pour la gauche, qui condamna (une fois de plus) l’ " alignement " de la Suisse sur les régimes fasciste et nazi.
Finalement, ne pouvant refuser explicitement d’appliquer les sanctions sans se déconsidérer auprès d’une SdN à laquelle il avait cru, et sans voulait encore croire (à condition qu’elle soit incapable de rien imposer à personne, sauf peut-être à l’Union Soviétique), le Conseil fédéral décida de " marquer le coup " en adoptant quelques mesures, plus symboliques qu’efficaces : interdiction du transit et de l’exportation de tout matériel militaire à destination de l’un ou l’autre des belligérants (ce qui revenait à traiter de la même manière l’agresseur italien, bien armé et qui n’avait pas besoin de livraisons suisses, et l’agressé éthiopien, démuni et à qui de telles livraisons eussent pu être fort utiles), limitation des échanges avec l’Italie… les partisans de la politique des sanctions se contentèrent d’autant moins de telles mesures que la première était douteuse en son principe, et que la seconde était fort aisément contournable; des Etats comme la Hollande ou les pays scandinaves avaient, eux, répondu efficacement à le demande d’une " sanction universelle de l’agression ", et leur exemple fut largement opposé à la pratique de la Suisse. Quant à la droite conservatrice, elle défendait les intérêts de l’industrie d’exportation et en appelait, elle, à l’exemple de l’Autriche et de la Hongrie, toutes deux gouvernées par la droite de la droite, toutes deux membres de la SdN, toutes deux refusant d’appliquer la moindre sanction. Enfin, la droite fasciste, applaudissant à l’expédition italienne, clamait sa volonté de voir resserrer les liens entre la Suisse et l’Italie.
Le débat politique fut sans doute à cette occasion d’autant plus polémique que l’opinion publique n’y fut guère sensible, hors le cercle relativement restreint des responsables, cadres et militants des organisations politiques. La Guerre d’Abyssinie n’est pas la Guerre d’Espagne : pour l’essentiel, ce furent les appareils de partis et quelques groupes de pression qui s’échauffèrent, pas les citoyens. Toutefois, il apparaît que pour quelques uns, le conflit éthiopien fut le révélateur des risques de guerre et des logiques bellicistes et expansionnistes du fascisme. Parmi les " cadres militants " où se recrutent les élus cantonaux et municipaux du parti socialiste, et à partir de qui se forme ce " tissu " politique par lequel, de la commune à la Confédération, se manifeste la force et la présence du parti, on constate quelque sensibilité à cette guerre lointaine, menée en Afrique par un régime honni (le fascisme) contre un régime qui, en d’autres circonstances, l’eût été tout autant (l’empire du Négus), à supposer que l’on s’en préoccupât.
Le pacifisme, une fois encore, va " fusionner " avec le socialisme dans la dénonciation de la guerre (de cette guerre, du moins) pour la même raison que le mouvement ouvrier avait en quelque sorte " récupéré " le patriotisme face au fascisme. Puisque " le fascisme c’est la guerre ", la lutte pour la paix est une lutte antifasciste, et la lutte antifasciste est une lutte pour la paix. Le même syllogisme exprime le choix de l’unité nationale et celui de l’antifascisme :
1.
La fascisme et le nazisme sont intrinsèquement expansionnistes
2.
Le fascisme et le nazisme, expansionnistes, sont installés aux frontières de la Suisse, et menacent donc sa souveraineté et son indépendance
3.a
Défendre la souveraineté de la Suisse est donc une position antifasciste
3b
L’antifascisme conséquent implique la défense de l’indépendance nationale, et donc l’acceptation des moyens de la défense nationale, y compris de ses moyens militaires.
Par le même type de raisonnement, l’adversaire de Mussolini, le Négus, devient pour les socialistes une sorte d’ " allié objectif ", lors même que ni lui, ni son régime n’ont rien de commun avec ce qu’ils défendent. Assemblées, pétitions, manifestations vont se succéder, jusqu’en 1936, la Guerre d’Espagne prenant la suite (avec un impact d’une toute autre ampleur dans l’opinion publique) de la Guerre d’Ethiopie. Pour les uns, c’est la paix qu’il s’agit de défendre, à presque n’importe quel prix (ce " presque " fera la différence entre " munichois " et " antimunichois " en 1938) ; pour les autres, le bien le plus précieux est l’indépendance nationale en tant qu’elle est la condition (l’instrument) de la démocratie, et une arme contre le fascisme : ceux-là seront les piliers de la stratégie de " front patriotique " conçue dès 1939. Pour certains, enfin, la paix et la démocratie sont avant des moyens, des terrains et des arguments de la lutte pour le socialisme et contre le fascisme : telle sera la position de la gauche socialiste et des communistes, du moins jusqu’en 1941. Il y a donc plus que des nuances entre les différentes composantes du mouvement qui naît -mais il y a surtout accord, au moins tacite, sur l’urgence de l’action et la définition de l’ennemi : le fascisme menace la paix ? Les pacifistes seront donc antifascistes. Le fascisme menace l’indépendance nationale ? les socialistes deviendront donc patriotes, lors même que les fascistes exaltent la patrie. Il faudra attendre 1939 pour que se défasse ce " front commun " des pacifistes, des antifascistes, des " patriotes progressistes " et des démocrates : les " pacifistes ", alors, devront choisir entre la paix munichoise et l’antifascisme, et les communistes entre la fidélité à l’Union Soviétique (et donc le soutien au pacte germano-soviétique) et la fidélité à l’antifascisme (et donc la rupture avec le parti). Mais deux ans plus tard, ce front défait en 1939 se reconstituera.
A vrai dire, lors même que la condamnation de l’entreprise abyssinienne de Rome est unanime à gauche, la défense des droits de la victime l’est nettement moins. L’agression importe plus que l’agressé, et la distinction entre " le peuple d’Abyssinie " et le régime " féodal " et " esclavagiste " du Négus sera constamment faite -ce pouvoir ne méritant nulle compassion, et le Négus étant au faîte d’un système qui pressurait impitoyablement son propre peuple. Mais il se trouve que l’ennemi principal n’est pas le féodalisme : c’est le fascisme, et cette " nouvelle donne " du monde permet, ou plutôt impose, de se retrouver " objectivement " aux côtés d’un régime dont quelques années auparavant la chute eût fort réjoui les quelques militants de gauche qui se souciaient de son existence.
La Suisse officielle, dans tout cela, ne fait pas très bonne figure, accusée qu’elle est par la gauche de se compromettre avec le fascisme, et par la droite de soumettre aux injonctions du " cosmopolitisme " de la SdN. C’est tout le problème de la neutralité, et de sa définition, qui est posé. Le 20 mars 1815, les puissances européennes de la Sainte-Alliance contre-révolutionnaire (la France de la Restauration comprise) reconnaissaient, " dans les vrais intérêts de l’Europe entière ", la neutralité de la Suisse. Trois révolutions (1830, 1848, 1917), une guerre franco-allemande (1870) et une guerre européenne avec participation américaine (1914-1918) plus tard, qu’en était-il ? Les espoirs mondialistes placés en la SdN poussaient certains (et, d’entre eux, nombre de socialistes) à considérer que la neutralité était devenue " inutile, lâche, voire contraire à la morale " (Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit. p. 339). D’autres, plus à gauche, ou à tout le moins plus " motivés " par la solidarité internationaliste et antifasciste, ne tardèrent pas à considérer toute neutralité comme purement et simplement impossible, sauf à se rendre complices des agresseurs italiens, allemands et japonais d’Etats et de peuples victimes de l’inefficacité de l’institution genevoise et des faiblesses des démocraties (bourgeoises) : " L’Europe de Versailles s’en allait en morceaux " (Ruffieux, ibid.) sous les coups de l’ " ennemi principal ". Quelle neutralité, et a contrario quel engagement, pouvaient préserver la Suisse de ces coups ? Le Conseil fédéral s’en tint, officiellement, au premier terme de l’alternative, refusant l’engagement au nom de la neutralité. En n’appliquant pas réellement les sanctions décidées par la SdN dont elle était membre, et auxquelles elle ne s’était pas formellement opposée, la Suisse s’attacha à faire reconnaître cette même neutralité par les puissances qu’elle s’abstenait ainsi de sanctionner et par leurs alliés, pour ensuite la faire avaliser par les Etats ayant voté ces sanctions. Et en effet, l’Italie et l’Allemagne protestèrent hautement de leur respect de la neutralité helvétique -mais quel crédit accorder à ces déclarations lorsque leurs auteurs prouvaient par leurs actes en Ethiopie, en Espagne, en Albanie, en Autriche, en Tchécoslovaquie) ou leurs discours (tels ceux de l’Italie sur l’ " italianité " du Tessin) qu’ils ne se souciaient ni du respect des souverainetés d’Etat, ni de celui de la parole donnée, mais uniquement des rapports de force ? Le débat sur la politique internationale se joua dès lors en trop (dissonant), sur trois mélodies : partition antifasciste (il n’y a pas de neutralité possible, il faut choisir son camp) ; partition neutraliste, voire isolationniste (nous sommes notre propre camp, restons au-dehors de la mêlée, gardons-nous de tout ce qui pourrait nous y jeter) ; partition de l’ " ordre nouveau " (l’Europe change, prenons le bon chemin pendant qu’il est encore temps).
La politique du Conseil fédéral va évoluer au gré des rapports de force européens et non en fonction des principes généraux proclamés par la Suisse : de la neutralité " intégrale " (et du refus d’appliquer réellement les sanctions frappant l’Italie), on passera dès 1939 à une neutralité de plus en plus relative au fur et à mesure que les puissances de l’Ace engrangent les victoires, et à un antisoviétisme virulent (justifié notamment par l’agression soviétique de la Finlande). De 1940 à 1942, totalement encerclée par l’Allemagne et l’Italie (ou la France de Vichy, vassalisée par la première), la Suisse est pratiquement alignée sur l’Axe. Dès 1943, elle se prépare à changer de camp, la victoire ayant choisi le sien ; il faudra attendre 1944 pour l’entendre exprimer quelque antifascisme, hésitant, tardif et opportuniste, mais dès lors indispensable. L’épisode du conflit italo-éthiopien de 1935 a donc quelque chose de prémonitoire des oscillations politiques et stratégiques à venir : " Tour à tour, la politique de neutralité, la fidélité aux traités, les exigences d’ordre économique avaient été invoquées pour justifier la participation très incomplète de notre pays à la politique sanctionniste " de la SdN (Roland Ruffieux, op.cit. p. 340). La gauche était évidemment partisane des sanctions (lors même qu’elle doutait de leur efficacité), et s’opposait vigoureusement aux choix de Motta qu’elle accusait de trahir les idéaux de la SdN, en même temps que les principes proclamés par la Suisse elle-même. En face, la droite nationaliste et l’extrême-droite, tirant parti de l’impuissance de la SdN à faire respecter ses propres décisions, et reprenant les dénonciations italiennes de l’institution genevoise, appelaient soit à une " adaptation " de la Suisse au " nouvel ordre européen " proclamé par les fascismes, soit au retour à la neutralité intégrale et à l’isolationnisme. Lorsque le 27 février 1936 Mussolini déclara qu’un élargissement des sanctions jusqu’à l’embargo pétrolier conduirait à une crise grave, la Suisse se retrouva dans une situation particulièrement inconfortable et adopta une attitude contradictoire : elle refusa de lever les quelques mesures commerciales prises à l’encontre de l’Italie, mais témoigna publiquement de son opposition à la politique des sanctions. Le Conseil fédéral s’empressera d’abandonner, dès que faire se pourra, toute apparence d’adhésion au moindre " sanctionnisme ", la SdN elle-même reconnaissance finalement son impuissance et abandonnant, de facto, toute velléité de sanctionner l’agression italienne contre l’Abyssinie.
Cela étant, le contrôle personnel de Motta sur la politique étrangère de la Suisse faisait de plus en plus problème : la gauche combattait sa politique sur le fond, la droite parlementaire réclamait haut et fort la possibilité de la contrôler (sans rien avoir cependant à lui reprocher qui fût pour elle fondamental), les milieux d’affaires s’inquiétaient des difficultés que cette politique pourrait provoquer à l’égard de tel ou tel partenaire étranger, réel (la France) ou, pour le patronat le plus audacieux, potentiel (l’URSS). Les 21 et 23 avril 1936, le Parlement fédéral eut à débattre d’une proposition de Robert Grimm de créer une commission des Affaires étrangères au Conseil national ; vieille revendication de la gauche, déjà exprimée en 1920, repoussée en 1926 et que les socialistes réactualisaient à la lumière des derniers développements (et de leurs dangers) européens. Les partisans de Motta eurent beau reprocher aux socialistes de vouloir entraîner la Suisse dans une coalition antifasciste (ce qu’ils eussent été bien en peine de faire), la proposition de Grimm fut acceptée et Motta battu (puisque " mis sous contrôle parlementaire) par 91 voix contre 51, ce qui signifie évidemment le ralliement d’une partie de la droite à la gauche démocratique, non que cette droite fût mécontente des choix de Motta, parce par souci de défendre la possibilité pour le Parlement de contrôler le Gouvernement. En fait, la droite parlementaire " prenait une assurance " : elle ne désavouait pas le ministre en place (au moins quant au fond), mais s’assurait de la possibilité de désavouer ses successeurs, ou du moins de les contrôler. Motta réussit tout de même à " bloquer " la proposition votée par le Conseil national en la faisant repousser au Conseil des Etats. La " Chambre du Peuple " avait clairement manifesté son vœu d’une politique étrangère moins personnalisée, laissant la " Chambre des cantons " indifférente.
Le Conseil fédéral, c’est-à-dire Motta, eut l’occasion de prendre une revanche sur la méfiance parlementaire lorsque le moment vint de reconnaître ou de récuser l’autorité de l’Italie sur l’Ethiopie vaincue, autorité revendiquée par la proclamation de l’ " Empire " le 9 mai 1936. Mussolini posa ses conditions : il était d’accord de réintégrer la SdN (qui ne se départissait pas de la reconnaissance de la souveraineté de l’Ethiopie) si la SdN acceptait de légitimer le fait accompli de la conquête. Motta, qui avait déjà refusé au Négus le droit de s’établir en Suisse, décida d’accomplir au nom de la Suisse le geste exigé par le Duce : le 23 décembre 1936, la Suisse ferma le Consulat général d’Ethiopie à Zurich et étendit à toute l’Abyssinie la juridiction de l’Ambassade de Suisse à Rome. Ce Vae Victis ! clamé par la " patrie de Guillaume Tell " fut vivement dénoncé par la gauche, et par Haïlé Sélassié, qui considéra qu’ai la Suisse avait donné sa caution à " la violation la plus cynique et la plus horrible des traités ". Au sein de la classe politique " bourgeoise ", quelques voix s’élevèrent aussi pour critiquer la précipitation et l’opportunisme maladroit de la décision de Motta. Lorsque les 14 et 15 juin 1937 le Conseil National eut à débattre de ce problème, le ministre des Affaires étrangères vit sa majorité se réduire à 84 voix contre 56 ; commentaire de Roland Ruffieux :
Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit. p. 342
La Suisse officielle n’a pas résolu le problème de ses rapports avec l’Italie fasciste ; elle ne résoudra pas plus celui de ses rapports avec l’Allemagne nazie. Pendant les deux premières années du régime hitlérien, de 1933 à 1935, l’alliance germano-italienne est d’ailleurs loin d’être évidente, malgré les incontestables parentés idéologiques des deux régimes, leurs modes d’organisation comparables et leurs symboliques voisines. Il semblait qu’entre Rome et Berlin pût s’établir des rapports de concurrence, voire de conflit (à propos de l’Autriche), et les dénonciations répétées par les irrédentistes italophiles de la " germanisation du Tessin " pouvaient démentir le danger de " prise en tenaille " de la Suisse par le nazisme au nord et le fascisme au sud. Les " révolutions réactionnaires " de 1922 et de 1933, en Italie et en Allemagne, par leur nationalisme et, dans le cas du nazisme, leur contenu explicitement raciste (et " antilatin "), semblaient vouées à la méfiance réciproque, ainsi qu’il est historiquement de règle pour les nationalismes voisins (et donc concurrents, même lorsqu’ils sont alliés). La faiblesse de l’Italie aura, avec la guerre européenne, raison de cette méfiance et de cette concurrence. Mais ce sera pour y substituer l’alignement, puis la sujétion, pures et simples. Dans les années trente, toutefois, en Autriche, les deux totalitarismes de droite sont ouvertement rivaux ; or tout ce qui concerne l’Autriche concerne la Suisse qui, en 1922, avait participé à la " réfection " de l’Etat voisin. Les ambitions italiennes, puis allemandes, vont poser le problème de la survie de l’Autriche -avec on sait quelle conclusion : l’Anschluss. Dès 1928, par un projet d’union douanière austro-allemande (un projet que l’on croyait enterré après qu’il eût apparemment succombé quelques années auparavant à l’opposition de la Tchécoslovaquie et de la France) s’était profilé le désir allemand de faire main basse (avec leur accord) sur les restes " germaniques " de l’Empire des Habsbourg, et cela avant même que l’Allemagne fût nazie et l’Autriche " austro-fasciste ". Le 19 mars 1931, un accord préliminaire est signé à Vienne ; la France, la Tchécoslovaquie et leurs alliés le feront à nouveau échouer, en profitant de la crise financière dramatique traversée par l’Autriche. En sauvant Vienne de la banqueroute par un prêt internationale, la France sauvait (pour quelques années) l’indépendance de l’Autriche. La victoire nazie de 1933 remettra les compteurs à zéro. Auparavant, en mai 1932, le Chancelier autrichien Dolfuss était entré en fonction, appuyé par un bloc politique réactionnaire. Il se tournera vers l’Italie fasciste, dissoudra le parlement, imposera une constitution inspirée du modèle " corporatiste " proposé par la droite catholique (et l’Ambassade d’Italie) : ce sera l’éphémère " austro-fascisme ", prélude à la nazification. La résistance, parfois armée, du puissance mouvement syndical et socialiste est écrasée, en même temps que se développe un mouvement nazi militant pour le retour dans la " Grande Allemagne " (retour passablement mythique, puisque l’Empire austro-hongrois était plus ancien que l’Empire allemand). Le 25 juillet 1934, les nazis autrichiens fomentent un putsch qui échoue, mais lors duquel Dollfuss est tué. La voie est libre : elle mènera à l’Anschluss, à la disparition pure et simple de l’Autriche, " avalée " par le IIIème Reich.

Ce qui se passait en Autriche ne pouvait qu’avoir, en Suisse, de plus profonde répercussions que la crise abyssinienne : L’effondrement du pays voisin (de la " République-sœur des Alpes ", pour reprendre une expression usitée par le PSS) présageait-il d’un effondrement possible, comparable, de la Suisse sous les coups des mêmes acteurs (les nazis du cru et l’Allemagne), avec la même passivité des mêmes spectateurs (les " démocraties " occidentales) ? Les antifascistes mirent l’opinion publique en garde : Mussolini, Hitler, l’extrême-droite pouvaient tenter ici ce qu’ils avaient réussi là-bas. Les socialistes dénoncèrent le " clérical-fascisme " autrichien, en pensant à son équivalent suisse. Si les massacres commis contre la résistance socialiste, communiste et syndicale à l’ " austro-fascisme " de Dollfuss suscitèrent l’indignation de la gauche, le putsch nazi de 1934 inquiéta, lui, la droite démocratique et contribua à isoler à la fois les nazis suisses et les partisans d’un corporatisme " à la Suisse ", puisque le corporatisme " à l’autrichienne " s’était révélé incapable d’être un rempart contre le nazisme : le catholicisme réactionnaire, antidémocratique, se révélait soluble dans le " national socialisme "… La pression militaire de Mussolini sur le Brenner, destinée pourtant à réfréner les ardeurs allemandes en Autriche, ajouta encore à l’inquiétude (d’autant qu’elle fut, à terme, inefficace) et convertit nombre d’antimilitaristes d’hier en fervents partisans de la défense nationale militaire : si l’Autriche avait pu être ainsi " avalée " par l’Allemagne, n’était-ce pas, entre autres raisons, parce qu’elle manquait d’un instrument armé efficace de défense de son indépendance (en réalité, c’était surtout faute d’avoir conscience d’elle-même, d’être une nation spécifique et non seulement la frange sud-orientale de la " grande Allemagne "). Le Conseiller fédéral (agrarien) Minger saura tirer profit de cette " ré-adhésion " d’une partie de la gauche à la défense nationale militaire, et la convaincra de soutenir sa politique de réarmement et de modernisation de l’armée -une politique qu’en d’autres temps le PSS eût combattue, et que son aile gauche, Léon Nicole en tête, combattait encore.
Rétrospectivement, va-t-on considérer la crainte d’alors, d’une évolution " autrichienne " de la Suisse, comme fondée ? Nous sommes aujourd’hui portés à répondre par la négative à cette interrogation, cette crainte étant pourtant parfaitement légitime sur le moment. D’entre les données du cas autrichien, deux au moins manquaient pour que le cas suisse lui ressemblât réellement : d’abord, la nostalgie impériale, le traumatisme de la réduction du grand empire de l’Europe centrale aux dimensions d’une petite république bourgeoise alpine, avec tout que cela provoqua de frustrations, de nostalgies, de rancœurs, voire de volontés de revanche, traduites en désir de constituer avec l’Allemagne un nouveau grand empire, " purement germanique " celui-là ; ensuite, l’hégémonie confessionnelle du catholicisme (l’ " austro-fascisme " était en même temps un " cléricalo-fascisme ", incompréhensible si l’on ne tient pas comte des choix de l’Eglise catholique et de la culture politique de ses fidèles, surtout hors des villes (et surtout hors de Vienne). A ces deux données autrichiennes, on peut ajouter une donnée suisse pour expliquer la différence de situation politique des deux pays, et l’inégalité des menaces : le caractère " pluriculturel " de la Suisse, comparé à la cohérence culturelle, linguistique et religieuse de ce qui restait de l’Autriche après le démantèlement de son empire. Globalement catholique et germanique, l’Autriche s’oppose ici à une Suisse où catholiques et protestants sont en force à peu près égale, où un tiers de la population est de culture " latine ", où la culture germanique (au sens large, et en tenant compte du fait que l’allemand n’y fut jamais, et n’y est toujours, qu’une langue véhiculaire, " plaquée " sur les dialectes) n’est que l’une des trois cultures constitutives du pays. La séduction " nationale " (ou " raciale ", dans le langage du nazisme) du rattachement à l’Allemagne n’eut aucun sens, sinon répulsif, pour les Romands (même d’extrême-droite) et les Tessinois (même irrédentistes), et la prédication politique du catholicisme réactionnaire n’avait guère de prise sur les protestants. Le projet d’un Anschluss de la Suisse à la " Grande Allemagne " n’eut jamais en Suisse que de rares partisans, et encore n’en eut-il qu’en Suisse alémanique. En fait, il se fut agi plutôt d’une Berstung (éclatement) que d’un Anschluss (réunion), puisqu’il fallait pour que ce projet fût cohérent qu’il impliquât le " réunion " de la Romandie à la France et du Tessin (et de la moitié des Grisons) à l’Italie, ce que peu de Tessinois et de Romands avaient à cœur.
L’affermissement du nazisme en Allemagne et ses conséquences sur l’ordre européen allaient pousser définitivement l’ensemble du mouvement ouvrier suisse à une révision globale de ses politiques intérieures et extérieures, y compris de ses conceptions en matière de défense nationale. Il faudra cependant cinq années pour que cette révision se fasse, et encore ne se fera-t-elle que dans le désordre et la désunion ; la Guerre Mondiale la rendra inévitable pour ceux qui s’y refusaient encore en 1935, et la refusèrent à nouveau en 1939, jusqu’en 1941 : les communistes et l’aile gauche du PSS. Seuls les anarchistes refusèrent jusqu’au bout toute alliance avec l’ennemi de classe et son Etat (quoique certains d’entre eux s’y résignèrent, quittant le mouvement anarchiste pour la social-démocratie). La guerre devenant mondiale en 1941, avec la double agression de l’Allemagne contre l’URSS et du Japon contre les Etats-Unis et leurs alliés, le repli de la gauche helvétique sur la " forteresse nationale " (dont le " réduit national " alpin était l’expression stratégique, militaire) ne fut plus guère contesté, jusqu’en 1944 du moins. C’est le temps des plus grandes menaces (et qu’elles fussent réelles ou hypothétiques ne changea rien à leur perception, et à la réponse politique qui leur fut donnée) : si le fascisme prend encore des gants avec la Suisse, sa souveraineté, son système politique et les droits de ses citoyens, le nazisme ne s’embarrasse guère de convenances, et seuls lui importent ses intérêts et ceux de son Etat. Le danger qu’il représente est immédiatement perceptible, l’antisémitisme ajoutant au danger stratégique celui, social, de la désignation d’un bouc émissaire universel, ce qui ne manqua pas de séduire quelques secteurs non dénués d’influence de l’opinion publique helvétique,. mais en repoussa d’autres.
Si menaçant que soit devenu le nazisme, son avènement avait pourtant été salué comme une " chance pour l’Allemagne " (voire une " chance pour l’Europe ") par tous ceux que la République de Weimar avait inquiété au point que certains, à droite, l’avait prise en franche haine. Quant aux " weimariens suisses ", les premiers pas du nouveau régime nazi n’avaient inquiété que la gauche réformiste, puisque ces pas se faisaient encore dans le cadre formel des institutions de la République allemande. Dès 1934, toutefois, l’ambiance chance : la radio porte loin les paroles du Führer et l’orchestration par Goebbels des liturgies nazies, la langue (non pas commune, mais du moins communément comprise) aura sur le public alémanique un effet de vaccin : le germanophilie de 1914-1918 n’a pas d’équivalent vingt ans plus tard -il reste, bien entendu, des cercles germanophiles, et pronazis parce que pro-allemands (les Wille, par exemple), mais ça n’est plus un fait de masse, un élément constitutif de l’opinion publique. La francophilie non plus n’est plus ce qu’elle était : le Front Populaire a effrayé les " francophiles de droite ", Vichy consternera les " francophiles de gauche ", et de Gaulle sera suspect (pendant trente ans…) aux uns et aux autres.
Le Conseil fédéral ne cessera pourtant, Motta en tête, de défendre la cause de l’intégration de l’Allemagne " nouvelle " à l’Europe, lors même que cette Allemagne-là ne conçoit plus l’Europe que comme un ensemble de vassaux, d’ennemis et de terrains d’exercice. Dès la fin de la Guerre Mondiale, dès Versailles, la diplomatie suisse s’était engagée aux côtés des partisans de la révision des traités qui " culpabilisaient " l’Allemagne en ajoutant à la défaite militaire, relative, l’humiliation d’une capitulation politique et diplomatique absolue. Dans les premiers temps du nazisme, Berlin n’avait guère de reproches à faire à Berne (sinon celui d’accueillir quelques réfugiés antinazis) : l’ancien personnel diplomatique occupait encore ses postes, tout n’avait pas encore été " nazifié " et il était de l’intérêt du pouvoir allemand de faire de la Suisse officielle une alliée. Les premières inquiétudes suisses naquirent lors de la prise de distance de l’Allemagne à l’égard de la SdN. La droite " mondialiste " s’en émut, à l’instar du libéral Journal de Genève :
P.E.B. Journal de Genève du 14 décembre 1937
" Déserter la SdN, ce n’est pas la détruire mais en faire l’instrument de ses adversaires " : le commentateur libéral reproche ainsi aux puissances de ce qui sera l’Axe de laisser Moscou libre d’agir à sa guise au sein de l’institution genevoise. Ce n’est pas le contenu de leur politique, ni leur idéologie, ni leurs aventures militaires annoncées, qui inquiète, mais le champ libre apparemment laissé par eux à l’Union Soviétique. Sous ce reproche de circonstance, derrière cette inquiétude largement illusoire (les " Soviets " étaient arrivés à Genève avant que l’Allemagne n’en parte, et l’on sait les connivences qui s’étaient établies entre la Russie stalinienne et l’Allemagne nazie…), parce la déception des libéraux " mondialistes ", certes anticommunistes mais attachés au système mis en place par la SdN -un système dont ils perçoivent que la chute sera catastrophique pour l’ordre du monde auquel ils sont attachés.
Le gouvernement suisse ne vit pas en le nazisme des deux premières années autre chose que la version " germanique " d’un fascisme tenu en relative faveur. Il était pourtant informé de la " vraie nature " du national socialisme : articles de presse, démarches des organisations d’entraide, alarmes de la communauté juive, dénonciations de la gauche, rapports diplomatiques même (ceux de l’Ambassadeur suisse Paul Dinichert, entre autres) mettaient la droite démocratique suisse en garde. Dinichert informait Berne que Goering était un " morphinomane invétéré " et Goebbels un " véritable fanatique " (cité par Roland Ruffieux, op.cit. p. 271). La politique antisémite des nazis n’attendit guère pour se révéler conforme à leurs discours, contrairement à ce que croyaient pouvoir prédire les bons esprits optimistes (" tout cela n’est que poudre aux yeux, démagogie électorale ", gesticulations rhétoriques) qui attendaient des nazis qu’ils fussent en Allemagne respectueux des grands principes dont se réclamaient la Confédération Helvétique, son gouvernement et son ministre des Affaires étrangères, tout conservateur, catholique et italophile qu’il fût. Le boycott des juifs fut l’une des premières manifestations concrètes de l’antisémitisme allemand à avoir en Suisse même des effets : des membres de la communauté juive de Suisse furent touchés par des mesures qui visaient leurs intérêts en Allemagne, ou frappaient leur famille allemande (quand ils en avaient une). Ce fut le temps des premières inquiétudes : la suite des événements allaient en fournir bien d’autres, sans que la politique de Berne ne change.
Les choix politiques du nouveau régime allemand se révélèrent de plus en plus contraires aux espoirs, naïvement ou cyniquement, placés en lui -autrement dit : ils se révélèrent conformes à ce que les nazis, à commencer par Hitler lui-même, avaient annoncé : l’Allemagne national-socialiste devint un facteur d’instabilité et de trouble en Europe, porteuse de menaces de guerre, attentatoire à la souveraineté et à l’indépendance de ses voisins -sans parler de ses pratiques en Allemagne même. Sa politique débouchait de toute évidence sur l’irrespect des engagements et des obligations de l’après-guerre, et ses aspects militaires (réarmement, remilitarisation) furent plus clairement encore contraires aux intérêts et aux volontés des vainqueurs de 1918, sans que ceux-ci n’osent tenter quoi que ce soit pour y mettre fin. Or, la Suisse officielle (en particulier son ministre des Affaires étrangères) n’ignorait rien de la nouvelle réalité allemande ; elle s’y résigna facilement, par un mélange de prudence fataliste (ne rien faire qui pût fâcher le puissant voisin), d’intérêts économiques et commerciaux (le " redressement " de l’Allemagne est aussi celui de sa capacité à acheter à la Suisse) et de préjugés idéologiques favorables, imperméables à la réalité (enfin un pouvoir fort en Allemagne ! Et qui plus est, un pouvoir furieusement anticommuniste et antisoviétique, au moins rhétoriquement !).
Le soutien, inégal, sans planification et sans grande efficacité, apporté par les services allemands aux nazis helvétiques, s’il allait évidemment quelque peu gâcher les bonnes relations entre Berne et Berlin, n’empêcha ni ne freina l’établissement entre elles d’un lien privilégié, si on le compare à ce que furent (surtout dès 1936) aux relations franco-suisses. Ni la Guerre d’Espagne, ni la mise en œuvre progressive de la " solution finale " du " problème juif ", ni même les premières manifestations tangibles du nouvel expansionnisme allemand, ne remirent sérieusement en cause les conclusions tirées en termes de Realpolitik du nouvel ordre européen, par Motta et ses pairs. La victoire du Front Populaire en France ne fut évidemment pas de nature à faire changer d’avis et de politique les milieux dirigeants suisses, pesamment conservateurs (à quelques exceptions près) et animés d’un anticommunisme fervent, confinant parfois au fanatisme et à un sectarisme comparable à celui des staliniens. Il est néanmoins surprenant que les avatars helvétiques du nazisme, et les liens de ce " nazisme indigène " avec celui de Berlin, ne changèrent rien aux bonnes relations de la Suisse et de l’Allemagne ; il y avait pourtant là de quoi alarmer les forces politiques qui embouchaient rituellement les trompettes de la défense de la patrie…
L’ " Affaire Gustloff " (ou Frankfurter) mit en pleine lumière les agissements nazis en Suisse. Wilhelm Gustloff, ressortissant allemand installé en Suisse, employé fédéral, s’était proclamé Gauleiter du parti nazi de la " région suisse ", c’est-à-dire chef des organisations nazies en Suisse. Au vu et au su de tous, autorités suisses comprises, il organisait à ce titre (qui ne lui était cependant pas reconnu par tous les nazis locaux) l’activité, en principe illégale, des nazis alémaniques et allemands en Suisse. Moult interventions parlementaires, émanant le plus souvent des rangs socialistes, pressaient le Conseil fédéral de mettre fin à l’étrange tolérance dont bénéficiait Gustloff ; or le Conseil fédéral, craignant des représailles allemandes, temporisait et cherchait à éviter l’expulsion de l’encombrant activiste. Le 26 septembre 1935, il édicta des prescriptions, plus sévères que les précédentes, touchant les activités et la constitution des associations politiques étrangères en Suisse, prescriptions visant d’ailleurs aussi bien les fascistes que les antifascistes, les nazis que les antinazis. Le 5 février 1936, coup de théâtre : Gustloff est abattu à son domicile de Davos par un étudiant juif yougoslave, réfugié en Suisse, David Frankfurter, qui se livra spontanément à la police et expliqua son geste par sa volonté de combattre l’antisémitisme. On se trouvait face à une nouvelle " Affaire Conradi ", mais à fronts politiques inversés : la victime n’était plus un diplomate soviétique abattu par un Suisse anticommuniste, mais un agitateur allemand abattu par un réfugiés antinazi (et juif de surcroît, doit-on ajouter pour respecter le climat antisémite de l’époque). Comme on s’en doute, le traitement des deux " affaires " par les autorités suisses (et par les commentateurs de droits) fut pour le moins différent, choix politique et raison d’Etat (cousinage et voisinage) obligent. Motta jugea opportun d’envoyer immédiatement une lettre de condoléances à l’Ambassade d’Allemagne, qui considéra le geste comme insuffisant et réagit à l’attentat avec une vigueur décuplée par l’attitude " inamicale " d’une partie de la presse alémanique, et de toute la presse de gauche. Pour les autorités allemandes, l’attentat était la conséquence directe de la " campagne d’excitation " anti-allemande " de la presse suisse, encouragée dans cette voie par les milieux officiels " ((Roland Ruffieux, op.cit. p. 343). Interprétation pour le moins audacieuse, et en tous les cas excessive : le Conseil fédéral n’eut guère de peine à convaincre l’Allemagne de ses sentiments " amicaux " à son égard, et rejeta sans difficulté l’interprétation polémique donnée par les nazis (sans qu’ils y crussent eux-mêmes) du geste de Frankfurter. Les Allemands tentèrent cependant d’utiliser l’attentat dont leur Gauleiter helvétique avait été la cible pour obtenir une " neutralisation " de la presse suisse (alémanique). Motta crut devoir leur donner des garanties : il promit à l’Ambassadeur d’Allemagne de contrôler plus sévèrement les journaux suisses. La dépouille de Gustloff avait été entre-temps ramenée en grandes pompes en Allemagne, où des funérailles tonitruantes lui furent offertes avec éloge funèbre du Führer à la clef. Un paquebot de luxe fut baptisé du nom de Wilhelm Gustloff. Plus tard, au moment de la débâcle allemande, reconverti en transport de civils chassés de l’est par l’avance de l’Armée Rouge, il fut coulé dans la Baltique par un sous-marin soviétique, avec plusieurs milliers de personnes à son bord -dont fort peu survécurent.
Le Conseil fédéral marqua, le 18 février, quelque infléchissement de sa politique conciliatrice envers l’Allemagne : il décida, à l’unanimité semble-t-il, ce qui suppose pour le moins que Motta n’y fit pas obstacle, de dissolution de la direction suisse et des directions régionales du parti nazi allemand (NSDAP), au motif que ces " représentations politiques " faisaient double emploi avec les représentations diplomatiques et consulaires allemandes. Mesure prudente, évidente même, qui n’impliquait nullement que fussent interdites les organisations nazies, mais qui les poussait à s’installer dans les représentations diplomatiques du Reich. Mesure qui, en outre, ne fut guère que des mécontents : l’extrême-droite " frontiste " et les partisans d’une entente à tout prix avec l’Allemagne la dénoncèrent comme inamicale, les antifascistes la stigmatisèrent comme complaisante -interprétation que le sévère verdict du procès de David Frankfurter confirma : il fut condamné à 18 ans de réclusion, pour le même crime que celui pour lequel Conradi avait été acquitté.
Les prudentes mesures fédérales prises à leur encontre l’impressionnèrent guère les nazis. Le caractère multiforme de l’organisation helvétique du NSDAP, la multiplicité des mouvements se réclamant peu ou prou du nazisme, laissaient aux partisans du IIIe Reich toutes les possibilités d’organiser l’émigration allemande en Suisse lorsqu’elle se révélait sensible aux sirènes hitlériennes, de la surveiller si elle s’y avérait réfractaire ou opposée. Comme c’était le cas du fascisme italien, le nazisme encadra progressivement tout ce qui put l’être de la communauté allemande, par " toutes sortes d’organisations parallèles ou dérivées (noyautant) les colonies traditionnelles " (Ruffieux, op.cit. p. 344).
Par ailleurs, le nazisme allemand avait ses prolongements helvétiques et avait noué d’excellents rapports avec le " frontisme " alémanique. La Suisse alémanique avait été décrétée " ethniquement allemande " et semblait promise à un Anschluss avec la " mère patrie " sous quelque forme que se fasse cette réunion -et elle pouvait se faire de bien d’autre manière qu’ " à l’autrichienne ". Le 9 janvier 1938 se tint à Berlin une réunion de divers services officiels ou officieux, destinée à faire le point sur les actions de propagande et d’agitation en Suisse alémanique. Un collaborateur de Goebbels, le Dr Grosse, analysa les différents mouvements " frontistes " actifs en Suisse et leur position à l’égard du Reich, pour conclure sur le mode pessimiste : les " Fronts " restaient peu implantés, peu crédibles, peu soutenus par la population, et d’un national-socialisme improbable, aux seules exceptions du National Front et des Nationale Hefte de Oehler.
En juin 1936, Sigismund von Bibra arrive à l’Ambassade d’Allemagne à Berne ; il vient de Prague, où il s’était attaché à l’organisation du parti nazi. Il développa rapidement une politique de contacts plus étroits et plus étendus avec un " frontisme " dont la faiblesse en Suisse était insigne, et l’orthodoxie nazie douteuse. Il fut aidé en cette tâche par l’Ambassadeur Otto Köcher, puis, dès décembre 1938, par le Consul général de Zurich, Georges Ashton. Cette fine équipe soutint successivement l’aile la plus extrême du National Front (Henne, Schaffner) jusqu’à son échec électoral de 1938, puis les " scissionnistes " fondateurs du Bund Treuer Eidgenossen National-sozialisticher Weltanschaung (BTE), les Zander, Schäppi, Oehler, dont le journal Schweizerdegen était subventionné par le grand frère allemand.
Le 15 novembre 1938, le Conseil fédéral dut se résoudre à déclencher une opération de police contre le Volksbund, l’ESAP et le BTE, opération au terme de laquelle il fut prouvé ce que l’on savait déjà, et que la presse antinazie avait déjà publié : ces trois organisations étaient directement manipulées depuis l’Allemagne, ce qui justifiait leur interdiction et celle de leurs journaux. Les services de renseignement allemands, la SS elle-même, s’étaient mis de la partie, créant un organisme à façade " culturelle ", l’Alemanischer Arbeitkreis, dirigé par un certain Dr Peter, directement lié aux nazis locaux et à la Neue Basler Zeitung (interdite le 28 décembre 1939). De toute cette activité nazie en Suisse, activité de nazis suisses aussi bien que de nazis allemands, l’assassinat de Gustloff fut donc le moment de mise en lumière, ce qui eut pour effet de contraindre ses acteurs à plus de discrétion, et à un changement de stratégie : " L’infiltration (céda) le pas à une tactique plus révolutionnaire, (visant) à préparer l’instauration d’un ordre nazi en Suisse " (Ruffieux, op.cit. p. 346), passage en somme du simple et traditionnel espionnage à une " subversion " guère éloignée dans ses conceptions, ses stratégies et ses méthodes, de ce que fut la " diplomatie révolutionnaire " de l’Union Soviétique et du Comintern dans les années vingt.
Promouvoir leur idéologie en Suisse (comme ailleurs) fut l’un des soucis les plus constants des nazis. Ce souci, toutefois, ne put guère se traduire en actes ; par incompétence, par méconnaissance des réalités locales, par excès de nationalisme allemand, les tentatives d’implanter en Suisse un mouvement nazi durable et fort aboutirent toutes à l’échec. Il est vrai que la Suisse ne fut jamais un objectif prioritaire pour l’Allemagne et que celle-ci se satisfit toujours fort bien du maintien à ses frontières de cet Hinterland ni nazi, ni antinazi. Le maintien de la Suisse dans une " neutralité sympathisante " était en somme bien plus utile à Berlin que la déstabilisation " à l’autrichienne " de la Confédération. Le maximum des efforts allemands en Suisse fut donc consacré à surveiller la neutralité helvétique et son expression -et à surveiller les antinazis. C’est à quoi s’attachent, par exemple, les multiples interventions de Berlin ou de l’Ambassade du Reich en Suisse, contre la presse helvétique. La presse communiste vit son cas rapidement réglé par l’interdiction pure et simple ; elle n’était pas la plus dangereuse : trop marginale pour être efficace, trop sectaire pour être influente. La presse socialiste fut plus difficilement contenus (à vrai dire, elle ne le fut jamais) ; en Suisse alémanique, l’antinazisme joua dans et pour la presse socialiste et syndicale un rôle comparable à celui de l’antifascisme au Tessin ; la presse socialiste exprimait l’antinazisme dans la langue même de la " Grande Allemagne " et, à l’instar de la tessinoise Libera Stampa pour l’Italie, devenait " le refuge de la pensée libre " exprimée en allemand. Les nazis ne pouvaient admettre que de Suisse parvînt à se faire entendre et lire en Allemagne le discours de résistance qu’ils étouffaient chez eux. Que la gauche ne fût pas la seule à rendre compte des " aspects négatifs " du nazisme, que la grande presse bourgeoise s’y mît aussi, n’était évidemment pas de nature à rasséréner les nazis, au moment où ils affirmaient crûment leur volonté de définir et de contrôler totalement la moindre image " allemande ", la moindre expression allemande à l’étranger (" nazification de l’appareil diplomatique, accroissement des efforts de propagande). L’opposition socialiste au nazisme allait pour ainsi dire de soi, et les nazis s’en seraient sans doute consolés, moyennant quelques fermes pressions pour que fussent contrôlés et censurés les journaux les plus polémiques, mais que de respectables quotidiens bourgeois comme la Neue Zürcher Zeitung prissent parfois contre le nazisme la défense du libéralisme économique, de la démocratie politique (même quelque peu autoritaire dans la lutte contre le socialisme) et du pluralisme (relatif, compte tenu des interdictions frappant le PC et ses alliés), cela était insupportable. L’effet de surprise de 1933 passé, et après lui ce que l’on pourrait appeler l’ " état de grâce " des premiers mois du nazisme au pouvoir, les nouvelles défavorables à l’Allemagne furent données et écoutées en Suisse avec ce que les nazis perçurent et dénoncèrent comme une coupable complaisance. Du Travail de Léon Nicole à la NZZ, la presse helvétique ne manifesta en effet plus guère de préjugé favorable à l’égard de la " Nouvelle Allemagne " dès lors que celle-ci eût abandonné ses dernières prudences formelles. Ainsi l’opinion publique suisse était-elle, globalement, plus " antinazie " que le gouvernement suisse, enclin, lui, à ménager un puissant voisin. Cette contradiction entre l’opinion publique et le gouvernement fédéral offrait à la gauche, et en premier lieu au PSS, l’occasion de se définir et de se présenter comme la plus sûre des forces " patriotiques " -plus sûre qu’un gouvernement dénoncé par le PSS pour ses complaisances, en même temps que le PSS aspirait à y participer (minoritairement). Vingt ans auparavant, le Parti socialiste avait dénoncé l’Union Sacrée patriotique, une année après y avoir pourtant cédé ; il en dénonçait désormais les faiblesses et les lacunes. L’ennemi avait changé, qualitativement et quantitativement : le nazisme était d’une toute autre nature que l’impérialisme wilhelminien et, dès 1940, l’alliance qu’il domine (l’Axe) encercle totalement, pour quatre ans, la Suisse. Cette double différence, de nature et de puissance, est capitale : elle permet aux socialistes de justifier bien plus clairement et de manière bien plus convaincante leurs appels à l’union avec les forces les moins compromises (et les moins compromettantes…) de la droite et du patronat. Si en 1914-1918 l’Union Sacrée pouvait apparaître -et était- une compromission, de 1936 à 1945, elle n’était plus qu’un compromis, perçu comme nécessaire, face à " la Bête ".
Ce choix patriotique, l’extrême-gauche restera seule à le combattre, jusqu’en 1941 pour les communistes (y compris les trotskistes), qui s’y rallieront alors pour l’essentiel, jusqu’au bout pour les anarchistes. Ce refus, elle ne fondera sur l’antifascisme -qui précisément fonde aussi pour la social-démocratie le choix de l’unité avec la droite démocratique. Ainsi l’exprime aussi, déjà en mai 1938, la trotskiste Marxistische Aktion Schweiz :
Jusque là, il n’y a rien dans cette analyse trotskiste qui soit fondamentalement divergent de l’analyse social-démocrate ; mais sitôt le décor planté, et le contexte analysé, les divergences apparaissent : c’est qu’il faut concevoir une stratégie " intérieure " (au plan suisse), définir en termes politiques les rapports de classe -et cette définition ne sera évidemment pas la même selon que ceux qui la proposent se situent dans la gauche réformiste ou dans la gauche révolutionnaire :
Marxistische Aktion Schweiz, Le problème de la défense nationale, in Contre le défense nationale, Ligue Marxiste Révolutionnaire, op.cit.biblio pp 91-93
Les marxistes révolutionnaires affirment que " la mise en danger par l’impérialisme et le fascisme de l’indépendance de la Suisse ne représente (…) qu’une raison supplémentaire de mener le combat révolutionnaire " ; les sociaux-démocrates, eux, considèrent que cette menace représente au contraire une raison d’interrompre l’affrontement des classes et des forces politiques, et un motif d’union nationale avec la bourgeoisie démocratique, dont ils ne désespèrent pas de faire une alliée dans lutte antifasciste.
Cette lutte antifasciste, la gauche démocratique va pourtant, sur de nombreux terrains, la mener contre une partie -et parfois la plus grande partie- des milieux " bourgeois ", que les modèles autoritaires séduisent dangereusement. Ce sera le cas sur le terrain " intellectuel ", et notamment dans les milieux universitaires. Prenons ici l’exemple genevois : dans les années trente, l’université sera un terrain constant d’affrontements verbaux, écrits et parfois physiques, entre la gauche socialiste et communiste d’une part, l’extrême-droite fasciste ou fascisante et une partie de la droite traditionnelle, d’autre part (ces droits étant liées dans la dénonciation du " cosmopolitisme " intellectuel de l’université, " rénovée " par les radicaux de la fin du XIXème siècle).
" Un homme qui sait ne se réclame jamais de la liberté de conscience ; il parle et ne demande qu’une chose : c’est de ne pas être confondu avec ceux qui affirment le contraire ", écrit le " zofingien " Maurice Ferrier (cité par Marco Marcacci, in Etoile de Salomon… op.cit.), qui se range vraisemblablement au nombre des " hommes qui savent ", et répond ainsi à un discours " libéral " (c’est-à-dire reconnaissant le pluralisme des pensées et des opinions) du Conseiller d’Etat Paul Lachenal. Pour cette " jeune droite ", en effet, le pluralisme, c’est la confusion ; pire que la confusion, même : l’Université démocratique sape ses propres valeurs et prépare le terrain pour le marxisme. Contre les Lumières, contre la démocratie (en ce qu’elle implique de pluralisme), la " jeune droite " prône une sorte de retour à l’unicité de la pensée de l’Ancien Régime calvinien (ou de la vision qu’elle en a). Face à cette volonté, ou cette prétention, de " régénération " par le retour au passé pré-démocratique (mais non pré-républicain), de grands intellectuels " bourgeois " proclament la pérennité des valeurs libérales (au plein sens du terme) ; ainsi, William Rappard, dans son premier discours de Recteur de l’Université, en 1936 :
Cité par Marco Marcacci, in Etoile de Salomon, faucille et marteau, croix gammée et croix fédérale, Revue du Vieux Genève, Genève 1985
L’une de ces " mystiques régnante " posera un problème tout particulier à l’Université de Genève dans les années trente : le nazisme, en effet, s’y trouva bien représenté au sein d’une importante colonie estudiantine allemande, organisé par les autorités allemandes.
Depuis la démocratisation " fazyste " de l’Université genevoise, la présence d’étudiants étrangers y était considérée comme un signe très positif, l’indice de l’audience, de la qualité académique et du rayonnement de l’institution -en même temps que de celui de la Cité. En nombre et en proportion constamment croissante jusqu’en 1914, les étudiants étrangers virent leur colonie brutalement réduite par la guerre et ses suites, notamment la révolution en Russie alors que la colonie estudiantine russe était importante.. Il y avait 1638 étudiants inscrits à l’Université de Genève en 1913, dont 1298 étrangers (près de 80 % du total…) ; en 1922, il n’y avait plus que 704 étudiants inscrits, dont 176 étrangers (le quart du total). La chute du nombre des étudiants affecte gravement l’Université, et la réduit à des dimensions provinciales dans le même temps où elle permet aux Suisses d’y redevenir majoritaires, sans que leur nombre n’augmente, et par le seul fait de l’absence des étudiants étrangers. L’ouverture de l’université aux étudiants et, dans une bien moindre mesure, aux enseignants, étrangers était donc nécessaire à la stabilité même de l’institution académique, sauf à la vouloir réduite à ses dimensions calviniennes (encore que l’Académie de Calvin était elle aussi grandement peuplée d’étudiants étrangers, et presque totalement en mains d’enseignants étrangers, pour la plupart français, et que sa petitesse s’accompagnait d’un extraordinaire rayonnement international).
L’ouverture de l’université, acquise grâce aux efforts des radicaux progressistes, faisait problème politique : elle supposait en effet, ou à tout le moins provoquait, le pluralisme idéologique, en une époque qui tenait celui-ci en forte suspicion :
Marco Marcacci, op.cit.
La colonie estudiantine russe ayant pratiquement disparu après 1918, ce sont les étudiants allemands qui constituent la présence étrangère la plus importante à l’université genevoise durant toute l’entre-deux guerres. Ils sont particulièrement nombreux (toutes quantités par ailleurs relatives à celle de l’ensemble des étudiants) en Faculté de Droit, puisqu’un enseignement de droit germanique est donné en allemand à Genève depuis le début du siècle et que ce enseignement jouit de quelque réputation dans les pays germaniques. 150 à 200 étudiants " germaniques " sont inscrit en Droit de 1915 à 1929 ; le crise de 1929, puis l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933, réduira considérablement ce nombre, mais il y aura encore une quarantaine d’étudiants " germaniques " inscrits en 1934, et une trentaine en 1936, malgré les mesures restrictives prises par les nazis en ce qui concerne les séjours d’étude à l’étranger. Mais ces quelques dizaines d’étudiants allemands, précisément du fait de ces mesures restrictives, et donc du " tri " fait " à la source ", en Allemagne, des étudiants que l’on autorise à suivre des études à l’étranger, seront particulièrement représentatifs de ce que les nazis attendent de leurs compatriotes à l’étranger : du militantisme national-socialiste. Filtrés, formés, contrôlés, les étudiants allemands de Genève seront donc souvent de très fervents partisans du régime hitlérien, et d’actifs propagandistes de son idéologie.
L’Université, et derrière elle le gouvernement cantonal, avaient pour préoccupation centrale de " maintenir une présence étrangère (…) utile au développement de l’institution " (Marcacci, op.cit. p. 55), mais cette présence étrangère, en tant qu’elle était personnifiée par des étudiants " de plus en plus séduits et manipulés par un régime totalitaire " (ibid.) posait un évident problème politique -et un " problème d’ordre public "- dans la Genève des années trente, en particulier pendant toute la période du gouvernement socialiste (1933-1936). A cours de l’été 1933, le Département fédéral de Justice et Police avait invité le Recteur genevois à l’informer de la situation dans la colonie estudiantine étrangère : à Bâle s’était créé un groupe universitaire " aryen ", et la Confédération craignait que le cas se reproduise à Genève, conduisant à l’instauration d’une sorte de " service de renseignement politique pour un Etat étranger " (ibid.). Notons ici que le Conseil fédéral Häberlin s’adresse directement au Recteur, en passant " au-dessus " du Département cantonal de Justice et Police. Le 7 novembre 1933, les socialistes venant de gagner les élections cantonales, la Deutsche Studentenschaft (que le Recteur présentait au Conseiller fédéral comme une société d’étudiants officiellement reconnue et ne regroupant pas des militants nazis) invitait à une célébration du dixième anniversaire du putsch hitlérien (manqué) de Munich, et conviait les étudiants allemands à participer massivement à l’élection du Reichstag et au plébiscite pour le retrait de l’Allemagne de la SdN, deux actes considérés comme une " manifestation de confiance dans la nouvelle Allemagne et son grand Führer " (ibid.). Le quotidien socialiste Le Travail publia la circulaire estudiantine allemande et en profita pour attaquer le Chef du Département cantonal de l’Instruction Publique (encore en poste pour quelques jours), Paul Lachenal, " qui dîne avec le ministre hitlérien Goebbels " tandis que " les étudiants nazis affichent leur propagande à l’Université " (Le Travail, 11 novembre 1933). Au début de l’année 1934, la Deutsche Studentenschaft fait arborer la croix gammée par ses membres, et en fait son propre symbole. Un " Groupe genevois des étudiants contre la guerre ", lié au PC, fait de la dénonciation de la présence fasciste et nazie à l’université un thème de bataille, provoquant en retour la création à droite d’un " Groupe national d’étudiants " voué au combat " antimarxiste " et à la lutte contre " la subversion " (celle d’extrême-gauche, évidemment). Léon Nicole, devenu chef du Département cantonal de Justice et Police, ordonna une enquête fort détaillés sur les agissements nazis (l’enquête alla jusqu’à l’examen des graffitis et gravures sur les bancs et pupitres de l’université). L’activisme d’extrême-droite ne s’en réduira pas pour autant : la Deutsche Studentenschaft convoquera notamment une réunion " obligatoire " le 29 janvier 1934 pour célébrer l’anniversaire de la fondation du IIIème Reich, et une autre après l’assassinat de Gustloff pour manifester son deuil.
En mars 1935, le Conseil fédéral avertit les universités suisses du caractère de plus en plus militant de la présence des étudiants allemands : l’autorisation du " Commissariat pour l’étranger " de la Deutsche Studentenschaft centrale avait été rendue nécessaire pour tout étudiant désireux d’étudier ne fût-ce qu’un semestre hors du Reich. Selon les termes de la lettre du Conseiller fédéral Etter, " cette mesure a pour effet de créer en quelque sorte un lien officiel entre chaque Allemand résidant à l’étranger et le parti national-socialiste " (Marcacci, op.cit. p. 56). En 1938, à Genève, deux tentatives allemandes visant à aligner l’enseignement genevois du droit allemand sur les thèses nazies illustrèrent ce " militantisme universitaire " : la première tentative visait un professeur de confession juive, Louis Hamburger, la seconde un Allemand naturalisé Suisse, le professeur Liebeskind.
Louis Hamburger enseignait le droit civil allemand ; lors du semestre d’été 1938, son cours fut boycotté par les étudiants allemands, au motif que les dispositions en vigueur en Allemagne rendaient nul tout enseignement dispensé par un " israélite ". La situation était fort embarrassante pour les libérales et démocratiques autorités académiques genevoises, d’autant que nulle sanction n’était possible contre les étudiants " boycotteurs ", puisque la fréquentation des cours n’est pas obligatoire à l’université. Il ne s’en agissait pas moins d’une manifestation politique, " guidée de l’extérieur ", ouvertement raciste (antisémite) et pour le moins choquante. L’Université de Genève et le Conseil d’Etat manifestèrent donc à l’enseignant boycotté leur entière confiance et renouvelèrent son mandat. Les socialistes exigèrent que l’on mît fin aux activités de la Deutsche Studentenschaft au motif qu’il s’agissait d’une " organisation politique dirigée de l’étranger et responsable auprès du gouvernement du Troisième Reich " (ibid.). ironie de l’histoire : les socialistes étaient prêts à demander que l’on appliquât à l’organisation estudiantine nazie les mêmes dispositions qui avaient permis d’interdire le PC en 1937, et qu’ils avaient alors vigoureusement combattues. Le Chef du Département de l’Instruction publique, Adrien Lachenal (le gouvernement socialiste était tombé en 1936) exprima à cette occasion la conception " libérale-démocratique " de l’Université, conception combattue par l’extrême-droite (qui y voyait une faveur faite au marxisme) et raillée par l’extrême-gauche, qui constatait son impuissance face au nazisme. Adrien Lachenal :
Mémorial du Grand Conseil de la République & Canton de Genève, 1938, p. 643
Aux dénonciations socialistes et à l’émotion du Conseil d’Etat, l’extrême-droite répond par l’ironie ; Action Nationale, organe de l’Union Nationale de Géo Oltramare, écrit :
Cité par Marco Marcacci, op.cit. p. 58
Nouveau paradoxe : les xénophobes de l’Union nationale s’inquiètent des goûts et désirs académiques des étudiants étrangers… il est vrai que ces goûts sont nazis, ces désirs antisémites, ces étudiants allemands, et que nous sommes en 1938…
Du 8 au 10 novembre 1938 se déchaînent en Allemagne les fureurs de la " Nuit de Cristal ". S’ensuivent des décrets antisémites excluant les juifs de la vie économique et les rendant financièrement responsables des conséquences des pogroms nazis. A Genève, où il enseignait le droit germanique, cette étrange conception juridique (la victime est a priori responsable des actes commis contre elle, pour peu qu’elle soit juive et que l’auteur de ces actes ne le soit pas) suscita de la part du professeur Liebskind une déclaration introductive à son cours du 16 novembre, déclaration qui allait faire " rebondir " la polémique ; Liebeskind, spécialiste des " droits mobiliers réels ", exprima en effet une conception du Droit que les nazis jugèrent inacceptable :
Cité par Marco Marcacci, op.cit. p. 58
Pour un intellectuel, un juriste comme Liebeskind, les conceptions nazies du Droit sont inacceptables parce qu’en contradiction avec les " règles immuables de la justice et de la morale " telles que définies par les principes sociaux et politiques de la démocratie libérale -ce qui, soit dit en passant, devrait conduire à relativiser leur prétention à l’immuabilité. On ne s’étonnera donc pas que, dans ces conditions, le cours de Liebeskind fût, lui aussi, boycotté après que les étudiants allemands (les seuls, ou presque, qu’ait le professeur) eurent quitté la salle.
L’ " Affaire " fut rendue publique par le quotidien catholique (et, à l’époque, pour le moins conservateur, voire réactionnaire et corporatiste) Le Courrier, qui posa (naïvement ?) la question de savoir s’il valait la peine de maintenir pour la beauté des principes un enseignement spécial de droit allemand en allemand alors que ceux à qui il était destiné le refusaient (ou étaient contraints de le refuser). Au parlement, les députés Genêt (chrétien-social) et Vincent (communiste, élu sur la liste socialiste) exprimèrent, le premier son inquiétude, le second son indignation, devant le boycott nazi. La Faculté de Droit, elle, crut judicieux de rejeter sur le professeur Liebeskind la responsabilité du boycott de son propre cours : sa déclaration liminaire (" manifestation personnelle ", précisait la Faculté) aurait " froissé les sentiments " de ses élèves (cité par Marcacci, op.cit.). La même faculté prit la défense, non de son professeur boycotté mais des étudiants qui le boycottaient, et argua de l’absence de plainte contre eux (de plaintes en justice, en effet, il n’y eut pas ; de plaintes tout court, dénonçant une opération politique nazie, en revanche, les exemples foisonnent) : " il serait (…) inéquitable de -comme l’ont fait certains journaux- les accuser (les étudiants) d’une provocation qu’ils n’ont pas commise " (ibid.). Adrien Lachenal, qui avait quelques semaines auparavant exprimé éloquemment les valeurs de l’université libérale et démocratique, crut lui aussi devoir " calmer le jeu " en désavouant Liebeskind, qui aurait été " imprudent " (en rappelant ce qu’il entendait enseigner…), et couvrir les étudiants allemands en affirmant lui aussi que nulle provocation ne pouvait leur être reprochée. L’attitude de la Faculté de Droit et celle du Conseiller d’Etat furent dénoncées par la gauche comme relevant de la complaisance à l’égard des étudiants nazis, et Le Courrier lui-même (qui venait d’exprimer ses doutes sur l’utilité de l’enseignement contesté par l’extrême-droite) écrivit son scepticisme. La polémique " remonta " jusqu’au Conseil national, devant lequel Motta dut protester de la neutralité politique… des étudiants allemands en Suisse (alors qu’il était désormais de notoriété publique qu’ils étaient organisés par les nazis), et affirmer, sur la foi de déclarations des autorités allemandes, mais contre toute évidence, qu’ils n’étaient chargés d’aucune mission politique ou de propagande. Le Conseil fédéral fit en cette occasion bien peu de cas des informations dont il disposait (et dont disposaient les autorités genevoises), et qui, toutes, confirmaient l’encadrement politique des étudiants allemands par les nazis. Les cours de droit pour étudiants allemands furent d’ailleurs supprimés au printemps 1940 à la suite de l’arrestation de deux " étudiants " convaincus d’espionnage au profit de l’Allemagne ; il faudra l’intervention expresse du Conseiller fédéral Pilet-Golaz, alors Président de la Confédération, pour qu’ils soient rétablis à l’automne, sous prétexte de " resserrer les liens avec l’Allemagne " (ibid.)
Au-delà de ses aspects anecdotiques, corporatistes (universitaires) et locaux (genevois), le problème posé par la présence militante d’étudiants nazis dans une université suisse illustre l’extrême sensibilité des acteurs du moment à tout ce qui, d’Allemagne, arrivait en Suisse. Cette sensibilité crût constamment au fur et à mesure que le nazisme consolidait son pouvoir et radicalisait ses politiques : ce qui était encore accepté, " sous bénéfice d’examen ", par certaines forces de droite en 1933-1934, par anticommunisme ou par amour de l’ordre, fut par ces mêmes forces reconnu comme une menace pour tout ce à quoi elles tenaient, dès lors que les ultimes précautions formalistes furent abandonnées par les maîtres du IIIe Reich. La presse joua en cette évolution un rôle considérable : celle de gauche et d’extrême-gauche ne reconnut jamais la légitimité, ni formelle ni (et encore moins) historique du pouvoir nazi, et eut encore moins d’hésitation à l’égard du régime allemand qu’elle n’en put avoir à l’égard de son " cousin " (et inspirateur) italien. La presse " bourgeoise ", et les partis de la droite démocratique, hésitèrent plus longtemps : après tout, c’étaient dans les formes légales et selon les règles constitutionnelles que Hitler avait pris (ou ramassé) le pouvoir, même si ses pratiques étaient fort douteuses. L’espoir de quelque maintenance de quelque démocratie, même sous une surveillance autoritaire, ne disparut qu’après la première année d’exercice du pouvoir hitlérien. On avait fait mine de croire que les déclarations et les discours politiques du Führer n’étaient que manifestations de démagogie destinées à appâter les électeurs et les victimes de la crise -et si cela pouvait les détourner du communisme, on pouvait bien le pardonner… On feignait de ne lire dans Mein Kampf qu’une sorte de catéchisme lyrique à usage de propagande ; on croyait pouvoir affirmer qu’une fois intronisé, Hitler se comporterait " raisonnablement ", quoi qu’il en soit de la propagande et de la mise en scène : après tout, n’avait-il pas le soutien, même méprisant, d’une part non négligeable de la vieille oligarchie wilhelminienne, à laquelle la droite alémanique était si souvent liée ? Espoir rapidement déçu : il n’y eut que " la solution finale du problème juif " pour mettre longtemps à imposer l’évidence de la concrétisation dans les faits du programme exprimé par les mots : la droite démocratique nièrent le plus longtemps possible l’évidence, malgré les innombrables témoignages qui, dès 1933, se diffusèrent en Suisse -sans compter tous ceux qui, se diffusant ailleurs, notamment en France, avaient écho en Suisse. Finalement, la presse d’extrême-droite (fasciste, nazie et, quoique avec moins de conviction, catholique corporatiste) fut seule à saluer dans le 30 janvier 1933 le prélude à une véritable " révolution européenne " (en quoi elle ne se trompa d’ailleurs pas), dont la Suisse elle-même allait bénéficier et dont elle devrait s’inspirer. Les " complaisances " du Conseil fédéral à l’égard du nazisme ne furent après tout que le fait d’un sentiment de menace, conjugué à la certitude de l’impuissance, ajouté à un manque évident de courage politique et à un anticommunisme obsessionnel, le tout sur fond d’antisémitisme latent.
L’incendie du Reichstag, les persécutions contre les communistes, les socialistes, les démocrates, puis contre tout ce qui pouvait même de loin ressembler à une opposition ou à une dissidence (des traditionalistes prussiens aux protestants et aux catholiques reconnaissant en le nazisme l’exact contraire de la prédication évangélique), y compris à l’intérieur du nazisme lui-même (les SA), l’acharnement déployé contre les juifs, mais aussi les Tziganes, les handicapés, les homosexuels et toutes les marges sociales, la " plongée " dans l’obscurantisme culturel, tout cela éloigna progressivement le " marais " politique helvétique et la droite " éclairée " du camp des sympathisants au nazisme.
Il s’en fallut toutefois de beaucoup que la prise en compte de la nouvelle réalité allemande bénéficiât de tout l’empirisme nécessaire. Les communistes, par exemple, clamaient bien haut leur certitude que le fascisme mourra avec la capitalisme dont il n’est qu’un sous-produit, ni plus, ni moins détestable que les autres (dont la social-démocratie). Au gré des virevoltes du Comintern, le fascisme et le nazisme (confondus) seront tantôt dénoncés comme l’ennemi principal à combattre par tous les moyens, y compris l’alliance de Front Populaire avec la social-démocratie et la bourgeoisie progressiste, tantôt considéré comme une simple manifestation conjoncturelle du capitalisme, sa " main droite " (étant entendu que la social-démocratie en est la " main gauche ". L’antilibéralisme forcené des nazis, dans tous les domaines, y compris l’économie, put même, aux plus forts moments de sectarisme, séduire quelques cadres communistes, et le destin paradoxal d’un Doriot en intriguer d’autres. D’une manière générale, le regard porté par le mouvement communiste sur le nazisme le lui fit voir avec les yeux de Moscou, et le poussa à le juger en fonction des intérêts, des choix et des stratégies du Comintern -autrement dit de la direction stalinienne du PCUS, voire de Staline lui-même.
En 1934, la " Nuit des longs couteaux " met fin à quelques illusions : le massacre de Röhm et des SA par les chefs nazis et la SS élimine ce qu’il y avait encore de populisme " révolutionnariste " dans le nazisme, et manifeste avec la plus aveuglante évidence la totale absence de scrupules du pouvoir de Berlin. Les pratiques, désormais largement connues, de la Gestapo et de l’appareil judiciaire nazi contribuent à rendre illusoires les quelques attentes subsistant d’une évolution " civilisée " de l’Allemagne hitlérienne (encore que l’on put lire et entendre parfois les communistes proclamer leur conviction d’une évolution " socialiste " du nazisme). Le menace se précisant au fur et à mesure que se dissipent les précautions formalistes des premiers mois du IIIème Reich, les journaux suisses qui n’avaient pas encore choisi leur camp se résignent à le faire. L’extrême-droite " philonazie " étant marginale, au plan des institutions, c’est par capillarité que va se répandre la volonté (ou la résignation) de composer avec Berlin, comme on le fit avec Rome : la presse helvétique, pour l’essentiel, bascule dans un antinazisme rhétorique, tout en appelant à reconnaître le fait nazi. Le pouvoir politique lui-même devra prendre moult précautions pour justifier ce qui, dans ses décisions (ou ses absences de décision) relève de l’accommodement pur et simple avec le régime de Berlin. Solidement installé, le pouvoir nazi se dépouille des ambiguïtés dont on avait bien voulu le revêtir. L’ " affrontement " entre l’opinion publique suisse et l’Etat allemand, et en même temps entre le gouvernement suisse et la gauche suisse, va pouvoir se développer et s’approfondir, c’est-à-dire s’aggraver, en même temps que se préciseront ses enjeux, réels et symboliques.
La " question juive " (il vaudrait d’ailleurs mieux parler de " la question antijuive ", puisqu’il n’y a de " question juive " que par le fait de l’antisémitisme, au sens de l’antijudaïsme, qui constitue lui-même la " question juive ") ne sera pas le moindre de ces enjeux. La perception de l’antisémitisme nazi, le " statut qui lui sera accordé dans l’analyse que l’on produira du nazisme, seront l’un des principaux critères de distinction des attitudes à l’égard de l’idéologie hitlérienne au sein de la classe politique suisse. Les uns (le Vaterland par exemple) ne critiqueront guère que les " excès " de l’antijudaïsme nazi, et iront jusqu’à le justifier implicitement au nom des nécessités économiques (" débloquer " une économie allemande que l’on dit empêtrée dans les rets d’influence " juifs ") et culturelle (défendre la " culture allemande " contre un " cosmopolitisme " décadent et délétère, véhiculé par l’intelligentsia " juive " ou " apatride "). L’aile la plus conservatrice du catholicisme suisse mit également longtemps à s’apercevoir que l’antisémitisme nazi n’était pas un moyen " convenable " de lutter contre la déchristianisation de l’Allemagne, que tel n’était d’ailleurs pas son but, et que le nazisme était plus profondément et plus radicalement " antichrétien " que ne pourrait l’être le plus orthodoxe et le plus " intégriste " (comme on ne disait pas encore) des judaïsmes. A vrai dire, les régions les plus catholiques du " monde germanique " (la Bavière, l’Autriche) et slave (la Croatie, la Pologne même) furent aussi les moins résistantes à l’antisémitisme nazi (la Pologne résista, mais à l’Allemagne, non à l’antisémitisme) : de quelles obscures pulsions s’était donc nourri, et perverti, le catholicisme réactionnaire, et pas seulement celui de langue allemande (on verra bien aussi la France vichyste en appeler à la tradition catholique contre l’ " enjuivement "…) ?
L’antinazisme de la droite démocratique urbaine et protestante (ou laïque) fut incontestablement plus précoce et plus vivace (toutes proportions gardées, cependant, et quoi qu’il en soit des accommodements tactiques, ou économiques, avec les tenants d’une idéologie que l’on désapprouvait, sans toujours la combattre) que celui du conservatisme populaire catholique et rural. La Neue Zürcher Zeitung, pour qui l’Etat de droit est quelque chose comme une table de la Loi (du moins tant que le contenu du droit lui convient), dénonça ainsi les mesures discriminatoires d’abord, persécutrices ensuite, génocidaires enfin (mais qui ne furent dénoncées comme telles qu’une fois le IIIème Reich écrasé) dont les juifs allemands furent victimes de la part de leur propre gouvernement, avant que les juifs de toute l’Europe occupée ne les rejoignent dans les camps, les fosses communes, les chambres à gaz, les fours crématoires.
La presse socialiste, elle, liera constamment l’antisémitisme (l’antijudaïsme) nazi, et sa pratique, à l’ensemble des pratiques nazies, commettant peut-être ainsi l’erreur de ne pas lui accorder le statut " théorique " tout à fait particulier qui est le sien, et qui permet de distinguer le nazisme du fascisme ou du franquisme. La gauche social-démocrate, et de manière plus simpliste encore qu’elle, la gauche communiste, considérèrent l’antisémitisme nazi comme l’équivalent de celui manifesté par toutes les extrêmes-droites occidentales : la " Nuit de Cristal " ne serait ainsi qu’une manifestation de cet antisémitisme récurrent, endémique, et ne serait pas plus exemplaire du nazisme que l’Affaire Dreyfus le fut du maurrassisme. Cette confusion -car c’en est une, et de taille !- n’atténuera évidemment en rien la dénonciation par la presse socialiste des persécutions antisémites en Allemagne, ni l’indignation non feinte avec laquelle elle en reçu et diffusa le témoignage, mais elle aboutira à mettre ces persécutions sur le même plan que celles dont l’opposition de gauche allemande était, au même moment, victime. C’était oublier que si le nazisme entendait effectivement éliminer politiquement toute opposition, c’était physiquement qu’il il entendait éliminer les juifs; c’était oublier que l’antisémitisme nazi était une dimension particulière, nécessaire, constitutive du nazisme, et que celui-ci n’était pas un sous-produit du fascisme italien ; c’était tenir pour secondaire la dimension pathologiquement racistes du nazisme, pour privilégier sa dimension politiquement répressive, et n’en faire qu’une variété, certes particulièrement féroce, mais tout de même intimement proche, des idéologies contre-révolutionnaires traditionnelles. Or l’antisémitisme était (et est) le " noyau dur " du nazisme, et il son aboutissement exterminateur n’eut rien de fortuit. Il faudra pour que la gauche, socialiste ou communiste, s’en rende compte qu’affluent les informations, les témoignages, et qu’enfin apparaissent des survivants des camps de concentration.

Des témoignages sur l’univers concentrationnaire nazi, il en arriva rapidement, sans toujours -il s’en fallut de beaucoup- que leur audience soit qualitativement et quantitativement celle qu’ils eussent mérité. En 1935 paraît à Zurich le livre de W. Langhoff, Die Moorsoldaten ; c’est un best-seller, mais dont la véracité est immédiatement mise en doute, comme s’il s’agissait d’un récit romancé, " exagérant " pour les besoins de la cause antinazie les " vexations " subies par les victimes (allemandes) du nazisme. Si une partie de la presse (notamment la presse socialiste et syndicale) informe effectivement de la réalité concentrationnaire allemande, d’autres journaux se contentent de relater les visites officielles aux camps modèles installés pour satisfaire à la propagande de Goebbels. L’exemple soviétique fut de surcroît largement évoqué pour, sinon légitimer, du moins banaliser les camps allemands : chaque fois qu’un journal ou un tract communiste ou socialiste se permettait de dénoncer les camps nazis, on renvoyait ses auteurs à leur silence sur les camps soviétiques. Encore les socialistes pouvaient-ils répliquer qu’ils avaient, dès les années vingt, dénoncé les pratiques répressives du régime bolchevik (quoique l’aile gauche du PS ait été d’un mutisme assez assourdissant sur ce thème).
Savoir si les camps nazis étaient de " rééducation ", de " surveillance " ou de " concentration " (il faudra attendre 1942 pour que l’on commence à envisager l’abomination de camps d’extermination) occupera longtemps la presse suisse ; la majorité de ses titres opta finalement pour la première hypothèse, malgré les témoignages de plus en plus nombreux, précis et crédibles dont elle pouvait disposer. Cette prudence ne fut cependant pas suffisante aux yeux des Allemands. et les contraintes de la Realpolitik s’imposèrent à la liberté de la presse, en Suisse même. Les temps, déclare Motta le 22 mars 1933 déjà, sont " critiques " ; sous-tendu : pas d’imprudence ! Des imprudences, la presse suisse en commettra pourtant tout de même régulièrement, et notamment (au nom des principes de la démocratie) la presse de gauche. Der Kämpfer promet de répondre aux " fauves d’Hitler " ; la Basler AZ évoque les " Huns bruns " qui " déferlent sur l’Allemagne ", le Basler Vorwärts dénonce les " bourreaux ", les " sbires de Hitler ", les " assassins d’ouvriers "… En Allemagne (et en Autriche) où ne subsistent plus aucune voix d’opposition ni aucune presse libre d’aucune sorte, le discours antinazi tenu en Suisse, et qui en sort, en allemand, est pour le moins indésirable par le pouvoir en place, la communauté de langue étant évidemment un facteur aggravant. La Suisse sera, dès l’annexion de l’Autriche, le seul Etat de langue allemande disposant d’une presse puissante et indépendante, et d’une radio non nazie ; l’Allemagne est excédée par la relative liberté de ton de la presse et de la radio suisses de langue allemande, comme l’Italie par celle de la presse et de la radio suisses de langue italienne, comme plus tard la France de Vichy par la presse et la radio romandes. En sus que de la bloquer aux frontières, le pouvoir nazi décidera de " faire faire " (par les autorités suisses) pression sur la presse helvétique, et tentera constamment de la faire museler par Berne. Le 8 septembre 1933, 17 titre communistes ou socialistes sont interdits par le Conseil fédéral sous prétexte qu’y ont été publiés des articles " injurieux " sur le régime allemand ; la presse " bourgeoise " s’abstiendra prudemment de prendre en cette occasion la défense de ses confrères interdits -ce qui ne le préservera pourtant pas des tentatives de censure : son influence était plus grande, et donc plus dangereuse, sur la " classe politique helvétique ", ce qui excluait que l’on s’en prît ouvertement à elle, mais exigeait que l’on fît tout pour calmer ses (inégales) ardeurs antinazies.
En novembre 1933, sous prétexte de prendre des mesures contre la presse nazie en Suisse, le Conseil fédéral décide de réprimer plus encore… la presse antinazie de gauche. Il se posait au gouvernement un problème de méthode : le recours au code pénal était un " remède " pire que le " mal " qu’il était supposé combattre, car il débouchait sur un procès public qui se serait fatalement transformé en tribune politique et en procès du nazisme lui-même. Motta envisagea donc d’adopter des mesures administratives confiant au Conseil fédéral des pouvoirs accrus de contrôle de la presse, de manière à mettre fin à ce qu’il définissait comme une " campagne d’injures quotidiennes poursuivies contre des gouvernements avec lesquels il est pourtant indispensable que nous maintenions des relations correctes ". Un arrêté fédéral (du 26 mars 1934) donnera au Conseil fédéral les moyens nécessaires à sa politique d’intimidation de la presse de gauche. Premier paragraphe, essentiel, de cet arrêté :
Documents diplomatiques suisses, vol X, Benteli, Berne, 1983
Générales et abstraites, ces dispositions ne s’appliquèrent guère concrètement qu’aux journaux et périodiques menaçant de troubler les relations avec l’Allemagne ou l’Italie : on pouvait sans risque " menacer de troubler " les relations de la Suisse avec la France, et même traîner le gouvernement de celle-ci dans la boue (ce que la presse d’extrême-droite ne se priva pas de faire pendant le Front Populaire), et on ne pouvait pas plus troubler que le gouvernement central ne le faisait lui même les relations de la Suisse avec l’URSS. Ce constat vaut pour la disposition de l’arrêté fédéral invitant les cantons
Ibid.
Les " avertissements " ne seront pas rares, mais il n’y aura que deux cas, avant guerre, d’interdiction au sens de l’arrêté fédéral du 26 mars 1934 : celle du Journal des Nations en 1928, et celle du Schweizer am Sonntag en 1939, tous deux pour trois mois.
L’ " Affaire Jacob " en 1935, allait mettre à l’épreuve à la fois les relations entre Berne et Berlin et les rapports entre le gouvernement et la presse suisses. Le 9 mars 1935, Berthold Jacob, juif allemand réfugié en France, est enlevé à Bâle par la Gestapo et entraîné en Allemagne. Triple scandale : violation de la souveraineté suisse par la police politique nazie, violation des droits de la personne (l’enlèvement), atteinte aux relations franco-suisses (puisque la victime de l’enlèvement est protégée par la législation française, en tant que réfugié politique). L’émotion est considérable en Suisse et en France, et la presse -y compris la presse " bourgeoise " condamne au moins la méthode. A une " note verbale " helvétique, Berlin répond, contre toute évidence, que Jacob s’est rendu volontairement en Allemagne (d’où il s’était enfui et où il savait risquer la mort, puisqu’il animait à Strasbourg des cercles antinazis allemands) pour s’y livrer à des activités subversives, qu’il y avait été arrêté " normalement " et incarcéré en toute légalité, et qu’en somme l’Allemagne n’avait rigoureusement rien à se reprocher. Le 1er avril, le Conseil fédéral rejette cette version (il ne pouvait guère faire moins) et réclame réparation, soutenu en cette démarche par les Chambres fédérales, la majorité de la presse et de l’opinion publique " informée ". En France, la grande presse (et plus clairement la presse de gauche) prend parti pour la Suisse. Le gouvernement allemand réitérant cyniquement sa version des faits, à laquelle nul ne croyait, le Conseil fédéral demanda le 27 avril que le différend soit soumis à un tribunal arbitral, conformément au traité d’arbitrage et de conciliation de 1921 (amendé en 1928). Le 10 mai, Goering accuse, à Fribourg en Brisgau, le gouvernement suisse d’être manipulé par la presse, la gauche et les immigrants juifs. Le dispositif d’arbitrage mis en place, la Suisse dépose le 27 juillet un mémorandum accablant pour l’Allemagne, corroboré par les aveux de l’un des auteurs de l’enlèvement arrêté par la police bâloise. Deux mois plus tard, la réponse allemande au mémorandum suisse admet finalement la thèse de l’enlèvement, et affirme que " des sanctions ont été prises "… mais ne donne aucune nouvelle de Jacob. Le Conseil fédéral, à la colère de la presse et des partis de gauche, se résigne, par crainte de pousser les nazis à des représailles plus graves que les injures de Goering. La presse suisse (à l’exception des feuilles d’extrême-droite) dénonce cet arrangement " sur le dos des principes " : les " avertissements " prévus par l’arrêté fédéral du 256 mars 1934 tombent, tandis que les autorités allemandes, satisfaites de la décision suisse, restituent secrètement Jacob à la Suisse (mais en exigeant son expulsion immédiate vers la France). Si le Conseil fédéral accepte cet " arrangement ", l’ " affaire " ainsi close n’en aura pas moins mis en lumière son irrésolution face à la puissance allemande et sa propension (faute peut-être d’une pression suffisante de l’opinion publique et du monde politique) à céder aux nazis plus qu’il ne serait nécessaire. C’est dans le droit fil des débats provoqués par l’ " Affaire Jacob " que, le 29 avril 1935, les pouvoirs du Ministère public fédéral sont renforcée, qu’est créée une police fédérale et que la " lutte contre la subversion " (officiellement : toute subversion) est dotée de moyens supplémentaires. Ces moyens seront utilisés non seulement contre la " subversion " d’origine étrangère, mais aussi -les dangers se précisant- contre tous ceux qui, à l’intérieur et de l’intérieur, remettent en cause les fondements de l’ordre social et politique. La gauche socialiste et communiste en fera essentiellement les frais, bien plus en tous cas que l’extrême-droite fasciste e/o nazie.
Les interdictions dont avaient été frappées quelques organisations nazies en Suisse n’avaient qu’en surface démantelé les réseaux helvétiques du nazisme, fondés désormais sur les représentations diplomatiques et consulaires du Reich et les associations (notamment culturelles et sportives) allemandes en Suisse. La " subversion " nazie était d’autant moins désarmée que ses tuteurs allemands n’avaient aucune intention de la désarmer ; le Conseil fédéral tenta donc d’user des bonnes relations qu’il entretenait avec Berlin pour amadouer son puissant voisin. La Suisse fut fort inquiétée par un discours de Hitler, prononcé le 30 janvier 1937 devant le Reichstag et lors duquel le Führer avait cité la Belgique et la Hollande, mais pas la Suisse (ni la Suède), comme exemples d’Etats avec lesquels l’Allemagne entretenait des relations suffisamment amicales pour qu’elle soit prête à reconnaître l’inviolabilité de leur neutralité. On sait ce qu’il advint en 1940 de cette distinction entre les neutres : la Belgique et la Hollande, précisément, furent agressées, envahies et occupées, mais pas la Suisse (ni la Suède)… Les deux premières eurent sans doute l’échine moins souple devant l’Allemagne que la Suisse, et leur neutralité n’était pas si absolue qu’elle leur fît renoncer à leurs alliances occidentales. Le 23 février 1937, mettant à profit une visite privée en Allemagne, l’ancien Conseiller fédéral Schulthess fut reçu pendant une heure par Hitler, qui approuva, comme on pouvait s’en douter, les " réticences de Motta envers l’URSS " (Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, op.cit. biblio, p. 346) et protesta donc de son profond respect de le neutralité helvétique, dont il releva qu’elle était dans l’intérêt de l’Allemagne. Rendues publiques par Schulthess (avec l’accord de Hitler), ces déclarations rassurèrent le Conseil fédéral mais inquiétèrent la gauche, en raison même de la démarche de Schulthess (et, derrière lui, du gouvernement suisse) : qu’avait-on besoin de solliciter du chef nazi des paroles rassurantes auxquelles nulle crédibilité ne pouvait être accordée ? L’entrevue ne fut d’ailleurs suivie d’aucun effet concret, si elle convainquit Schulthess (mais non Motta, semble-t-il) de la sincérité de Hitler et de la " supériorité " de l’Allemagne sur les démocraties. Les principaux journaux suisses, et toute la presse alémanique de gauche, restèrent proscrits en Allemagne, alors que la presse nazie (notamment le Volksicher Beobachter) était largement diffusée en Suisse.
Cela étant, Hitler ne cherchait pas seulement à rassurer la droite démocratique suisse, mais également à " distendre les rapports entre (la Suisse) et la SdN " (Ruffieux, op.cit. p. 347). Quinze jours après l’entrevue Hitler/Schulthess, Motta expose au Conseil national ses états d’âme à l’égard de la Société des Nations et de sa politique " sanctionniste " : il réprouva explicitement le mécanisme des sanctions et, le 1er août 1937, affirma la primauté de la neutralité suisse sur les engagements du pacte de la SdN, signé par la Suisse. Lorsque l’Italie rompt avec la SdN, le 11 décembre 1937, et que l’Allemagne, à sa suite, proclame son refus de " revenir à Genève ", la Suisse emboîta prudemment le pas et, le 31 janvier 1938, demande à être " libérée " de l’obligation de respecter les décisions de boycott et de sanctions prises par la Société des Nations. Le 20 février 1938, Hitler approuva publiquement la position helvétique ; il pouvait en effet s’en réjouir : " le front de Genève se disloquait " (Ruffieux), et c’est bien ce qu’il souhaitait.
Le crise de 1930, et ses conséquences tout au long de la décennie suivante, avait accumulé les dangers aux frontières et à l’intérieur même du pays, et défait les certitudes qui fondaient, avec l’ordre social, économique et politique " libéral " et " démocratique ", l’espoir que cet ordre pouvait garantir l’amélioration graduelle et continue des conditions de vie, le progrès social et l’affermissement de la démocratie. Communistes et socialistes de gauche, et avec eux une partie du " centre " socialiste et syndical, constatent une aggravation de la lutte des classes, manifestée par le montée (relative) de l’extrême-droite et confirmée par les événements genevois du 9 novembre 1932. Paradoxalement, ce moment de radicalisation des conflits intérieurs est aussi celui, décisif, de l’intégration du plus grand parti de la gauche (devenu l’un des deux plus grands partis du pays) dans la " normalité " politique helvétique. Ces temps d’ " aggravation de la lutte des classes " sont aussi ceux de la fondation d’un consensus politique duquel ne seront exclus que les " extrémistes " des deux bords. Le paradoxe, ici, recouvre la causalité : l’aggravation des conflits et la " montée des périls " convainquent les " modérés " de gauche et de droite de la nécessité d’une concertation défensive. En même temps, toutefois, les volontés alternatives (dans un sens ou un autre) ne se résignent pas : c’est toute l’histoire du gouvernement Nicole, à Genève, que d’avoir tenté d’inscrire un projet de transformation radicale de la société dans une pratique locale de pouvoir, et c’est toute l’histoire de son échec que de ne pas avoir eu les moyens de cette ambition. Mais la recherche d’autres règles du jeu social, c’est aussi la tentative du corporatisme, avec ses complaisances à l’égard du fascisme, de tenter la réalisation d’un projet à la fois anticapitaliste et antisocialiste et de ressusciter les solidarités et les franchises anciennes, " féodales ", pré-démocratiques. Dans chacune de ces recherches oppositionnelles, la force des modèles étrangers est évidente : la référence italienne et allemande d’un côté, celle de l’Union Soviétique de l’autre, celle aussi du Front Populaire français et de la République espagnole… brandies les unes contre les autres, ces références sont constamment présentes dans le débat politique intérieur, et l’irriguent. C’est aussi contre cette sensibilité au monde que la classe politique dominante, et les forces sociales dont elle est représentative (la bourgeoisie, grande, moyenne ou petite, les paysans propriétaires, une partie des travailleurs du tertiaire) se dresse et, politiquement, s’arme. Très " suisse " est cette crainte de l’influence étrangère, cette peur que le fragile édifice helvétique n’éclate sous les coups conjugués et contradictoires des " idéologies étrangères ", le communisme et le socialisme révolutionnaire d’une part, le fascisme et le nazisme d’autre part (qui ne sont après tout que des caricatures des précédents). Pour conjurer cette peur (nourrie du souvenir du " fossé " de 1914-1918), la " solution suisse " va faire son chemin : marginalisation des extrêmes, élaboration d’un vaste consensus central, invention d’une " suissitude " politique. Georges-André Chevallaz :
Georges-André Chevallaz, Avoir été jeune en 1939, in 45 ans plus tard op.cit.biblio p. 7
Marginaliser à la fois la " droite musclée " et la " conjuration marxiste " : tel est le projet commun de la gauche réformiste et de la droite démocratique dans la Suisse de la fin des années trente, et dans les souvenirs vaudois (d’autant plus suisses, sans doute, qu’ils sont vaudois…) de George-André Chevallaz rendent assez bien compte (les œillères, en effet, n’empêchent pas de voir, si elles limitent le champ de vision). Il s’en faut toutefois de beaucoup que l’extrême-gauche fût aussi menaçante que l’extrême-droite : quoique marginaux et finalement assez peu " sérieux ", les " Front " s’étaient trouvée renforcés par l’arrivée des nazis au pouvoir. Ce n’était pas par des régimes communistes que la Suisse pouvait craindre d’être encerclée (et qu’elle le sera réellement dès juin 1940), mais par le fascisme italien et le nazisme allemand. La lutte politique antifasciste menée par la gauche se trouva investie d’une urgence et d’une radicalité supplémentaires, et en même temps qu’elle, la solidarité internationale. L’expérience socialiste genevoise en donne témoignage : la polémique entre Nicole et ses adversaires emprunte constamment au vocabulaire et aux symboles français, allemands, italiens, espagnols et soviétiques, et se déroule fréquemment sur le terrain (choisi par les socialistes eux-mêmes) de la solidarité internationale et de l’antifascisme. Mais le fascisme menace aussi par la séduction qu’il exerce sur des secteurs importants de l’opinion publique traditionaliste, notamment auprès des catholiques -mais aussi de certains protestants.
Que les catholiques les plus traditionalistes fussent quelque peu séduits par le fascisme n’a au fond rien de surprenant : le rejet du libéralisme, de la démocratie, du pluralisme et de la liberté de conscience, la réaction catholique l’avait exprimé et pratiqué bien avant la naissance du fascisme ; de même, le combat antisocialiste, l’" antimaçonnisme " et un certain antisémitisme faisant des " juifs " les " assassins du Christ ". Le fascisme avait certes pu inquiéter ces catholiques-là dans ses premières années (Mussolini était après tout d’un assez solide anticléricalisme), mais on installation au pouvoir l’avait rapproché du seul pouvoir qui, avec lui, comptait en Italie -celui de l’Eglise. Que le fascisme ait eu une audience favorable dans des milieux protestants, historiquement et philosophiquement plus attachés au pluralisme et à la démocratie, a par contre quelque chose d’assez paradoxal : ce que les fascistes combattaient était certes d’abord l’héritage de la Révolution (française) et des Lumières, mais aussi, indirectement, l’héritage de la Réforme. Le protestantisme, donc, eut sa " droite de la droite " : dans le canton de Vaud, par exemple, où l’Eglise protestante faisait corps avec l’Etat radical, la maurrassienne Ligue Vaudoise avait " acquis un droit de cité " naturel " au sein de l'Eglise nationale " officielle (Claude Cantini, L’Eglise nationale vaudoise et le fascisme, op.cit.biblio p. 10), et l’on sait la brièveté du chemin menant pour beaucoup de ses disciples de Maurras au fascisme. Des pasteurs furent ainsi membres de la Ligue Vaudoise, ou de l’un ou l’autre des mouvements protestants fortement marqués à droite (par anticommunisme, notamment), comme " Eglise et Liturgie " ou la " Ligue pour le Christianisme ", dont furent membres les Conseillers d’Etat Dubuis, Fazan et Bujard, tous mouvements que soutenait, directement ou non, officiellement ou non, l’Eglise nationale vaudoise. Le Semeur Vaudois, organe de presse de l’Eglise, prendra position en faveur de Pétain en 1940 et appellera (sans être entendu) les Protestants français à se rallier à lui (ce ralliement se révélera en fait bien moins massif que celui des catholiques, tradition républicaine -souvent radicale ou socialiste, souvenir des persécutions et situation minoritaire obligent) Claude Cantini relève (op.cit. pp 26-33) une polémique assez révélatrice, en 1938, à propos de la " question juive ", entre protestants vaudois et à propos de la " question juive " (telle que posée par les antisémites), polémique où s’exprimèrent des opinions franchement antisémites (" Les juifs achètent la presse ", " le judaïsme est antichrétien ", il y a " infiltration juive ", la dénonciation de l’antisémitisme relève du " sentimentalisme " et de l’ " humanitarisme ", toutes opinions qui peuvent paraître surprenantes sous la plumes d’hommes dont on est en droit de supposer que, calvinistes, et parfois pasteurs, ils ont été nourris de l’histoire antique d’Israël et de la Bible (de la Bible juive, pour user d’un pléonasme). Cantini remarque que cette polémique a permis de " mettre en évidence les vagues racistes qui agitent une partie (..) du corps pastoral vaudois ". C’est dire que les thèmes fascistes, voire nazis, trouvent oreilles complaisantes en maints milieux, et que les " contre-feux " que la gauche ne va cesser d’allumer auront beaucoup de difficultés à prendre dans certaines couches, ou castes, sociales.
Contre les régimes fascistes à l’étranger, contre leurs antennes en Suisse, contre les groupes fascistes suisses et les tendances fascisantes dans les partis " bourgeois " (le corporatisme étant, un peu rapidement, considéré par la gauche comme une " variante du fascisme "), le mouvement ouvrier va s’affirmer comme le pôle d’une résistance qui, progressivement, intégrera à l’antifascisme proprement dit le patriotisme suisse, c’est-à-dire la défense de l’indépendance nationale. La Guerre Mondiale aidait, on passera ainsi de la résistance au fascisme à la Résistance tout court (toute proportion devant évidemment être gardée dans cette comparaison de la situation suisse avec celles des pays occupés). Ce faisant, la gauche démocratique réussira à s’affirmer à la fois comme l’un des " piliers " de la démocratie suisse et comme une actrice du changement social. Cette synthèse du " participationnisme " réformiste, de l’antifascisme militant et de la volonté de changement social, réussit à concilier deux stratégies, la révolutionnaire et la réformiste, dont la contradiction fut pendant un demi-siècle un facteur de division du mouvement socialiste. La crise mondiale rendait possible cette synthèse, la guerre mondiale la rendra nécessaire. Le mouvement socialiste en fera l’axe d’une stratégie nouvelle, qu’il peinera à définir mais dont il finira par accoucher : justifié par l’antifascisme et la nécessité de défendre l’acquis démocratique, si " bourgeois " qu’il fût, le " participationnisme " l’emportera. Il lui en coûtera l’essentiel de sa force, et même de sa volonté, de changement (quoique l’Etat social, ou son ébauche, naîtra de cette synthèse). On ne combattra plus désormais pour un changement de société, mais pour un changement des formes de la société existante.
Il n’empêche : impressionnantes furent souvent les manifestations par lesquelles le mouvement ouvrier suisse protesta contre le fascisme (le fascisme en Suisse et ailleurs), et impressionnante aussi la détermination des gouvernants de droite de contenir -par la force, si besoin leur semblait- cette mobilisation de la gauche. Novembre 1932 en est un exemple : le conflit est mûr au point d’être violent, et sanglant lorsqu’il semble à quelque acteur qu’il faille courir le risque qu’il le soit. Dans toute la Suisse, la fusillade de Genève provoque des manifestations et des grèves (des débrayages, pour être plus précis) dirigés à la fois contre les fascistes suisses, le gouvernement genevois, le gouvernement fédéral, l’armée et " le fascisme " en général (ce qui comprend, dans le vocabulaire du temps, le nazisme). En face, à droite, ce même événement pousse à renforcer l’arsenal juridique répressif : c’est la Lex Häberlin II (qui succombe comme la première à un référendum lancé par le PSS et le PCS, mais sans l’USS, dont la base est nettement plus flottante lorsqu’il s’agit d’ordre public ou d’immigration). A Zurich, Genève, Lausanne, des exécutifs " rouges " ont été ou seront élus, qui devront, soit au niveau municipal (Zurich, Lausanne, Bienne) soit au niveau cantonal (Genève) se battre sur tous les fronts à la fois : contre le chômage, contre la crise, contre le fascisme.
C’est encore et toujours sur fonds de division que le mouvement ouvrier suisse -comme ses homologues européens- doit " gérer " ces multiples enjeux. Division syndicale entre l’USS, son " opposition révolutionnaire " et le mouvement syndical catholique ; division politique entre le PSS et le PCS, et au sein du PSS entre sa gauche, son centre et sa droite. Le mouvement anarchiste, doucement, semble s’éteindre : le destin d’un Lucien Tronchet est un peu à l’image du mouvement d’où il est issu. Cet anarchiste prend en main la FOBB à Genève; il en fait un instrument de lutte redoutable sur le terrain, pratiquant l’action directe grâce à sa " Ligue des gars du bâtiment ", puis met cette puissance et cette combativité au service de la négociation. La FOBB devient ainsi l’un des piliers du " partenariat social " à la genevoise, et son chef adhère finalement au Parti Socialiste Genevois, quelques années après que celui-ci ait éclaté et ait été réduit par cet éclatement à son aile " droite ".
Au sein de l’USS et son sein du PSS, le conflit entre " modérée et radicaux " ira s’amplifiant, jusqu’à la rupture. Comme on l’a vu, le problème de l’unité avec les communistes concourra puissamment à ce conflit, mais lors des élections fédérales de 1931, le PSS avait obtenu près de 15 fois plus de suffrages (28,7 %) que le PC (environ 2 %). Sur le terrain, toutefois, cette énorme différence d’influence sur le " public " se nuance de l’activisme forcené des militants communistes, comparé à une certaine somnolence de la " base muette " du PS (le cas genevois étant une exception, Nicole ayant réussi à engager la totalité du parti, ses adversaires " sociaux-démocrates " compris, dans un combat d’une particulière âpreté contre la droite et l’extrême-droite). Le refus de la radicalisation exprimé par les majorités respectives de l’USS et du PSS mettra, doublement, les volontés unitaires à l’épreuve. Ajouté à la polémique sur le rôle de l’URSS, ce refus poussera à l’éclatement du Parti socialiste et, du côté syndical, à la disparition de l’ " Opposition syndicale révolutionnaire " (entrée d’ailleurs assez tôt en léthargie) et à une certaine atténuation du conflit entre syndicalisme " social-démocrate " et syndicalisme " catholique ".
L’Union Syndicale avait renoncé dès 1927 à la référence à la lutte des classes. Sa volonté de paraître " politiquement neutre " va progressivement l’éloigner du combat politiquement proprement dit, et ancrera profondément la " division du travail " entre elle et le PSS sur un modèle " nordique " (ou " germanique "), partiellement importé en Suisse -mais sans le syndicat unique qui en est l’élément fondamental. Le PSS, quant à lui, avant que de prendre définitivement et officiellement (et programmatiquement) le virage du réformisme, se consacre de plus en plus au travail parlementaire et quand il le peut à sa présence dans les exécutifs, ponctuant l’un et l’autre de référendums et d’initiatives.
A vrai dire, le choix syndical de la concertation est bien plus ancien que la " Paix du Travail " qui le consacre et le symbolise. On assiste en Suisse à une lente -mais logique- évolution du mode de réglementation des rapports entre employeurs et employés (entre patrons et travailleurs), évolution qui mène des premiers contrats collectifs (apparaissant vers le milieu du XIXème siècle) à la généralisation des conventions collectives de travail, dont les première à avoir portée nationale sont conclues au début du siècle. A la fin de la Grande Guerre, les contrats collectifs restent une " spécialité " des petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat ; comme le relève Geneviève Billeter, la grande industrie oppose une " résistance farouche " (Geneviève Billeter, Le pouvoir patronal, Droz, Genève, 1985) à la conclusion d’accords collectifs et généraux avec les syndicats.
Pourquoi cette résistance ? Certes, la conclusion de contrats collectifs peut avoir pour conséquence une hausse des coûts de production (due à une hausse des salaires) ; mais jusque dans les années vingt et trente, les réticences patronales à la conclusion de contrats collectifs et de conventions collectives ont surtout des motifs d’ordre politique : le grand patronat refusera longtemps de reconnaître aux syndicats un statut de " partenaires " (et donc une légitimité), et doutera longtemps (à tort) qu’une telle reconnaissance pût amener les organisations de travailleurs à la " modération " de ces revendications et de ses pratiques. La situation politique et sociale née de la grande crise de 1929 rendra nécessaire un dépassement de ces réticences (et, au sein du mouvement syndical, des résistances au Sozialpartnerschaft).
A deux reprises, en 1929 et en 1937, la FOMH avait proposé à son " partenaire " patronal, l’ASM, la conclusion d’un accord général, valable pour l’ensemble du secteur de la métallurgie et dans tout le pays. En 1929, l’organisation ouvrière propose un vaste contrat collectif ; en 1937, elle fera une autre proposition : celle d’un accord portant sur les modes de résolution des conflits et divergences à venir, quitte à " faire l’impasse " (dans l’accord proposé) sur les contenus concrets de ces conflits et de ces divergences. Entre les deux propositions est survenu le grand ébranlement de la crise : cet événement à lui seul eût expliqué, sinon justifié, ce changement d’attitude, mais ses conséquences politiques ajouteront à l’urgence d’un tel changement (du point de vue syndical). Si la proposition de 1929 de la FOMH sera refusée par le patronat de la métallurgie (l’ASM), celle de 1937 sera à l’origine de la signature de la Paix du Travail. Quelles différences, alors, entre ces deux textes ? Le vaste contrat collectif proposé en 1929 contient déjà une disposition de " paix du travail ", c’est-à-dire un engagement réciproque de renonciation aux " moyens de combat " (grève, lock-out) ; mais cette disposition est encore d’ordre instrumental : ce qui compte en 1929, c’est le contenu social de l’accord (salaires, horaires de travail etc…). En 1937, le mode de résolution des conflits sera devenu central (la " Paix du Travail " est un " accord sur l’accord "). La FOMH aura entre-temps abandonné l’idée " planiste " de fixer par un grand contrat national les conditions sociales du travail et de l’emploi, dont elle admettra désormais qu’elles fassent l’objet de négociations particulières, par branches, par métiers, par régions -voire par entreprises. C’est la reconnaissance par le syndicat du rôle des commissions ouvrières, à l’égard desquelles il nourrissait une assez solide méfiance (elles avaient été, il est vrai, instituées par le patronat " libéral " pour contourner les syndicats).
La reconnaissance par le mouvement syndical de l’utilité et de la légitimité des commissions ouvrières, puis la proposition de " Paix du Travail ", rappellent évidemment cette autre reconnaissance, politique, et plus ancienne : celle de l’utilité et de la légitimité des institutions de la démocratie bourgeoise par le mouvement socialiste, reconnaissance suivie de la volonté d’y participer, puis de cette participation elle-même. Quoi qu’il en soit des réticences de l’aile gauche du mouvement syndical à l’égard de ce qu’elle dénonce comme un " auto-désarmement " des travailleurs face au patronat, de 1929 à 1937 -d’une proposition de la FOMH à une autre-, c’est d’un véritable changement de stratégie dont il est question :
Geneviève Billeter, Le pouvoir patronal, Droz, Genève, 1985
Ainsi, le contexte international pèse sur les choix syndicaux et patronaux suisses ; il pèse aussi, on s’en doute, sur les décisions gouvernementales ; or l’une de ces décisions, au lendemain de la dévaluation du Franc suisse, le 26 septembre 1936, va convaincre le dernier carré des hésitants au sein du patronat : le Conseil fédéral déclare qu’il autorise par arrêté le Département de l’Economie Publique à arbitrer d’office et sans appel les conflits collectifs de salaire qui n’auraient pas été résolue par les " partenaires sociaux ". Ceux-ci n’avaient dès lors plus guère de choix : faute d’accord entre eux, l’Etat central interviendrait, s’arrogeant ainsi des compétences que le patronat (et une part importante des milieux syndicaux, autant d’ailleurs à la droite du mouvement que sur sa gauche) lui avaient toujours refusées. Il fallait en somme " affirmer en public que les deux organisations (l’ASM et la FOMH) sont capables de s’entendre, de régler leurs différends entre elles, sans immixtion étatique " (Geneviève Billeter, op.cit.). Le syndicat, dans cette partie, ne se présente plus en adversaire du patronat, mais en partenaire (et allié, dans la démarche qui consiste à affirmer face à l’Etat la capacité des " partenaires sociaux " de régler leurs problèmes entre eux, et sans lui). En 1929, la FOMH avait envisagé d’appeler à la grève pour contraindre l’ASM à accepter d’entrer en matière sur le projet de contrat collectif que le syndicat lui proposait ; rien de tel en 1937. Et lorsque les travailleurs de l’entreprise Sulzer menacent de se mettre en grève, à Winterthur, Conrad Ilg, dirigeant de la FOMH, se rend sur les lieux pour les en dissuader (il avait déjà fait de même à Genève en 1932). Ceux qui s’opposeront à l’accord de 1937 ne se recruteront d’ailleurs guère au sein du patronat, mais bien plutôt au sein du mouvement ouvrier, c’est-à-dire de son aile gauche, prompte à dénoncer une " trahison " dont le moins que l’on puisse écrire est qu’elle était dans l’air du temps : ce qui est " trahi " par la " Paix du Travail " est une conception de la lutte syndicale (et politique) que les directions syndicales avaient abandonnée depuis une bonne dizaine d’années, et à laquelle la FOMH n’avait d’ailleurs jamais réellement adhéré.
La proposition de la FOMH ne suscita donc guère l’enthousiasme de l’ASM, mais celle-ci ne pouvait plus, en 1937, refuser d’entrer en pourparlers avec les syndicats, sauf à courir le risque de voir l’Etat fédéral se mêler directement de réglementer les rapports sociaux entre organisations ouvrière et patronales, ce que ces dernières craignaient plus que les conséquences d’un accord autonome avec les syndicats. Pour autant, les méfiances anciennes n’avaient pas disparu, et nombre de patrons restaient persuadés que l’organisation ouvrière n’avait qu’un seul et unique but : les affaiblir. Ceux-là craignaient qu’en acceptant d’entrer en matière sur les propositions syndicales, l’ASM accordait à son partenaire-adversaire (la FOMH) une importance et surtout une légitimité nouvelles. La proposition de la FOMH sembla pourtant raisonnable au plus grand nombre de ceux à qui elle était soumise. Raisonnable, elle l’était, en effet : le principal syndicat de la métallurgie, et l’un des deux principaux syndicats ouvriers du pays, était prêt à renoncer à la grève (à la condition que la principale organisation patronale du secteur renonce, elle, au lock-out) ; il affirmait également son souci de " contenir " les interventions étatiques dans les domaines gérables par la négociation contractuelle ; il reconnaissait enfin, au moins implicitement, la valeur et la solidité des principes de l’économie " libérale ", quoiqu’il manifestât la volonté de les " socialiser " quelque peu… Le président du Vorort, Hans Sulzer, tire la leçon politique de ce grand moment -et l’adresse à ceux qui, dans son " camp ", hésitent encore : " Nous devons prouver au monde que notre démocratie est assez mûre pour conserver dans notre pays une économie reposant sur un accord local entre les intérêts particuliers " (cité par Geneviève Billeter, op.cit).
Le 9 juillet 1937, l’Assemblée générale de l’ASM donna, par 128 voix contre 3 et 6 abstentions, son accord à ce qui sera désormais célébré comme la " convention de Paix du Travail ". Majorité écrasante, qui semble donner raison à ceux qui, à l’extrême-gauche, dénoncent un " contrat honteux ", liquidant le droit de grève : une proposition syndicale si massivement acceptée par le patronat peut-elle être autre chose qu’une capitulation ?
Le 19 juillet 1937, l’accord est signé. Au bas du texte figurera non seulement, pour les travailleurs, la signature de la FOMH mais aussi celle des " minoritaires ", dont les syndicats chrétiens (catholiques). La " Paix du Travail " est née : plus qu’une méthode -encore qu’elle le soit-, elle sera à la fois un principe et un symbole, et à ce double titre célébrée dans les décennies suivantes comme une manifestation de l’unité retrouvée des Suisses face aux périls extérieurs, alors qu’il s’agissait, historiquement, plus d’une " unité " inventée que d’une unité " retrouvée ". Le Conseiller fédéral Hermann Obrecht, Chef du Département de l’Economie publique, ne manquera pas à l’obligation de féliciter les signataires de la convention ; quant à Motta, Président de la Confédération en exercice, il en fera le thème de son discours du 1er août 1937. Enfin, lors de l’Exposition Nationale de 1939, grand moment s’il en fut de célébration de l’unité patriotique, le texte de la convention est exposé à la reconnaissance des foules, dans la section " Patrie et Peuple " de l’exposition…
La FOMH elle aussi fera de la signature de la Convention de Paix du Travail un symbole : celui de l’efficacité de la nouvelle ligne syndicale (nouvelle en ce sens qu’elle est nouvellement proclamée). Le critère de l’efficacité devient ainsi le critère décisif de l’action syndicale, bien avant la fidélité aux principes -et à quels principes, d’ailleurs, la FOMH était-elle supposée être fidèle ? A ceux proclamés par les " pères fondateurs " du syndicalisme helvétique ? Ils paraissaient obsolètes ; à ceux du syndicalisme révolutionnaire des années vingt ? Ils n’ont jamais été ceux de la FOMH ; à ceux du syndicalisme réformiste, social-démocrate et " gradualiste " ? La "Paix du Travail en est précisément le fruit…
L’organisation syndicale, ainsi, devient (ou redevient, après l’avoir été en ses premières années) sa propre fin : il est vrai qu’elle pouvait se sentir menacée par l’évolution dramatique des crises des années trente, et, en ce qui concerne la FOMH, par les multiples concurrences suscitées sur sa droite -syndicats catholiques- et sur sa gauche -tendances oppositionnelles communistes. Sitôt la convention signée, et cette signature délibérée comme il convient, la FOMH engage ses sections à entamer une campagne de recrutement, persuadée que les circonstances lui sont favorables, que la convention est un excellent argument " publicitaire " et que l’objectif fixé (5000 nouveaux membres) est parfaitement atteignable. Geneviève Billeter résume :
Geneviève Billeter, Le Pouvoir Patronal, op.cit.
Cette conception de son tôle par le syndicat, et cette attente d’une reconnaissance patronale de ce rôle, concluent une dizaine d’années d’évolution idéologique. En 1934, l’USS avait adopté un programme de travail dont toute la logique était celle de l’intervention mesurée de l’Etat sur une économie " libérale " incapable de s’autoréguler, mais qu’on ne cherche plus à bouleverser. On invente ainsi l’Etat social : il ne s’agit plus de socialiser l’économie, au niveau de l’Etat central ou des collectivités locales selon que l’on est " marxiste " ou " libertaire ", mais de favoriser les éléments d’un " socialisme du possible " (d’où il ne restera bientôt plus d’ailleurs que le " possible ", sans le socialisme), dans l’économie telle qu’elle est, et à tous les niveaux d’organisation du pouvoir social : communes, cantons, Confédération, grandes régies publiques, mouvement coopératif, économie sociale. Ce projet maintient pour l’essentiel intacte l’économie " libérale ", et ne remet plus en cause la " domination du capital ".
Application (ou tentative d’application) de cette conception nouvelle : l’ " Initiative de Crise ", toujours en 1934, proposera une politique " anticyclique " typiquement keynésienne, comme alternative au libéralisme caricatural du " Laisser faire ". Sur une telle démarche, l’Union Syndicale Suisse, auteur de l’initiative, réalise une assez large unité d’action avec les organisations d’employés et certaines couches paysannes, pour la création d’emplois, la protection des salaires et le blocage des prix, l’institution de l’assurance-chômage, des prêts agricoles, etc… Le PS (et même le PC, par opportunisme, et quoique le contenu de l’initiative fût à peu près en tout contradictoire de son propre projet et de sa stratégie de l’époque (on est encore dans la période " sectaire " d’avant la reconnaissance officielle par le Comintern de la légitimité des " fronts populaires "), soutiennent l’USS. Repoussée de justesse, après une campagne dans laquelle la droite engagea de considérables moyens, l’ " Initiative de Crise " ne réalisera en fait qu’un semblant d’unité, sans lendemain, sans assise réelle " au niveau de la base " et dans les entreprises : non pas une unité autour d’un projet, mais une unité contre les adversaires de ce projet.
La Paix du Travail de 1937 consacre donc le recentrage syndical. Dans une septantaine d’entreprises de la métallurgie, des revendications salariales étaient présentées et le recours à la grève encore envisagé que, déjà, la direction de la FOMH négociait avec l’Association des industriels de la métallurgie et de l’industrie des machines cette convention générale fixant la méthode qui désormais sera employée pour négocier avec le patronat les revendications des travailleurs, en excluant le recours aux moyens de lutte directe (grève, lock out). La contribution de cette " réconciliation sociale " à l’ " unité nationale " fut abondamment mise en valeur par ses signataires et par la presse, jusqu’à acquérir son statut de symbole. C’est là, sans doute, une preuve supplémentaire que l’heure, décidément, était bien à un " front commun " -mais pas à celui proposé par le PC, entre partie de gauche : à celui décidé par les majorités syndicales et social-démocrates, avec les forces démocratiques " bourgeoises ", face aux menaces extérieures et intérieures. Geneviève Billeter :
Geneviève Billeter, op.cit.
D’une certaine manière, la FOMH de 1937 est à l’avant-garde de la gauche helvétique : elle réalise, par la Paix du Travail, cette unité nationale et démocratique à la recherche de laquelle va désormais se vouer la majorité " modérée " du mouvement syndical et du parti politique. Quarante-cinq ans plus tard, un homme peu suspect de sympathies pour la gauche, fût-elle modérée, Pierre Favre, président des " Amis de Brasillach ", salue cette stratégie :
Pierre Favre, Du printemps de beauté à l’automne désabusé, in 45 ans plus tard, Alliance Culturelle Romande, op.cit.biblio p. 162
L’invention du Sozialpartnerschaft à la sauce helvétique se fait ainsi par référence au contexte international et à la situation de la Suisse, toutes classes confondues, dans ce contexte. Les expériences étrangères ne sont pas absentes de cette référence : avant même que la Paix du Travail soit signée, E. Giroud, Secrétaire central de la FOMH, explique aux délégués de son syndicat que la Suisse n’est décidément pas la France du Front Populaire :
Cité par Jules Graber, Les Front populaires et la Suisse, in La Brèche, 21 juin 1986
C’est bien d’une alternative au Front Populaire (inlassablement proposé par les communistes dès lors que le Comintern les y autorisa) qu’il s’agit -d’une alternative inspirée à la fois du New Deal rooseveltien et du " planisme " d’un Henri de Man (ou d’un Marcel Déat). Le " Front du Travail " proposé par l’USS et le PSS va déboucher, en octobre 1936, sur l’adhésion du Congrès de l’USS au programme des " Lignes Directrices ", qui implique clairement le refus de toute forme de " Front Populaire " et de toute alliance avec les communistes (et avec quelque tendance " antidémocratique " que ce soit, à droite ou à gauche). L’USS et le PSS se conçoivent et se présentent comme représentants uniques de la classe ouvrière, comme le mouvement ouvrier à eux seuls, quoique la première admette et recherche la présence au sein du " Front du Travail " d’organisations objectivement syndicales de paysans et d’employés : empiriquement, le mouvement syndical suisse constate qu’il n’y a pas identité entre la classe ouvrière dont il est le représentant et la " classe des travailleurs " que d’autres, à ses côtés (les organisations d’employés et de paysans), représentent également.
Parallèles, l’intégration de l’USS et du PSS à la " normalité " politique et sociale helvétique s’accentuent au fur et à mesure que se précisent les menaces " extérieures ". La pratique du PSS, ni sa stratégie, n’avaient déjà plus grand chose de révolutionnaire, hors les discours. Anticapitaliste, le PSS l’était certes resté, mais d’un anticapitalisme assumant désormais pleinement ses choix réformistes. En 1931 encore, le programme électoral socialiste pour les élections fédérales proclamait une volonté de " dépassement " du capitalisme (50 ans plus tard, la même terminologie resurgira au cœur du débat programmatique, lors du congrès de Lugano du PSS en 1982) et de création d’un Etat " prolétarien " - la dictature du prolétariat elle-même étant au cœur du programme officiel du parti depuis 1922. Mais il ne s’agissait déjà plus, le stalinisme aidant, que d’une réminiscence de la rhétorique révolutionnaire de l’immédiat après-guerre. Il y a contradiction entre le discours et la pratique, entre ce que le socialisme suisse est et ce qu’il dit être -une contradiction que la gauche socialiste propose de résoudre en mettant (en haussant ?) la pratique au niveau du discours, et que la droite et le centre social-démocrates résorberont au adaptant (en réduisant ?) le discours à la pratique (ce qui, ironiquement, témoigne d’une méthode plus sûrement marxiste que celle de la gauche marxiste…) : c’est la reconnaissance de la démocratie " bourgeoise " comme un acquis à défendre avant même que de songer à la rendre caduque par son dépassement qualitatif. La crise économique, la montée du fascisme, le discrédit jeté par le stalinisme sur la gauche révolutionnaire (globalement et caricaturalement assimilée, toutes tendances confondues, au stalinisme), tout concourt à renforcer la tendance à l’assimilation du PSS à la vie politique traditionnelle du pays. Cette assimilation, la participation de socialistes au Conseil fédéral en sera la manifestation concrète, la pierre de touche, au même titre que pour le mouvement syndical, la Paix du Travail.
La participation de socialistes au gouvernement central est débattue au sein du parti depuis les années vingt -elle est évoquée depuis bien plus longtemps, mais sans enjeu faute de possibilité réelle. Le clivage interne au PSS respecte, sur cette question, la différenciation des trois courants : une gauche, avec Léon Nicole, qui refuse le principe même de la participation minoritaire à un gouvernement de coalition dominé par les partis bourgeois ; un centre, avec Robert Grimm, qui jusqu’au milieu des années ’30 subordonnera toute participation à l’exécutif fédéral à un rapport de force politique plus favorable ; une droite, enfin, liée à la direction de l’USS, pour qui dès les années vingt l’accession du parti au Conseil fédéral est une revendication légitime en soi. En 1925, le Jurassien Georges Moeckli exprime les raisons qui animent cette dernière tendance et lui font souhaiter une présence à tous les échelons du pouvoir exécutif (Moeckli parle ici du pouvoir exécutif cantonal bernois -il y siégera dès 1938, aux côtés de Robert Grimm) :
in La Sentinelle du 4 juin 1925
La force électorale du parti ne paraissant pas pouvoir dépasser le tiers du corps électoral, l’ambition d’une majorité gouvernementale socialiste est, au plan fédéral, abandonnée (pour la participation minoritaire au gouvernement), au moment même où elle se concrétise à Genève, dans les difficultés et avec l’arrière-plan international qu’on sait, et sans majorité parlementaire, ni électorale. Le discours (" discours de Saint-Pierre, du nom de l’ancienne cathédrale) de Léon Nicole lors de la prestation de serment du Conseil d’Etat à majorité socialiste illustre la profonde différence de conception qui le sépare du PSS :
(…)
Nous vaincrons ou nous succomberons avec le peuple et pour la paix !
Vive la Genève du travail et de la paix !
En avant vers plus de lumière et de fraternité !
in Le Travail du 4 décembre 1933
Ce n’est pas tant par son style que par ses références " internationales " que le discours de Nicole manifeste une profonde différence avec les choix et les références du PSS et de l’USS. Contre les " mouvements de régression politique ", la gauche socialiste a choisi le " prise du pouvoir " (par les urnes, et au plan cantonal, faute de pouvoir la prendre au plan fédéral), quand les directions nationales du parti et du syndicat ont fait le choix de la participation (minoritaire) au pouvoir et de la concertation au plan social.
La stratégie " nicoliste " sera sans autre lendemain que celui du passage définitif de ses initiateurs dans l’opposition, sitôt fermée la " parenthèse " du gouvernement de la " Genève Rouge " : la stratégie des " majoritaires ", elle, détermine encore la réalité politique du pays plus de cinquante ans après. A plus forte raison le choix de la " concordance " a-t-il été prégnant pendant la Guerre Mondiale : la Paix du Travail a largement contribué à " assainir " le climat social pendant les " six années terribles " de 1939 à 1945, devenant l’un des éléments déterminants de la " défense nationale spirituelle ". Quant à la défense nationale militaire, le PSS y adhérera pratiquement sans réserves en 1935 et, en avril 1936, l’USS ira jusqu’à demander au Conseil fédéral de doubler ses demandes de crédits militaires, " afin que le pays dispose (…) des moyens nécessaires à sa défense économique " ; en même temps, l’Union Syndicale suggère au gouvernement central de " préparer la défense nationale sur le plan psychologique et intellectuel " (Edouard Weckerle, Les Syndicats en Suisse, USS, Berne, 1947, p. 52).
La création du " Mouvement des Lignes Directrices " pour la " reconstruction économique et la sauvegarde de la démocratie ", en 1936, une année après l’échec de l’ " Initiative de Crise ", manifeste peut-être le plus clairement l’engagement de l’Union Syndicale, à l’origine du mouvement, dans la voie de l’ " unité nationale ", et sa participation à la formation même d’une nation -nation dont nous avons déjà relevé le caractère longtemps improbable, s’agissant de la Suisse. Le Mouvement des Lignes Directrices exprime bien le projet social et économique du syndicalisme suisse : économie solidaire (pour réduire les tensions sociales et renforcer la cohésion nationale), unité d’action de toutes les organisations démocratiques (ce qui, dans l’esprit des initiateurs du mouvement, exclut aussi bien les communistes que les fascistes et les nazis). L’USS jouera par ailleurs un rôle important dans la création d’ " Armée et Foyers ", conformément à son souhait de voir se développer la " défense nationale spirituelle ", c’est-à-dire la conscience nationale et démocratique), et fera même quelques pas en direction du " corporatisme laïque " d’un Arnold Bolle.
Le Congrès de Lucerne du PSS consacre en 1935 le changement de ligne du parti -que le syndicat avait précédé sur cette voie : à la " dictature du prolétariat " se substitue, dans une terminologie traduite de l’allemand, le " large front populaire du travail " (à différencier à la fois du Front Populaire à la française et -plus encore- du Front Unique ouvrier proposé par les communistes). Le même congrès de Lucerne, revenant sur vingt années d’antimilitarisme, approuve après des débats houleux le principe de la défense nationale -qui sera définitivement ancré dans les thèses du parti deux ans plus tard, ainsi que le " plan de travail ", ébauche d’un programme politique pour le " large front populaire du travail " dont le PSS veut prendre la tête et pour lequel il tente de conjuguer anticapitalisme, anticommunisme, réformisme, attachement à la démocratie et défense de l’intégrité nationale.
Que propose le PSS au plan social et intérieur ? La nationalisation des grandes banques, des assurances et des monopoles industriels ; le coopérativisme agricole ; le volontarisme étatique dans les domaines de travaux publics, de l’urbanisme et du logement ; l’extension, enfin, de la démocratie au domaine économique par la participation des travailleurs à tous les niveaux de la structure socio-économique. Bref, le programme socialiste de 1935-1937 exprime l’essentiel de ce qui restera, jusqu’aux dernières années du XXème siècle (jusqu’aux tentations " sociales-libérales ") le Credo social-démocrate : L’Etat social, l’Etat de droit, le volontarisme économique. La " rénovation " de la Suisse mise à l’ordre du jour par le " Mouvement des Lignes directrices " et le programme socialiste de 1935 sont projetés en des termes, qui, un demi-siècle plus tard, n’étaient toujours pas frappés d’obsolescence apparente, et synthétisés en des propositions qui, à la fin du siècle, n’avaient toujours pas été concrétisées.
En 1937, le PSS approuve en congrès le programme les " Lignes Directrices ". Il sera la principale organisation politique à s’y rallier et à s’engager clairement dans la " défense spirituelle " du pays. Les thèses keynésiennes du Mouvement des Lignes Directrices (et de l’Union Syndicale, qui en était la colonne vertébrale) avaient certes facilité cette adhésion socialiste : création d’emplois, grands travaux, conception d’une politique sociale comme moyen de renforcer l’unité nationale, résorption des conflits sociaux par la réduction des inégalités.
Un tel programme, porté par une telle stratégie, rompant avec les ultimes nostalgies révolutionnaires des années vingt, fut comme on s’en doute violemment dénoncé par la gauche du PSS et par les communistes. Les oppositions internes s’en trouveront ravivées, tant au sein du PS qu’au sein de l’Union Syndicale (en 1935, une scission se produit au sein du Cartel syndical vaudois). Et quand la nouvelle ligne communiste (celle du Front Populaire) apposera une sourdine, tardive, aux attaques du PC contre le PS (puisque le premier propose une alliance au second), d’autres forces politiques, plus minoritaires et marginales encore que le PC, dénoncent l’ " alignement de la social-démocratie sur la bourgeoisie ". Les trotskistes de la Marxistische Aktion Schweiz, dans un texte du 2 mai 1938 consacré à la question de la " défense nationale ", expriment une analyse dont le moins que l’on puisse écrire est qu’elle est fondamentalement différente de cette qui conduit le PSS à se rallier au Mouvement des Lignes Directrices (et à la défense nationale militaire) :
Cité dans : Ligue Marxiste Révolutionnaire, contre la défense nationale, op.cit.blbio., pp 89-91
Pour les marxistes révolutionnaires, la bourgeoisie suisse est aussi incapable de préserver l’ " indépendance nationale " de la Suisse que de préserver les droits démocratiques des Suisses. Le choix de la gauche réformiste de se rapprocher des secteurs les moins réactionnaires -les moins tentés par le fascisme- des partis de droite et du patronat apparaît donc à cette extrême-gauche intransigeante comme une profonde erreur stratégique : les trotskistes aussi, et depuis plus longtemps que les staliniens, préconisent le " front commun ", s’ils sont sceptiques à l’égard du Front Populaire. Or le front commun, le comité de l’Union Syndicale Suisse l’a refusé en 1933 déjà, au motif qu’elle, l’USS, est déjà un front commun à elle toute seule :
In Revue Syndicale Suisse No 5, mai 1933
L’argument du refus syndical ne se limite pas à cette prétention à être déjà la réalisation du front commun : c’est aussi par référence à la démocratie menacée par la montée des fascismes que l’USS justifie son refus de toute alliance avec les communistes et les courants " antidémocratiques " au sein du mouvement ouvrier :
(Ibid.)
C’est ainsi cette affirmation du caractère fondamental de la défense de la démocratie, même dans son expression " bourgeoise ", qui exclut une alliance avec des forces qui ne font pas preuve du même attachement ; ce refus du " front unique " est antifasciste :
in Revue Syndicale Suisse No 5, mai 1933
Cette même année 1933, le Parti socialiste refuse lui aussi le front unique sous la forme où le lui proposent les communistes ; les arguments du refus social-démocrate ne sont évidemment pas contradictoires de ceux du refus syndical, si leur contenu politique est plus explicite :
Procès verbal des décisions du Congrès de Bienne (1933) du PSS
Langage " gauchiste ", encore, que celui du PSS en 1933 -mais c’est pour refuser la ligne " gauchiste " qu’est réitéré l’objectif de 1922 : instaurer le socialisme, " conduire en rangs serrés " la classe ouvrière contre " le pouvoir capitaliste ". Refusant l’alliance avec les communistes, le PSS accepte un " front unique " -mais pas celui proposé par le PCS, et pas avec lui. Quant aux moyens que le PSS entend employer pour arriver à ces fins, ils sont ceux de la légalité. Nous userons de " tous les moyens, même légaux ", promettait Léon Blum ; nous userons de " tous les moyens légaux ", précisent les socialistes suisses :
Procès-verbal des décisions du congrès de Bienne (1933) du PSS
En d’autres termes : les socialistes resteront légalistes aussi longtemps que la bourgeoisie en fera autant et qu’elle n’aura pas " choisi le fascisme ". Utilisé comme argument de refus de la politique unitaire proposée par les communistes, ce choix fait évidemment référence à leurs pratiques, à leur conception du pouvoir, aux directives tactiques stratégiques du Comintern. Au congrès du PSS, tous ne se satisferont pas de cette argumentation : Ernst Walter, secrétaire du PS zurichois, prend ainsi position pour le front unique en donnant à la fois son expérience personnelle et la situation internationale comme critères de choix stratégiques :
La situation internationale nous enseigne que nous ne devons plus nous battre en socialistes et communistes, sinon nous seront abattus un à un, exactement comme en Italie, en Pologne et maintenant en Allemagne. (…) Communistes comme socialistes, nous qui nous trouvons sur le terrain de la lutte des classes, sur le terrain du socialisme (…) asseyons-nous autour d’une table (…) et discutons de camarades à camarades (…). Il est inacceptable que la " bonzocratie " de l’USS décrète l’interdiction de négocier avec les communistes. D’ailleurs, d’où tient-elle le droit de l’interdire ? Les syndicats n’ont pas été consultés à ce sujet, ils n’ont pas pu dire s’ils étaient d’accord ou non. (…) Je ne vois pas comment nous pouvons mener un combat national, voire international, contre la Réaction sans les communistes. Nous ne pouvons pas repousser la réaction (à la) Musy si nous ne comptons que sur nos propres forces (…) Tant sur le plan national qu’international, devant cette sombre perspective, avant ces temps peut-être tragiques que nous allons vivre, je dirai, camarades, que jamais il n’a été plus nécessaire de se rallier au mot d’ordre, aujourd’hui particulièrement prophétique : " Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ".
Procès-verbal des décisions du congrès de Bienne (1933) du PSS
L’appel de Walter, nous le savons, ne fut pas entendu par la majorité du congrès et celui-ci, comme le souhaitait la direction du parti, repoussa les offres communistes. Face au fascisme, ce ne fut pas le " front unique " qui fut proposé comme stratégie, mais l’ " union de toutes les forces populaires ", cette manière d’union nationale autour des grands principes de la démocratie. Lors du congrès de Lucerne, en 1935, ce choix s’exprimera on ne peut plus clairement par le ralliement du PSS à la défense nationale (conçue moins comme la défense d’un territoire que comme celle des droits et des libertés fondamentales, mais admettant néanmoins l’armée comme un instrument légitime). Le Président du parti suisse, Ernst Reinhard, s’en explique :
Procès-verbal des délibérations du congrès de Lucerne (1935) du PSS
Comme deux ans auparavant sur le " Front unique ", la gauche socialiste se retrouvera minoritaire à Lucerne sur la défense nationale. Le Conseiller national bâlois Fritz Schneider exprimera son opposition à ce ralliement à un principe combattu depuis vingt ans par le parti, même si ce ralliement est justifié par un recours aux valeurs révolutionnaires jacobines. Dans les positions de la gauche socialiste comme dans celles de la droite et du centre, la référence internationale sert d’argumentation première, et c’est l’attitude face au fascisme qui détermine celle face à l’armée. Tous affirment leur volonté première de lutter contre la " peste brune ", mais tous -il s’en faut de beaucoup- ne proposent pas les mêmes moyens et les mêmes voies de lutte, ni même ne désignent précisément le même ennemi. Ainsi, Fritz Schneider :
Procès-verbal des délibérations du Congrès de Lucerne (1935) du PSS
Le danger fasciste -puisque de l’avis de tous danger fasciste il y a- vient-il d’abord de l’extérieur, de l’Allemagne et de l’Italie (ce qui justifierait que l’on " armât l’armée " contre lui) ou de l’intérieur, de la bourgeoisie suisse elle-même, ce qui impliquerait que la lutte soit à mener avant tout contre cette bourgeoisie suisse ? C’est encore là cette divergence qu’on a vu à l’œuvre dans les débats de 1933 sur le front unique et que, sur le même sujet revenu à l’ordre du jour du congrès de 1935, l’on va à nouveau entendre être exprimés, dans un contexte international de plus en plus menaçant. Si les majorités " modérées " du PSS et de l’USS choisissent l’alliance démocratique, la " gauche de la gauche ", elle, semblera après 1936 attendre en Suisse une évolution " à l’espagnole ", la résistance au fascisme se confondant avec la révolution :
Marxistische Aktion Schweiz, Le problème de la défense nationale (2 mai 1938), in Ligue Marxiste Révolutionnaire, Contre la défense nationale, op.cit.biblio, p. 94
1938 : L’Allemagne envahit et annexe l’Autriche ; c’est l’ultime confirmation, avant Munich, du " danger mortel qui menace la Suisse " -et les Suisses. Le PSS va signer avec la droite démocratique une déclaration dans laquelle tous prennent l’engagement de renforcer leur collaboration et leur volonté de surmonter leurs dissensions " dans un esprit de dignité et de respect mutuel " (Histoire du Mouvement ouvrier suisse, op.cit. biblio p. 242). En 1937 déjà, le Conseiller fédéral Minger, artisan du " réarmement " de la Suisse, pouvait exprimer sa satisfaction à la suite du ralliement du PSS au principe de la défense nationale et affirmer que ce ralliement permettait de " passer l’éponge sur le passé " (ibid.), ce qui tout de même suggérait qu’il y eût quelque tache sur ce passé, et qu’elles y furent laissées… par le PSS. En 1939, l’Exposition Nationale manifestera urbi et orbi cette réconciliation nationale, celle des organisations hégémoniques du mouvement ouvrier et de ses adversaires " bourgeois ", devenus par le fait des crises ses partenaires sociaux et politiques. Victime de cette réconciliation, la gauche nicoliste et communiste sera promptement sacrifiée et condamnée à s’unir, formellement, dans la Fédération Socialiste Suisse d’abord, le Parti Suisse du Travail ensuite. Les stratégies nicolistes et communistes étaient trop contradictoires (jusqu’en 1941) de celles du PSS et de l’USS pour qu’une " cohabitation " fût envisageable après 1939. Il leur fallait se soumettre au PSS ou s’en démettre ; or les leaders de la gauche socialiste, Léon Nicole en tête, refusaient pareille alternative. Ils furent donc exclus du PSS, point final d’un processus d’éclatement en germe depuis plus de dix ans. Une année après cette exclusion collective (sur laquelle nous reviendrons), les trotskistes de la Marxistische Aktion Schweiz réitéraient leur analyse de 1938 :
17. La politique de " neutralité " de la bourgeoisie suisse n’est que l’expression de sa soif inaltérable de profit, et de ses liens profonds avec les grandes puissances impérialistes et de sa situation d’intermédiaire entre pays capitalistes. Cette " neutralité " ne lui interdit nullement de vendre les intérêts " nationaux " de la population suisse à la coalition impérialiste la plus forte. Elle le fera comme elle a déjà brimé sur le plan intérieur les intérêts économiques, politiques et sociaux de la population. Il est clair depuis longtemps que par sa politique antisociale et réactionnaire sur le plan intérieur, sa capacité de résistance sur le plan extérieur est considérablement affaiblie. Personne ne prépare mieux la Suisse a accueillir Hitler que la bourgeoisie helvétique.
(…)
19. La classe ouvrière n’a pas à faire confiance à la bourgeoisie suisse et à son gouvernement ou à son armée, elle ne doit soutenir aucune de ses mesures ou de ses actions. (…) La classe ouvrière ne doit soutenir aucune des mesures capitalistes d’Etat à coloration pseudo " socialiste ", ni la politique d’alliance avec l’Entente, qualifiée d’ " antifasciste ". Même pendant la guerre, nous refusons d’accorder des crédits de guerre à l’Etat capitaliste. La classe ouvrière lutte inébranlablement pour la révolution. La défaite de la bourgeoisie, voilà son but.
20. Si la bourgeoisie suisse était entraînée malgré elle dans la guerre, elle capitulerait sans résistance, comme le montrent les exemples de l’Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, du Danemark et de la Norvège, ou se battrait comme alliée d’une des coalitions impérialistes. (Il n’est qu’une chose qu’elle ne ferait jamais et qu’elle prétend faire pourtant : défendre le peuple). La classe ouvrière ne saurait s’associer à aucune des deux issues. Elle ne connaît qu’une guerre : la guerre de libération révolutionnaire. En cas de guerre, elle compléterait sa position défaitiste révolutionnaire à l’égard de la bourgeoisie suisse par le mot d’ordre suivant : guerre populaire contre les envahisseurs impérialistes et contre leurs alliés bourgeois suisses. Ce mot d’ordre est synonyme de guerre civile, de révolution socialiste (…).
21. La classe ouvrière suisse doit se rallier entièrement à la politique de l’internationalisme prolétarien ; elle ne doit en aucun cas mettre ses espoirs dans l’impérialisme allemand ou dans celui de l’Entente. Elle doit trouver les forces qui la mèneront vers la libération dans son propre sein, et unie à ses frères des pays voisins, elle doit construire une nouvelle Europe, prolétarienne et socialiste.
Marxistische Aktion Schweiz, Thèses sur la situation actuelle (1940), in : Ligue Marxiste Révolutionnaire, Contre la défense nationale, opcit.biblio pp 100, 101
Si être léniniste consiste à répéter vingt ans après, dans un contexte totalement différent et face à un adversaire nouveau (le fascisme et le nazisme) l’analyse faite par Lénine de la Guerre Mondiale, alors les trotskistes de la MAS sont d’un incontestable léninisme -mais c’est le léninisme de Kienthal, alors que Lénine enjoint de procéder à une " analyse concrète de la situation concrète "… Toute la gauche révolutionnaire ne se retrouvera pas réduite au sectarisme dogmatique de la MAS, et bien plus fréquent sera finalement le choix de mettre, pour un temps, l’objectif de la dictature du prolétariat " au frigo ", pour en venir à quelque traduction helvétique d’un front de " salut public " -pour user de références jacobines assez fréquentes dans les rhétoriques socialistes d’alors. Reinhard, au nom du PSS, exprime à Lucerne, en 1935, une position qui sera cinq ans plus tard partagée par l’essentiel de la gauche révolutionnaire :
Procès verbal des délibérations du Congrès de Lucerne du PSS (1935).
De ce consensus, que confirmera la suite des événements, Reinhard tire l’enseignement que s’impose désormais un changement de stratégie et de méthodes de lutte :
Procès-verbal des délibérations du Congrès de Lucerne (1935) du PSS
L’invite de son président à " changer de système de pensée et d’action ", le PSS la suivra, et avec le parti suisse, la majorité (mais non la totalité) de ses sections, de ses partis cantonaux, de ses " organisations sœurs " et de ses responsables. Ainsi sera, une fois de plus, confirmée la coupure entre des " réformistes " qui désormais s’avouent comme tels, sans précautions " gauchistes " de langage, et des " révolutionnaires " (communistes et socialistes de gauche) qui n’ont rien renié des phraséologies et des stratégies du Comintern, quoi qu’il en soit de leurs velléités de les " helvétiser ". En témoigne, paradoxalement, le " virage " communiste des temps de " front populaire ". C’est le très anticommuniste Théodore Aubert qui, dans le très libéral Journal de Genève, en rend compte, en décembre 1937 :
Après le VIème congrès de l’I.C., la direction opportuniste du parti à cette époque a mis le Parti communiste suisse en opposition ouverte avec la politique de l’Internationale communiste. A la base de cette politique, il y avait la théorie des particularités historiques de la Suisse. Cette théorie a été absolument démolie par le développement économique et politique de la Suisse. Ceux qui la préconisaient ont été écartés du Parti.
Ainsi, à Moscou, le camarade Bodenmann affirme l’absolu conformisme du Parti communiste suisse avec l’Internationale communiste et que, par conséquent, son but reste l’instauration en Suisse d’une République socialiste soviétique (et que) la dictature à la mode soviétique reste l’objectif final des communistes bien plutôt que le maintien de nos traditions démocratiques. Il en existe d’innombrables preuves. Et tout d’abord on ne comprendrait pas pourquoi le journal de M. Nicole, qui est le protecteur avoué des communistes genevois, contiendrait des dithyrambes quotidiens sur l’URSS si ces mêmes communistes et leurs sympathisants n’avaient pas les yeux fixés davantage sur l’URSS dictatoriale que sur la démocratique Confédération suisse. (…) Le 1er mai 1937, la " Lutte ", organe du Parti communiste, imprime en gros caractères : " Oui, nous resterons toujours fidèles à l’Internationale communiste ". (…) on lit à l’article premier, alinéa 2, des Statuts de l’Internationale communiste, que celle-ci lutte " pour l’instauration de la dictature mondiale du prolétariat, pour la création d’une fédération mondiale des Républiques socialistes soviétiques ". Les palinodies communistes sur la patrie, la liberté (et) la démocratie sont des manifestations de la nouvelle tactique bolchévique. Déjà, dans son numéro de mai 1936, la revue L’Internationale Communiste invitait les militants à tromper leurs auditeurs en leur parlant un nouveau langage. " Tous, y lisait-on, nous avons énormément à apprendre auprès de nos camarades français ". " Les chansons du peuple français, et les chefs d’œuvres de la littérature française, l’air lumineux de la patrie… la description enthousiaste des beautés et des richesses de la France… ", tels sont en effet les thèmes avec lesquels les sirènes de l’Internationale bolchévique ont séduit les électeurs français. Tels sont aussi les thèmes, transposés sur le ton suisse et genevois, que la nouvelle publication bolchévique, Connaître, éditée à Genève, dès juillet de cette année, offre à ses lecteurs. Les créatures de Moscou y exhalent maintenant le passé de la Suisse, ses héros, son histoire, et placent Philibert Berthelier, le héros genevois, l’artisan des combourgeoisies, au nombre des ancêtres du bolchévisme.
Journal de Genève du 14 décembre 1937
La brutale conversion des communistes aux valeurs patriotiques avait en effet de quoi laisser sceptiques leurs adversaires (voire leurs ennemis) qui, comme Théodore Aubert, ne cessèrent d’en dénoncer l’opportunisme et la duplicité. Cette conversion était pourtant dans l’air du temps, autant qu’une conversion peur l’être : à son niveau, dans son langage et pour ses propres raisons, le PSS y succomba aussi ; son programme de 1920 était nettement d’inspiration marxiste (léniniste) ; celui de 1935 sera, tout aussi nettement, social-démocrate (kautskyste, voire bernsteinien). D’un programme à l’autre, le virage semble considérable -et il l’est, idéologiquement parlant. Mais la pratique, elle, était réformiste bien avant que le programme ne l’admette définitivement : elle l’était en fait depuis le début du siècle, depuis la fusion de la social-démocratie et du Grütliverein. Il y a certes rupture entre le programme de 1920 et celui de 1935, mais rupture symbolique et rhétorique : ce dont il s’agit, c’est de l’acceptation réciproque de la Suisse officielle et du PSS, le second érigeant la première en rempart contre le fascisme :
Programme du Parti Socialiste Suisse (1935)
L’acceptation réciproque du PSS et de la Suisse officielle n’annihile dont pas la volonté du premier de changer la seconde ; elle impose toutefois à cette volonté le respect de la démocratie (dans sa forme " bourgeoise ") et l’usage exclusif des moyens démocratiques d’action politique. Le programme socialiste de 1935 reconnaît ainsi la démocratie " comme moyen et comme fin " (Marie-Madeleine Grounauer, La Genève rouge de Léon Nicole, op.cit.biblio p. 26) :
Programme du PSS (1935)
Le socialisme est toujours à l’ordre du jour, mais un socialisme qui désormais reconnaît la démocratie, même sous sa forme réduite, " bourgeoise ", comme lui étant consubstantielle, et qui se propose de " réunir dans une communauté de lutte pour les victimes de la mauvaise gestion capitaliste ", du prolétaire-ouvrier au prolétaire-paysan en passant par le petit artisan, l’intellectuel, le technicien, tous ensemble formant cette majorité populaire sans laquelle le passage au socialisme (forme supérieure d’organisation sociale) serait illusoire, parce que contraire aux principes démocratiques sans lesquels il n’y a pas de socialisme concevable.
L’adhésion socialiste à la " démocratie bourgeoise " n’est évidemment pas exclusive d’une critique de la forme concrète de cette démocratie, mais cette critique s’exprime sur le ton d’un constat d’inadéquation de la réalité au discours officiel, de distance entre la démocratie bourgeoisie et ses promesses : ce que l’on reproche à la démocratie bourgeoise, c’est de ne pas être à la hauteur des principes qu’elle proclame. Marie-Madeleine Grounauer :
*Yves Collart, Le Parti socialiste suisse et l’Internationale, op.cit.blbio p. 42
Marie-Madeleine Grounauer, La Genève rouge de Léon Nicole, op.cit.biblio pp 11-13
En fait, le seul programme du PSS qui ne reconnut pas explicitement, sous quelque prudence de langage, la démocratie politique " bourgeoise " comme un fait acquis et un principe méritant d’être défendu, fut le programme " révolutionnariste " de 1920 ; après comme avant, en 1935 comme en 1904, le " cœur " du programme socialiste est dans la volonté d’étendre cette démocratie au champ économique, pour assurer le bien-être des couches populaires, les libertés fondamentales du peuple, l’indépendance nationale et la souveraineté de l’Etat. Venir à bout de l’exploitation capitaliste ? Certes, mais graduellement, patiemment et surtout légalement.
On conçoit que de telles certitudes dussent assez peu du goût de la gauche socialiste (des gauches socialistes), pour ne rien écrire d’un Parti communiste déterminé par sa fidélité (spontanée ou non) à Moscou et déterminant son attitude à l’égard de la démocratie " bourgeoise " (comme de la social-démocratie) en fonction des critères énoncés par le Comintern. Le communiste bâlois Franz Dübi en témoigne :
Franz Dübi, Pourquoi je reste communiste, in Réalités, Genève, 31 mars 1988
Jusqu’en 1943, toute l’activité du PC est, comme le reconnaît Jules Humbert-Droz, déterminée par les décisions prises à Moscou ; des décisions
Jules Humbert-Droz, Dix ans de lutte antifasciste, op.cit.biblio p. 13
Cette détermination extérieure des stratégies communistes a des effets sur toute la politique du PC au plan national ; elle en a donc aussi sur sa politique au plan local, surtout lorsque des enjeux locaux deviennent des enjeux nationaux. Ainsi des élections cantonales genevoises de 1933, qui virent la victoire des socialistes : loin de soutenir la tentative du PSG d’arracher une majorité parlementaire et gouvernementale, le PC affirme que
Cité par Marie-Madeleine Grounauer, in La Genève rouge de Léon Nicole, op.cit. p. 180
Cette étrange conception du " front unique ", consistant à combattre ouvertement le parti avec lequel on prétend vouloir le conclure, et à appeler les électeurs socialistes à s’abstenir de voter pour leur propre parti, sera d’autant moins du goût de des électeurs genevois (ils n’étaient d’ailleurs que quelques centaines) que l’espoir mis en Léon Nicole et en le PSG débordait largement de la clientèle " normale " du PS. Il y eut en tout et pour tout 46 bulletins blancs… cruelle démonstration de la réalité de l’ " implantation du parti dans les masses " et de la valeur des mots d’ordre du Comintern, même si " certains communistes se sont montrés plus clairvoyants que la direction de l’Internationale " (Marie Madeleine Grounauer, op.cit. p. 180). Le PC n’avait pourtant pas ménagé sa peine pour dénoncer les " sociaux-traîtres " et la " main gauche de la bourgeoisie ". La chose était jugée : le Parti socialiste suisse, exemples nombreux à l’appui, était dénoncé comme le plus efficace soutien de la bourgeoisie. Et le PS genevois, alors, dont nul n’ignorait qu’il était dirigé par son aile gauche (Nicole, Dicker), et que de très profondes divergences l’opposaient au parti suisse ? Pour le PC, il n’y avait aucune différence entre socialistes " de gauche " et socialistes " de droite ", si ce n’est que les premiers étaient porteurs d’un plus grand danger (pour la classe ouvrière) que les seconds : la droite socialiste, elle au moins, " ne cache plus son alliance avec la bourgeoisie "…
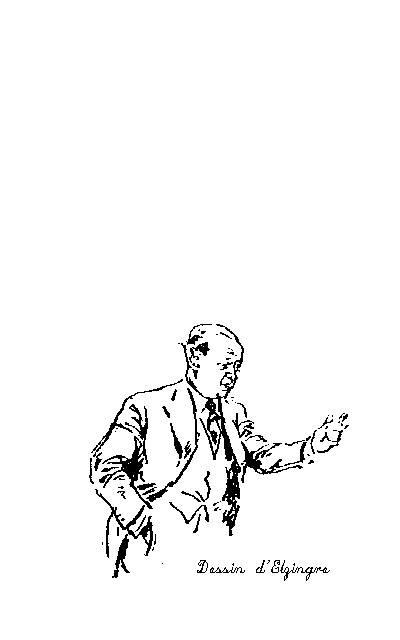
Le Drapeau Rouge, organe du PC, va donc tenter de convaincre ses lecteurs de la perversité de la gauche socialiste ; pour la direction du PC, il n’y a d’ailleurs pas d’aile gauche ni d’aile droite au sein du PS, mais seulement division du travail :
Le Drapeau Rouge du 17 février 1934
L’ennemi principal au sein de la classe ouvrière (de la " classe en soi ") n’est évidemment pas le fascisme, qui en Suisse ne s’y implante que faiblement, qui nulle part n’en est l’émanation ni n’agit en son nom, mais la social-démocratie, qui " détourne les travailleurs de leurs tâches révolutionnaires " ; et d’entre les sociaux-démocrates, les plus dangereux (parce que politiquement les plus " séduisants ") sont les plus à gauche. Il faut donc combattre Léon Nicole à Genève, précisément parce qu’il est le leader de la gauche socialiste, et qu’à ce titre, il jouit " du plus grand prestige auprès de la classe ouvrière qui le considère comme un vrai révolutionnaire " (Marie-Madeleine Grounauer, op.cit. p. 185).
Le PC, finalement, changera d’attitude à l’égard du PS. Spontanément ? Certainement pas : bien plutôt par fidélité envers la ligne du Comintern, par référence à la nouvelle stratégie du PCF, dès 1934 (la montée du fascisme en France l’y puissant), mais aussi par constat de l’absolue stérilité de la ligne sectaire suivie jusque là. En juillet 1934, le PCF et la SFIO décident de faire cause commune " contre le fascisme et la guerre " ; cette ligne politique n’aura pu évidemment être adoptée par le PCF sans que le Comintern ne l’y autorise ; dès lors, pour les communistes, les sociaux-démocrates ne sont plus des sociaux-fascistes. Le VIIème Congrès de l’IC, une année plus tard, consacre l’adoption de la stratégie de Front Populaire, et l’abandon de celle du Front Unique. Double changement : l’unité doit se faire désormais avec les partis socialistes, et donc avec leurs directions, et non plus " à la base " en dressant les socialistes de gauche contre leurs directions de droite ; d’autre part, cette unité pourra s’étendre, au-delà du mouvement socialiste, jusqu’aux partis bourgeois " progressistes " : en France, elle englobera le Parti radical, pourtant solidement anticommuniste ; en Suisse, elle concernera la gauche du Parti radical, ou des forces naissant hors des partis traditionnels, comme l’Alliance des Indépendants de Gottlieb Duttweiler.
En Suisse, pourtant, le PSS fut seul à être réellement concerné par le tournant communiste : le grand parti de la gauche étendait son influence politique sur un champ très large, de la gauche révolutionnaire au centrisme le plus prudemment réformiste, du PS genevois à la direction de l’Union Syndicale, des intellectuels internationalistes aux ouvriers patriotes. Dans les cantons de Bâle et de Zurich, le PSS laissa se conclure des apparentements (si les partis cantonaux le désiraient) avec les communistes… mais pas ailleurs. Léon Nicole protesta contre une attitude qu’il qualifia de " politique de boutiquiers et d’épiciers ", de " politique d’unité au compte-gouttes ", et réclama pour le PSG la possibilité de régler librement la question. Le Congrès du PSS ayant, contre la volonté du Comité central, reconnu quelque validité à cette protestation, l’alliance de gauche fut admise sans restrictions au plan cantonal, au bon vouloir des partis et des sections, sans toutefois qu’il fût question de l’appliquer au plan national. En 1936, communistes et socialistes genevois firent liste commune pour la Grand Conseil et deux communistes (Vincent et Pons) furent élus. La gauche n’en perdit pas moins les élections, et la majorité gouvernementale. De son côté, le Parti communiste se vit imposer Jules Humbert-Droz à sa tête pour bien marquer le tournant stratégique pris par l’Internationale. Membre de l’aile " droite ", boukharinienne, de l’IC, Humbert-Droz défendait depuis longtemps le principe de l’unité avec les socialistes, conscient qu’il était de la nécessité de ne pas se couper de l’organisation politique hégémonique de la classe ouvrière suisse. Il y avait quelque logique à le charger d’appliquer la ligne politique qu’il avait défendue lorsque le Comintern versait dans le sectarisme " classe contre classe "… et quelque cruauté à l’en charger lorsqu’il était déjà trop tard pour qu’elle fût efficace.
Quoi qu’il en fut des accords électoraux régionaux, partis socialistes et communistes restaient séparés ; il faudra une scission au sein du PSS pour que la gauche socialiste et communiste s’unifie (apparemment) au sein d’une même organisation politique, et pour quelques années seulement. L’accord passé en 1935 entre le PS et le PC du canton de Zurich, par exemple, manifeste à la fois le souci de l’unité d’action et celui de sauvegarder l’autonomie réciproque de chaque organisation. Le PS zurichois impose en effet des dispositions très claires, et on est loin de la presque fusion (de genevoise de 1936 :
Le mouvement ouvrier suisse, op.cit.biblio p. 287
De même, lorsque le Congrès du PS Vaudois, le 3 mai 1936, se déclare " prêt à collaborer occasionnellement avec le PC Vaudois ", c’est à la condition que celui-ci " fasse dès maintenant abstraction de toute attaque contre l’une quelconque des organisations du Parti Socialiste " (Pierre Jeanneret, Histoire du PSV, op.cit.biblio p. 11).
Changement de ligne, sans doute, et de par et d’autre, mais changement prudent, contrôlé, du côté socialiste, par l’imposition de conditions politiques très claires. Le PS peut se le permettre : il est le partenaire majeur -et c’est peu dire- de cette alliance. La politique sectaire du PC dans les années précédentes avait maintenu les communistes dans une marginalité sans autre exception, au moins relative, que quelques villes alémaniques (Schaffhouse, Zurich, Bâle). A Genève, par exemple, la ligne " de gauche " suivie par le PS bloquait tout développement du PC. Le " Front unique " devait avoir pour fonction de préparer l’unification (sous direction communiste) de l’aile gauche du PS, des syndicats et du PC (les droites syndicale et socialiste en étant écartée). Cette ambition avouée du PC ne fut d’ailleurs pas pour rien dans l’échec de ses propositions. Jules Humbert-Droz, en brossant le tableau général de la situation au VIe Congrès du PCS (Zurich, 1937) tirait lucidement les enseignements des erreurs passées tout en réitérant, plus pour la forme que par conviction, la proposition de " front unique " (en changeant son contenu et en le tirant vers le Front Populaire) et l’espoir de fonder avec les socialistes " le parti unique de la classe ouvrière " :
Jules Humbert Droz, Dix ans de lutte antifasciste, op.cit.biblio, p. 170
Cette résolution du Congrès du PCS, adressée au PSS (qui repoussera évidemment les propositions qu’elle contient) porte, de toute évidence, la marque de Jules Humbert-Droz et de la nouvelle ligne " unitaire " imposée par l’Internationale (avec une dizaine d’années de retard). Le PCS, après le PSS, finira même par accepter le principe de la défense nationale et par soutenir le " Mouvement des lignes directrices " (qui ne voudra d’ailleurs rien savoir de ce soutien).
Pour autant, l’anticommunisme ne faiblit pas, bien au contraire, malgré les efforts du PCS pour briser les murs du ghetto politique dans lequel il s’était lui-même enfermé ; c’est que, derrière le PCS, on voyait toujours le PCbUS, et derrière Jules Humbert-Droz, Staline (dont Humbert-Droz n’était pourtant pas le plus aveugle des fidèles). Les grands procès de Moscou donneront d’ailleurs de nouveaux arguments à ceux qui, en dénonçant le régime soviétique, ont les socialistes en point de mire quand ils affirment viser les communistes. Dès 1937, le PC sera interdit dans plusieurs cantons. Il sera interdit dans l’ensemble du pays en 1940, alors que la signature du pacte germano-soviétique une année auparavant aura donné à la direction du PSS l’occasion de régler par l’exclusion le problème posé par la gauche du parti, Léon Nicole ayant -avec quelque mauvaise conscience- justifié le pacte Hitler/Staline (ou Ribbentrop/Molotov, ce qui revient au même).
Revenons sur le " statut ", théorique et symbolique, de l’Union Soviétique dans le débat politique au sein de la gauche helvétique : au risque de l’anachronisme et de la simplification vulgarisatrice, il nous semble bien qu’il y ait quelque ressemblance, pour les intellectuels et les militants communistes, entre ce " statut " et celui des Refuges protestants, et de Genève en particulier, du XVIème et du XVIIème siècle, pour les clercs et les fidèles huguenots : terre d’exemple, laboratoire politique et philosophique, camp du vrai et du Bien, l’Union Soviétique est perçue (et décrite) par ses thuriféraires moins pour ce qu’elle est que pour ce qu’elle signifie, et pour l’espérance que son existence même, et son existence seule, conforte, et dont on l’investit -comme la Genève de Calvin et Bèze, trois siècles auparavant. En 1935, après la publication du Taille de l’Homme de Ramuz, l’Association Suisse des Amis de l’URSS adresse au grand écrivain romand une Lettre ouverte qu’elle conclut par une véritable chrestomathie prosoviétique (on y retrouve André Gide, André Malraux, Paul Signac, Marcel Prenant, aux côtés du ministre français Flandin, de Maxime Gorki et de Serge Prokoviev). Les Amis de l’URSS commencent par se féliciter de l’intérêt porté par Ramuz à leur Terre Promise :

Cela écrit, les Amis de l’URSS passent à la critique du texte de Ramuz (" Besoin de grandeur ") -une critique mesurée, tant est grande leur satisfaction, et sans doute aussi leur surprise, de lire sous la plume du plus grand écrivain suisse de son temps l’expression de quelque sympathie (même mesurée elle aussi) pour leur cause :
" Récupérant " ainsi Gide (qu’ils honniront après son Retour de l’URSS) et Malraux (dont le romantisme révolutionnaire entretient l’illusion du " compagnon de route "), faisant de Romain Rolland l’usage auquel eux-mêmes se complurent, et s’abritant derrière l’exemple (réel ou proclamé) des uns ou des autres, les Amis de l’URSS haussent ensuite le ton pour s’en prendre aux " insuffisances " de Ramuz -à la " misère de sa philosophie " :
Association des Amis de l’URSS, Lettre ouverte à C.-F. Ramuz, Imprimeries Populaires, Genève, 1935
" Qui n’est pas avec nous finira par être contre nous " : à Ramuz (qui n’en a cure), les Amis de l’URSS adresse cette injonction : choisis ton camp ! Ainsi les communistes procéderont-ils constamment dès leur constitution en force autonome, c’est-à-dire dès la scission originelle, et jusqu’à leur passage dans la clandestinité (une clandestinité " à la Suisse ", qui leur fera perdre le droit d’agir à visage découvert, sans que leur situation ait grand chose à voir avec celle de leurs camarades des pays voisins, quoiqu’ils bénéficieront du prestige acquis dans la Résistance par les communistes italiens et français -et que, dans la mesure de leurs moyens, ils auront pu apporter à ceux-ci une aide précieuse.
A l’intérieur de la gauche, comme dans l’ensemble du " monde politique " suisse, les dernières années de l’entre-deux-guerres sont des années de conflits. Le " cas genevois " est exemplaire, mais il n’est pas isolé : Zurich, Lausanne, Bienne, La Chaux de Fonds, Le Locle, sont " passés au rouge " dans ces temps de crise. Le débat politique va, à gauche, s’achever dans l’exclusion et la scission. Ainsi à Neuchâtel : toute une série de différends (personnels, stratégiques, théoriques) opposent dans les syndicats et dans le PS la " gauche " et la " droite " du mouvement socialiste. Le PS se trouve confronté non seulement à son aile gauche et au PC, mais à sa propre " droite " et à celle du syndicat (Pierre Aragno, René Robert, Pierre Reymond) qui lui reprochent de se montrer trop " conciliant " avec les communistes et de ne pas " poursuivre avec la droite une politique de concertation analogue à celle que les syndicats viennent d’entamer avec le patronat " (Nicolas Rousseau, Historique du PSN, op.cit.biblio pp 33, 34) par la signature de la " Paix du Travail ". Cette division cantonale, représentative de bien d’autres débats du même genre dans les autres organisations (locales, cantonales ou fédérales) du mouvement syndical ou du PS, aboutira à la création à Neuchâtel en 1944 d’un " Parti Travailliste " qui durera jusqu’en 1956 et défendre tant qu’il le pourra le projet " social-corporatiste " des " communautés professionnelles " réunissant, par branches, patrons et salariés (ouvriers et employés) pour la défense de la branche. Mais s’il aboutit à des exclusions et à des scissions, le débat politique fait aussi des morts ; à Genève et à Zurich en 1932, on le sait, mais aussi, en 1937, à La Chaux de Fonds, où un sympathisant fasciste, le docteur Eugène Bourquin, succombe à une crise cardiaque après une échauffourée lors d’une conférence d’extrême-droite. L’incident sera le prétexte à l’interdiction du PC (qui n’y était pas pour grand chose) dans le canton de Neuchâtel, votée par le Grand Conseil quelques semaines avant qu’on en fasse autant à Genève, puis combattue par référendum populaire, et finalement acceptée en votation populaire, contre l’avis du PS, le 25 avril 1937. La même année, toujours à Neuchâtel, le Conseil d’Etat interdit d’enseignement le socialiste de gauche (et professeur) André Corswant, futur membre fondateur du POP. Quatre ans plus tôt, déjà, un autre professeur (et lieutenant à l’armée), Georges Henri Pointet, avait été " mis en disponibilité " de l’armée pour avoir publiquement soutenu la candidature de E.-Paul Graber au Conseil d’Etat neuchâtelois et implicitement déclaré qu’il refuserait de tirer ou de faire tirer sur ses camarades en cas de réédition neuchâteloise des " événements " genevois de 1932. Commentaire de Jean Liniger :
Jean Liniger, Georges-Henri Pointet : vie, textes, documents, op.cit.blbio p. 21
De 1937 date la mise hors-la-loi du Parti communiste, canton par canton, puis au plan fédéral. En juin 1936, l’ancien Conseiller fédéral (philofasciste) Jean-Marie Musy, qui avait démissionné du gouvernement en 1934… dans l’espoir d’y revenir) avait fait adopter par le Conseil national une motion anticommuniste ; un arrêté du Conseil fédéral interdit, le 3 novembre 1936, les discours politiques d’étrangers sauf autorisation expresse des autorités ; les 14 et 25 août 1936, c’est au soutien de la gauche à la République espagnole que s’en prennent les autorités suisses ; le 13 mars 1937, au Grand Conseil genevois, l’interdiction du PC est à l’ordre du jour. Socialistes et communistes avaient, l’année précédente, fait liste commune pour le législatif cantonal et les communistes Vincent et Pons siégeaient depuis au Parlement, aux côtés des socialistes. Jean Vincent, bien sûr, s’oppose à l’interdiction de son parti ; il est soutenu par la gauche socialiste. Mais la droite socialiste elle-même combat la proposition " liberticide ". Charles Rosselet, à la tribune du Grand Conseil :
Et Rosselet, ayant ainsi rappelé les fondements de son anticommuniste, de s’appuyer sur cet anticommunisme même pour condamner au nom de son parti (allié aux communistes) le proposition de la droite d’interdire le PC :
Mémorial des séances du Grand Conseil de la République & canton de Genève, séance du 13 mars 1937
Rosselet fait donc appel à la fois aux sentiments démocratiques et à l’instinct de conservation politique de la droite bourgeoise. Quelques mois plus tard, le 10 novembre 1937, c’est, après Neuchâtel et Genève, au Grand Conseil vaudois que se tient un débat sur l’interdiction du Parti communiste ; ce sera Paul Golay qui, non moins anticommuniste que Rosselet (mais plus lyrique) se chargera de combattre l’anticommunisme bourgeois, tout en recommandant ironiquement à ses hérauts de faire adhérer le canton de Vaud à l’axe germano-italien. Paul Golay :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit.blbio pp 242, 245
Comme Rosselet, Golay en appelle à la démocratie (bourgeoise) pour repousser la proposition d’interdiction du PC. Il ajoute à cet appel celui, spécifiquement socialiste, d’un travail sur les causes de la révolte sociale, et ses références sont explicites : le Front Populaire français, le travaillisme britannique, la social-démocratie scandinave. Et de dénoncer (dans la presse socialiste) la méthode du bouc-émissaire employée par la droite pour masquer ses propres responsabilités dans la montée des mécontentements populaires :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 211-214
Ainsi les sociaux-démocrates font-ils justice de la " conception policière de l’histoire " qui transparaît dans les justifications " bourgeoises " du projet (qui sera accepté) d’interdiction du PC. Quant au PC lui-même, dont l’avis importe d’ailleurs assez peu à ceux qui le veulent proscrire, il répond aux menaces qui pèsent sur son existence légale en protestant hautement de la qualité de ses sentiments démocratiques, tenant à l’occasion un discours que le Parti socialiste n’eût pas désavoué, et que, quelques années plus tôt, les communistes eurent qualifié sobrement de " social-fasciste " :
Cité dans Le Mouvement Ouvrier Suisse, op.cit.biblio p 293
Datant de 1938, ce texte s’ouvre donc sur une dénonciation des tendances fascistes au sein de la bourgeoisie suisse, sur le même ton -et avec un contenu comparable- que le discours du président du PSS, Reinhard, au Congrès de Lucerne de son parti en 1935 ; mais le texte communiste se conclut par le désormais rituel appel à l’unité avec les socialistes. Surtout, le Parti communiste proteste de ses sentiments démocratiques. Il est vrai que le " tournant " du VIIème Congrès de l’Internationale communiste a effacé du discours stalinien l’appel à abolir la démocratie " bourgeoise ", là où elle a été instaurée et où elle n’a pas été abolie par le fascisme, le nazisme ou quelque réaction autoritaire, et que le PCS a, après le PSS, décidé de soutenir le " Mouvement des Lignes Directrices " (qui ne voulut d’ailleurs rien savoir de ce soutien, dont il n’avait que faire et qui ne lui apportait rien).
L’exclusion des communistes de l’ " arc démocratique " suisse avait été dénoncée par les socialistes comme le présage à d’autres mesures d’interdiction politique ; cette crainte se vit confirmée lorsqu’en 1941 les socialistes genevois (il est vrai, préalablement exclus du PSS) furent eux-mêmes victimes d’une véritable " purge " ordonnée par la droite bourgeoise. Le 21 juin 1941, le Grand Conseil genevois eut à débattre d’un projet d’arrêté du Conseil d’Etat " expulsant " 27 députés socialistes régulièrement élus, dont les trois communistes Jean Vincent, Louis Huissoud et Etienne Lentillon, admis au sein du groupe socialiste. C’est la totalité des membres du groupes parlementaire restés fidèles à Léon Nicole après la scission de 1939, c’est-à-dire l’écrasante majorité des élus, qui doivent ainsi être exclus du parlement cantonal. Le libéral Balmer, Président du Conseil d’Etat, dénonce les " conceptions étrangères, contraires à l’esprit suisse " (cité par Jean Vincent, in Raisons de Vivre, op.cit. p. 146) dont les socialistes seraient animés, et qui justifieraient que le Conseil fédéral les ait assimilés aux communistes le 27 mai précédent, en les frappant de la même interdiction que le PC. A ceux qui, comme Balmer, accusaient son parti (le Parti socialiste genevois " maintenu " et la Fédération socialiste suisse, créée après l’exclusion de la gauche du parti par le PSS) de " fomenter la discorde ", Léon Nicole répondit en soulignant l’exceptionnelle gravité d’une décision consistant à exclure du jeu politique légal le quart du parlement genevois, sans soumettre cette décision à l’examen d’une commission parlementaire (à laquelle eussent forcément participé des représentants de la force politique que l’on voulait exclure). Nicole en profita pour dénoncer les responsabilités de la direction du PSS dans la répression qui le frappait, lui et les siens, ainsi que la confiscation, sur ordre fédéral, de son imprimerie. A quoi Charles Rosselet, leader de l’ancienne aile droite du PSG devenue le parti socialiste " officiel " (Parti socialiste de Genève, section reconnue du PSS), répliqua pour justifier son abstention lors du vote de l’arrêté d’expulsion de ses anciens camarades, que " depuis que le Parti socialiste genevois s’est collé aux communistes, depuis qu’il les a introduits dans son sein, il a été complètement dominé par eux " (cité par Jean Vincent, op.cit. p. 148), ce qui était pour le moins justifier l’assimilation du PSG au PC et par conséquent l’application au premier des dispositions interdisant le second. Après que Rosselet eut encore traité Nicole d’ " effroyable menteur " et que le Conseil d’Etat eut justifié l’exclusion des parlementaires socialistes en leur lançant un arrogant " nous vous mettrons au bénéfice de la Constitution quand vous en serez dignes " (ibid.), les socialistes genevois furent donc exclus du parlement cantonal par 49 voix (la droite) contre 21 (les futurs exclus) et 6 abstentions (les socialistes " officiels ", et par le moyen dilatoire d’un arrêté législatif urgent excluant le référendum populaire. Le lendemain, commente ironiquement Jean Vincent 45 ans plus tard, " la guerre prenait un tournant fabuleux par l’agression de la Wehrmacht contre l’Union Soviétique " (ibid) ; ce basculement de la guerre, et de l’URSS dans la guerre (quoique des combats aient déjà opposé les Soviétiques aux Japonais) fut en effet un tournant décisif, non seulement du conflit lui-même, mais de toute l’évolution politique ultérieure -et à tous les niveaux : du local à l’international. En 1941, donc, point final de l’évolution unitaire du socialiste genevois : les élus socialistes subissent le sort des élus communistes et perdent leur siège, non à la suite d’une défaite électorale mais par décision arbitraire du pouvoir politique -et d’un pouvoir qu’ils avaient partiellement détenu quelques années auparavant à Genève, et auquel le PSS et le PS genevois " officiel " aspiraient toujours à participer, fût-ce minoritairement.
En 1936, les élections cantonales genevoises avaient vu la présentation d’une liste socialiste portant le nom de neuf candidats communistes, présentés comme tels et pour lesquels le PC avait fait sa propre campagne (pareil exercice sera réédité en 1993, lorsque la liste du Parti du Travail sera élargie à la gauche révolutionnaire regroupée dans solidaritéS et faisant campagne autonome). Deux communistes, Vincent et Pons, furent élus. Sur quelle base, pour quel programme, avec quelle argumentation ?
Les chefs bruyants de peuples élus massent leurs armées, tonnent et menacent.
Les races supérieures se reconnaissent à la perfection de leurs armes, à l’efficacité de leurs gaz, à la brutalité de leurs actes.
La diplomatie fasciste ébranle de ses coups la Société des Nations, dernier vestige de la volonté pacifique des peuples.
Notre pays est menacé à ses frontières nord et sud.
Nous sommes décidés à défendre son indépendance contre l’agresseur fasciste. Mais nous ne pouvons faire confiance aux chefs actuels de l’Etat et de l’armée.
Trop de scandales ont marqué leurs sympathies partisanes pour les régimes générateurs de la guerre qui vient.
M. Motta a saboté les sanctions contre l’Italie et proclamé une neutralité favorable aux généraux espagnols traîtres à leur patrie.
La défense de l’indépendance de notre pays sera le fait d’une collaboration étroite avec toutes les nations fermement attachées à la paix.
L’Union Soviétique est à l’avant-garde de ces nations.
Les communistes veulent construire dans la paix la Suisse libre et heureuse de demain.
Les communistes appellent à l’Union du peuple travailleur pour garantir la paix et l’indépendance du pays.
Pour une Genève pacifique, il faut une majorité populaire.
Votez la liste socialiste, qui porte les noms des neuf candidats communistes.
Tract électoral du PC genevois, 1936
Texte exemplaire de la nouvelle ligne communiste et de son projet d’unité nationale antifasciste et patriotique, dont le demande (refusée) d’adhésion au Mouvement des Lignes Directrices est le symbole. Pour le PSS et l’USS, chevilles ouvrières du mouvement, la réforme sociale est le ciment de l’unité nationale. Les positions de principe du mouvement étaient d’ailleurs fort claires, et il eût été deux ans auparavant impensable que le PC lui apportât son soutien, quand il honnissait tout ce qui pouvait ressembler à un compromis avec la " bourgeoisie " (fût-elle " démocratique ") et ne se privait pas d’ " incendier " le PSS coupable d’un tel désir de compromis. Le Mouvement des Lignes Directrices est en effet un modèle de réformisme social-démocrate, voire " rooseveltien ", et de keynésianisme économique ; qu’on en juge :
II. Les tâches de la politique économique
Le but de la politique économique est la disparition du chômage et la pleine utilisation de toutes les forces productives de notre pays. (…) Si l’on veut en premier lieu ranimer l’activité économique privée, il faut alors permettre à l’Etat d’intervenir comme compensateur en faveur de ceux qui sont économiquement faibles (…)
IV. La défense nationale militaire
in Revue Syndicale Suisse No 5, mai 1939
Dans ce programme, commun à toutes les forces de la gauche démocratique de l’immédiat avant-guerre, se trouvent donc exprimées les principales " innovations " du moment : la " défense spirituelle ", l’impôt fédéral direct (dit de " défense nationale "), la définition d’une " culture suisse "… programme explicitement, rigoureusement " social-démocrate " (et même " social-patriote "), économique keynésien, fonctionnant par référence constante à l’Etat de droit et à la démocratie. C’est un coup de maître : la gauche réformiste s’affirme, par le moyen des " lignes directrices ", comme la colonne vertébrale de la résistance politique, avant que d’être, si besoin est, le moment venu, militaire, au fascisme et au nazisme. Ce " social-patriotisme " ne sera cependant pas du goût de ceux, non moins réformistes et démocrates pourtant que les chefs du PSS et de l’USS, qui rechignent à adhérer à cette exaltation nationale, fût-elle justifiée par les dures nécessités du combat antifasciste ; ainsi, Paul Golay :
Paul Golay, De la défense spirituelle, in Terre de Justice, op.cit. biblio., pp 147-148
Paul Golay, De l’imitation servile à la déchéance voulue, in Terre de Justice, ibid p. 145
Les réticences ou les protestations de ceux qui, tel Paul Golay, récusent l’évolution " social-patriote " du mouvement socialiste suisse, ne pourront guère entraver cette évolution, tant elle semble portée par " l’air du temps ". Mais la gauche socialiste prend part au rapprochement du mouvement ouvrier et de la Suisse bourgeoise, après avoir constaté (et déploré) l’impossibilité de la réunification entre socialistes et communistes. En 1939, au Caire, le professeur socialiste suisse Georges-Henri Pointet déclare dans une conférence de presse que " les forces (…) du fascisme ne pourront rien contre les peuples des démocraties si ces peuples aident leurs gouvernements à maintenir une politique nette et courageuse, la politique de l’intérêt général " (George-Henri Pointet, Textes, op.cit.blbio p. 31). Camarade d’études et ami personnel du communiste André Corswant, sympathisant de l’URSS, membre du Rassemblement Universel pour la Paix et, en Egypte, de l’Union Démocratique, Pointet (par ailleurs Lieutenant de l’armée helvétique) fut un " compagnon de route " du mouvement communiste, un socialiste de gauche, puis un " socialiste gaulliste ", partisan par antifascisme de l’unité d’action avec les communistes et les " bourgeois " démocrates. Poussant à son terme son analyse et son engagement personnels, Pointet s’engagea dans les Forces Françaises Libres et mourut au combat lors du débarquement de Provence, en 1944. Itinéraire exemplaire (et exceptionnel, quoique non unique), façonné certes par les convictions personnelles du personnage, mais aussi par l’événement international. Alors qu’après les accords de Munich s’organise dans son canton de Neuchâtel une collecte destinée à offrir… un chronomètre en or à Chamberlain, " sauveur de la paix ", le même événement fait prendre encore plus conscience à Pointet des dangers du moment, et contribue à l’éloigner des positions dogmatiquement léninistes de l’extrême-gauche (et de celles, servilement staliniennes, des communistes) ; d’entre ces léninistes dogmatiques, les trotskistes de la Marxistische Aktion Schweiz s’illustrent en 1938 :
in Ligue Marxiste Révolutionnaire, Contre la défense nationale, op.cit.blbio., pp 87, 88
En d’autres termes : la classe ouvrière seule peut résister au fascisme, et toute alliance avec la bourgeoisie ne ferait qu’éroder cette capacité de résistance. La prescience de la guerre conduit ainsi les différents courants de la gauche (y compris de la gauche révolutionnaire) à des choix opposés ; du moins cette prescience est-elle générale, de la gauche à la droite du mouvement. Les organisations se préparent au conflit qu’elles sentent de moins en moins évitable; les militants modifient leurs modes d’agir au fur et à mesure que la menace se précise. Deux militants anarcho-syndicalistes genevois en témoignent :
En ce temps-là, j’étais pour un changement par la révolution. Et puis, quand j’ai vu ce qui se passait dans les pays autour de nous… La première cible de la répression c’étaient les grands militants. Ils étaient connus, c’était facile. Et quand ceux-là étaient tués, il restait qui ? Les ouvriers pouvaient recommencer à se battre pour deux ronds ! Alors je me suis dit, il vaut mieux lutter autrement, on ne peut pas se permettre de faire tomber les meilleurs camarades.
A la veille, on a eu peut. Moi, j’ai tout détruit, je me suis débarrassé de tout (…). On savait bien que si les choses venaient à se gâter en Suisse, on était connus et, les premiers qu’ils seraient venus arrêter, c’étaient nous.
La vie quotidienne et les luttes syndicales (…), op.cit.blbio p. 151
Ces militants anarcho-syndicalistes feront le pas du " réformisme " et de l’adhésion à la démocratie " bourgeoise ", ne serait-ce que pour user des instruments qu’elle offre, contre le fascisme. L’affirmation de la démocratie politique et de la nécessité de son extension au domaine social et économique porte de toute évidence la marque de l’aile " modérée " du PSS et de la direction de l’USS, en un moment où il n’était pas encore possible de dire aussi franchement dans le programme du parti ce que l’on faisait dire au Mouvement des Lignes Directrices. Le programme de ce mouvement exprime ainsi le " non-dit " (ou le " non-encore-dit ") de la gauche helvétique des ultimes années trente, sans concession à son aile la plus " radicale " -qui en tire la conclusion que la gauche réformiste n’est plus qu’une " annexe de la bourgeoisie " :
Marxistische Aktion Schweiz, 2 mai 1938, cité dans : Ligue Marxiste Révolutionnaire, Contre la défense nationale, op.cit. p. 94
*Nous sommes en 1938 : le " bloc impérialiste allié à l’Union Soviétique " que dénoncent les trotskistes est (encore) celui des démocraties. Il sera incapable de concrétiser cette alliance. L’année suivante, l’Union Soviétique signera avec l’Allemagne un Pacte de non agression qui permettra aux nazis d’envahir d’abord la Pologne, puis une bonne partie de l’Europe occidentale, avant de se retourner contre l’Union Soviétique dont elle avait pu écarter la menace… Bref, la prescience trotskiste a des limites.
Renvoyant dos à dos tous les " ennemis de la démocratie ", les " Lignes directrices " s’affirmaient " objectivement " en résistance à la fois au nazi-fascisme et au stalinisme, et " subjectivement " en opposition avec toute tentative de bouleversement de l’ordre social et politique, qu’il soit réactionnaire (nazi, fasciste) ou révolutionnaire (communiste). L’adhésion socialiste à ce double combat se manifestera avec la plus crue des évidences lorsqu’en 1939 la crise interne, vieille de vingt ans, qui opposait la gauche socialiste à la majorité " modérée " et à l’aile " droite " du PSS, se résoudra par l’exclusion pure et simple de la gauche " nicoliste " et de ses alliés à l’intérieur du parti, pour fait de complaisance à l’égard de la politique soviétique. La maladresse de Nicole et des siens donnera aux directions du PSS et de l’USS l’occasion de se débarrasser politiquement d’eux.
Le 23 août 1939 est signé à Moscou un pacte, apparemment " contre nature ", entre l’Union Soviétique et le IIIe Reich nazi. C’est un coup de tonnerre : Comment Staline peut-il tendre la main au massacreur des communistes allemands ? (rares étant ceux qui savent, et sont prêts à admettre, qu’en fait Staline a fait massacrer plus de communistes que Hitler…). Les communistes et les socialistes de gauche sont désorientés, " déchirés " entre leur antifascisme et leur fidélité à l’Union Soviétique. certains membres du PC, écœurés, rompent avec le parti. Les socialistes " modérés " condamnent le pacte, la droite syndicale et social-démocrate saute sur l’occasion : sa Schadenfreude éclate. L’occasion, il est vrai, est trop belle d’illustrer l’absence totale de scrupule du chef du mouvement communiste international, et d’en faire rejaillir l’opprobre sur tous ceux les communistes, puis sur tous ceux qui parlent d’unité avec les communistes. Le PC et les " compagnons de route " qui lui restent fidèles tentent vainement d’expliquer le " coup " de Staline par l’incapacité des Occidentaux à conclure une alliance tripartite (franco-anglo-soviétique) qui eût rendu le pacte inutile pour Staline, et par la " volonté de paix " de l’URSS. Au sortir de la Guerre Mondiale, les communistes tenteront, non moins vainement, d’accréditer l’hypothèse d’une manœuvre " géniale " du Petit Père des Peuples, afin de retarder le moment de la confrontation avec Hitler, en repoussant le front vers l’ouest. Léon Nicole, avec un temps d’incrédulité, finit par approuver le pacte, donnant ainsi à ses adversaires au sein du PSS le motif dont ils rêvaient pour se débarrasser de lui. Le Travail titre le 24 août sur " L’Union Soviétique au service de la paix ". Une semaine plus tard, Hitler se jette sur la Pologne. Le 17 septembre, l’Armée Rouge participe à la curée : la Guerre Mondiale a commencé. Mais le 5 septembre, Léon Nicole écrit encore dans Le Droit du Peuple que si l’on " crie " contre l’URSS, c’est parce qu’elle " a repris les terres que les impérialistes lui avaient ravies en 1918 " ; outre qu’une telle argumentation, purement " territoriale ", fait bon marché des principes de l’internationalisme prolétarien, la cause de Nicole est entendue pour le PSS depuis fin août, et le 8 septembre le Comité directeur du parti suisse propose son exclusion (elle sera effective huit jours plus tard) et celle des sections qui se déclareraient solidaires de lui ou conserveraient Le Travail ou Le Droit du Peuple comme organes officiels. Tel sera le cas des sections genevoises et de la majorité des sections vaudoises. Dans les cantons de Genève et de Vaud, l’exclusion des " nicolistes " lamine le mouvement socialiste (au point qu’il en reste encore des traces à Genève plus de soixante ans plus tard…). Les partis " officiels ", reconnus comme partis cantonaux par le PSS, sont totalement minoritaires, privés d’organes de presse, sans base réelle au-delà d’un cercle restreint de permanents syndicaux et de députés, et ne doivent leur survie qu’à la bienveillance de la droite démocratique et à la " perfusion " politique sous laquelle le PSS les place. D’élections en élections, la droite démocratique genevoise (notamment le Parti radical) va ainsi appeler, ouvertement ou non, ses propres électeurs à soutenir les candidats socialistes officiels contre les candidats " nicolistes ", bien plus représentatifs pourtant de l’électorat de gauche.
Justifié par la direction stalinienne du PCUS et de l’Internationale communiste (qui vit ses dernières années d’existence) comme un " exemple de l’exploitation des contradictions interimpérialistes " (Annie Kriegel, Les Internationales ouvrières, op.cit.biblio p. 108), le pacte de 1939 est évidemment présenté par ses contractants soviétiques comme une victoire du socialisme :
Cité par Annie Kriegel, in Les Internationales Ouvrières, ibid. pp 108, 109
L’Internationale communiste (c’est-à-dire la direction stalinienne du parti soviétique) justifie donc le pacte avec le nazisme au nom de la lutte contre la réaction ; Annie Kriegel relève (Annie Kriegel, ibid.) que, dans l’appel lancé par l’exécutif de l’IC à l’occasion du vingt-deuxième anniversaire de la Révolution d’Octobre, le nom de Hitler n’est pas prononcé alors que celui de Léon Blum est quatre fois honni ; que la bourgeoisie allemande n’est pas citée mais que les bourgeoisies française, britannique et américaine sont stigmatisées ; que le nazisme, enfin, n’est pas condamné alors que le démocratie bourgeoisies est dite " démasquée "… Aberrante attitude, que Staline lui-même finit par remettre en cause (mais en 1946, et sans bien sûr faire allusion à sa propre responsabilité dans le choix de 1939) en reconnaissant a posteriori que la Guerre Mondiale prit, " dès le début le caractère d’une guerre antifasciste, libératrice " (ibid.) -" dès le début ", c’est à dire dès 1939, dès l’alliance de facto entre l’URSS et le IIIème Reich, alliance justifiée par le discours rigoureusement inverse de celui tenu six ans plus tard, par les mêmes forces qui la passèrent.
Dans tous les pays occidentaux, les communistes subirent de plein fouet le choix du pacte. Jean Vincent témoigne de ce qui en fut en Suisse, tout en niant le caractère d’alliance de ce qu’il réduisait à un pacte de non-agression :
* exclusion du PSS : les communistes genevois avaient en effet collectivement adhéré au PSG après l’interdiction cantonale du PC.
Jean Vincent, Raisons de vivre, op.cit.biblio pp 119-121
Déstabilisateur pour les communistes et les socialistes de gauche, l’effet du pacte ne fut pas moindre sur ceux des socialistes " modérés " qui, si anticommunistes (ou antisoviétiques, ou antistaliniens) qu’ils fussent, ne désespéraient pas (encore) du caractère " socialiste " de l’URSS ; ainsi, Paul Golay :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit.blbio pp 126-128
Ainsi s’exprime Golay, le 30 août 1939 ; une semaine plus tard, le PSS " tranchait dans le vif " en décidant d’exclure de ses rangs Léon Nicole et en proposant d’agir de même avec tous ceux qui lui resteraient fidèles.
Léon Nicole, pour qui l’Union Soviétique était le " bastion de la lutte antifasciste ", eut semble-t-il quelque peine à croire en la nouvelle du pacte ; lorsque cette nouvelle ne put plus être mise en doute et attribuée à la propagande anticommuniste, il tenta de présenter le pacte comme un geste de paix, et prétendit même qu’il allait assurer… la sauvegarde de la Pologne -qui en fut la première victime : " La Pologne (…) serait protégée par la Russie, mieux assurément que ne le fut la Tchécoslovaquie par les capitulards de Munich ", écrit-il dans Le Droit du Peuple du 24 août. Le 17 septembre, la " protection de la Pologne par la Russie " se traduit en actes : l’Armée Rouge prend sa part du dépeçage entamé par la Wehrmacht deux semaines auparavant. Il ne s’agit plus alors que de stratégie d’Etat : l’URSS s’accorde une marche élargie en repoussant à l’ouest un éventuel front germano-soviétique (telle sera du moins l’explication, ou la justification, donnée du pacte par les Soviétiques, après 1941).
Reste de tout cela que, pour tous ceux qui voyaient en l’URSS l’adversaire le plus résolu du nazisme, le pacte de 1939 fut " contre-nature ", conclu entre l’ " Etat soviétique des ouvriers et paysans " et le Reich hitlérien ; pour la gauche modérée, il s’agit d’un pacte qui provoque la guerre et " trahit, après 15 jours, les visées territoriales soviétiques en Pologne " (Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 168) sans que Léon Nicole ne démorde pour autant de son prosoviétisme. Cette fidélité même ne sera pas sans accroître encore l’argumentaire de ses adversaires au sein du PSS : " La politique de Léon Nicole est inspirée par un sentiment qui domine tous les autres : rester fidèle à Staline, quoi qu’il arrive " (ibid.), écrit Pierre Graber (secrétaire romand du PSS, futur Conseiller fédéral, et fils de son père). A vrai dire, ce n’est pas tant à Staline que Nicole est fidèle, qu’à l’URSS : Trotsky eût-il réussi à prendre le pas sur le Géorgien que Nicole lui eût été tout aussi " fidèle " -et eût alors considéré le vaincu de cette hypothèse comme il considéra le vaincu de l’Histoire : Vae Victis !
L’argumentation " nicoliste ", paraphrase de celle des communistes, justifie ainsi le pacte de plusieurs manières -qui, toutes, apparaissent aujourd’hui comme erronées, voire purement mensongères, selon que l’on accorde ou non à ceux qui la présentent le bénéfice de la bonne foi. Pierre Jeanneret les résume et les confronte à la réalité :
2) Le deuxième argument concerne la responsabilité écrasante des démocraties occidentales dans l’échec du pacte anglo-franco-soviétique (…). Il est vrai que les puissances occidentales avaient contribué au " sabotage " des pourparlers par leur évidente mauvaise volonté, leurs tergiversations, leur incapacité à offrir à Staline un engagement militaire massif à l’Ouest en cas de conflit. (…) La France et la Grande-Bretagne n’avaient envoyé à Moscou que des diplomates de deuxième rang, ne disposant pas des pleins pouvoirs pour signer quelque engagement que ce fût. (…) Hitler dépêchera par avion son Ministre des Affaires étrangères Ribbentrop. Enfin, l’aveugle obstination de la Pologne qui -non sans quelque raison, il est vrai- se refusait à envisager le passage des troupes soviétiques sur son sol. fut définitivement capoter l’Accord tripartite le 21 août. Sur les responsabilités de l’échec du pacte d’assistance mutuelle, l’historien contemporain peut souscrire à la thèse soviétique.
3) L’URSS, selon le troisième argument, restait hors du conflit et sauvegardait ainsi " ses conquêtes sociales et l’espoir qu’elles représentent " (Jeunesse Socialiste de La Chaux de Fonds). (…) Quand l’URSS fut à son tour entraînée dans le conflit généralisé, le 21 juin 1941, par la ruée des Panzerdivisionen hitlériennes, cette thèse se mua en celle du répit : " Nous avons assuré la paix à notre pays pendant un an et demi " expliqua Staline le 3 juillet 1941 dans une allocution radiodiffusée (…).
Les spécialistes de l’histoire militaire discutent aujourd’hui encore ce point controversé. Sans doute le Pacte avait-il assuré un délai et donné à l’Armée Rouge affaiblie par les purges staliniennes le temps de se réorganiser. Sans doute avait-il permis aux armées soviétiques d’occuper des positions défensives avancées ainsi que des bases dans les Etats baltes et en Finlande. (…) Mais on peut retourner l’argument : en 1941, l’URSS se retrouvera quasi seule à supporter le poids des armées allemandes. Le Pacte en supprimant le risque de double front avait permis à Hitler de liquider en 1940/41 tous les alliés potentiels de l’URSS, à l’exception de l’Angleterre.
4) La première conséquence du Pacte fut l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, avec l’accord passif et bientôt la participation active de l’Union Soviétique au démembrement. Les communistes et Nicole, reprenant de manière mécanique le jugement de Lénine sur la première guerre mondiale (…) justifièrent aussitôt cette première conséquence du traité par la thèse de la lutte entre les impérialismes et les fascismes rivaux : " La Russie a donc décidé de demeurer neutre dans un conflit mettant aux prises deux capitalismes, celui de Londres d’une part, et de Berlin de l’autre, et deux fascismes, celui de Berlin d’un côté et de Varsovie de l’autre " (Léon Nicole). (…) cette neutralité était en contradiction absolue avec les affirmations de Léon Nicole des 22/23/24 et 25 août : " Au dix-huitième congrès du Parti communiste à Moscou, le 10 mars de cette année, il a été dit par Staline que la Russie apportera son aide aux peuples victimes d’une agression et luttant pour leur indépendance. (…) L’Allemagne devenant l’agresseur, sait que cette promesse de la Russie, aux pays victimes d’une agression, sera tenue ". Certes, le refus catégorique de toute aide soviétique par le colonel Beck (…) justifiait dans une certaine mesure la neutralité soviétique. Pouvait-on lui reprocher de n’être pas intervenue contre la volonté de l’Etat qu’elle prétendait défendre ? … Si la passivité soviétique était donc pleinement justifiable, en revanche l’invasion du pays par l’Armée Rouge (…) était de nature à choquer les militants de la gauche. (…) L’Union Soviétique ne reprenait-elle pas à son compte la politique impérialiste traditionnelle des Tsars ? Communistes et nicolistes recoururent donc aux arguments suivants :
(…) Le thème d’Hitler dupe de Staline revient fréquemment dans la presse bourgeoise. Hitler et le nazisme cessent d’être le rempart de la civilisation contre le bolchévisme. La Tribune de Lausanne (…) constate que (…) " Le nazisme a frayé la voie à la soviétisation de la Pologne et demain peut-être à la bolchévisation de l’Europe centrale ".
5) Communistes et nicolistes participent enfin d’une illusion : la croyance en la transformation de l’Allemagne hitlérienne dans un sens prolétarien, sous l’effet de l’entente avec l’URSS (…). Utopie qui sera démentie par le plus sinistre corollaire du Pacte : la livraison à la Gestapo des communistes allemands réfugiés en URSS. (…) Il est vrai que ces phantasmes politiques sont partagés par des notables du socialisme officiel. Le Droit du Peuple attribue à Walther Bringolf cette déclaration : " Il ne serait pas étonnant que demain ou dans quelques mois Hitler et Goering proclament la révolution soviétique pour l’Allemagne " (28.IX.1939). Cette assimilation, par osmose, du communisme soviétique et du " socialisme viril " amènera Léon Nicole à une troublante dérive fascisante.
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. pp 169-173
C’est sans doute trop dire que parler d’une " dérive fascisante " de Nicole, mais ce genre de déclarations fut en tous cas d’un précieux secours à ceux qui depuis des années rêvaient de se débarrasser (politiquement) de leur auteur. Quoi qu’il en soit de l’argumentation de la gauche socialiste, en Suisse comme dans toute l’Europe, la réaction des partis socialistes face au pacte fut la même, et mêmement immédiate : condamnation du pacte, rupture avec les communistes -là où il y avait quelque chose à rompre-, sanctions contre les tendances de gauche fidèles à l’argumentation soviétique. En France (en guerre avec l’Allemagne depuis le 3 septembre), le PC est interdit, ses militants pourchassés par une police dont le ministre de tutelle (Sérol) est socialiste. En Suisse, la circulaire adressée le 8 septembre par le PSS à ses sections et partis cantonaux est sans ambiguïté :
Circulaire du PSS du 8 septembre 1939 (archives du PSG)
Le PSS a dans cette affaire beau jeu d’utiliser les voltes-faces staliniennes pour disqualifier ceux qui, invariablement, défendent les choix les plus contradictoires dès lors qu’ils sont ceux de Moscou. Et ce sera aussi au nom de l’ " honneur du socialisme " que l’on va proposer l’exclusion de Nicole et des siens. Golay :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 129, 130
A ses sections, à ses partis cantonaux et à ses membres, le PSS explique donc que
Circulaire du Parti socialiste suisse du 8 septembre 1939 (archives du PSG)
Pour rendre plus claire encore l’invite (illusoire) faite au PSG de se désolidariser de son leader, le PSS énumère les mesures qu’il s’apprête à prendre contre Nicole, son journal et l’ensemble du parti genevois si celui-ci ne rompt pas avec le premier et ne repourvoit pas à la direction du second :
Circulaire du PSS du 8 septembre 1939, op.cit.
Ces menaces, le PSS devra les concrétiser : la circulaire du Comité directeur n’eut aucunement l’effet que certains attendaient encore, la plupart des membres de la direction nationale du parti ne se faisant cependant aucune illusion sur son efficacité. La majorité des membres des partis cantonaux genevois et vaudois, et de fortes minorités dans le reste de la Romandie, refusèrent de céder au Diktat central et furent donc exclus du PSS. Officiellement, l’exclusion fut prononcée pour fait d’alignement sur l’Union Soviétique, mais comme on le sait, ce motif avoué en recouvrait bien d’autres, implicites. Les " staliniens " de la gauche socialiste, et à plus forte raison encore les communistes, furent ainsi victimes, consentantes, de leur " patriotisme soviétique " -un " patriotisme " à la fois exalté (comme un devoir) et dénoncé (comme une régression intellectuelle) par quelqu’un dont ils refusaient d’entendre quoi que ce soit, Trotsky :
Léon Trotsky, L’Internationale Communiste après Lénine, op.cit.blbio p. 167
Ainsi donc, la gauche nicoliste, confite en " patriotisme révolutionnaire " (entendez : soviétique), repousse l’ultimatum du PSS ; pouvait-elle, d’ailleurs, s’y soumettre sans se renier ? A Genève bien sûr, à Lausanne, mais aussi (quoique le plus souvent minoritairement) dans toute la Romandie, les conditions du PSS sont repoussées avec véhémence. Le " nicolisme ", en tant que volonté d’unité avec les communistes, n’est d’ailleurs pas confiné à l’ " arc lémanique " ; à Neuchâtel, le soir même où la signature du traité germano-soviétique était rendue publique, Georges-Henri Pointet exaltait dans une conférence la " volonté de paix " de l’URSS ; à La Chaux de Fonds, il faudra que le PSN exclue toute la Jeunesse socialiste locale ; en Valais, Karl Dellberg, sans se solidariser explicitement avec Nicole, critique son exclusion par le parti suisse… Rien n’y fera : le 16 septembre 1939, le Comité central du PSS décide l’exclusion des " nicolistes " -et donc, de facto, des partis socialistes cantonaux de Genève et de Vaud. Le Secrétaire du parti pour la Romandie (où il faudra, dans les deux principaux cantons, recréer des partis cantonaux officiels à partir d’une toute petite minorité de membres des partis exclus), Pierre Graber, a établi un accablant recueil de citations " prosoviétiques " émanant du Travail. Léon Nicole présente lui-même sa défense devant le " parlement " du parti : il conteste la validité de la procédure, " se pose en victime d’un marchandage entre la bourgeoisie et le Parti socialiste : la liquidation de Nicole contre un siège au Conseil fédéral " (Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission…op.cit.biblio p. 179) et insiste sur le soutien dont il dispose à Genève et en Pays de Vaud.
Au vote final, Nicole est exclu du PSS par 44 voix contre 5 (les deux Genevois Dicker et Schumacher, le Lausannois Masson, le Bernois Giovanoli et le Saint-gallois Hugo Kramer, rédacteur de la Volkstimme, qui exprimera sa crainte de l’ouverture d’une chasse aux sorcières nicolistes dans le PS). Paul Golay, si antisoviétique qu’il soit, et si vigoureuse que fut sa dénonciation du pacte, s’abstiendra, comme Karl Dellberg. Le 22 septembre, un recours est adressé au Congrès du PSS, instance suprême du parti. Sans attendre d’être fixé sur le sort qui sera fait à son recours (et ne se faisant d’ailleurs aucune illusion à ce sujet), la gauche genevoise se casse en deux -mais en deux part fort inégales. Pierre Jeanneret relève que " l’échéance des élections fédérales du 17 octobre 1939 accélère la formation de deux parti socialistes genevois antagonistes " (Jeanneret, ibid.) : le 29 septembre, l’Assemblée des délégués du PSG, en présence d’un bon demi-millier de sympathisants (non membres du parti) venus là pour témoigner de leur soutien à " Léon ", le réélit à l’unanimité et par acclamations à la présidence du Parti. La minorité " de droite ", désormais en charge de la reconstitution d’un parti cantonal " officiel " du PSS, s’organise de son côté : le 2 octobre, le Parti Socialiste de Genève, " section reconnue du Parti Socialiste Suisse ", est fondé. Charles Rosselet en sera président, André Oltramare vice-président, Alexandre Berenstein secrétaire. Fortes têtes, mais maigres troupes : moins d’une centaine de membres. Le 14 novembre 1939, au soir des élections cantonales, le PSG " nicoliste " obtiendra 28 sièges, Nicole étant élu en tête de liste, et le PsdG " officiel " tout juste sept, en passant de peu, sans doute grâce à la complaisance électoral d’une partie de la droite, la limite du quorum au dessous duquel il n’aurait même pas été représenté au parlement cantonal. Tel est à l’automne 1939 le rapport des forces à Genève : un parti " nicoliste " hégémonique à gauche, face à un parti " rosseletiste " qui ne doit son existence parlementaire qu’au soutien discret d’une partie de la droite démocratique. Ce sera, pour reprendre l’expression de Pierre Jeanneret, le " temps des anathèmes " :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission, op.cit. p. 180
Les " nicolistes " vont ainsi traiter E.-Paul Graber d’ " esprit servile et mal équilibré ", accuser André Oltramare de vouloir devenir le " Gauleiter socialiste de Genève (avec) l’appui secret des capitalistes et impérialistes ", assimiler la politique préconisée par Alexandre Berenstein aux " pires intrigues trotskistes " et désigner Charles Rosselet comme étant " notre Doriot national " ; les socialistes " officiels " ne font pas preuve de beaucoup plus de retenue : " Un immonde s’écroule : Léon Nicole ! ", jubile Le Peuple du 3 juin 1940, pour qui le leader genevois n’est que " cupide de gloire ". Au Grand Conseil, le communiste Jean Vincent et Charles Rosselet en viennent aux mains, le 20 avril 1940…
Que la très grande majorité des socialistes genevois restassent fidèles à Léon Nicole n’eut rien pour surprendre la direction du PSS, qui s’y attendait et s’était résignée à n’avoir plus à Genève qu’un fantôme de parti cantonal : " Quelque préjudice qu’elle portât aux forces du socialisme en Suisse romande ", l’exclusion collective de la plupart des socialistes genevois " était (pour le PSS) le prix à payer pour une clarification devenue nécessaire " (Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 181). En revanche, qu’une majorité " nicoliste " se dessinât en Pays de Vaud fut une douloureuse surprise. La gauche socialiste vaudoise avait réagi à la circulaire du PSS du 19 septembre par la convocation d’une " assemblée d’information " (statutairement sans pouvoir de décision) le 24 septembre ; cette assemblée, dont les animateurs affirmèrent qu’elle représenta près de 80 % des membres du PSV, se solidarisa avec Nicole (tout en se distançant quelque peu de son pro-soviétisme acritique) et appela à la résistance au " Diktat de Zurich " (utilisation quelque peu démagogique, mais politiquement efficace, du sentiment cantonaliste vaudois). Le 28 septembre, le PS lausannois se prononça officiellement par 106 voix contre 16 en faveur de la gauche nicoliste, et le 1er octobre 1939 se tinrent deux congrès socialiste vaudois, l’un " nicoliste " et l’autre " officiel ".
Lors du congrès " nicoliste ", Maurice Jeanneret-Minkine dénonça une " conjuration " destinée à tuer la presse socialiste vaudoise et genevoise. Le congrès, qui affirme être celui d’un PSV " maintenu ", exclut Paul Golay, révoque le rédacteur en chef du Droit du Peuple, Albert von der Aa, et dénonce (puis exclut) Pierre Graver. " En face ", le congrès " officiel " réunit péniblement une trentaine de personnes, " essentiellement (des) mandataires et (des) responsables syndicaux " (ibid.). Lui aussi affirme être le congrès du PSV -le seul, le vrai, l’officiel, le seul reconnu par le PSS. Paul Golay sera élu à la présidence d’un parti " reconstitué " par le congrès, qui condamne le Pacte et accuse Léon Nicole de se prendre pour un Führer, un demi-dieu et un sauveur. De part et d’autres, on ne fait guère dans la nuance…
A Genève et Lausanne, la scission consommée, la lutte entre les partis socialistes " nicolistes " et " officiels " va avoir pour premier enjeu le contrôle de la presse socialiste, Le Travail à Genève, Le Droit du Peuple à Lausanne. Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 185
Les socialistes " officiels " se lancèrent donc dans une offensive contre les deux quotidiens " nicolistes " (à vrai dire, il s’agissait plutôt d’un quotidien et demi, Le Droit du Peuple n’étant guère qu’une édition vaudoise du Travail), propriétés de l’Union de Presse Socialiste de Lausanne et Genève majoritairement en mains " nicolistes ", mais devant se faire imprimer sur des presse qui, elles, étaient aux mains des " modérés ". Faute de pouvoir déloger politiquement de cette position forte au sein de la presse du parti, les "socialistes " officiels " usèrent de l’arme économique : la presse socialiste était en effet débitrice (pour environ 120'000 FS de l’époque) des Imprimeries Populaires contrôlées par les partisans du PSS, et présidées par Charles Rosselet. L’imprimerie cessa donc purement et simplement d’éditer les deux quotidiens socialistes, lesquels étaient dans l’impossibilité de régler leur dette. Le Travail et Le Droit du Peuple devinrent dès lors, et jusqu’à leur interdiction pure et simple à l’été 1940, des publications à la parution irrégulière et à la pagination réduite. Le 17 septembre, vingt-deux sections locales du PS genevois (celui de Nicole) fondent une imprimerie coopérative (l’actuelle Coopérative d’Imprimerie du Pré-Jérôme). Pendant une année, néanmoins, les publications de la gauche socialiste devront être imprimées à Bâle, avec tous les problèmes liés à la guerre (difficultés de transport, difficultés matérielles, raréfaction des militants due à la mobilisation générale). Le 1er juillet 1940, la nouvelle imprimerie est prête à fonctionner… mais quatre jours plus tard, les deux quotidiens sont interdits par le Conseil fédéral. Le 9 avril 1941, c’est l’imprimerie elle-même qui sera saisie, et ses responsables traduits devant les Assises fédérales.
La presse socialiste officielle n’est pas préservée des difficultés matérielles : le nouveau quotidien socialiste officiel, Le Peuple, devra être sauvé en catastrophe après quelques mois de parution, par un accord faisant intervenir les syndicats et le quotidien socialiste de La Chaux de Fonds, La Sentinelle, dont il deviendra une sorte d’édition régionale lémanique.
La scission de 1939 n’aura pas d’effets qu’à Genève et Lausanne. Dans toute la Romandie, mais également en Suisse alémanique, le PSS subit le choc, et le mouvement syndical également -mais le parti plus que le syndicat, la Romandie bien plus que l’Alémanie et le Tessin, Genève et Lausanne plus que le reste de la Romandie. L’automne 1939 fut celui de la scission, même là où les " nicolistes " étaient minoritaires et où une solide tradition social-démocrate pouvait laisser espérer en une limitation des dégâts. Ainsi, à Neuchâtel, où la Jeunesse Socialiste s’était de fait constituée en une tendance de gauche, au point d’être devenue (selon E.-P. Graber) un " centre nicoliste et communisant " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 187), certains de ses membres, tel André Corswant, étaient clandestinement membres du PC, tandis que les communistes pouvaient y adhérer sans problème, et que le Front Antifasciste et les Amis de l’Espagne Républicaine servaient de " passerelle " entre la gauche du PS et les communistes… Sitôt le pacte germano-soviétique signé, la direction du PSN, fidèle au PSS, organise le " nettoyage " du parti cantonal. Le 13 septembre, le parti municipal chaux-de-fonnier approuve par 57 voix contre 17 l’exclusion de Nicole ; le 4 octobre, il réaffirme par 101 voix contre 8 son soutien aux décisions du PSS. La Jeunesse Socialiste soutient Nicole ? La droite du parti (Henri Jacquet, René Robert) exige sa dissolution. Le " centre " (E.-P. Graber) temporise : le PSN imposera à son organisation de jeunesse une stricte discipline lui interdisant de prendre des initiatives d’ordre politique et limitant les possibilités d’y adhérer par l’imposition d’un âge maximum de 20 ans. A La Chaux-de-Fonds, le parti municipal exclut purement et simplement la JS locale (le PSS fera de même le 11 février 1940 à l’égard de la Jeunesse Socialiste Suisse, qui avait soutenu Nicole).
Pierre Jeanneret résume la situation neuchâteloise :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission…, op.cit. p. 190
Solidement installée aux commandes du PS cantonal et des sections locales dans le canton de Neuchâtel, la " droite " social-démocrate n’y est nullement en peine d’éliminer la gauche socialiste. Tel ne sera pas le cas en Valais, où Léon Nicole jouit d’une grande popularité et où Karl Dellberg ne manifeste guère plus de cordialité que son camarade genevois à l’égard de la direction du PSS. Encore embryonnaire, marginal, dominé (comme à Genève, mais dans un contexte totalement différent) par la personnalité ombrageuse de son leader, le socialisme valaisan réagit très négativement aux décisions du PSS, tout en décidant finalement de ne pas rompre avec le parti national. Le 16 septembre 1939, le Comité cantonal valaisan demande au PSS de revenir sur sa décision d’exclure Nicole : " En vous attaquant à la personnalité du camarade L. Nicole, vous atteignez l’âme du parti tout entier en Suisse romande " (Jeanneret, op.cit. p. 190). Six mois plus tard, le 31 mai 1940, le parti valaisan décide pourtant de rester au sein du PSS (ostracisé en Valais, il a besoin de cet appui national) et de ne pas adhérer à la Fédération Socialiste Suisse. Une éphémère dissidence nicoliste, le Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, témoignera de l’influence directe de Nicole, de 1940 à 1943, mais en Valais cette influence se heurte à celle de Dellberg -conflit non pas idéologique, puisque les deux hommes sont finalement assez proches l’un de l’autre sur ce plan, mais conflit de personnalités : ces deux crocodiles ne peuvent vivre ensemble dans le même marigot. Le Genevois le comprendra et tentera par la suite d’établir avec le Valaisan une alliance qui eût permis de faire basculer le PS-VS tout entier. Dellberg se gardera bien de toute rupture, avec qui que ce soit : il restera (et maintiendra le PS-VS) au sein du PSS, tout en collaborant régulièrement avec la gauche socialiste, et en participant même, le 13 juin 1943, au congrès de fusion de la Fédération Socialiste Suisse et du Parti communiste suisse (la " Noce des interdits ", qui donnera naissance du Parti du Travail.
Dans le canton de Fribourg et dans le Jura bernois, il ne semble pas que la gauche " nicoliste " ait pu compter sur une réelle implantation ; point de scission, donc, mais des départs individuels.
Quant à la Suisse alémanique, si le conflit entre l’aile gauche du parti, sa direction " centriste " et son aile " droite " n’y fut certes pas moins aigu qu’en Romandie, le " cas Nicole ", pour d’évidentes raisons culturelles (plus précisément : linguistiques) n’y fut pas prétexte à rupture -ce qui ne signifie pas pour autant qu’il y fut tenu pour négligeable : l’exclusion collective du parti cantonal d’une ville de l’importance de Genève, la scission du parti cantonal dans un canton du poids de celui de Vaud, le trouble politique provoqué dans toute la Suisse romande, eurent un impact national. L’épicentre est romand, mais le séisme est tout de même ressenti dans le reste du pays. La gauche socialiste alémanique s’opposa évidemment aux mesures frappant le leader genevois, son parti cantonal et ses camarades romands, mais elle avait une autre histoire, était " guidée " par d’autres références et reposait sur d’autres bases que la gauche romande. La Jeunesse Socialiste d’une part, L’Opposition Socialiste (SPO) d’autre part, manifestèrent donc à la fois leur solidarité et leurs différences avec Nicole. S’agissant de la JS, le conflit avec la direction du PSS est une constante de l’histoire de l’une et de l’autre, jusqu’à nos jours, quelque variété qu’il prît. Toujours plus à gauche que le parti, toujours plus tentée que lui par les solutions radicales, cultivant le romantisme révolutionnaire, antimilitariste, opposée au " consensualisme " helvétique, la JS ne cessera, dès le début du siècle, de pousser son autonomie jusqu’aux limites de l’indépendance pure et simple. La rupture entre le PSS et la JSS, entre les partis cantonaux et les JS cantonales, est à plusieurs reprises envisagée, mais toujours évitée -jusqu’en 1940, où elle finira par se produire, et aboutir à la même sanction que la rupture entre Nicole et le PSS : l’exclusion collective. Sous l’apparence (et parfois la réalité) d’un " conflit de génération ", c’est bien d’un conflit de cultures politiques dont il s’agit.
Les rapports entre le parti et son organisation de jeunesse ont toujours été déterminés par deux soucis contradictoires : celui du parti de contrôler une organisation qu’il finance et dont l’audience est fonction de ses liens avec lui, et celui de la JS d’être la plus autonome possible de lui ; Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 212
Entre la volonté du parti de contrôler la JS et la volonté de la JS d’être indépendante du parti, un compromis devra être trouvé ; la recherche de ce compromis sera d’ailleurs une constante de l’histoire centenaire des rapports entre le PSS et la JSS. En 1934, une convention avait été établie : la JS reconnaissait devoir respecter les choix politiques fondamentaux du PSS, auquel ses membres devaient adhérer dès leur vingtième année. Mais cette convention, comme toute autre, ne valait qu’en l’absence de motifs et de situations de conflits ; or le temps, précisément, était aux conflits. Une " cellule trotskiste " entre dans la JS (et en est exclue peu après) ; Léon Nicole jouit auprès des jeunes socialistes d’une popularité certaine, et ses positions, sur l’essentiel (crédits militaires, participation au Conseil fédéral, unité populaire entre socialistes et communistes) rejoignent celles de la JSS. Résultat : la JS romande, dirigée par le " cryptocommuniste " André Corswant (les communistes ayant à Neuchâtel et Zurich adhéré à la JS) soutient fermement Nicole, et soutiendra fermement la Fédération Socialiste Suisse. Les JS alémaniques, moins touchées par le " phénomène Nicole " que les romandes, n’en sont pas moins sur la même ligne politique que le Genevois.
Poussant à son terme logique sa volonté d’autonomie, la JSS réclama, lors de son congrès de 1940 (tenu à Zurich) le droit de mener sa propre politique, jusqu’à la possibilité pour ses membres d’adhérer à la Fédération Socialiste Suisse " nicoliste " au même titre qu’au PSS lui-même. ce sera pour ce dernier le prétexte de la rupture : le 11 février 1940, le Comité central du PSS " prend acte " du fait que la JSS s’est "elle-même érigée en organisation indépendante du parti, et en tire la conclusion qu’y adhérer est désormais incompatible avec la qualité, exclusive de toute adhésion à une autre organisation politique, de membre du PSS. Une nouvelle Jeunesse Socialiste sera reconstituée, l’ancienne étant finalement purement et simplement interdite, le 27 janvier, par le Conseil fédéral.
Quant à l’Opposition Socialiste (SP-Opposition), elle affirme son existence le 1er août 1940 par un manifeste, et est interdite par le Conseil fédéral le 5 septembre 1941 : " Agissant dans une semi-illégalité (…), son importance fut modeste et son existence fut brève. Elle resta étrangère à la scission en Suisse romande et n’adhéra jamais à la Fédération Socialiste Suisse " (Jeanneret, op.cit. p. 214). Néanmoins, il y a nombre de points communs entre elle, en tant qu’opposition de gauche en Suisse alémanique, et le " nicolisme " romand. Le Bernois Harry Gmür et l’Appenzellois Werner Nef sont les chefs de file de la SPO. L’un et l’autre dénonce l’aggiornamento réformiste du mouvement ouvrier suisse, et l’antisoviétisme obsessionnel de son aile droite. Après la signature du pacte germano-soviétique et la " purge " qui en prend prétexte, cette gauche alémanique se solidarise avec la gauche romande. Le 1er août 1940, le " Manifeste de Brunnen " exprime en effet le même credo que Nicole :
Pierre Jeanneret, op.cit. p. 216
Ce manifeste n’aura guère d’écho, ni la SPO de succès. Le manifeste fut interdit de publication au nom du respect de l’arrêté fédéral du 6 août 1940 contre les activités " communistes et anarchistes ". Le SPO elle-même fut interdite au même prétexte le 5 septembre 1941. Elle n’avait pas réussi à s’implanter réellement dans les bastions de la gauche socialiste alémanique (Zurich, Bâle, Schaffhouse), ni n’avait réussi à établir avec la Fédération Socialiste Suisse des rapports stables. Fort symboliquement, c’est à la périphérie, en Appenzell, que la SPO obtint le plus de succès… Phagocytée par le PC, elle en suivra l’évolution, et en subira le destin.
Reste, enfin, à évaluer l’impact de la scission de 1939 au sein du mouvement syndical social-démocrate (ou " trade-unioniste "), c’est-à-dire de l’USS, dont les choix politiques précédèrent régulièrement ceux du PSS sur la voie d’un réformisme et d’un " participationnisme " dont la Paix du Travail fut la manifestation symbolique et le projet des " Communautés professionnelles " l’expression ultime. La montée des fascismes (nazisme inclus) avait encore renforcé le tentation d’une alliance avec la droite démocratique, et l’USS avait pesé de tout son poids sur le PSS pour qu’il adoptât cette même attitude. Le stalinisme avait de plus conforté le solide anticommunisme de l’aile majoritaire de l’USS, désormais aussi férocement opposée au PC et à ses partisans (ou à ses compagnons de route) qu’au corporatisme catholique. Le PC avait cru bon et efficace de se lancer en 1927 dans la constitution au sein de l’USS d’une " Opposition syndicale révolutionnaire ", dotée d’un journal, der Rote Gewerkschafter (le Syndicaliste rouge), dont le style " triomphaliste " (Jeanneret) était en raison inverse de l’audience. L’OSR avait été dissoute en 1936, par le PC lui-même, lors de l’adoption de la ligne de " front populaire " par les communistes suisses, mais cette dissolution ne fut en réalité qu’un constat de l’échec de la stratégie " fractionniste ", et ne changea strictement rien aux sentiments de l’USS à l’égard des communistes.
En Romandie, toutefois, une forte opposition à la ligne officielle de l’USS se manifestait, mais sans que les communistes y fussent pour grand chose : cette opposition se nourrissait essentiellement d’une tradition libertaire, particulièrement vivace dans le bâtiment avec des hommes comme Lucien Tronchet ou Clovis Pignat, mais parfois " en phase " avec l’opposition socialiste " nicoliste " dans les centres urbains de Genève et Lausanne -même si l’anticommunisme (au sens d’antiléninisme et d’antistalinisme) des libertaires les opposaient régulièrement aux " nicolistes ", et si les contradictions entre les actions des premiers et les politiques des seconds s’accentuèrent lors du " gouvernement socialiste " genevois de 1933-36. Ce " syndicalisme de gauche ", teinté de syndicalisme révolutionnaire, dénonçait violemment la " bureaucratisation " de l’USS, les " pontes syndicaux ", les " compromis avec le patronat ", alors que les dirigeants de la droite syndicale clouaient le " moscoutaire " Nicole au pilori, ne se privant pas d’y mettre une particulière Schadenfreude alors qu’il était traîné par la droite politique genevoise et suisse devant les Assises fédérales, après le 9 novembre 1932, au point que le PSS dut s’interposer entre deux quotidiens socialistes (La Sentinelle et Le Travail) pour faire cesser une polémique de plus en plus violente entre eux.
La scission du PS aura d’importantes répercussions au sein des cartels syndicaux USS genevois et vaudois. Nombre de responsables syndicaux étaient aussi militants socialistes (et, dans une moindre mesure, réciproquement) ; la capillarité entre les organisations ouvrières (parti, syndicat, organisations culturelles, sportives, d’entraide etc…) ne pouvait qu’avoir pour conséquence une diffusion de la scission à chacune d’entre elles. La lutte entre les deux tendances du parti se résout donc en une lutte pour le contrôle des cartels syndicaux : le 28 février 1940, les partisans de l’USS (et du PSS) perdent le contrôle de l’Union syndicale lausannoise, dont le " nicoliste " Henri Jordan prend la présidence. Le 17 avril 1940, mêmes causes, mêmes effets à Genève, où malgré tout son prestige personnel, Charles Rosselet perd la présidence de l’Union des Syndicats, au profit du " nicoliste " René Novel. L’USS n’a d’autre ressource que d’exclure collectivement les cartels syndicaux genevois et lausannois (pour les reconstituer ensuite), comme le PSS avait du exclure collectivement les partis cantonaux genevois et vaudois.
Le succès " interne " des " nicolistes " au sein de l’USCG et de l’USL est, certes, explicable par l’influence exercée sur la classe ouvrière genevoise et lausannoise par un Nicole ou un Jeanneret-Minkine ; il n’en est pas moins surprenant, tant le débat et le contexte syndicaux pouvaient paraître différents du débat et du contexte partisans. Non seulement les problèmes immédiats (le chômage, les bas salaires, l’impact de la mobilisation sur les conditions de vie des couches populaires) étaient supposés prendre le pas, dans les syndicats, sur les débats de " haute politique " (stratégie d’union avec les communiste, " question soviétique "), mais la gauche socialiste était de plus combattue aussi rudement dans les syndicats sur sa gauche que sur sa droite. A Genève comme à Lausanne, des syndicalistes issus du mouvement libertaire (Lucien Tronchet, Adrien Buffat) pouvaient personnifier une opposition à la fois au stalinisme et au réformisme social-démocrate. Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission…, op.cit. pp 197, 198
Dans les autres fédérations syndicales, où la tradition libertaire d’indépendance absolue du syndicat par rapport aux partis était beaucoup plus diffuse -quand encore elle existait, ou subsistait- le conflit finit par se résoudre en exclusions : la gauche syndicale est ainsi exclue de la FOMH (métallurgie et horlogerie) genevoise en avril 1940 ; la VPOD (services publics) romande éclate. Boutés hors du syndicat majoritaire, sans possibilité réelle de créer une nouvelle force syndicale (ce qui eût d’ailleurs été parfaitement contradictoire de la stratégie, menée -avec quelques pauses sectaires- pendant vingt ans, d’ " entrisme " au sein de l’USS, sans alternative acceptable à l’USS (les syndicats catholiques, " courroie de transmission " de l’église et des partis catholiques conservateurs au sein de la classe ouvrière, ne pouvant en tenir lieu), les " nicolistes " et les communistes vont tenter de compenser par une suractivité " à la base " leur défaut d’influence " au sommet ". C’est dans les commissions ouvrières, là où elles existent, et au sein des associations culturelles et sportives (le " sport ouvrier " Satus, les musiques ouvrières, etc…) que vont se réfugier les militants de la gauche exclue -de quoi nous vient par exemple cette tradition genevoise d’un Parti du Travail dont la pérennité, et parfois les succès électoraux, tiennent plus à sa présence dans les " milieux sportifs ", gérés (cajolés) au plan municipal depuis un quart de siècle par un magistrat communiste (Roger Dafflon, puis André Hediger) qu’à l’adhésion de son électorat à un discours ou une tradition communiste.
Catastrophiques à Genève et Lausanne, graves dans toute la Romandie, faibles et inégaux en Alémanie, imperceptibles au Tessin, quels furent, quantitativement, les effets de la scission de 1939 ? Deux mesures sont possibles : la mesure électorale (résultats obtenus lors des élections nationales de 1939 et de 1939) et la mesure militante (effectifs du PSS, encore qu’il faille se garder de confondre membres et militants). Pierre Jeanneret s’est livré à une attentive étude des effectifs du PSS et de ses sections ; nous en reprendrons ici l’essentiel :
Depuis 1933, le PSS perd des membres chaque année : ses effectifs passent de 57'227 membres en 1933 à 50'599 membres en 1936, 42'859 en 1938. En 1939, le parti ne compte plus que 37'156 membres. En 1940, il n’en compte plus que 32'856. Le recul est donc constant, et la scission de 1939 ne l’a qu’accéléré (on reste dans un ordre de grandeur de 5000 membres perdus par an de 1936 à 1940, mais sur un nombre total de plus en plus bas -la proportion des pertes augmentant par conséquent). Le chômage, la gêne financière (les effectifs du parti sont ceux de ses membres cotisants), jouent un rôle probablement aussi important que les tensions internes. Mais au-delà des effectifs globaux, nationaux, les variations cantonales révèlent d’impressionnantes disparités : de 1938 à 1940 (du PSG de Nicole au PSdG de Rosselet), le PSS perd 93 % de ses effectifs à Genève : de 1425 membres en 1938, il passe à… 89 en 1940. Dans le canton de Vaud, le PSS perd 85,7 % de ses effectifs (il passe de 1456 à 207 membres). Même le PS valaisan de Dellberg est durement secoué, et perd 77,5 % de ses effectifs. La chute est brutale, et massive : le PSS se retrouve dans ces trois cantons marginalisé par ceux dont il voulait se débarrasser. Dans le reste de la Romandie, toutefois, l’effet de la scission est moindre : le PS fribourgeois et le PS neuchâtelois perdent le tiers de leurs effectifs entre 1938 et 1940, mais ce recul, qui n’est qu’une manière de poursuite du recul entamé les années précédentes, est dû surtout à des causes matérielles (la mobilisation de 1939, les difficultés financières de nombreux membres).
Quant à l’impact électoral de la scission, il est du même type que son impact militant : contenu au plan suisse, il est catastrophique dans les deux cantons " nicolistes " de Genève et Vaud. En 1939, le PSS avait récolté en moyenne nationale les suffrages de 28 % des électeurs, et obtenu 50 sièges au Conseil national. En 1939, il obtiendra encore 25,9 % des suffrages au plan national, mais perdra 5 de ses 50 sièges, la moitié de sa députation vaudoise (deux sièges sur quatre) et les deux tiers de sa députation genevoise (deux sièges sur trois). Le minuscule Parti socialiste de Genève de Charles Rosselet n’obtient un siège que grâce à l’appui de la droite démocratique (Rosselet deviendra d’ailleurs Président du Conseil National, en témoignage d’estime pour son combat anticommuniste, et sera élu au gouvernement genevois grâce au jeu d’une liste d’union de tous les partis " démocratiques " (entendez : à l’exclusion des socialistes " nicolistes " et des communistes d’une part, de l’extrême-droite d’autre part).
Source des chiffres : Pierre Jeanneret, op.cit. pp 200 ss
Pour l’essentiel, la scission de 1939 est donc un phénomène romand, nourri de la spécificité d’un socialisme dont les références " françaises " ne passent guère la Sarine. De plus, l’impact de la scission varie même selon les cantons et les régions de Romandie : pratiquement nul à Fribourg, faible à Neuchâtel et dans le Jura, il est important en Valais, considérable dans le canton de Vaud, massif à Genève. Ce caractère " romand ", et plus précisément même " lémanique " du " phénomène Nicole ", ne devait pas faciliter sa compréhension par la direction du PSS, d’autant que, comme le relève Pierre Jeanneret, les uns et les autres nourrissent leurs grognes et leurs hargnes de préjugés et de lieux communs peu propices à l’ " analyse concrète des situations concrètes " : Genevois cultivant leur particularisme, alémanique le leur renvoyant en retour (aidés en cela par un Paul Graber faisant de ses adversaires " nicolistes " un portrait calamiteux : les " masses genevoises " seraient " antisuisses, antizurichoises et toutes imprégnées d’esprit français "… A l’heure de la rupture, les particularismes, soigneusement entretenus, contribueront à asseoir la Fédération Socialiste Suisse, puis le Parti du Travail, en ses bastions lémaniques. Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, op.cit. pp 208, 209
L’argument " fédéraliste ", culturel, ne sera toutefois avancé qu’à titre polémique : Léon Nicole n’est pas Roland Béguelin, son parti socialiste n’est pas le Rassemblement Jurassien et ce n’est pas sur la base politique d’une " résistance romande à l’hégémonie alémanique " que Nicole et les siens, refusant de se plier aux injonctions du PSS, constituent à Renens, le 3 décembre 1939, une Fédération Socialiste Suisse " dont la tâche est le regroupement en Suisse de toutes les forces socialistes et ouvrières décidées à continuer la lutte pour un ordre nouveau, l’ordre socialiste ". En février 1941, Léon Nicole résume les causes de la scission, de son point de vue :
Léon Nicole, Le Parti Socialiste Genevois, ses origines, op.cit.blblio.
Nicole explique donc la scission par les divergences d’appréciation de la situation internationale et par l’intégration du mouvement ouvrier suisse au " régime capitaliste ". Il y ajoute la question communiste, mais passe comme chat sur braises sur le Pacte germano-soviétique :
Léon Nicole, ibid. pp 17, 18
Léon Nicole se donne (et donne à " son " PSG) le beau rôle, passant totalement sous silence son adhésion au pacte germano-soviétique (le texte que nous venons de citer date de février 1941) et entretenant (sciemment ?) la confusion entre la situation née du ralliement social-patriotique de la Grande Guerre et celle provoquée les agressions fascistes dès 1936. L’ennemi de 1914 et celui de 1939 n’est pas le même, et les analyses léniniennes de Kienthal ne pouvaient pas être scolairement appliquées à la situation de 1939 : on n’avait plus affaire au chauvinisme français ou à l’impérialisme " traditionnel " de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, mais au fascisme et au nazisme -Trotsky, d’ailleurs, le comprit fort bien, qui fit sans doute preuve d’un léninisme d’autant plus conséquent en 1939 qu’il n’était pas léniniste en 1914, et qu’il était proscrit de l’Etat fondé par Lénine.
Toujours est-il que la Fédération Socialiste Suisse était destinée à poursuivre vigoureusement la politique suivie par Nicole avant son exclusion. Le 1er mai 1940, la FSS lançait un vibrant appel à la " classe ouvrière suisse " :
Le Travail 1er mai 1940
1940, c’est encore pour la gauche socialiste (et pour les communistes) le temps du renvoi dos à dos des deux " impérialismes concurrents ". Les communistes détaillent (et raffinent, autant qu’elle peut l’être et qu’ils peuvent le faire) cette analyse à prétentions et à références léninistes :
L’Etincelle du 13 juillet 1940
L’Etincelle du 10 août 1940
L’Etincelle du 19 octobre 1940
De l’aveu même des communistes genevois (et l’on peut douter qu’ils puissent avancer pareille hypothèse sans être certains qu’elle corresponde à quelque réalité), le stalinisme fait donc " un bout de chemin " avec l’ " hitlérisme ", ne serait-ce qu’ " objectivement ", par le fait d’une commune opposition à l’ " impérialisme de la City ". C’est là, précisément, le reproche majeur adressé aux " nicolistes " et aux communistes par les socialistes " officiels " -des socialistes " officiels " que la guerre ne " mobilise " pas toujours autant que leur antifascisme proclamé le laisserait croire, puisqu’après tout, l’ennemi des " démocratie " est nazi ; Paul Golay, en 1940 :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit.biblio p. 102
Ainsi, même contre le fascisme et le nazisme, le socialiste Golay refuse-t-il encore d’admettre la légitimité de la guerre (ce qui ne serait pas, encore, admettre celle de l’armée, ni celle de la défense nationale…). C’est en Occident, le temps de la " drôle de guerre ", d’une guerre à laquelle on ne croit pas. Luigi Bertoni, l’un des plus lucides des acteurs du mouvement ouvrier et socialiste de ce temps-là, en décrit l’ambiance :
Le Réveil du 2 décembre 1939
A droite, ce sera bientôt, la défaite de la France consommée, le temps des accommodements avec le vainqueur du moment : Le Conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz et le Général Henri Guisan appelleront tous deux -le militaire avec, assez paradoxalement, plus de subtilité que le politique- à l’adaptation au " nouvel ordre européen " que l’on croit voir se créer. On se souviendra du discours de Pilet-Golaz, on oubliera celui de Guisan…
L’entrée en guerre (malgré elle) de l’Union Soviétique, puis celle (malgré eux) des Etats Unis, clarifiera la situation : de " guerre entre impérialistes " pour la conquête du monde, le conflit deviendra pour les communistes et les " nicolistes " une " guerre à mort contre le fascisme et pour la défense de l’Union Soviétique ". Le " Front commun antifasciste " va dès lors s’élargir, de facto, aux communistes et à la Fédération socialiste suisse, sans pour autant que celle-ci, réduite à la clandestinité, ne rejoigne le PSS, puisqu’elle sera au contraire la matrice du futur Parti Suisse du Travail. Avant que cette mue se fasse, et en guise de réponse à leur interdiction, les " nicolistes " et les communistes apparaîtront ensemble sous plusieurs " couvertures " organisationnelles successives : ce seront, dès l’automne 1941 à Genève, la Ligue de Défense des Droits et Libertés Populaires (avec Léon Nicole à sa tête) et le Lien Confédéral (présidé par André Ehrler) ; en novembre 1942, une " Liste du Travail " est déposée pour les élections cantonales, et invalidée arbitrairement par les autorités genevoises ; une nouvelle liste du même genre sera déposée en 1943 lors des élections municipales, et, les temps stratégiques ayant changé, les autorités se garderont bien cette fois-ci de l’invalider. Les " nicolistes " gagneront ces municipales, et se transformeront en Parti Ouvrier. Un Parti Ouvrier va également apparaître à Bienne en décembre 1943, à Bâle en mars 1944. En juin 1943, le Parti communiste et la Fédération socialiste, interdits, fusionnent ; les 30 et 31 mai 1944 se crée le Parti Ouvrier et Populaire (POP) neuchâtelois ; le 21 mai 1944, les partis ouvriers cantonaux créent une Fédération des partis ouvriers ; en juin 1944 se créée la Gauche Socialiste ; en août 1944, La Voix Ouvrière reçoit l’autorisation de parution. Point d’orgue : les 14 et 15 octobre 1944 se constitue le Parti Suisse du Travail (PST). C’est ici résumer cinq ans d’évolution structurelle de la gauche socialiste et communiste, depuis la fondation le 3 décembre 1939 à Renens de la Fédération Socialiste Suisse, présidée (évidemment) par Léon Nicole, et dont le siège sera (évidemment) fixé à Genève. Ces cinq ans d’évolution de la gauche suisse sont totalement déterminés par l’évolution du cours de la guerre, et pour résumer, on constatera aisément que lorsque les nazis paraissent vainqueurs, les partis situés à la gauche du PSS sont interdits, et que lorsque les nazis paraissent sur le chemin de la défaite (et les Soviétiques sur celui de la victoire), ces mêmes partis sont autorisés.
C’est un programme social-démocrate que se donnera la Fédération Socialiste Suisse (à vrai dire, le programme du PSG de Nicole était déjà un programme social-démocrate, si l’on s’en tient à son contenu cantonal et national) ; preuve s’il en était besoin que ce qui sépare les " frères ennemis " du socialisme suisse est moins le contenu de leurs propositions respectives dans les domaines sociaux, économiques et politiques, au sens restreint de ces termes et au plan national) que leurs conceptions stratégiques, leurs références internationales et leurs cultures politiques respectives.
Or donc, la FSS réclame l’adaptation des salaires au coût de la vie, une progressivité accrue de l’imposition directe, la levée du secret bancaire, la nationalisation des banques, des assurances et des industries " stratégiques ", la garantie de la propriété agricole à ceux qui la travaillent, le monopole étatique du commerce extérieur, l’AVS, la démocratisation des études, la laïcité de l’enseignement, une politique de grands travaux et de rénovation de l’habitat, la défense, enfin, des libertés fondamentales. Rien que de très réformiste, rien que de très social-démocrate. Seul point de discorde important (au plan national) : la Paix du Travail, que le PSS a entérinée et que la FSS dénonce. C’est donc " ailleurs " qu’il faut chercher ce qui va distinguer la FSS du PSS. Cet " ailleurs ", c’est le contexte international et, partant, puisque l’on est en pleine guerre mondiale, la situation de la Suisse dans une Europe embrasée.
Jusqu’en 1941, à l’instar des communistes, les " nicolistes " laboureront le terrain du pacifisme, du neutralisme -pour ne pas écrire, excessivement, du " défaitisme " : c’est la théorie pseudo-léniniste du " conflit entre impérialismes rivaux " renvoyés dos à dos et c’est la présentation de l’URSS comme garante de la paix. Le mouvement ouvrier est supposé ne pas avoir à choisir entre les alliances belligérantes : Londres vaut Berlin, la démocratie bourgeoise vaut le nazisme, un impérialisme vaut l’autre. A quoi s’ajoute l’inévitable optimisme révolutionnaire, de mise depuis 1917 : " Le capitalisme est en train de s’effondrer, victime de ses contradictions internes ", écrit Maurice Jeanneret-Minkine dans Le Droit du Peuple… du 18 juin 1940 ! Air connu, devenu refrain.
A l’avant-garde (avec les anarchistes et les trotskistes) de l’antifascisme et de l’antinazisme jusqu’en 1939, communistes et socialistes de gauche se retrouvent ainsi former comme un " ventre mou " de la résistance à la " bête immonde ", et laissent la social-démocratie (avec les anarchistes et les trotskistes, mais également les socialistes chrétiens) occuper le terrain de cette résistance -qui prendra bientôt un R majuscule. La gauche " socialo-communiste " devra faire preuve d’une considérable capacité d’invention théorique, et rhétorique, pour justifier ses chois -une capacité d’invention dont le principe de réalité ne sera pas le critère dominant. La Finlande sera ainsi présentée comme un Etat " capitalo-fasciste " dont les classes populaires finlandaises ne pouvaient que souhaiter l’effondrement, et une " citadelle avancée " de l’impérialisme anglo-saxon et français contre l’Union Soviétique, dont les peuples du monde ne pouvaient qu’applaudir l’invasion par l’Union Soviétique. Le même discours sera d’ailleurs tenu à propos de la Pologne.
Avant que l’attaque allemande du 22 juin 1941 ne leur simplifie les choses, socialistes de gauche et communistes commirent donc quelques inventions théoriques assez accablantes pour qui les examine, commodément, un demi-siècle plus tard. Ainsi des étranges complaisances de Nicole lui-même à l’égard du nazisme, entre la signature du Pacte de 1939 et l’agression allemande de 1941. Pierre Jeanneret rend compte de cette errance :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. pp 224. 225
Fascisant, alors, Léon Nicole ? Non, mais aveuglé par son anticapitalisme, et porté par cet anticapitalisme irréductible à saluer tout ce qui lui paraît être de nature à hâter l’effondrement de l’ordre du monde -même si le boutoir est nazi. Cet aveuglement (car c’en est un) ira si loin que la presse " nicoliste " se fera, en juin 1940, furieusement antigaulliste, voire même carrément pétainiste. Errance de brève durée, mais errance tout de même, et qui fera mal à la conscience de nombreux partisans de Nicole. De Gaulle sera ainsi présenté comme un " rebelle " (au sens péjoratif du terme, non au sens laudatif et romantique) au service des " intérêts du grand capital anglo-saxon aux abois " (cité par Pierre Jeanneret, p. 225), alors que Pétain, " digne " et " noble ", sera présenté comme le " garant d’une certaine renaissance française " (ibid.) :
In Le Droit du Peuple, 25 juin 1940
Alors, Nicole = Doriot ? Comme l’écrit Pierre Jeanneret, " cette déviance d’un Nicole antifasciste intraitable, si elle fut éphémère, pose une fois de plus à l’historien le problème de la tentation fasciste (…) des hommes de gauche " (Jeanneret, p. 226). Au vrai, c’est de populisme dont il s’agit, d’un populisme anticapitaliste, et non de fascisme. Mais un Doriot, un Déat, un De Man ou un Mosley, venant du communisme ou du socialiste pour aboutir au fascisme ou au nazisme, ne sont peut-être pas de purs accidents explicables par la pathologie ou l’ambition. L’anticapitalisme n’est pas le socialisme : anticapitalistes, Hitler et Mussolini le furent, à leur manière, et peut-être même révolutionnaires, en leur caricature de léninisme ; anticapitaliste aussi, de l’espèce réactionnaire et catholique, Franco. Le fascisme et le nazisme, répétons-le, sont des mouvements de masse, dont la base de classe (le sous-prolétariat, la petite bourgeoisie) et la volonté de " table rase " n’ont rien qui puisse être confondu avec le libéralisme bourgeois (dont les séparent au surplus le culte de l’Etat et l’exaltation du Chef). Le fascisme et le nazisme ont donc avec le socialisme des rapports de caricature à modèle -et dans le trouble et l’incertitude d’un temps de guerre et de défaites, de replis et d’exclusions, il est facile de confondre la caricature et son modèle. Le mode d’organisation des partis fascistes et du parti nazi a bien " quelque chose à voir " avec le léninisme, et le culte du Chef n’a pas forcément pour un stalinien l’aspect bouffon qu’il a pour l’auteur de ces lignes. Pierre Jeanneret estime qu’il y a un " doriotisme nicoléen ", tout en précisant que, au contraire de Jacques Doriot, Nicole ne fut jamais ni munichois, ni antisémite. Ce " doriotisme nicoléen " est fait d’abord de quelques similitudes de caractères, et ensuite de quelques analogies de situation :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. pp 229, 230
Il y a cependant entre " Léon " et le " Grand Jacques " deux différences, et de taille : la première n’est rien moins que leur rapport à l’Union Soviétique. Si Nicole paraît un moment céder aux troubles séductions d’un " socialisme viril " aperçu dans le nazisme, c’est que Staline lui a donné l’exemple : l’invasion allemande de la " patrie du socialisme " remettra les pendules à l’heure. La seconde différence n’est pas moins considérable que la première : il s’agit cette fois du socialisme, c’est-à-dire de la conception qu’en ont respectivement Nicole et Doriot. Si personnelles qu’en soient la définition qu’en donna Nicole et la pratique qu’il en eut, le socialisme (une certaine forme de socialisme, autoritaire, certes, mais sans pour autant cesser d’être fondamentalement démocratique) resta, pour la Suisse, son projet jusqu’au bout, sans qu’il y ait possibilité de confusion entre le socialisme " à la Nicole " et la référence au socialisme que Hitler avait cru bon de glisser dans le nom même de son parti ; le " national-socialisme " n’avait de socialiste que cette rhétorique, dès lors que la " race ", l’ethnie, pour ne pas dire la tribu, prenaient la place de la classe et de la société. Pas plus que Pierre Jeanneret, nous ne pouvons donc accepter de considérer Nicole comme le " fasciste de gauche " en quoi voulut par exemple le vêtir, ou le travestir, Alexandre Berenstein -qui, il est vrai, eut à souffrir des emportements, des polémiques et des simplismes nicoléens. Après tout, la Fédération Socialiste Suisse (et le PCS) suivirent en Suisse un chemin comparable, à moindres risques, que le PCF dès 1941, s’engageant dans ce qui tint helvétiquement lieu de Résistance (Guisan y jouant symboliquement le rôle d’une sorte de de Gaulle à l’aune helvétique, toutes proportions gardées et tous risques personnels incomparables).
Il faut y insister : ces incertitudes et ces ambiguïtés ne durèrent que le temps du Pacte germano-soviétique. La Fédération Socialiste Suisse elle-même n’aura d’ailleurs de temps de vie légale que celui-là, interdite qu’elle sera le 27 mai 1941, un mois avant que Hitler ne rompe son alliance avec Staline. Depuis 1931, les communistes d’abord, les socialistes de gauche ensuite, les trotskistes et les anarchistes également, font l’objet de mesures répressives qui les confinent progressivement aux marges de la légalité, avant que de culminer dans leur interdiction formelle. Le 2 décembre 1932, les communistes ont été exclus de l’administration fédérale ; le PC lui-même a été interdit à Neuchâtel en février 1937, à Genève en juin de la même année, dans le canton de Vaud en novembre 1938. Les 6 août, 26 novembre et 17 décembre 1940, trois arrêtés fédéraux frappent le PC : le 6 août, on lui interdit (ainsi qu’aux trotskistes et aux anarchistes) toute activité en tant que " formation révolutionnaire et liée à l’étranger " ; le 26 novembre, le PC est dissout ; le 17 décembre, ce sont les communistes en tant qu’individus qui sont frappés : même élus sur des listes socialistes, comme à Genève, ils sont déchus de leurs mandats (à Genève, les socialistes " nicolistes " se solidarisent avec eux).
La Fédération Socialiste Suisse pouvait d’autant moins échapper aux foudres fédérales qu’elle les avait elle-même attirées en accordant " l’asile politique " aux communistes. En 1940, le gouvernement genevois fait fermer la Librairie du Faubourg ; le 5 juillet 1940, les deux quotidiens " nicolistes " (Le Travail et Le Droit du Peuple) sont fermés. Les " nicolistes " protestent, vigoureusement mais vainement : assemblée de protestation, lettre aux abonnés des deux quotidiens, pétition au Conseil fédéral, lettres au président de la Confédération (Marcel Pilet-Golaz)… Paradoxalement, c’est alors qu’elle adhère à une sorte de " neutralisme " (en ce qu’elle renvoie dos à dos les deux " impérialismes concurrents ") que la presse " socialo-communiste " est interdite par un Conseil fédéral soucieux (officiellement) de défendre… la neutralité de la Suisse. Selon le colonel Perrier, ancien chef de la Division de presse et radio de l’armée (et qui sera le défenseur de Nicole en 1943), l’interdiction de la presse de la Fédération socialiste suisse était contraire aux règles adoptées par le Conseil fédéral lui-même : " Peu de journaux auraient, selon l’avocat, respecté plus scrupuleusement la neutralité de la Confédération " que les journaux " nicolistes " (Jeanneret, p. 235) ; c’est en effet le moins que l’on puisse dire : les " nicolistes " ne cessent d’appeler la Suisse à se tenir hors du conflit européen entre " l’impérialisme repu " de Londres et " l’impérialisme affamé " de Berlin.
Enfin, en 1941, c’est au tour de la Fédération Socialiste Suisse elle-même d’être frappée d’interdiction : le 9 avril, la Coopérative d’imprimerie du Pré-Jérôme est dissoute et confisquée, le prétexte en étant la publication de " propagande communiste " (en l’occurrence, et entre autres, l’Anti-Dühring de Engels, commandé et payé par le PC clandestin). Le 27 mai, la FSS est dissoute, les 11 et 12 juin ses élus aux Chambres fédérales (dont Nicole lui-même) sont déchus de leurs mandats.
En fait, c’est le gouvernement genevois qui prit l’initiative de demander l’application à Léon Nicole et Jacques Dicker de l’arrêté fédéral de dissolution du PC (qui ne s’appliquait pas à eux, puisqu’ils n’étaient pas, ni ne furent jamais, membres du PC) et leur exclusion du Conseil national, ce qui devait entraîner par extension et par " égalité de traitement " celle des " nicolistes " vaudois Gloor et Masson. Juridiquement, la demande genevoise était pour le moins douteuse ; politiquement, elle était totalement inopportune, compte tenu du soutien populaire dont les futurs exclus, Nicole en tête, continuaient de jouir à Genève. Prudent, le Conseil fédéral soumit la proposition du gouvernement genevois à une commission présidée par un socialiste (le Saint-gallois Johannes Huber), à laquelle appartenaient quatre autres socialistes )Meierhans, Gloor, Golay et Arnold), et qui " auditionna " le Conseiller fédéral von Steiger et le Procureur de la Confédération Stämpfli.
Cette commission avait pour mandat de vérifier si la proposition du gouvernement de déchois les " nicolistes " de leurs mandats électifs fédéraux pouvait être suivie. Elargissant elle-même son mandat, allant au-delà des compétences qui lui avaient été attribuées, elle crut bon de recommander l’interdiction pure et simple de la FSS. Il apparut en effet assez rapidement qu’il n’était pas possible d’appliquer à des parlementaires de la FSS, issus des rangs du PSS, ne les ayant quitté que sur décision de celui-ci et n’ayant jamais appartenu au PC, des dispositions prises à l’encontre du seul PC et de ses membres. Si l’on voulait (et on le voulait) se débarrasser de Nicole et de Dicker (et entraîner par ricochet Gloor et Masson dans cette exclusion), il fallait d’abord se débarrasser de leur parti, c’est-à-dire procéder à l’interdiction de la FSS, interdiction sans laquelle il n’était pas possible d’exclure Nicole et les siens du Parlement fédéral. D’où la proposition de la commission ; d’où, aussi, une polémique fort âpre sur l’attitude de plusieurs des socialistes qui en étaient membres, notamment de Paul Meierhans, accusé d’être à l’origine de la proposition (et donc, par elle, de la décision) d'interdire la FSS. Le très anticommuniste (et antinicoliste) Meierhans fut en tous cas l’un des plus chauds partisans au sein du PSS de l’interdiction de la formation socialiste concurrente, interdiction que le Comité central du parti finit par approuver le 17 mai et que le Congrès confirma les 24 et 25 mai. Pierre Jeanneret détaille les arguments avancés par le PSS pour justifier la mise hors-la-loi d’un parti largement issu de ses propre rangs, et regroupant l’essentiel de ses anciennes sections cantonales genevoise et vaudoise :
2. Léon Nicole est le correspondant officiel de l’agence Tass (…)
3. Nicole écrit des articles dans le journal communiste Die Welt, publié en Suède.
4. Nicole a déployé constamment une activité cryptocommuniste depuis son approbation du Pacte germano-soviétique et de la guerre de Finlande.
5. Surtout, le Comité directeur et son rapporteur Meierhans invoquaient un mystérieux " dossier secret ". (…) Ce " dossier écrasant " se révélera vide (…). Cet argument (le dossier), qui pouvait laisser soupçonner des affaires d’espionnage au service d’une puissance étrangère ou de trahison -mythe que la presse bourgeoise s’employa à entretenir jusqu’à ce qu’il se dégonflât comme une baudruche (…)- emportera la décision du congrès de Zurich. Ajoutons que ce dossier reposait notamment sur les déclarations de l’ancien député communiste puis socialiste A.P.*. Or P., exclu du PCS en 1940 pour ses implications dans des affaires pénales, se révélera comme un délinquant de droit commun. (…)
6. Selon le témoignage P., certains nicolistes auraient " fréquenté assidûment, en qualité d’invités, les séances du MN " (Pierre Graber), le Mouvement National Suisse, d’inspiration nazie, interdit le 8 novembre 1940. Il y aurait eu également, selon le rapport du Conseil fédéral, des contacts avec le Dr. Walter Michel, un nazi notoire. (…) Nicole s’est contenté de démentir formellement cette assertion.
L’adhésion du congrès socialiste à la dissolution de la FSS favorisait les dessins de la majorité bourgeoise. Cette dernière pouvait prononcer l’interdiction sans courir le risque d’une opposition socialiste au Parlement.
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. pp. 240, 241
* Albert Ponts
Le PSS, donc, choisir de soutenir la droite contre sa propre gauche. Pierre Graber justifie ce choix sur le ton de Saint-Just : " Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ! ", et ceux qui au sein du PSS auraient pu lui répondre sur le ton de Voltaire : " je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils disent, mais je me battrai pour qu’ils puissent le dire ! ", ceux-là se turent. Ils avaient pourtant, comme Paul Golay, comme Charles Rosselet même, défendu cette position lorsqu’à Genève et dans le canton de Vaud, l’interdiction du PC (et non encore celle de leurs anciens camarades) vint en débat dans les parlements cantonaux. C’est dire à quel point la situation s’était, en quelque quatre ans, dégradée. Le Pacte germano-soviétique, la manière dont les " nicolistes " le justifièrent et leurs coupables errements populistes n’y sont évidemment pas pour rien ; mais, plus crûment, la " droite " et le " centre " social-démocrate semblent avoir voulu saisir l’occasion de se débarrasser, une fois pour toutes, d’une gauche encombrante et désarmée par sa fidélité aux choix soviétiques.
Le 11 juin 1941, au Conseil national, Léon Nicole dénonce la mesure dont il sait devoir être victimes dans les heures à venir (ainsi que ses camarades vaudois Gloor et Masson, et que son plus fidèle camarade genevois, Dicker). Nicole dénonce à la fois les arrêtés frappant les communistes et l’application de ses arrêtés à lui-même et à ses partisans : arrêtés frappant d’une discrimination inacceptable des dizaines de milliers d’électeurs dont le choix est réputé nul et les élus considérés comme indignes ; il " démontre -et l’histoire lui donnera raison sur ce point- l’inutilité des mesures préconisées, qui n’arrêteront pas la marche des idées " (Jeanneret, p. 242). Il relève ensuite les conséquences dommageables pour les relations helvéto-soviétiques des décisions qui vont êtres prises : il est vrai qu’en juin 1941, ces relations sont presque au plus bas, qu’elles atteindront lorsque les moins perspicaces croiront venu le moment de l’effondrement soviétique devant l’avance nazie.
Après que Johannes Huber ait exprimé ses scrupules de juriste face aux interdictions (pourtant proposée par une commission dont il était le président), les socialistes " droitiers " René Robert et Charles Rosselet se livrèrent à la justification des arrêtés anticommunistes et de leur extension à la FSS, Rosselet demandant que l’on fasse preuve à l’égard des organisation d’extrême-droite de la même sévérité que celle qu’il approuve lorsqu’elle frappe ses anciens camarades de parti. Et c’est finalement par 138 voix contre celles de Nicole, Dicker et Masson que sont entérinées les mesures de proscription de l’extrême-gauche helvétique, le 11 juin 1941. Le lendemain, les quatre élus " nicolistes " sont déchus de leur mandat, malgré les protestations de Dicker, rappelant qu’au contraire d’autres (Walter Bringolf, par exemple), ils ne furent jamais membres du Parti communiste et que les mesures qui les frappaient présageaient sinistrement de la décadence de la démocratie. La moitié des élus socialistes, plusieurs " bourgeois " et la plupart des " indépendants " du Landesring de Gottlieb Duttweiler s’abstinrent toutefois d’approuver (comme de combattre…) l’extension aux " nicolistes " des dispositions qu’ils approuvaient, lorsqu’elles n’étaient dirigées que contre les communistes.
Après la proscription fédérale survinrent les proscriptions cantonales : le 21 juin 1941, le Grand Conseil genevois " expulsait " 27 députés de ses rangs, avec une clause d’urgence destinée à éviter un référendum populaire. Une liste de 271 inéligibles fut dressée, comprenant tous les responsables, cadres et mandataires du PC et du PSG " nicoliste " (dont, qu’on lui pardonne cet aparté, le grand-père de l’auteur du présent texte…). Le 30 juin suivant, le Conseil d’Etat vaudois emboîte le pas : les " nicolistes " sont exclus du Grand Conseil et des Conseils communaux, le 11 juillet, 18 Conseillers communaux lausannois sont exclus du Parlement municipal (les socialistes s’abstiennent, sauf l’ancien syndicat Arthur Maret, qui vote contre l’exclusion).
La boucle est bouclée : la gauche socialiste est non seulement exclue du PSS, mais aussi de la légalité politique. Il faudra attendre que le cours de la Guerre Mondiale ait changé et que la défaite du Reich apparaisse comme inéluctable, après Stalingrad, pour que les exclus de 1941 soient prudemment réintégrés dans la légalité (encore n’y furent-ils d’abord qu’à la marge : le Parti du Travail, dont l’existence même est la conséquence des mesures de proscription de 1941, ne sera jamais totalement considéré par la Suisse " officielle " comme un " parti comme les autres "). Du 25 janvier au 1er février 1943, Léon Nicole et le communiste Karl Hofmaier comparaissent devant la Justice fédérale. Paradoxalement, ce procès témoigne des changements qui se sont produit en deux ans : la gauche socialiste et communiste avait été frappée d’interdiction au plus fort des victoires de l’Axe, quelques jours avant l’agression contre l’URSS, quelques mois avant l’agression contre les USA ; deux ans plus tard, le vent a tourné, et les " politiques " le savent. Les Allemands et les Italiens ont été stoppés par les Britanniques en Afrique du nord, les Américains ont pris l’offensive dans le Pacifique et surtout, les Soviétiques se sont lancés à la reconquête de leur propre territoire, prélude à la conquête de la moitié de l’Europe continentale. En outre, dans les pays occupés, la Résistance s’est organisée. L’Italie, enfin, est épuisée, et l’Allemagne désormais est, sur le terrain de ses opérations, sans allié qui compte. Enfin, il est apparu clairement que les mesures d’interdiction ont été d’une rare inefficacité, quand elles n’ont pas été purement et simplement productive : la gauche socialiste et communiste, même illégale, même agissant dans une semi-clandestinité, n’a pas disparu du paysage politique en étant exclue de ses apparences légales. Des milliers d’électeurs genevois se sont plusieurs fois prononcés passivement (par le vote nul ou blanc ou par l’abstention) ou activement (en reportant leurs voix sur des listes de circonstance) en faveur de Nicole et des siens.
" Vu l’inanité des accusations lancées contre Nicole, le grand procès attendu allait se dégonfler de lui-même ", constate Pierre Jeanneret (op.cit. p. 245). Le Procureur Général lui-même contribuera à ce " dégonflage " en réduisant la portée des actes reprochés à Nicole à une simple infraction aux arrêtés fédéraux interdisant la propagande communiste ; plus question d’espionnage, donc, ni de mise en danger de la sécurité publique. En 1943, l’ " espionnage " (ou plutôt : le service de renseignement) pour le compte des Soviétiques se faisait désormais au vu et au su des services helvétiques, parfois même avec leur agrément (officieux), et correspondait de mieux en mieux aux intérêts d’Etat de la Suisse, au fur et à mesure que s’annonçait la défaite finale de l’Axe : il faut " renouer les liens ", " reconstruire les ponts " avec la (grande) puissance honnie, mais en passe de gagner la guerre mondiale. Nicole ne sera donc plus accusé que de s’être livré à de la propagande " subversive " et " communiste " ; mais la définition même de ce qui est subversif (ou communiste) était devenue malaisée : " La radio suisse donne, quatre fois par jour, les bulletins de l’Etat-major soviétique, rédigés par de très authentiques membres du parti communiste russe ", relèvent ironiquement les " nicolistes " (op.cit. p. 245), tandis que Nicole lui-même ajoute :
cité par Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p.245
Nicole a quelques raisons, et prend sans toute quelque plaisir, à ironiser sur la conversion (Realpolitik oblige) de certains de ses plus fougueux détracteurs, rendus à un rôle assez peu glorieux de girouette, furieusement antisoviétiques en 1941, prudemment réalistes en 1943…
Il n’était cependant pas concevable que les autorités fédérales fassent publiquement étalage de leur opportunisme, et rappellent au bon souvenir de l’opinion publique leur position de 1941 ; Nicole et Hofmaier devaient donc être condamnés, quoique leurs dossiers fussent à peu près vides, que les accusations se trahison se fussent effondrées et que tout ce que l’on pouvait encore leur reprocher était de s’être livrés à des activités de propagande communiste. Hofmaier fut donc condamné à six mois de prison ferme, Edgar Woog à trois mois, Léon Nicole à trois mois avec sursis et François Graisier à deux mois avec sursis. Le 1er février 1943, Nicole et Graisier furent triomphalement accueillis, en vainqueurs, à Genève, par une foule qui, au-delà du slogan " Libérez Hofmaier ! ", avait surtout pour intention de rendre évident le soutien populaire dont jouissaient en leur bastion genevois les " interdits " de 1941.
La condamnation conjointe (quoique à des peines inégales) du communiste Hofmaier et du socialiste Nicole, outre qu’elle apparaissait comme une absurdité et qu’elle révélait l’inanité des interdictions de 1941 (puisque la gauche socialiste était toujours là, toujours aussi forte et toujours alliés aux communistes), était symboliquement maladroite, en ce qu’elle liait encore un peu plus les " nicolistes " aux communistes. Le Parti du Travail naîtra aussi de ce genre de maladresses des autorités fédérales, soutenues parfois par le PSS.
De 1941 à 1943 (formellement jusqu’en 1945, mais dès 1943 le formel n’est plus le réel), la gauche " socialo-communiste " est donc en Suisse frappée d’illégalité, et conduite à agir dans une relative clandestinité -que les grandes victoires alliées de 1943, à commencer par celles des Soviétiques (Stalingrad : 2 février 1943) adouciront considérablement. De 1940 à 1942, lorsqu’il semble que la poussée de l’Axe ne peut être contenue, de nombreuses arrestations, des perquisitions, des saisies et des procès sanctionnent la permanence de l’activité politique de la gauche interdite. Cette période est celle de la clandestinité ; elle se terminera au printemps 1943, et lui succédera une stratégie fédérale de " tolérance passive " à l’égard des activités " nicolistes " et communistes. La dissolution de la Troisième Internationale, le 22 mai 1943, y concourra (et laissera présager des retrouvailles entre les " frères ennemis " de la gauche, la FSS et le PSS -retrouvailles qui ne se produiront pas.
La période des interdictions est marqués par une floraison de journaux plus ou moins clandestins, à la périodicité plus ou moins précise, remplissant tant bien que mal le vide laissé par l’interdiction du Travail et du Droit du Peuple (en Romandie), et par celle des réunions publiques. D’entre ces journaux " nicolistes ", communistes ou, plus franchement, explicitement " soviétiques " (c’est-à-dire reprenant en français, en allemand ou en italien les textes diffusé par Tass et les articles publiés dans la presse soviétique), citons ici les titres les plus connus : Die Freiheit, die Wahreit, die Neue Welt, der Kämpfer, SowjetInformationen, en allemand, L’Etincelle, le Travail, les Informations soviétiques, en français, La Verità et La Libertà en italien. Les Informations soviétiques et SowjetInformationen reprenaient purement et simplement les dépêches de Tass, que Nicole recevait et publiait sans en rien changer -quitte à ce que leur style et leur langue de bois ait l’effet inverse de celui recherché, surtout dans les premières années. Jean Vincent ajoute que le censure et les autorités militaires les laissaient passer, les lisant au passage pour bénéficier ainsi des informations diffusées par les Soviétiques. Nicole ayant au surplus une conception très personnelle, et très improbable, de la clandestinité, ses activités elles-mêmes se déroulaient au vu et au su des autorités fédérales chargées de les réprimer (et qui se gardaient bien de commettre pareille maladresse). Les socialistes genevois s’en offusquèrent d’ailleurs, inutilement, et constatèrent amèrement que la presse " nicoliste " pouvait " librement et impunément (paraître) à la barbe des autorités " grâce à la " complaisance " d’une bourgeoisie " qui se réjouissait fort de son travail de division " (Le Peuple, 17 septembre et 31 octobre 1942). Au fur et à mesure que s’amorce à l’est le grand reflux, puis la franche débâcle, des armées nazies et de leurs auxiliaires, le prestige de l’URSS rejaillira sur la presse qui en chantait déjà la gloire au temps des défaites, et sur le courant politique qui, même au plus fort des errances staliniennes, ne marchanda jamais (mais lorsque cela eût été légitime) son soutien à la " patrie du socialisme ".
Au plus fort de la " semi-clandestinité " à quoi les condamnait l’interdiction de la FSS, les " nicolistes " n’avaient pas renoncé à revenir au grand jour de l’action politique légale. Plusieurs tentatives de levée partielle ou complète des interdictions marquèrent ainsi les années 1942 et 1943, avant que, changeant de méthode, la gauche " socialo-communiste " n’engageât le processus de formation d’un nouveau parti. En février 1943, le socialiste de gauche bâlois (membre du PSS) Carl Miville et le socialiste chrétien Georg Mattmüller (entre autres) lancèrent une pétition demandant la levée des interdictions des organisations " ouvrières " et de leurs organes de presse. La pétition est un succès : 80'000 signatures. Le PSS ne se prononcera pas officiellement sur la " pétition Miville ", adressée d’ailleurs au Conseil fédéral (qui n’en tint aucun compte non plus). Ce silence du PSS s’explique probablement " par la crainte de provoquer des divisions internes ", estime Pierre Jeanneret, qui ajoute :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 253
Grimm renvoie ainsi dos à dos (en usant d’une méthode quelque peu " stalinienne " d’amalgame) la gauche " socialo-communiste " et l’extrême-droite fasciste, en réponse à quoi la première, usant de la même subtilité d’analyse, accusera la " droite " social-démocrate de se faire la complice du fascisme : Hofmaier, emprisonné par les autorités suisses avec l’aval du PSS, ne l’avait-il pas déjà été auparavant par les fascistes en Italie ?
C’est pourtant un socialiste " officiel ", le député Albert Dupont-Willemin, qui défendra le 6 novembre 1943 devant le Grand Conseil genevois un projet d’arrêté demandant au gouvernement de la " parvulissime République " d’intervenir auprès de celui de la Confédération pour que soit levée l’interdiction de la FSS. Dupont-Willemin, il est vrai, n’avait pas rompu avec ses camarades " nicolistes ", tout membre du PS " officiel " qu’il avait choisi d’être. De plus, la " Liste Ouvrière ", avatar de la FSS, avait gagné les élections municipales du mois de mai précédent en Ville de Genève, avant que de se transformer en Parti Ouvrier. Un bon tiers de l’électorat genevois, et l’écrasante majorité de l’électorat de gauche, persistait en sa fidélité nicoliste, dans un contexte international marqué par l’offensive de l’Armée Rouge et la retraite allemande, ce qui ne pouvait que faire rejaillir une petite part du prestige acquis par l’Union Soviétique sur ceux dont on savait le " pro-soviétisme " constant. Le PSS lui-même s’en rendit finalement compte : son congrès de 1943, les 4 et 5 septembre à Winterthur, avait adhéré à l’exigence de levée des interdictions. Au Parlement genevois, Albert Dupont-Willemin ne faisait en somme que relayer cette décision. Il la justifia par des arguments qu’on n’avait guère entendu dans la bouche des socialistes " officiels " du " Parti socialiste de Genève " depuis sa création en 1939 :
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 254
L’orateur relève ensuite que les vainqueurs des élections municipales du printemps précédent (la " Liste Ouvrière ", devenue Parti Ouvrier) ne sont, de notoriété publique, que les porte-paroles des " nicolistes " (et de Nicole lui-même) et des 272 citoyens privés du droit d’éligibilité :
Ibid.
Situation d’une évidente hypocrisie, en sus d’être malsaine parce que foncièrement contraire aux règles démocratiques, contre-productive parce que transformant en victimes de la vindicte bourgeoise des hommes dont on voulait exposer l’ " indignité " politique, et injuste parce qu’instaurant une catégorie de " demi-citoyens " :
Ibid. p. 255
On compte en effet, au nombre des " inéligibles ", un capitaine (et 89 militaires en service actif) et un Tuteur Général (et 38 salariés de la fonction publique). Albert Dupont-Willemin conclut en mettant en garde ses collègues du Parlement genevois contre le divorce entre un pays réel dont participent pleinement les " nicolistes ", et un pays légal qui les exclut. Peine perdue, du moins temporairement : sa motion est rejetée par 47 voix (la droite bourgeoise) contre 16 (les socialistes " officiels " et les indépendants " duttweileriens ", dont l’entrée au parlement était pour une bonne part due au report des voix qui ne pouvaient plus se porter sur le PS de Nicole. Comme le relevait Dupont-Willemin (qui en faisait l’un des arguments de sa démonstration), les interdictions n’avaient pu empêcher la gauche " nicoliste " et communiste de participer, victorieusement compte tenu de la situation, aux consultations électorales survenues depuis 1941.
Le 28 septembre 1941, une élection complémentaire est organisée pour désigner les deux " remplaçants " de Léon Nicole et Jacques Dicker au Conseil national. Le socialiste " nicoliste " Louis Piguet déposa une liste de " défense des droits et libertés populaires " portant candidature… de Léon Nicole. Provocation évidente : la liste est interdite, comme ses initiateurs s’y attendaient, et un recours est déposé au Tribunal fédéral, qui le déclare irrecevable (comme les recourants s’y attendaient…) le 20 septembre. L’élection se tiendra donc sans candidatures " nicolistes " -mais non sans vote de l’électorat " nicoliste " : seront élus un candidat " bourgeois " et l’indépendant " duttweilerien " William Rappard, qui bénéficiera des voix " nicolistes ", Le candidat socialiste officiel, Albert Dupont-Willemin, est largement battu (alors même qu’il avait pris la défense des " nicolistes " devant le Grand Conseil) : il n’obtient que 3'153 voix, contre plus de 16'000 pour Rappard -et même 7000, comptées pour nulles, pour Léon Nicole, inéligible.
L’alliance " objective " (et les tractations officieuses) entre " nicolistes " et " duttweileriens " a certes quelque chose de surprenant, mais n’est pas " contre-nature " : il s’agit de deux populismes, et de deux fortes personnalités. Interdit, inéligible, mis au ban de la société politique, Nicole se tourne (prudemment) vers le fondateur de la Migros et du Landesring, lui-même grand perturbateur de l’officialité politique. Alliance de circonstance, mais alliance tout de même, qu’explique la situation née des interdictions. En 1938, lors des élections municipales zurichoises, le Landesring avait chassé le NationalFront du parlement communal, et récupéré son électorat de classes moyennes plus ou moins prolétarisées, en gagnant vingt sièges (sur 125) d’un coup. Quatre ans plus tard, les " Indépendants " passeront à 37 sièges : la percée est spectaculaire. " Ni de gauche, ni de droite ", au-dessus des partis ", partisane du " capital à but social ", opposée à la lutte des classes, prônant une communauté solidaire aux accents corporatistes, l’ " Alliance " de Gottlieb Duttweiler séduit cette frange de la population que le fascisme avait lui aussi tenté de séduire (échouant d’ailleurs, en Suisse, dans cette entreprise), et dont un peu plus tard, la guerre terminée, le " qualunquisme " italien et le " poujadisme " français diront les peurs, les contradictions et les impuissances. Mais en Romandie, l’Alliance des Indépendants ne réussit pas réellement à s’implanter, aux deux exceptions temporaires de Genève et Lausanne (tant que Nicole n’aura pas fait sa " rentrée " politique légale). Le succès genevois s’explique par la mise hors-jeu du premier parti de la République, et le report, spontané ou organisé, des votes des socialistes de gauche sur la liste indépendante. Ce report fut encouragé par Duttweiler lui-même, dont la personnalité n’était d’ailleurs pas sans rappeler celle de Nicole :
Pierre Jeanneret, op.cit. p. 257
Duttweiler ouvrir dont à Nicole les colonnes de son quotidien, die Tat, et les électeurs de Nicole envoyèrent à Berne le candidat de Duttweiler, William Rappard.
L’implantation politique (mesurée par l’implantation électorale) de la gauche interdite à Genève put encore être confirmée par les élections cantonales du 8 novembre 1942 ; le PSG était interdit depuis une année et demie, il ne disposait d’aucun mass medium capable de toucher son électorat potentiel et de répondre à la violente et incessante campagne menée contre lui par les quatre quotidiens locaux. C’est en de si défavorables conditions que la " Liste du Travail ", même annulée par les autorités parce qu’ouvertement " nicoliste ", obtint le soutien de plus de 7200 électeurs, soit davantage que le Parti radical, majoritaire au gouvernement, et trois fois plus que le Parti socialiste " officiel ". Des milliers d’électeurs genevois choisissent donc d’exprimer un vote " nul " pour une liste interdite : " Cette situation témoigne une fois de plus du malaise politiquement genevois. Elle remet en question la légitimité des pouvoirs exécutifs et législatifs cantonaux : sont-ils encore représentatifs du peuple genevois ? ", s’interroge (judicieusement) Pierre Jeanneret (op.cit. p. 258)
La réponse à cette question sera donnée le 9 mai 1943 lors des élections municipales. Jamais élection municipale n’aura été si " politique ", dans un canton où la distinction est toujours malaisée entre les motivations des votes au niveau municipal de la Ville et au niveau cantonal. Cette fois, la gauche " nicoliste " décide de jouer complètement le jeu électoral, et de s’assurer de la légalité de ses listes en ne présentant que des candidats éligibles -en se privant, donc, de la totalité de ses leaders (à commencer par Nicole) et de la plupart de ses cadres. Des " listes ouvrières " sont déposées dans les principales communes du canton, à commencer par la Ville de Genève ; elles sont composées de " modestes citoyens, politiquement inconnus " (Jeanneret, op.cit. p. 258), mais chacun sait qu’il s’agit en réalité de " listes Nicole sans Nicole " (ibid.), qu’il est impossible à leurs adversaires d’annuler. Ces élections municipales seront aussi le moment de l’apparition, sous la forme d’un bulletin électoral, de la Voix Ouvrière, première mouture de ce qui deviendra le quotidien officiel du Parti du Travail lorsque la demande d’autorisation de parution déposée au lendemain des élections, le 14 mai 1943, aura été acceptée.
C’est dans cette Voix ouvrière des origines que les " Listes ouvrières " exposent leur programme -un programme éminemment social-démocrate : hausse des revenus et des salaires, protection sociale, assurances, droits politiques et sociaux, grands travaux urbanisme social, routes, hôpital, aéroport). " La politique internationale est totalement absente de ces quatre bulletins ", relève Pierre Jeanneret, quoique " la situation internationale et l’évolution des opérations militaires (…) présentes dans tous les esprits (pèsent) d’un grand poids dans le scrutin " ((Jeanneret, op.cit. p. 259). S’agissant d’élections locales, la référence internationale pouvait en effet ne pas être explicite ; s’agissant d’élections locales à Genève, en 1943, elle ne pouvait cependant pas être absente.
Le résultat des "municipales " genevoises de 1943 constituera un " tournant dans la vie politique " de la République (ibid. p. 260) et manifestera une nouvelle fois le soutien massif et solide de la " classe ouvrière politisée " et d’une grande partie des " couches populaires non ouvrières " aux nicolistes : La " Liste ouvrière " conquiert la première place en Ville de Genève et obtient 26 des 80 sièges du Parlement municipal. Les radicaux perdent le tiers (9 sièges sur 28) et les chrétiens sociaux près de la moitié (4 sièges sur 10) de leurs " députations " municipales en Ville, alors que les socialistes " officiels " subissent une véritable déroute et que l’Alliance des Indépendants disparaît du " paysage politique " municipal. On se retrouve donc avec une Liste ouvrière qui se réclame du PSG d’avant les interdictions, à la situation de 1939 : le " nicolisme sans Nicole " redevient (ou reste) la première force politique genevoise. Consultation locale, certes, mais dont la charge politique va bien au-delà des frontières genevoises. Le " test " est d’ampleur nationale : c’est toute la politique des interdictions qui est, d’un seul coup, rendue caduque -et c’est la levée des interdictions qui se profile. Retournement politique intérieur qui correspond au retournement stratégique mondial.
Dans le canton de Vaud, les consultations électorales aboutissent à des résultats comparables (en signification) à ceux obtenus à Genève, et à la même conclusion politique : avec ou sans Nicole, le " nicolisme " perdure, et sa base populaire lui garde sa confiance. Comme à Genève après l’exclusion du Conseil national de Nicole et Dicker, il fallut repourvoir les deux sièges des deux exclus " nicolistes " vaudois, Gloor et Masson. Ce fut fait le 7 septembre 1941, et l’élection se solda par une lourde défaite du candidat socialiste " officiel ", Pierre Graber, qui n’obtint que 6718 voix contre près de 25'000 au radical Despland et plus de 20'000 au libéral Rubattel : les " nicolistes ", en produisant un vote nul en faveur des deux Conseillers nationaux exclus, et inéligibles, manifestèrent clairement le peu d’estime qu’ils portaient aux socialistes " officiels " et à leur candidat. Deux mois plus tard, lors des élections communales lausannoises, ces voix " nicolistes " se portent toujours, pour 700 d’entre elles, sur le nom de Masson, toujours inéligible et non candidat, mais aussi, et plus massivement, sur la liste " duttweilérienne " qui, ex nihilo, devient la deuxième force politique de la ville au premier tour de ces élections se déroulant au scrutin majoritaire. Au second tour, la droite bourgeoise unanime appelle à voter pour les socialistes " officiels " afin de barrer la route à cette étrange coalition populiste, mi-nicoliste, mi-duttweilérienne. Opération réussie : les socialistes " officiels " obtiennent, grâce à l’apport massif des suffrages d’électeurs de droite, 30 des 100 sièges du Parlement municipal lausannois : jamais parti si peu représentatif n’aura occupé un si grand espace parlementaire ! Au traditionnel affrontement gauche/droite s’est substitué une sorte d’affrontement centre/périphérie du " monde politique ", partis traditionnels contre partis marginaux, respectabilité démocratique contre populisme. Ce nouveau clivage politique se confirmera lors d’une élection complémentaire au Grand Conseil vaudois, le 4 juillet 1942 : un journaliste totalement inconnu, et de plus récemment revenu au pays, Florian Delhorbe, est élu grâce à l’appui des " nicolistes " contre le candidat socialiste officiel, Robert Abt. Delhorbe était le candidat de Duttweiler, et à ce titre soutenait la levée des interdictions frappant la gauche " socialo-communiste " (le Landesring avait fait sienne cette revendication). Nicole soutenant toute formation s’engageant à réclamer la " re-légalisation " de la FSS, l’alliance de la gauche " socialo-communiste " et du populisme " duttweilérien " devenait logique ; Duttweiler disposait en outre de gros moyens financiers, ce qui n’était pas négligeable en un moment où les interdictions et la semi-clandestinité qui en découlait confinaient Nicole et les siens dans une précarité de moyens d’action politique qui les affaiblissait face à leurs adversaires.
Ces élections passées, et la politique des interdictions ayant largement fait preuve de son inefficacité (voire de sa contre-productivité), le temps vint de la " renaissance " officielle du socialisme nicoliste. Ce temps est, insistons-y, celui du reflux généralisé des forces de l’Axe sur tous les terrains d’opérations militaires, en particulier sur le front de l’Est. L’Union Soviétique acquiert une " respectabilité " nouvelle par le fait de ses victoires militaires, mais aussi par son alliance avec le " camp des démocraties ", et au prix (léger) de la dissolution d’un Comintern désormais sans utilité pour le pouvoir stalinien, dont il était depuis quinze ans devenu un pur instrument.
Sitôt après les élections municipales de mai 1943 se créée à Genève, le 8 juin, le Parti Ouvrier, qui proclame son intention de s’affilier à l’organisation nationale " dont les buts sont analogues aux siens ", soit le Parti socialiste Suisse. Le Parti Ouvrier veut donc tirer un trait sur toute la période allant de la scission de 1939 aux interdictions de 1941, et réintégrer la " famille socialiste " de plein droit, quitte à en former (comme avant) l’aile gauche. Les communistes ont cependant une vision différente de l’avenir du nouveau parti, qu’ils conçoivent comme l’ébauche d’une formation durablement indépendante du PSS, située clairement à sa gauche et rassemblant toutes celles et tous ceux pour qui l’Union Soviétique et son quart de siècle d’histoire sont la référence première du mouvement populaire.
Toujours officiellement frappé de proscription politique, Léon Nicole ne pourra pas assumer personnellement la direction du Parti ouvrier ; Jean Bommer le fera à sa place, et sur ses instructions. Quelques semaines après sa création, le Parti ouvrier atteindra les 2000 membres à Genève, soit plus que n’en jamais compté (jusqu’à ce jour) le Parti socialiste genevois. Le 31 octobre se déroulent les élections fédérales. A Genève, le Parti ouvrier dépose une liste de huit candidats, dont quatre inéligibles : Léon Nicole, Jean Vincent, Paul Naine et Louis Piguet. La Chancellerie d’Etat genevoise exige le remplacement de ces quatre candidats par quatre autres, éligibles ceux-là ; le Parti ouvrier refuse, au nom de l’égalité des droits des citoyens, et en particulier de leur droit à être également candidats à des élections lors desquelles ils disposent du droit de vote (puisque les " inéligibles " restent des électeurs), tous droits garantis par les constitutions fédérale et cantonale. Comme le Parti ouvrier lui-même s’y attendait, les autorités cantonales et fédérales maintinrent leur position (tout en la sachant déjà frappée d’obsolescence). Les " nicolistes " en prirent prétexte (tel était d’ailleurs le but de l’opération) pour boycotter l’élection et appeler les électeurs à l’abstention : " La classe travailleuse et populaire de Genève veut que l’on en finisse avec toutes les restrictions portant sur les droits de souveraineté du peuple, quelle que soit la classe à laquelle il appartienne " (Recours en invalidation des élections des 30 et 31 octobre du Conseil national pour le Canton de Genève, Parti Ouvrier, Genève, 1943, p. 7).
Le résultat de ces élections fut aussi clair que ceux des consultations précédentes : la gauche " nicoliste " n’eut certes aucun élu, puisqu’elle avait décidé de présenter des candidats qui ne pouvaient l’être, mais la participation électorale chute de moitié en huit ans, passant de 66,6 % en 1935 (Nicole regnante) à 35,9 % huit ans plus tard (Nicole proscrit), le nombre des bulletins blancs et nuls étant dans le même délai multiplié par neuf (de 107 à 911). Le Parti ouvrier en déduisit, fort logiquement, que s’il avait pu participer librement aux élections en y présentant les candidats qu’il avait désignés et que son électorat avait l’intention d’élire, il aurait eu trois élus (dont certainement Nicole et probablement Vincent), au détriment de la droite bourgeoise, dont chacun des trois partis constitutifs de l’ " Entente " (libéraux, radicaux, chrétiens-sociaux) aurait laissé un siège à leur adversaire. Et de conclure :
Recours en invalidation… op.cit. pp 9 à 13
Dans sa propagande électorale, le Parti ouvrier enfonce le clou, sans précautions oratoires, mais non sa habileté : les interdictions sont une violation des règles démocratiques ; le Parti ouvrier, victime de ces interdictions, se bat pour le respect de ces règles, et c’est donc faire acte de respect pour la démocratie que s’abstenir (ou voter blanc, ou nul) :
Tract électoral du Parti ouvrier, octobre 1943
Vous devez faire savoir à Berne que vous ne voulez pas que notre pays connaisse les malheurs de nos voisins qui négligèrent de défendre la démocratie, qui laissèrent piétiner les droits politiques et bafouer le principe de la souveraineté du suffrage universel.
Léon Nicole, C’en est assez ! Genève, octobre 1943 (tract électoral)
La gauche " socialo-communiste " genevois use donc à la fois de la protestation démocratique, de le menace du débordement extraparlementaire et de la méfiance traditionnelle de Genève à l’égard de Berne ; elle use aussi des quelques instruments " parlementaires " que les récents assouplissements de la politique des interdictions lui laissaient. Ainsi, le 11 juin 1943, lors de la prestation de serment du nouveau Conseil municipal de la Ville de Genève, les élus du Parti ouvrier lurent-ils une protestation contre la déclaration d’inéligibilité de 271 cadres et militants socialistes et communistes. Le 15 juin, Jean Bodmer, au nom du groupe du Parti ouvrier, présenta au Conseil municipal de la Ville un projet d’arrêté incitant le Conseil administratif à intervenir, au nom de la Ville, auprès du Conseil d’Etat afin que celui-ci à son tour intervînt auprès du Conseil fédéral pour la levée des interdictions. La droite, fort peu désireuse de voir débattre une politique dont elle avait elle-même pris l’initiative (au plan cantonal et au plan fédéral) refusa d’entrer en matière sur ce projet d’arrêté, en jugeant le pouvoir municipal incompétent dans une question d’ordre cantonal et fédéral. Peu importait, à vrai dire, aux " nicolistes ", qui ne se faisaient aucune illusion sur les chances d’acceptation d’un projet qu’ils ne présentaient que pour marquer leur retour (temporairement confiné au plan municipal) dans l’arène parlementaire, et par souci d’ " agit-prop’ ". Et de dénoncer à nouveau la politique de restriction des droits démocratiques menées par la droite :
Au Peuple de Genève, tract électoral, octobre 1943
Dans le canton de Vaud, le Parti Ouvrier et Populaire fut fondé le 21 mai 1943 ; à la différence de Genève, les communistes y prennent le pas sur les anciens socialistes : derrière le socialiste chrétien Samuel Thévoz, et quoique le socialiste " nicoliste " Masson jouât un rôle important, ce sont les communistes (notamment André Muret) qui " tiennent " le nouveau parti. Cela étant, pas plus qu’à Genève, il ne s’agit de (re)constituer un parti communiste : bien plutôt s’agit-il de rassembler l’ensemble des forces situées à gauche du socialisme officiel. La même volonté conduira à la création de partis ouvriers (ou " ouvriers et populaires ", histoire de ne pas proclamer ouvertement qu’il s’agit de reconstituer une organisation dissoute -la FSS- sous un autre nom, commun à toutes les formations cantonales) ; ce sera chose faite à Bienne en décembre 1943, à Bâle en mars 1944 et à Neuchâtel en mai 1944. La création du Parti du Travail suivra, après qu’ait échoué une tentative de réunification avec le PSS, souhaitée par Léon Nicole et la plupart des anciens socialistes, mais " sabotée " par les communistes, avec la complicité consciente ou inconsciente des socialistes " officiels " de Genève et du canton de Vaud.
Au bout du compte, rien de ce que le monde politique officiel avait tenté contre Léon Nicole ne l’avait entamé, ni n’avait entamé le " capital de confiance " dont il jouissait dans la classe ouvrière en 1939 :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission, op.cit. p. 267