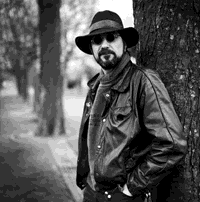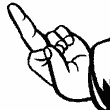

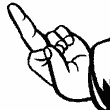

La Guerre d’Espagne : Lutte antifasciste et solidarité ouvrière
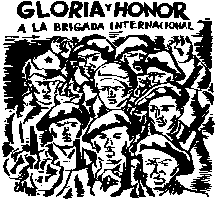
Le parti-pris de la Suisse officielle pour Franco
La Suisse s’apprête à poursuivre les Suisses engagés aux côtés
de la République espagnole
La mobilisation de toute la gauche -de
toutes les gauches.
Les combattants suisses de la Guerre d’Espagne, figures les plus
hautes de la solidarité
L’impact de la Guerre d’Espagne sur le débat au sein de la gauche
L’exemple de la Centrale Sanitaire Suisse
La solidarité continue après la défaite
Les Brigades Internationales : la fine fleur
militante du mouvement ouvrier international
Le refus obstiné de l’amnistie et de la réhabilitation des combattants
suisses d’Espagne
Ce que la Guerre d’Espagne rendit urgent, c’est la fusion, dans l’action, de la lutte contre la fascisme « intérieur » et de la solidarité avec les forces antifascistes « extérieures ». Les Amis de l’Espagne Républicaine, l’œuvre suisse d’entraide ouvrière et la Centrale sanitaire suisse, mais aussi les combattants suisses des Brigades internationales et des milices républicaines, anarchistes, du POUM, basques et catalanes, en s’engageant aux côtés du Gouvernement espagnol issu du Frente Popular ou des organisations révolutionnaires, sont tous bien conscients de lutter non seulement contre les armées de Franco, de Mussolini et de Hitler mais aussi contre ceux qui, en Suisse, soutiennent un pronunciamento réactionnaire où se mêlent monarchisme, catholicisme « intégriste » (comme on ne disait pas encore), fascisme et autoritarisme militaire. Les manifestations de soutien, les collectes de fonds et de matériel « pour l’Espagne » sont aussi l’affirmation d’un choix sans équivoque au plan national : de nombreux et puissants secteurs des partis bourgeois et des « milieux de l’économie » ont pris fait et cause pour la tentative autoritaire espagnole qui, au cri de Arriba España !, proclame des valeurs « traditionnelles » qui leur paraissent (et paraissent à la hiérarchie catholique) la meilleure des garanties de l’ordre social, culturel et économique auquel ils adhèrent.
Le Conseil fédéral et la majorité du parlement, sous couvert de neutralité, ne tardent pas en fait à prendre « objectivement » parti, ne serait-ce qu’en traitant de la même manière le gouvernement légal de la République, procédant d’élections démocratiques, et les forces insurgées qui veulent le renverser, qui au nom de la monarchie, qui au nom de l’Eglise, qui au nom de l’ « ordre nouveau » fasciste. Le 11 août 1936, le Conseil fédéral interdit toute exportation d’armes à destination de l’Espagne, au motif que
ü La politique de neutralité fait à notre pays un devoir d’autant plus impérieux de se tenur scrupuleusement à l’écart de la guerre civile espagnole que d’autres puissances pourraient incliner à favoriser l’un ou l’autre des partis en présence.
Cité par Jean-Claude Favez, Guerre d’Espagne : neutralité d’abord ! in Journal de Genève du 2 août 1986
Une telle position aurait sans doute du amener le gouvernement suisse à adhérer à l’accord de non-intervention proposé (naïvement) par la France ; il ne le fera pas, au nom d’une « neutralité perpétuelle » sensée être de nature différente de la neutralité occasionnelle, conjoncturelle, que la France propose aux Etats européens (y compris à l’Allemagne nazie et à l’Italie fasciste) ; l’adhésion de la Suisse à un accord de non-intervention est donc réputée superflue par le Conseil fédéral, puisque la neutralité pourvoit à tout choix politique. En réalité, la neutralité helvétique ne sera pas, dans l’ « affaire espagnole », exempte d’abord d’ambiguïtés, puis d’hypocrisie. Le 27 août 1936, le Département politique fédéral demande au Consul de Suisse à Séville d’établir avec les « autorités » franquistes locales des contacts effectifs. Bien que ces relations ne signifie pas (encore) une reconnaissance de jure du « gouvernement » de Burgos, c’est bien à sa reconnaissance de facto que la Suisse procède. Les « milieux de l’économie », qui n’y sont pas étrangers, ne font pas même mine de l’ignorer, et demandent au Conseil fédéral, le 1er décembre, d’établir un contact officiel non plus avec les « autorités » franquistes locales, mais avec le « gouvernement » de Burgos lui-même, au nom de la défense des biens suisses et à titre de précaution (ou de préparation) pour « le jour où le gouvernement national parviendrait à prendre le contrôle de la totalité du pays » (lettre du Vorort à Giuseppe Motta du 1er décembre 1936). Le « gouvernement national », dit le Vorort : le 2 novembre, Motta et Pilet-Golaz ont imposé à l’Agence télégraphique suisse d’user de ce titre (celui qu’il s’est lui-même décerné) pour désigner le « gouvernement » franquiste, c’est-à-dire les putschistes, en lieu et place de l’expression « gouvernement insurgé » utilisée jusqu’alors. C’est bien d’une préparation à la reconnaissance officielle de l’Espagne franquiste qu’il s’agit à une reconnaissance que les sympathies d’une grande partie de la droite à l’égard du pronunciamento laissaient prévoir bien avant que les conditions matérielles en fussent remplies.
Le 14 août 1936, le Conseil fédéral interdit aux Suisses toute participation aux hostilités, et décide de poursuivre ceux qui s’engageront dans l’un ou l’autre camp (ce qui concrètement concernera d’abord et surtout les volontaires engagés dans le camp républicain et révolutionnaires ; en même temps, le gouvernement helvétique repousse définitivement la politique de « non-intervention » proposée par la France, et proclame sa volonté de « prendre de sa propre initiative les mesures autonomes tendant à assurer sa neutralité » (cité par J.-Cl. Favez, art. cit.). En fait, la Suisse manifeste ainsi à la fois sa prudence et son refus de la concertation internationale. Sa prudence : il s’agit d’être prêts à établir avec un gouvernement franquiste victorieux (même s’il est encore loin de l’être, et qu’il lui faudra obtenir l’intervention allemande et italienne pour arriver à briser la résistance républicaine) les meilleures relations possibles ; son refus de la concertation internationale : le discours helvétique est un discours de non-intervention, mais il n’est pas question pour le Conseil fédéral que cette non-intervention s’intègre dans un plan plus vaste, commun à plusieurs Etats (et par conséquent offrant à chacun d’entre eux la possibilité de juger la politique des autres). La « non-intervention » telle que proposée par la France souffrait de deux vices aux yeux de la Suisse officielle : elle était de toute évidence « orientée », en ce sens qu’elle était visiblement destinée à empêcher un engagement déterminant de l’Allemagne et de l’Italie aux côtés de Franco (il fallait être quelque peu naïf, mais peut-être l’était-on volontairement, pour croire que les engagements pris par les nazis et les fascistes allaient être tenus) ; surtout, cette proposition était française, émanant d’un gouvernement (celui de Léon Blum, celui du Front Populaire) avec lequel le Conseil fédéral suisse n’avait, et c’est un euphémisme, que fort peu d’atomes crochus.
Subtilement profranquiste et anti-républicain, le Conseil fédéral semble bien être à l’unisson de la majorité (de droite) de l’opinion publique suisse, lorsqu’il affirme vouloir préserver la Suisse et les Suisses de toute ingérence dans le conflit espagnol. La gauche, toutefois, et toutes « familles politiques » confondues (des anarchistes à l’aile droite du PS, en passant par les communistes), prend fait et cause, et se mobilise, pour la République espagnole, pour la classe ouvrière espagnole, pour la révolution en Espagne, pour toutes ensemble ou pour l’une ou l’autre. Cette mobilisation inquiétera d’ailleurs suffisamment le Conseil fédéral pour que, le 25 août 1936, l’usage des libertés démocratiques soit sérieusement limité. Au PS, qui proteste, le Conseil fédéral rétorque, dans une lettre du 15 septembre, que « les droits politiques des citoyens ne sont pas garantis de façon illimitées » ; la gauche, et en particulier son aile « extrême », aura d’autres occasions de s’en apercevoir.
Paul Golay juge sévèrement, avec le mélange d’ironie et de lyrisme dont il est coutumier, l’attitude du Conseil fédéral :
ü (Le Conseil fédéral) invite le peuple suisse à s’abstenir de toute manifestation en faveur des gouvernementaux espagnols, à leur refuser aide matérielle, une attitude d’indifférence étant seule compatible avec les nécessités de notre neutralité. Est-il nécessaire de souligner le caractère profondément humiliant des exigences de l’autorité ? Si, incidemment, par sa fixation à un sol déterminé ou par l’origine de ses ancêtres ou par le jeu des naturalisations purificatrices, un homme est Suisse, il demeure également d’une façon permanente un être humain à qui, par définition, rien de ce qui se passe dans son domaine, la Terre, ne saurait être étranger. Ce besoin naturel de participer, par sympathie ou par protestation ou par concours effectif aux événements, aux pensées, aux mystiques, aux revendications ayant leur siège hors de nos frontières fut le besoin que nous avons satisfait de tout temps. Arméniens massacrés, Boers envahis, Belges violés, indigènes exploités, peuples noirs décimés, etc., de tous ceux-là, en des époques diverses, le peuple suisse s’est épris avec violence, sans songer à sa neutralité qui est celle de la nation, mais qui n’est pas celle des citoyens (…).
En avril 1833, plusieurs centaines de Polonais expulsés de France, étant des révolutionnaires, s’installèrent dans le canton de Berne. Beaucoup vinrent chez nous. Ils participèrent à une expédition contre la Savoie. De nombreux citoyens les facilitèrent dans leur entreprise. Les autorités s’en émurent. Druey prit nettement la défense des amis des réfugiés et écrivit notamment ce qui suit : « Il est juste de reconnaître, hautement, ce qu’il y a d’honorable, de national, de patriotique, de vraiment suisse dans la conduite des citoyens qui ont pris fait et cause pour les réfugiés, qui ont favorisé leur entreprise. Ils ont été les dignes interprètes de l’avenir, d’une politique régénérée, de la liberté. Si la Suisse se souvenait de son origine toute révolutionnaire, si elle savait apprécier la loi de sa position et ses véritables intérêts, elle verrait qu’elle est placée dans le camp des peuples, que ses ennemis naturels sont les rois ». En 1848, Ochsenbein (…) voulait que l’on forme en Suisse des corps francs pour les envoyer en Allemagne. Il s’exprimait ainsi : « La Suisse est tellement compromise aux yeux des royautés déchues et de celles qui restent debout que, s’il y avait une réaction européenne, la Suisse serait envahie, opprimée, pillée, brûlée, lors même qu’elle n’aurait fourni ni armes, ni munitions, ni hommes, car la Suisse est coupable par le fait de son existence ». Et conclusion, Ochsenbein considérait que notre salut dépendait du triomphe de la démocratie et que puisque ce triomphe nous était une garantie, il s’agissait de participer à la lutte. (…) Quant à Druey, lui, il demandait à la Commission de la Diète d’exprimer l’ « intention de la Suisse de coopérer, par des forces militaires, à l’affranchissement de l’Italie ». Il y avait, dans de telles impulsions, une générosité un peu imprudente, mais de quel éclat de brillait-elle pas, cette démocratie des années héroïques ! Que de haute philosophie et de belle hardiesse dans la pensée de ce chef du radicalisme vaudois ! Le gouvernement actuel est son fils spirituel. Que dirait le papa s’il voyait aujourd’hui son môme ! Il demanderait à l’Eternel de rentrer, et en vitesse, dans le calme austère du tombeau !Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 139-141
La Guerre d’Espagne sera ainsi le moment du plus décisif des engagements solidaires pour des centaines (plus de 800) de militants suisses : l’engagement de s’en aller combattre, au nom de principes et d’une nécessité politiques sans échappatoire, aux côtés de leurs camarades espagnols, contre la version ibérique du « fascisme international ». Si communistes d’une part, anarchistes d’autre part, formèrent l’essentiel du « contingent » helvétique en Espagne, les socialistes, les syndicalistes « socialisants » mais non adhérents du PS, et les simples citoyens « de gauche » mais membres d’aucune organisation, n’en furent pas absents. L’épisode est en fait celui où se manifeste de la plus claire manière la développement dans le mouvement ouvrier suisse d’une conscience solidaire qui ne se contente plus de protestations « idéales » et de l’expression théorique de principes généraux. En s’en allant combattre en Espagne, les « volontaires suisses de la liberté » sont les figures les plus hautement symboliques de cette conscience solidaire née des convulsions des années trente -comme après eux, les militants des réseaux suisses de résistance au nazisme et de solidarité avec ses victimes -et avec les résistances antinazies « à l’étranger », notamment en France et en Italie- le seront de la conscience solidaire en temps de guerre. Ces anarchistes, ces communistes, ces socialistes pratiqueront à l’égard de l’Espagne cette solidarité active dont le radical Druey se faisait le héraut un siècle auparavant, pensant alors à l’Allemagne républicaine.

Des militants syndicalistes libertaires genevois se souviennent, cinquante ans plus tard, des multiples formes prises alors par cette solidarité :
ü Alex (Burtin) :
J’étais pacifiste, mais en 1936, au moment de la Guerre d’Espagne, quand j’ai vu que l’armée pouvait faire tomber une république, je me suis dit, il faut être formé pour la bagarre, alors j’ai fait mon école de recrue. Et puis, je ne suis pas parti en Espagne, mais je me suis beaucoup occupé des Espagnols qui venaient ici. Genève était un lieu de transit. On était tout un groupe de syndicalistes, il y avait les amis de l'Espagne républicaine, beaucoup étaient des anarchistes. (…) on a fait de l’accueil pour les Républicains espagnols qui devaient momentanément quitter leur pays. On louait des appartements pour les loger et on fournissait des papiers à ceux qui n’en avaient pas, pour qu’ils puissent circuler.
ü Gustave (Berger)
Moi, je suis parti en Espagne, je voulais voir ce qui s’y passait. Et puis je voulais les aider, alors je suis resté. Mais je ne pensais pas que ça aller durer si longtemps. Au début, personne ne le pensait. J’y suis resté jusqu’aux journées de mai 1937 * où j’étais à Barcelone. J’en ai un souvenir terrible. Entre combattants pour l’Espagne républicaine, on ne pouvait plus se faire confiance.
* Affrontements entre communistes (et républicains « bourgeois » d’une part, anarchistes (et trotskistes) d’autre part.
cités par Christiane Wist, la vie quotidienne et les luttes syndicales…, op.cit. p. 156

« Le sort de la démocratie ne se joue pas sur les champs de bataille d’Espagne », déclarait alors le Conseiller fédéral Baumann. Ils furent plus de 800 à être suffisamment persuadés du contraire pour s’en aller combattre du côté républicain (ou, plus largement dit, antifranquiste). Le Ministère public de la Confédération recensa 369 de ces combattants, ceux dont il eut connaissance et qu’il poursuivit pour s’être « enrôlés dans une armée étrangère ». Des ces 369 combattants reconnus (et poursuivis) comme tels par la justice de leur pays, 103 venaient du canton de Zurich, 46 de Genève, 38 de Bâle-ville et 33 du Tessin. Un tiers moururent sur le champ de bataille ou dans les hôpitaux ; ceux qui revinrent en Suisse, après la défaite de la République (ou de la Révolution) espagnole, furent pratiquement tous, en tant qu’ils avaient été « repérés » par la justice helvétique pour avoir combattu en Espagne, condamnés ; 200 d’entre eux furent de surcroît privés de leurs droits civiques, pour avoir conçu comme un devoir civique ce qui, précisément, menaçait ces droits : le fascisme. Plus d’un demi-siècle après, l’amnistie des survivants (et, à titre posthume, la réhabilitation de leurs camarades décédés entre temps) restait à l’état de revendication.
La gauche suisse, donc, perçut clairement l’enjeu, national et international, de la Guerre d’Espagne, en son triple aspect stratégique, idéologique et symbolique. Comprenant l’enjeu, elle en tira la conséquence, en s’engageant sans ambiguïté dans la lutte (du moins, sans autres ambiguïtés que celles qui naquirent au sein même du « camp républicain »), persuadée qu’il y avait dans ce conflit un camp du Bien et un camp du Mal, un camp des Justes et un camp des salauds. L’extrême-droite n’en sera d’ailleurs pas moins persuadée, son choix étant évidemment à l’inverse de celui de la gauche, mais son influence sur l’opinion publique étant considérablement moindre, et la droite traditionnelle se cantonnant dans une prudente et hypocrite neutralité, l’engagement des fascistes, nazis et frontistes suisses aux côtés des franquistes n’aura jamais l’impact de celui des militants de gauche dans le camp de la République (et/ou de la révolution).

Des centaines de communistes, anarchistes, socialistes et syndicalistes suisses participeront donc de ce romantisme révolutionnaire, de cette « illusion lyrique » que célébrera André Malraux dans L’Espoir, et qui, longtemps, jettera un voile pudique sur les dissensions et les conflits internes du camp antifasciste. Cette sensibilité de la gauche helvétique à la « question espagnole » sera telle que le PSS critiquera violemment la politique du gouvernement français de Front Populaire : le « pacifisme » de Léon Blum ne trouvera pas grâce aux yeux des socialistes suisses (pacifistes, pourtant, eux aussi), ni l’incapacité de la SdN à prendre une position claire dans ce conflit. Au sein du PSS, toutefois, la « question soviétique » faisait toujours problème, lors même qu’il s’agissait de se prononcer, par des actes, sur la « question espagnole ». A ceux qui proclamaient l’Union Soviétique comme étant le « seul rempart contre le fascisme international », et qui mettaient en évidence l’aide matérielle apportée par l’URSS à la République espagnole, les « antisoviétiques » du PSS et les « antistaliniens » de gauche (trotskistes et anarchistes en tête) répondront, dès que les événements espagnols les y inciteront, en dénonçant le rôle joué par les communistes (espagnols et étrangers, notamment soviétiques, mais aussi français) et les services d’Etat soviétiques dans les conflits sanglants survenus au sein même du camp républicain -un camp que les communistes voulurent « épurer » par la forces de ses composantes anarchistes et marxistes révolutionnaires.
Toutes les tendances, et toutes les organisations, de la gauche se retrouveront toutefois pour dénoncer d’une même voix, sinon avec les mêmes mots, les équivoques de la politique du Conseil fédéral. Au début de cette guerre, la Suisse dispose d’une légation à Madrid, de deux consulats à Barcelone et Séville et de deux agences consulaires. Il y a 4000 Suisses en Espagne en 1935-36, il en restera 2000 en 1937, et nombre d’entreprises industrielles, commerciales et financières espagnoles sont en mains helvétiques. La victoire du Frente Popular avait grandement inquiété ces Suisses-là, petits ou gros possédants se sentant menacés par les engagements de la gauche, et plus encore par les intentions des forces révolutionnaires (essentiellement anarchistes) désireuses de pousser au plus loin -jusqu’à la rupture- la volonté de changement exprimée par les électeurs. La « colonie » suisse semble donc avoir accueilli avec soulagement un pronunciamento militaire dont elle se persuada qu’il la préservera des « exactions » et des collectivisations menées du côté républicain. La politique du Conseil fédéral tiendra directement compte de cette préférence franquiste des Suisses d’Espagne ; surtout, elle mettra au premier plan de ses préoccupations, non la défense de la démocratie ou le soutien au gouvernement légitime, mais la sauvegarde des intérêts économiques et commerciaux suisses en Ibérie. En fait, Motta adopte à propos de l’Espagne l’attitude exactement inverse de celle qu’il adopta à l’égard de l’Union Soviétique : en Espagne, les intérêts matériels de la Suisse (disons plutôt : d’une « certaine Suisse » -celle qui, précisément, y a des intérêts matériels) priment les principes de la démocratie libérale ; à propos de l’URSS, ces intérêts matériels doivent céder le pas à ces principes : « l’élite diplomatique suisse semble acquise très tôt aux thèses de Franco, symbole de l’anticommunisme et du zèle religieux » (Jean-Bernard Mottet, Le Courrier, Genève, 28 juin 1986). Le 9 août 1936, moins d’un mois après le début de la guerre, le Conseil fédéral interdit toute exportation d’armes vers l’Espagne ; deux jours plus tard, Motta interdit toute participation de Suisses à la guerre espagnole, après qu’une dizaine de communistes zurichois aient été arrêtés à Bâle alors qu’ils partaient pour l’Espagne ; les 14 et 20 août, le Conseil fédéral interdit tout départ vers l’Espagne et toute manifestation en rapport avec le conflit ; parallèlement, Motta et Pilet-Golaz imposent à l’Agence Télégraphique Suisse l’usage du qualificatif « nationales » pour désigner, en lieu et place de « rebelles », les forces franquistes. En novembre, des contacts officieux sont établis entre la Suisse et les franquistes, qui installent un bureau de représentation à berne. En juin 1938, une délégation suisse est reçue par le « ministre des Affaires étrangères » de Franco.
La gauche a immédiatement saisi la dimension internationale du conflit espagnol : ce n’est pas seulement le combat de la République contre Franco et Mola, c’est aussi et surtout le combat, mondial, de la liberté contre le fascisme. Après des années de reculs et de défaites, il est possible, enfin, de vaincre la Bête sur le terrain qu’elle a elle-même choisi, celui de la confrontation militaire. Ailes gauche et droite confondues, le PSS affirme donc sa solidarité avec une Espagne devenue symbole de la résistance internationale au fascisme ; cette solidarité, le PSS l’affirme aussi avec ceux qui, de Suisse même, sont partis combattre en Espagne. Soutenus par les communistes et quelques personnalités du centre-gauche (l’aile « progressiste » des partis bourgeois, essentiellement du parti radical), le PSS se lance dans la bataille de l’amnistie des combattants suisses d’Espagne -et la perd (la bataille se poursuit toujours, près de 70 ans plus tard…). Il se lance aussi dans la solidarité concrète : André Oltramare fonde en 1936 les Amis de l’Espagne Républicaine et Genève devient une plaque tournante de la solidarité avec l’ « Espagne en lutte » -de toutes les solidarités, avec toutes les luttes : de l’engagement dans les Brigades Internationales ou les colonnes anarchistes à l’envoi de lait condensé.
La Guerre d’Espagne fera évidemment débat politique au sein du mouvement ouvrier suisse ; si la solidarité avec la gauche espagnole (et, au-delà, avec la République « quelle qu’elle soit », contre la « restauration monarcho-cléricalo-fasciste ») ne fut jamais mise en cause, la « guerre civile dans la guerre civile », et plus précisément le combat mené par les communistes (staliniens) pour l’élimination (politique en tous cas, physique le cas échéant) des anarchistes et des trotskistes, de la CNT, de la FAI et du POUM, remit à l’ordre du jour le clivage gauche-droite au sein du PSS, mais avec une ligne de partage originale, puisque par fidéisme « soviétique » la gauche socialiste couvrira l’élimination par les communistes de la gauche révolutionnaire espagnole, tandis que la droite social-démocrate et syndicale se retrouve aux côtés de ceux, dont pourtant tout politiquement les sépare, que la politique stalinienne en Espagne vise : les anarchistes et les trotskistes :
ü Le fossé se creuse entre la droite (E.-Paul Graber, Bringolf, Reinhard, en gros le Comité directeur) et les « nicolistes ». (…) L’Espagne renforce Léon Nicole dans son immense -et bientôt aveugle- admiration pour l’URSS, seul soutien militaire de la République, seul rempart contre le fascisme, elle qui seule peut faire « reculer Hitler et ses hordes guerrières ».
Pierre Jeanneret, Le Parti socialiste suisse face à la guerre d’Espagne, in Tribune Socialiste Vaudoise N° 182, septembre 1986
Pour Pierre Jeanneret, « la Guerre d’Espagne, en radicalisant les positions antagonistes au sein du PSS, a précipité la scission de 1939 » entre le PSS et les « nicolistes » ; acceptons-en ici l’hypothèse, tout en précisant bien que l’effet du conflit espagnol sur les débats internes au PSS ne fut que celui d’un « accélérateur », d’un « mûrisseur » de ce conflit, et que la scission se serait produite même si la Guerre d’Espagne n’avait pas été la raison ou le prétexte de divergences, et même si la République (ou la Révolution) espagnole avait finalement vaincu la sédition franquiste : les divergences entre les deux ailes du socialisme suisse étaient trop profondes, et les références politiques trop antagoniques, pour que ces divergences et cet antagonisme pussent être résolue autrement que par l’éclatement. Mais la Guerre d’Espagne eut peut-être un autre effet, encore : celui de convaincre nombre de socialistes de gauche réticents à l’idée d’admettre la légitimité de la défense nationale (du moins sous sa forme militaire) de l’utilité de s’y rallier ; ainsi la référence à l’Espagne fut-elle « explicite », nous dit Jeanneret, dans la décision prise par les socialistes vaudois, le 17 janvier 1937, d’accepter l’adhésion au principe de la défense nationale.
Au-delà du débat politique, plus large que lui, plus profondément ancré que lui dans la base sociale du mouvement ouvrier et socialiste suisse, il y eut le formidable mouvement de solidarité avec l’Espagne républicaine et les victimes de la guerre, mouvement en lequel s’engagea toute la gauche helvétique, des anarchistes à la gauche du parti radical. Dès le début du conflit, dans toute l’Europe, ce mouvement s’était rapidement organisé. A Genève, le 7 août 1936, 40 organisations (dont toutes les organisations politiques de gauche et d’extrême-gauche) convoquèrent à une grande « assemblée d’information » ; en moins de trois semaines, les « Samaritains Ouvriers » recueillirent 10'000 francs (soit près de quinze fois plus en termes réels aujourd’hui) pour l’ « aide au peuple espagnol » ; une somme constituée pour l’essentiel de centaines de dons modestes effectués par des travailleurs aux revenus très bas : « L’ouvrier anonyme qui envoie un franc « pour que l’on ne voie jamais cela chez nous me paraît bien résumer cet élan de générosité populaire » (cité par C. Ph, dans Le Courrier de Genève du 20 septembre 1986), commente un journaliste contemporain. Dans toutes les villes suisses, de semblables collectes permettent l’envoi très rapide de médicaments, de nourriture, d’ambulances et de matériel médical, de vêtements, en Espagne. Ce mouvement général de solidarité se poursuivra jusqu’à la fin de la guerre, parallèlement au mouvement d’engagement direct de milliers de militants de gauche dans les rangs républicains.
Début 1937 avait été fondée à Paris la Centrale Sanitaire Internationale : le « camp républicain » était dramatiquement démuni de médecins et ne disposait ni d’un service sanitaire militaire organisé, ni du matériel et des médicaments nécessaires. Un médecin suisse, le Lausannois Ernest Jaeggy, avait participé à la fondation de la CSI ; de retour en Suisse, il donnera l’impulsion nécessaire à la création, le 9 décembre 1937, de la Centrale Sanitaire Suisse dont il deviendra le secrétaire romand (la CSS sera présidée par le Zurichois Hans von Fischer, Ernest Jaeggy étant « Président d’honneur »). La CSS livrera du matériel sanitaire et des médicaments pendant toute la durée de la guerre, depuis Genève ou Bâle. Le conflit espagnol terminé, certains responsables de la CSS, organisation aux buts et actions purement humanitaire (quoi qu’il en soit des convictions politiques personnelles de ses membres) durent affronter quelques « problèmes » liés à leur engagement aux côtés de la République espagnole. En janvier 1939, Ernst Rosenbusch, secrétaire central de la CSS et membre du Parti socialiste, fut ainsi « mis en disponibilité » de l’armée (il était Premier-lieutenant) à cause de son soutien à l’Espagne républicaine et de ses contacts avec ses autorités ; le docteur Roger Fischer, de Genève, faillit également être relevé de sa responsabilité de chef du centre de transfusion sanguine de l’armée, le général Henri Guisan estimant qu’il serait « fort maladroit d’avoir recours à un praticien de cette tendance alors que le pays entier lutte contre le communisme » (Cinquantenaire de la Centrale Sanitaire Suisse, aperçu historique 1937-1987, CSS, Dommartin, 1987, p. 8) ; la Police fédérale accusa Fischer d’avoir organisé le départ de volontaires vers l’Espagne, soigné des combattants espagnols et collecté du sang pour les républicains )il ne nia pas s’être livré à cette dernière activité). Il fallut que le Chef de l’état-major recommandât à Guisan de maintenir Fischer à son poste en raison de ses indiscutables compétences dans son domaine )il avait fondé l’Hémocentral de Genève et réussi le premier envoi de flacons de sang conservé, vers Barcelone) pour que le médecin genevois soit maintenu dans ses fonctions.
Lorsqu’au printemps 1939 la République espagnole dut déposer les armes, les restes de ses armées et les réfugiés civils, par centaines de milliers, affluèrent en France. Parmi eux, et les accompagnant, le délégué de la Centrale Sanitaire Internationale à Valencia, François Jaeggy. Près d’un demi-million d’hommes, de femmes et d’enfants furent internés, dans des conditions calamiteuses, par les autorités françaises : la CSI et la CSS intervinrent pour que les conditions sanitaires et d’hygiène dans ces véritables camps de concentration (au strict sens du terme) ne soient pas fatales, et que ne s’y ajoute pas la sous-alimentation. En Suisse même, il fallut s’occuper des combattants de retour d’Espagne : des médecins mobilisés par la CSS s’engagèrent à soigner gratuitement ces patients sans travail et victimes par ailleurs de l’ire judiciaire et policière.
L’un des acteurs de cette solidarité militante de la gauche suisse avec l’Espagne républicaine, Roger Dafflon, futur Maire (communiste) de Genève, en témoigne :
ü C’est à Puigcerda, non loin de la frontière française et de Bourg-Madame, que le gouvernement de l’Espagne républicaine avait réquisitionné quelques résidences de riches Espagnols en fuite pour y héberger de nombreux enfants victimes de la guerre. Une institution soutenue par l’Association Suisse des Amis de l’Espagne républicaine, encadrée par du personnel helvétique. Au printemps 1937, cri d’alarme : les réserves de nourriture, vêtements et autres marchandises sont épuisées. A Genève s’organise alors un grand meeting de solidarité et des milliers de participants apportent qui des pâtes, qui du riz ou du savon et de l’huile, etc… en plus d’un peu d’argent. Ces marchandises sont si nombreuses qu’il faut louer une arcade pour les stocker et surtout les expédier rapidement et à bon port. Pour cela, un seul moyen : frêter un wagon de chemin de fer, qu’il faut cependant faire « accompagner » pour qu’il arrive le plus rapidement possible à destination et surtout -comme ce fut une ou deux fois le cas précédemment- qu’il ne soit pas détruit ou détourné par les amis français des fascistes espagnols. Donc veiller, en suivant à motocyclette le wagon, de gare de triage en gare de triage, qu’il soit immédiatement « accroché » au bon train, en faisant appel à la compréhension et à la solidarité des cheminots français. Les marchandises arrivèrent ainsi à la frontière espagnole en 24 heures.
in Réalités (Genève) du 26 juin 1986
Les Amis de l’Espagne Républicaine auxquels Roger Dafflon fait allusion furent constituée en organisation dans les premiers jours de la guerre, par le socialiste genevois (et membre de l’aile « modérée », pour ne pas dire de l’aile « droite », du parti), André Oltramare ; cette association, fort œcuménique dans sa composition, fut active jusqu’à l’effondrement de la République espagnole, procédant à des collectes de fonds et de matériel, à l’acheminement de ce matériel, à l’organisation de meetings de solidarité et d’assemblées d’information. En 1938, les AER de Romandie décidèrent de concentrer l’essentiel de leurs actions de solidarité matérielle sur la ville catalane de Gerone, submergée par des milliers de réfugiés et en proie à de considérables difficultés alimentaires et sanitaires. Rien qu’à Genève, pas moins de dix assemblées publiques furent organisées dans la seule année 1938 et par les seuls AER, assemblées auxquelles prirent part de multiples oratrices et orateurs, de la Madrecita catalane Sofia Blasco à la Rote Regina zurichoise, Regina Kägi-Fuchsmann, âme de l’œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière, sans omettre bien sûr les ténors de la gauche locale : Léon Nicole, Jean Vincent, Etienne Lentillon, André Oltramare. La solidarité avec l’Espagne républicaine usa de tous les media disponibles : presse et tracts, affiches, mais aussi cinéma, meetings, fêtes champêtres, marchés militants… Le rapport d’activité des AER pour 1938, signé d’André Oltramare, témoigne éloquemment de l’activisme inlassable du mouvement de solidarité : meeting avec la Centrale Sanitaire Suisse, assemblée de protestation contre le bombardement par les forces de l’Axe des « villes ouvertes », non défendues militairement, des zones républicaines, réception (sous la présidence de Léon Nicole) de volontaires suisses au service de l’Espagne républicaine, de retour au pays… occasion aussi de demander pour eux une amnistie qui leur sera toujours obstinément refusée. 75'000 tracts sont distribués pour protester contre les bombardements fascistes, 2000 exemplaires d’une brochure sur Gerone « partent comme des petits pains », jubile Oltramare, 1500 affiches représentants les clochers de Gerone derrière un enfant famélique sont placardées dans toute la Romandie, des réunions sont tenues dans toute la Suisse latine, de Genève à Lugano, des sections créées partout, jusque dans les petites localités… André Oltramare égrène ses chiffres :
ü En 1938, c’est au rythme de deux par mois (…) que partent les envoie à destination de Gerone. Ce sont presque exclusivement des dons en nature, surtout des vivres : 20'200 kg de riz, 11'000 kg de farine, 9000 kg de lait condensé, 4200 kg de sucre, 4200 kg de morue sèche, 3400 kg de haricots et de pois, 600 kg de conserves de viande, d’huile de fois de morue, de chocolat (…), 5900 kg de savon (…). Les vêtements sont réparés par des volontaires du Mouvement des femmes contre la guerre et le fascisme et du Groupe des femmes socialistes. (…) On envoie des chaudrons aux homes de réfugiés de Gerone, des cahiers aux gosses, et des crayons, des jouets, 120 kg de biberons et 1000 doses de sérum contre la diphtérie.
Rapport d’activité 1938 des Amis de l’Espagne Républicaine, cité par Jean Bühler, in Solidarité Ouvrière, Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière, No 25, mars 1986
Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette solidarité au quotidien, « à ras les pâquerettes », exprimée par de tels dons et par une population ouvrière dont les conditions matérielles d’existence étaient fort difficiles : une solidarité de pauvres envers de plus pauvres qu’eux. Les Espagnols (les Catalans, en l’occurrence) s’en rendaient d’ailleurs parfaitement compte, qui à Gerone baptisèrent « Jardin de Suisse » le parc central, et « avenue de Genève » l’une des principales artères de la ville. En mars 1938, André Oltramare s’était rendu en Catalogne ; en juin, le Maire de Gerone, Cerazo, rend la visite à Genève ; en juillet, Gerone est prise par les franquistes… le reflux républicain sur tous les fronts impose une concentration des actions de solidarité sur les réfugiés espagnols en France. Toute la gauche, à nouveau, s’y met : le combat militaire semble perdu, quoique l’on n’ait cessé jusqu’au bout d’espérer en un renversement de situation, et que l’on croira jusqu’en 1945 que la défaite du nazisme et du fascisme en Europe entraînera la chute du franquisme, mais l’exigence solidaire demeure ; elle demeurera jusqu’à la mort de Franco, et l’Espagne restera l’un des thèmes communs les plus forts, et les plus provocateurs de manifestations et de solidarité, pour l’ensemble de la gauche -de toute la gauche, toutes sensibilités confondues, toutes organisations réunies.
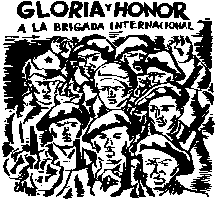
Le combat militaire de 1936-1939 en Espagne, des Suisses le menèrent donc dans les rangs républicains (e/o révolutionnaires). Ils furent 800, au moins, à rejoindre ces rangs, en particulier (mais non exclusivement) ceux des Brigades Internationales, officiellement constituées en octobre 1936 par le mouvement communiste international, et auxquelles participèrent quelque 70'000 combattants (de loin pas tous communistes) originaires du monde entier (outre 3000 Soviétiques) : 10'000 Français, 5000 Italiens, 5000 Allemands, 5000 Polonais, plus de 2000 Tchèques et Slovaques, 2000 Britanniques, 1700 Autrichiens, 1700 Yougoslaves… la fine fleur militante du mouvement ouvrier international, et surtout du mouvement communiste, répartie en 24 bataillons par communautés linguistiques. On remarquera la forte présence de ressortissants de pays « sous la botte » fasciste ou nazie, pour qui la Guerre d’Espagne était aussi une lutte contre leur propre ennemi national. Dissoutes en 1938, les Brigades Internationales virent 12'000 de leurs combattants (un sixième de leur effectif) tués au combat, dont au moins 124 Suisses.
C’est en novembre et en décembre 1936 que se produisirent les plus importants départs de combattants suisses pour l’Espagne. Une statistique (partielle) indique la provenance géographique de 370 de ces volontaires : on y dénombre 119 Zurichois, 83 Tessinois (le plus fort contingent proportionnellement à la population cantonale), 46 Genevois et 38 Bâlois. L’engagement dans les Brigades et les milices semble donc fonction de l’expérience locale du combat politique, et notamment (le cas du Tessin l’illustre) du combat antifasciste. Les « brigadistes » suisses sont jeunes (68 % de ceux recensés plus haut avaient entre 20 et 30 ans, 8,5 % avaient moins de 20 ans). Au sein du « contingent » tessinois, sept volontaires sur dix sont des ouvriers (surtout du bâtiment). Quant à leur affiliation politique, si 33 des 83 Tessinois se définissent comme communistes (les Brigades Internationales étant d’obédience et d’encadrement communiste, ce qui n’impliquait pas que tous les brigadistes fussent communistes), six se définissaient comme socialistes, deux comme anarchistes, et 28 « antifascistes » sans autre précision -l’antifascisme suffisant évidemment à motiver un engagement armé contre le franquisme et ses alliés italiens et allemands.
Ces hommes (mais aussi ces femmes) s’en vont combattre en Espagne un ennemi dont la classe dirigeante suisse semble fort apprécier le programme politique, et dont la Suisse officielle ne tardera pas à reconnaître la légitimité, avant même que les faits et les armes n’aient rendu cette reconnaissance logique, en termes de Realpolitik, sinon légitime en termes de principes démocratiques. Le 26 juillet 1936, l’éditorialiste du Journal de Genève salue un putsch dont les auteurs, s’ils l’emportent, « libéreront l’Espagne de tout lien avec Moscou et avec les fronts populaires », et rétabliront l’ordre en s’appuyant sur « tous les éléments sains de la nation », alors que la République, après avoir « armé les factieux d’extrême-gauche et ouvert les prisons » a demandé l’aide « de la Troisième et de la Première Internationales, communistes et anarchistes ne songeant qu’à renverser la République démocratique pour lui substituer une dictature, soviétique ou autre, en tous cas une dictature de classe ». Pour les militants de la gauche helvétique qui s’en iront combattre en Espagne, la guerre qui s’y déroule est, pour reprendre les termes employés par Le Travail du 28 juillet 1936, « une phase de la lutte implacable entre la Démocratie et le fascisme » -une lutte qui concerne aussi les démocrates suisses : « Sur la terre ensanglantée d’Espagne se jouent le sort de la République et le nôtre » (Le Travail 6 août 1936). Le choix du combat en Espagne est donc la poursuite logique du choix antifasciste fait en Suisse même -un choix que les autorités suisses pouvaient elles d’autant moins assumer qu’il était parfaitement contradictoire de leurs propres complaisances à l’égard du franquisme, du fascisme, voire, en certains cas, du nazisme. D’où les décisions prises par le Conseil fédéral et diverses autorités cantonales contre les partisans de la République e/o de la révolution espagnoles : le 13 août 1936, onze communistes zurichois en partance pour l’Espagne sont arrêtés à Bâle sur ordre du procureur de la Confédération ; le 23 octobre, deux ouvriers genevois sont arrêtés à leur domicile pour avoir manifesté l’intention de partir ; les tribunaux civils et militaires se mettent à sévir :
ü De nombreux dirigeants de gauche, coupables d’avoir pris parti pour l’Espagne républicaine et contre les arrêtés du Conseil fédéral, sont condamnés à de lourdes peines. Henri Trüb, communistes genevois, est condamné à dix mois d’emprisonnement, sans déduction de trois mois de préventive. Quant aux volontaires qui reviennent en Suisse, ils sont arrêtés et condamnés, pour « atteinte à la puissance défensive du pays », à des peines de prison allant de un à six mois. En outre, la plupart d’entre eux sont privés de leurs droits civiques pendant une ou plusieurs années. La campagne pour l’amnistie, appuyée par 80'000 personnes, n’aura aucun effet. En septembre 1939, quand la Suisse mobilise, les rares Suisses à avoir une expérience de la guerre croupissent dans les geôles militaires !
C. Philipona, Volontaires suisses dans la Guerre d’Espagne, in Bulletin des Droits de l’Homme, Ligue suisse des droits de l’Homme, Genève, septembre 1986
En 1982 encore, l’amnistie des anciens combattants suisses d’Espagne fut remise à l’ordre du jour : le Conseiller national Dario Robbiani (socialiste tessinois) proposa en effet leur réhabilitation -proposition refusée pour d’obscures raisons juridiques. Le Conseil fédéral frisera même l’indécence historique en proclamant que « la grande majorité des anciens combattants d’Espagne ont entre-temps rempli leur devoir de citoyens suisses et ont recouvré leur honneur », comme s’ils l’avaient perdu en combattant les franquistes espagnols, les fascistes italiens et les nazis allemands en Espagne -puis, pour certains, en France. Des initiatives locales suppléèrent cependant au refus des autorités fédérales d’assumer leur devoir de mémoire et de justice : ainsi, la Ville de Genève érigea-t-elle un monument en l’honneur des combattants suisses d’Espagne, non loin du monument à la mémoire des fusillés du 9 novembre 1932.
Ces combattants n’ont laissé que d’assez rares témoignages de leur expérience et de leurs motivations. Citons-en deux ici, celui du plus jeune d’entre eux, le Tessinois (de seize ans) Eolo Morenzoni, et le Bernois de Genève (de sept ans son aîné) Joseph Marbacher. Morenzoni, dans la lettre laissée à ses parents au moment de son départ :
ü Chers parents,
Je dois céder à l’élan de mon cœur, je ne puis faire autrement. Il me faut partir pour l’Espagne, y combattre, pour mettre au servir de la cause tout le courage et tout ce qu’avec tant de soins et d’amour vous avez fait naître dans mon cœur. (…) Vous ne devez pas penser que quelqu’un m’a bourré le crâne. Tout ce que je fais, je le fais de ma propre conviction, en suivant ma conscience. Je ressens le besoin d’échanger pour une fois la plume contre un fusil ou une mitrailleuse, de combattre les traîtres.
C. Philipona, Volontaires suisses dans la Guerre d’Espagne, in Bulletin des Droits de l’Homme, Ligue suisse des droits de l’Homme, Genève, septembre 1986
Quant à Marbacher, il indique que, pour lui, « ce qui était déterminant, c’était la haine du fascisme, la conscience qu’il fallait combattre un danger menaçant également toute l’Europe » (ibid.).
Sur le front de Cordoue, Otto Brunner commande la bataillon « Tchapaïev » ; sur le front de Guadalajara et dans la 11ème Brigade, à Madrid, combattent de nombreux Suisses ; Ernst Bickel est commissaire politique du 3ème bataillon de cette brigade ; les Tessinois sont nombreux, aux côtés des antifascistes italiens, dans la Brigade « Garibaldi » ; des Suisses, encore, sur le front d’Aragon, des Suissesses, enfin, nombreuses dans les lazarets et les hôpitaux de l’ « arrière » (tant qu’il eut un « arrière » dans cette première guerre européenne où furent testés les bombardements terroristes des populations civiles). Dans les Brigades internationales se cotoyèrent ainsi, outre les communistes qui avaient pris l’initiative de leur création et le contrôle de leur encadrement, démocrates de gauche, socialistes, progressistes de toutes tendances, et quelques anarchistes qui n’avaient pu rejoindre les milices de la CNT et de la FAI ; ceux des libertaires qui combattirent avec leurs camarades espagnols retirèrent d’ailleurs de leur expérience un solide anticommunisme, forgé dans les luttes provoquées par la volonté communiste (espagnole et soviétique) d’éliminer politiquement et militairement les forces révolutionnaires non staliniennes (le POUM, marxiste révolutionnaire, la CNT et la FAI, anarchistes).
Prêtant serment de donner « jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour sauver la liberté de l’Espagne, la liberté du monde entier » (cité par Arthur London, in Espagne, Editeurs français réunis, Paris, 1966), ces combattants manifestaient la conscience d’une lutte sans frontière contre le fascisme –une lutte qui obligeait certains d’entre eux, les Italiens et les Allemands, à combattre les corps expéditionnaires et les conseillers militaires de leurs propres pays. Mais ceux qui, militants de la Centrale Sanitaire Suisse, du Secours Rouge, de l’Entraide Ouvrière, des Amis de l’Espagne Républicaine ou du Comité de Puigcerda, collectaient en Suisse de l’argent, des vivres ou des médicaments, adoptaient et hébergeaient les enfants victimes de bombardements italiens et allemands, ceux-là manifestaient la même conscience : cette solidarité se partage, elle ne se divise pas.
Fin 1938, les Brigades Internationales sont retirées du front, sur pression du « Comité de non-intervention » franco-britannique, alors même que l’intervention germano-italienne aux côtés des franquistes est d’une criante évidence (Britanniques et Français croient pouvoir obtenir des nazis et des fascistes qu’ils renoncent à soutenir Franco, en échange du retrait des Brigades, et le gouvernement républicain s’était incliné , espérant –sans y croire réellement- que ce « geste de bonne volonté » pouvait inciter Mussolini à retirer ses troupes et Hitler ses bombardiers. Devant la Société des Nations, Juan Negrin, Chef du gouvernement espagnol, avait confirmé l’accord de Madrid au retrait des Brigades, mais avait conclu son intervention par un vibrant hommage de gratitude envers les volontaires étrangers :
ü L’Espagne n’oubliera pas ceux qui tombèrent sur ses champs de bataille ni ceux qui y luttent encore, mais je ne crois pas me tromper si je dis que leurs propres pays se sentiront fiers d’eux, et ce sera la plus haute récompense morale qu’ils peuvent recevoir.
Horngacher, Volontaires suisses de la liberté, in Voix Ouvrière (Genève) du 11 août 1983
Si la Suisse se sentit « fière » de « ses » volontaires, elle le cacha fort bien –en tout cas la Suisse officielle, en condamnant ceux qui revinrent à de lourdes peines (et ceux qui, survivants, ne revinrent pas tout de suite, à des peines plus lourdes encore, par contumace). Mais de quelle Suisse s’agissait-il alors ? Celle des volontaires d’Espagne n’était pas celle qui les condamnèrent, celle de Nicole ou de Bertoni n’était pas celle de Motta ou de Guisan. Dans l’armée suisse mobilisée en 1939 lors du déclenchement « officiel » d’une guerre mondiale qui avait en fait commencé des années auparavant, avec les entreprises italiennes, allemandes et japonaises, et avait réellement éclaté en Espagne en 1936), les « anciens d’Espagne » seront tenus en extrême suspicion par une hiérarchie militaire plus apeurée par leur étiquette de « rouges » qu’impressionnée par leur expérience de la guerre : les cadres de l’armée craignaient les premiers, et ne connaissait pas grand chose à la seconde. Après la dissolution des Brigades, et plus encore après la défaite de la République, le retour en Suisse est dur pour les combattants :
ü La police attendait les volontaires à la frontière (après qu’ils eurent été internés par les Français), les coffrait immédiatement, après quoi ils étaient traduits devant les tribunaux militaires et en général condamnés à de lourdes peines de prison, auxquelles s’ajoutait parfois la perte des droits civiques pour un à cinq ans. Seul motif de sursis, le jeune âge du volontaire au moment de son enrôlement dans les Brigades.
Horngacher,
art.cit.
Après la guerre, les combattants d’Espagne et leurs camarades constituèrent l’ « Amicale des anciens volontaires de l’Espagne républicaine » (qui à ce jour existe encore), laquelle apposa, lors de son quatrième congrès, en 1976, une plaque commémorative sur les murs du Volkshaus de Zurich, rappelant les noms des Suisses tombés en Espagne. En 1978, une plaque semblable fut posée sur le Monte Ceneri avec les noms des 15 volontaires tessinois morts au combat. Dans les années nonante, enfin, la Ville de Genève érigea un monument en hommage aux combattants suisses des Brigades internationales, à deux pas du monument commémorant le massacre du 9 novembre 1932, dans le quartier de Plainpalais. Quant aux innombrables militants du mouvement suisse de solidarité avec la République ou la révolution, la défaite de celle-ci et de celle-là ne les repoussera pas dans l’inactivité apolitique : la guerre mondiale leur offrira, bien malgré eux, d’autres occasions d’agir, auxquelles ils ne manquèrent pas (notamment en solidarité avec la résistance au nazisme et au fascisme). L’Espagne elle-même ne disparaîtra pas avant la mort de Franco de l’horizon politique de la gauche : André Oltramare, père fondateur des Amis de l’Espagne Républicaine, créera ainsi la « Cuisine des exilés »pour les victimes du nazisme et du fascisme réfugiées à Genève et, pendant toute la guerre, protégera et secourra quantité de réfugiés.
La chute de la République espagnole sonne le glas de l’Europe de l’entre-deux guerres, et annonce la grand embrasement de la Guerre Mondiale. Alors qu’en Espagne la solidarité antifasciste se payait de la vie et qu’au retour d’Espagne elle se paya de la prison, c’est à un « recentrage » politique généralisé que l’on assistera en Suisse –un « recentrage » dans l’héritage duquel vit toujours la Suisse d’aujourd’hui. La Suisse qui quittèrent les volontaires de 1936 mourait lorsqu’ils la retrouvèrent en 1939. Une autre Suisse naissait, celle du consensus et de l’unité nationale, de la Paix du Travail et de la Landi de Zürich, celle, bientôt, de la participation du Parti socialiste au gouvernement fédéral.