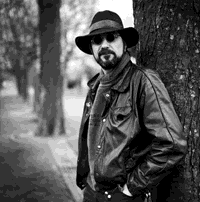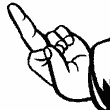

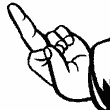

" Classe contre classe " ou Front populaire ?
L’arrière-plan politique du conflit entre le PSG et le PSS
Le " stalinisme acritique " de Léon Nicole
La rhétorique de gauche du programme de 1920 du PSS
Unité nationale ou unité ouvrière ?
L’URSS : caricature de socialisme ou bastion du socialisme ?
Le " nicolisme " : un réformisme verbalement révolutionnaire
La catastrophe allemande, effet de la désunion ouvrière
De la participation socialiste au Conseil fédéral
La municipalité socialiste, " îlot dans la mer capitaliste "
La divergence sur la défense nationale
L’armée, recours contre le fascisme étranger ?
La démocratie défendue par une armée de classe ?
La " défense nationale ", principe instrumental -non fondamental
Genève : un PS hégémonique calque son attitude sur celle d’un PC marginal
Un déchirement : l’évolution de la révolution soviétique
De l’intérêt (selon le PSS) pour la Suisse de reconnaître l’URSS
Les quotidiens socialistes romands, défenseurs acritiques du stalinisme
L’URSS, mythe mobilisateur
Le pèlerinage soviétique de Léon Nicole en 1939
Manouïlsky : les communistes soviétiques seront démocrates quand ils ne seront plus menacés
Une Internationale pour la révolution européenne
L’échec de la ligne " classe contre classe " sanctionné par la diplomatie soviétique
La ligne de front populaire : trop tard pour le PCS
Toutes les tactiques du PCS échouent
Le dernier choix du PCS : le retour au PS ou la disparition
La subordination incapacitante du PC au Comintern (et du Comintern au PCUS, et du PCUS à Staline)
Avril 1933 : le congrès du PSS refuse le Front Populaire
Le Front Populaire à Genève
Face au fascisme : l’unité ou la défaite
Zurich, 15 juin 1932 : la policed’une municipalité socialiste ouvre le feu sur une manifestation communiste
Août 1932 : Nicole au congrès d’Amsterdampour la paix
L’engagementd’allégeance du PSG du PSS (15 juin 1933)
L’exemple français pèse sur la gauche romande
La ligne de Front Populaire en Romandie
L’antifascisme unitaire se dissout dans l’affrontements des gauches en Espagne
La guerre civile dans la guerre civile
1937 : la fusion de fait entre le PC et le PS à Genève

Sans doute le poids des personnalités, et en particulier de celle de Léon Nicole, peut-il contribuer à expliquer la sourde mésentente, puis le conflit ouvert qui opposèrent le parti genevois et le parti suisse pendant toutes les années trente… mais ne cédant pas aux charmes de l’explication des conflits politiques par les seules rivalités personnelles, nous prendrons garde à ne pas omettre ce qui, dans ce conflit-là, renvoie à un arrière plan éthique, culturel et surtout politique, international (" surtout ", dans la mesure où ce travail est supposé traiter prioritairement de cet aspect là, mais non pas forcément parce que cet aspect-là fut prédominant). Le conflit PSG/PSS est moins affaire théorique qu’affaire stratégique, et la personnalité même de Nicole semble le confirmer, telle que la dessine, par exemple, Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission de 1939, Fonds national de la Recherche Scientifique, chez l’auteur, Lausanne, 1987, pp 48, 49
Au-delà des personnalités, c’est bien l’Union Soviétique qui divise en deux camps le mouvement socialiste : L’Union Soviétique, le communisme, son Internationale, sa section suisse et la question de l’unité. Le " stalinisme acritique " de Nicole, c’est sa certitude que l’Union Soviétique, " première société socialiste ", " première tentative réussie d’abattre le capitalisme ", " forteresse de l’antifascisme " (ce dont quoi Nicole ne démordra pas même après le Pacte germano-soviétique de 1939), l’Union Soviétique donc est à défendre envers et contre tout et tous. Tel est le choix " nicoliste ", telle sera la cause de la scission de 1939 (et, avant elle, des tensions récurrentes entre PSG et PSS). La montée des fascismes a rendu plus radical, plus brutal, et sans doute plus caricatural (en tous cas plus péremptoire) ce choix : face à l’adversaire, Nicole appelle à serrer les rangs. Son " arrière-plan " personnel n’est ni genevois, ni suisse, mais européen -c’est-à-dire mondial. Agissant à Genève et en Suisse, Nicole et les siens ont à l’esprit l’Union Soviétique, mais aussi l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Espagne, leurs crises et leurs exemples. L’appel à l’unité, la stratégie qui en découle, viennent de là : de l’analyse tirée, non sans perspicacité, de l’effondrement face au nazisme du mouvement ouvrier allemand miné par les divisions internes ; de la riposte du mouvement ouvrier français, surmontant ses contradictions face au front des droits anti-démocratiques. Unitaire, le " stalinien " Nicole le sera malgré les communistes, et le restera lors même que Staline imposera la rupture de l’unité là où elle semblait pouvoir se faire, et que les communistes suisses désigneront les socialistes de gauche, et Nicole lui-même, comme des ennemis plus dangereux encore que les " sociaux-fascistes ", c’est-à-dire l’aile droit et le centre du PSS, les Rosselet, Ilg ou Grimm.
Révolutionnaires genevois contre réformistes suisses ? Le résumé serait sans doute satisfaisant pour l’esprit de clocher socialiste local (voire l’amour-propre de l’auteur), mais dans le débat engagé entre le PSG et le PSS sur la ligne du parti, ses méthodes d’action, ses stratégies et ses alliances, Nicole n’est au fond pas moins réformiste et plus révolutionnaire que Grimm, s’il l’est différemment, dans une situation autre, avec une perception autre du contexte international et de ses enjeux. En 1932, le PSS a toujours pour programme celui, révolutionnaire (ou révolutionnariste) de 1920 -ce programme voté au moment même où le PSS refusait d’adhérer à la IIIème Internationale et devait se défendre sur sa gauche de la qualité de ses sentiments et de ses volontés socialistes. Ce programme de " lutte de classe ", Nicole le reconnaît pour rien alors que le PSS n’en tient plus compte (s’il le fit jamais). A Genève, le PS " rouge " inspire encore à la droite la même crainte qu’en Suisse le PSS de 1918, lors de la grève générale, alors qu’il était lié au Comité d’Olten ; à Genève, le PS tient par la bouche de Nicole et la plume de Dicker le langage même du programme du parti suisse… verbalisme, sans doute, mais sincère : ceux qui parlent croient à ce qu’ils disent : Nicole " n’avait rien d’un idéologue et la dialectique marxiste le rasait jusqu’à l’os. Il était personnellement révolté contre l’injustice sociale " (René Leyvraz, Le Courrier, 30 juin 1965). C’est cette révolte qui transparaît dans la rhétorique de la gauche socialiste nicoliste des années trente, comme la prescience du danger fasciste et de la nécessité de l’unité de la gauche pour y faire face transparaît dans les choix stratégiques et la véritable " obsession unitaire " dont le leader genevois ne se départira plus jusqu’à la fin de la Guerre Mondiale.
Dans les années vingt, le PSS et le PSG tentent, chacun à son échelle, de devenir des " partis de masse ", le pôle de vastes rassemblements populaires anticapitalistes (et anticapitalistes plus que socialistes). Dans les années trente, l’antifascisme s’ajoutera à l’anticapitalisme en modifiant quelque peu le projet ultime. Ce dont il s’agira désormais sera moins d’instaurer le socialisme que d’instaurer une véritable " communauté nationale " rassemblant autour de la classe ouvrière l’ensemble des classes populaires (paysans, artisans, petits commerçants, travailleurs intellectuels). En 1935, le PSS fera le pas auquel se refusera -symboliquement plus que réellement- le PSG : il reconnaîtra la légitimité du droit à la propriété privée transmissible, repoussant par là même la socialisation étatiste des moyens de production et des instruments de travail. Ce sera le temps de l’unité : le PSS inclinera vers l’unité nationale, le PSG vers l’unité ouvrière. Choix différents, mais cause identique : la lutte contre le fascisme et la guerre. Ce sera pour le parti suisse le temps des acquiescements : à propriété privée, à la défense nationale, à la paix du travail, à la participation au Conseil fédéral, alors que les Genevois dénoncent dans ces choix la matérialisation de l’intégration du mouvement socialiste au " modèle " bourgeois.
Les rapports avec le mouvement communiste (et en arrière-fond avec l’Union Soviétique stalinienne) se trouvent être le " nœud " du problème : les choix stratégiques du PSS, sa recherche du " rassemblement démocratique ", impliquent la plus grande distance possible d’avec le PC et le refus de toute entente politique (ne fut elle qu’électorale) avec lui. L’alliance ici privilégiée, c’est l’alliance à droite, avec les forces démocratiques bourgeoises. A ce choix, Nicole oppose celui du rassemblement de la gauche, de l’unité avec le PC et les organisation qu’il contrôle : unité d’action d’abord, de stratégie si possible, d’organisation comme but ultime. Le choix de Nicole, en clair, c’est le Front Populaire. Or pour le PSS l’Union Soviétique n’est plus qu’une sombre caricature du socialisme, répugnante et répulsive, et d’autant plus condamnable qu’elle se prétend socialiste ; pour le PSG de Nicole, elle est le bastion du socialisme et de l’antifascisme, quoi qu’il en soit de la réalité de " son " socialisme. Pendant toutes les années trente, le conflit entre ces deux visions de l’URSS, et les deux lignes qui en découlent, ira s’aggravant, Nicole dénonçant l’évolution " droitière " du PSS et le PSS l’ " alignement stalinien " de Nicole. Les mots, ici, cachent parfois la réalité des reproches : le PSG dénonce le " réformisme " du PSS alors que lui-même est réformiste, et que son " révolutionnarisme " est essentiellement rhétorique. C’est bien d’un attachement symbolique dont il s’agit, plus que d’un choix stratégique et Nicole est un réformiste qui parle de révolution :
Droit du Peuple (organe du PS vaudois) du 19 avril 1932
Comme le relève Pierre Jeanneret, " le concept (de) révolution reste cependant flou chez Nicole et tient plutôt de l’incantation verbale " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 64). On en verra la preuve dans l’accession même des socialistes genevois à la majorité gouvernementale cantonale :
Pierre Jeanneret, op.cit. p. 64
Pour prouver quoi ? Le caractère fondamentalement réformiste du " nicolisme ", malgré son verbalisme révolutionnaire. A la dénonciation du " réformiste " (des autres…) s’ajoute, de la part de l’autocrate socialiste genevois, celle de la " bureaucratisation " du mouvement ouvrier suisse -d’un mouvement désormais en mains de " bonzes " syndicaux et de " carriéristes " auxquels Nicole oppose un spontanéisme révolutionnaire qu’on se serait plutôt attendu à voir invoquer par Lucien Tronchet ou Luigi Bertoni. Mais, autocratique dans ses pratiques politiques au sein d’un PSG qu’il dirige (au plein sens du terme), Léon Nicole a, dans ses attentes politiques, quelque chose du romantisme révolutionnaire des anarchistes et de leur optimisme : " trahies " par les " bureaucrates ", les " masses " restent néanmoins, fondamentalement, révolutionnaires. Il y a donc quelque trace d’anarcho-syndicalisme dans l’attitude du " stalinien " Nicole, s’adressant en ces termes aux militants ouvriers : " Veillez à ce que (vos) organisations ne deviennent point la chose des scribes ou la proie des bureaucrates. Demeurez-en toujours les maîtres. Vous avez des comptes à demander. Vous n’en avez pas à rendre " (Droit du Peuple, 1er mai 1932).
Profondément ancré dans le terrain genevois, agissant depuis ce bastion sur le terrain suisse, Nicole porte son regard au-delà, sur une Europe convulsive, livrée aux entreprises autoritaires (de droite), et sur un mouvement ouvrier international divisé, affaibli, impuissant. " Léon " s’était opposé à l’adhésion du PSS à la Troisième Internationale au nom de la nécessaire unité du mouvement ; pour autant, la IIème Internationale ne trouve pas grâce à ses yeux :
Droit du Peuple du 19 avril 1932

… et les socialistes genevois de demander, sans succès, au PSS de convoquer un congrès extraordinaire consacré à la politique de l’Internationale Ouvrière Socialiste… La gauche " nicoliste " prendra acte, sans surprise, de la victoire du nazisme et de l’effondrement du mouvement ouvrier allemand. Le Travail et Le Droit du Peuple avaient sans mollir dénoncé la politique de compromis -de compromission- et l’embourgeoisement du plus puissant parti socialiste d’Europe (l’allemand), mais n’avaient eu de cesse de regretter, aussi, la division du mouvement ouvrier allemand. Or cette division était pour beaucoup, et sans doute pour l’essentiel, due aux choix stratégiques du Comintern et à l’incessante dénonciation par les communistes des sociaux-démocrates comme adversaires principaux du mouvement révolutionnaire… Tirer les leçons de la " catastrophe allemande ", ce sera contempler les ravages de la désunion. L’obsession unitaire de Nicole et des siens s’en trouvera confortée, au moment même où le PSS et l’USS font définitivement un choix inverse.
Autres choix faits par le PSG et le PSS, en sens inverse l’un de l’autre, du moins apparemment : celui de la participation minoritaire au gouvernement central (" minoritaire " : la précision est importante, d’autant que s’y ajoute celle de l’élection du gouvernement fédéral par le parlement, et non par le peuple). " Nous ne voulons pas d’une entrée à plat ventre au Conseil fédéral " tonne Nicole (cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 66) au congrès de Lausanne du PSS en 1939, quelques mois avant son exclusion du parti suisse. Depuis vingt ans, la gauche socialiste se bat contre l’idée d’une telle participation, contre la tentation de participer minoritairement à un gouvernement fédéral composé majoritairement de représentants de la droite bourgeoise, alors que le principe de la participation (même minoritaire) aux gouvernements cantonaux et aux exécutifs municipaux avait été accepté sans grand drame. La participation au Conseil fédéral apparaît à juste titre à la gauche socialiste comme le point d’orgue de l’intégration du mouvement ouvrier à la Suisse officielle ; mais ce point d’orgue conclut une mélodie que la gauche socialiste elle-même a entonnée : celle de la présence de socialistes dans les exécutifs municipaux et cantonaux, moins douloureusement acceptée mais non moins significative de cette intégration. Au contraire, même : c’est par cette insertion progressive dans le " tissu " politique du pays, par cette participation à la gestion des affaires les plus concrètes, que le mouvement socialiste s’intègre à la Suisse officielle (avec l’appui de l’électorat, qui l’y mandate par son vote), bien plus que par une participation gouvernementale au plan fédéral qui apparaît à la fois comme un symbole (refusé en tant que tel) et une conséquence. Dès 1897, un socialiste genevois avait participé au gouvernement de la République ; ils y seront quatre -dont Léon Nicole- en 1933, sans majorité parlementaire. En 1921 à Bienne, en 1928 à Zurich, en 1934 à Lausanne des majorités socialistes municipales tentent d’impulser des " expériences modèles " ; la Municipalité comme laboratoire, comme " îlot socialiste dans la mer capitaliste " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 67)…
Cette participation-là, pourtant plus significative de l’intégration sociale et politique du mouvement que la participation au Conseil fédéral, la gauche socialiste ne la réprouve guère, et parfois y concourt (il est vrai qu’elle est sanctionnée et obtenue par l’élection populaire, alors que le Conseil fédéral est désigné par le parlement). L’objectif ultime, proclamé, n’est rien moins que la gestion socialiste de la Suisse entière, par une sorte de " métastase politique " qui verrait ces " îlots socialistes " croître et multiplier jusqu’à former des " archipels " dont on fera ensuite des continents… La logique même d’une telle stratégie est aux antipodes de celle de la gauche socialiste : en 1920, devant le congrès du PS tessinois, son secrétaire, Gasparini, explique ce dont il s’agit :
cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 68
Au Congrès de Bâle du PSS, en 1929, les divergences éclatent. E.-P. Graber et Léon Nicole, chacun exprimant en français les thèses respectives des partisans et des adversaires de la participation au Conseil fédéral, s’affrontent. Pour le premier, cette participation est la conséquence logique de la reconnaissance de " la valeur de la démocratie pour la défense des intérêts de la classe ouvrière " (cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 68) ; pour le second, la participation minoritaire au gouvernement central ferait du (ou des) socialiste(s) concerné(s) l’otage ou les otages de ceux qui l’auront élu(s) et lui (ou leur) feront endosser " une partie de la responsabilité de la politique radicale " (op. cit. p. 69). Au terme du débat, le principe de la participation au Conseil fédéral est accepté par 324 voix contre 147 et le Maire de Zurich, Emil Klöti, est désigné comme candidat -sans aucune chance, encore, d’être élu. La question reviendra à maintes reprises sur le tapis, avec de part et d’autre une argumentation (" pour " ou " contre ") dont les arguments essentiels ne différeront guère, sur le fond, de ceux échangés en 1929. Les 11 et 12 février 1984, ce sera encore par les mots et les raisonnements de Graber ou de Nicole que s’affronteront partisans et adversaires de la participation minoritaire au Conseil fédéral.
Unité de la gauche ou unité nationale, participation minoritaire au gouvernement ou non… A ces divergences s’ajoutent, entre PSS et PSG, celle, non moins fondamentale, portant sur la défense nationale. Conséquence, sans doute, des choix précédents : le PSS adhérant aux grands principes de la démocratie suisse ne peut faire l’économie d’une révision déchirante de ses traditions antimilitaristes, révision que refuse le PSG au nom de la lutte contre la capitalisme -et donc contre son instrument armé. Divergence puisant au vieux fonds historique de l’antimilitarisme et du pacifisme socialistes, voire aux racines libertaires du socialisme " utopique ". Le congrès de Bâle de 1912 n’est pas si vieux que le cri de " Guerre à la guerre ! " se soit estompé dans les mémoires, ni le " grand fossé " de 1914-1918. La gauche socialiste se retrouve sur ce thème l’alliée " objective " du pacifisme chrétien, celui des Ragaz et des Ceresole, et de la vieille tradition antimilitariste romande, celle des Graber et des Golay -par ailleurs adversaires farouches du stalinisme et de tout ce qui peut ressembler à une entente, à plus forte raison, avec lui. " Guerre à l’armée ! " est un slogan qui convient autant à Léon Nicole et à Jules Humbert-Droz qu’à Leonhard Ragaz et Paul Golay. Là encore, l’histoire pèse dans les choix politiques : depuis 1869, l’armée a déjà été employée une cinquantaine de fois en Suisse contre les travailleurs et leur mouvement quand la fusillade du 9 novembre 1932 remet à l’ordre du jour sa contestation la plus virulente. Le leader du PS lausannois, Maurice Jeanneret-Minkine, ne prendra pas de gants :
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 71
Il y a de la tradition dans l’antimilitarisme socialiste, notamment en Romandie, et de la tradition libertaire. Il y a aussi de la mémoire et du ressentiment. Mémoire du grand massacre de 1914-1918, même si la Suisse n’y prit pas part, ressentiment à l’égard de l’armée, pour son rôle lors de la Grève Générale de 1918. Le PSS avait quant à lui toujours accepté le principe, sinon les modalités, d’une défense nationale (on se souvient de Greulich défendant face au mouvement socialiste international le droit de la Suisse à défendre son indépendance par les armes). La période ouverte par la révolution russe va rompre avec cet " acquis patriotique ". Le congrès du PSS de 1917 avait, par 222 voix contre 77, fait le choix de l’antimilitarisme -un choix entériné par le programme " gauchiste " de 1920, le groupe parlementaire socialiste au Conseil national se distinguant à cette époque par son refus systématique des crédits militaires. Cela étant, cet antimilitarisme ne fait pas, ne fit jamais, consensus il y a loin du pacifisme chrétien d’un Ragaz à l’antimilitarisme politique d’un Nicole : le premier récuse la violence, le second l’armée.
La montée, puis la victoire, du nazisme (après celle du fascisme) et l’effondrement de la social-démocratie allemande, la remise en cause des droits démocratiques, l’offensive générale de l’autoritarisme de droite dans toute l’Europe (des Ligues françaises au nazisme allemand) : ce contexte est bien de nature à provoquer une révision de l’attitude du Parti socialiste à l’égard de l’armée, instrument de répression, certes, mais aussi instrument proclamé de la défense de l’indépendance nationale. Le " clash " du 9 novembre 1932 retardera le moment de cette révision, mais de cinq ans seulement. Dès la fin des années vingt, et plus précisément dès le début des années trente, le PSS pose les jalons d’une révision de sa position de 1917 et d’une " réadmission " de la défense nationale dans son programme, au motif que la menace fasciste rendrait désormais nécessaire une préparation à l’emploi de tous les moyens possibles pour la défense des droits démocratiques (" Tous les moyens, même légaux ", pour paraphraser Léon Blum). Non moins antifasciste que ses camarades suisses (quoi qu’il en soit de ses errements rhétoriques), Léon Nicole n’admet pas que la menace fasciste pût être prétexte au reniement des options antimilitaristes des années vingt. Son fils Pierre tonne pour lui :
Le Droit du Peuple, 17 janvier 1934
Le 9 novembre 1932 est alors trop proche encore pour que les socialistes genevois puissent accepter de voir l’armée être traitée autrement qu’en ennemie du mouvement ouvrier, d’autant que nombre des cadres de cette armée affichent, et afficheront jusqu’en 1944, plus ou moins ouvertement, des sympathies fascistes ou nazies, et que l’armée n’a jamais été investie à Genève du prestige dont elle se targuait de bénéficier auprès du peuple suisse. Les conceptions, souvent contradictoires, défendues par le mouvement socialiste suisse à propos de la " question militaire " mériteraient d’être présentées et analysées en une étude spécifique ; ici, elles nous intéressent en ce qu’elles sont au cœur des débats sur la résistance au fascisme, au cœur de la divergence entre ceux qui veulent fonder cette résistance sur l’unité nationale (avec la droite démocratique) et ceux qui la veulent fonder sur l’unité de la gauche (avec les communistes).
En octobre 1934, la prolongation des écoles de recrue suscite une opposition résolue de la gauche socialiste romande, sans que le PSS ne s’engage réellement à ses côtés (le Comité central avait d’ailleurs renoncé à lancer ou à soutenir un référendum populaire, qui sera lancé, mais sans le soutien du PSS). Le 24 février 1935, en vote populaire, la prolongation des écoles de recrues est acceptée par 54,2 % des votants. Nicole accuse l’aile " modérée " du parti suisse d’avoir permis cette courte victoire des " militaristes ". Le 24 octobre 1934, l’Assemblée des délégués du PSG avait donné mandat à ses représentants au prochain congrès du PSS de s’opposer à toute révision du programme socialiste sur les thèmes de la défense nationale. Ce qui est en jeu, c’est la " réadhésion " du socialisme suisse au principe même de la défense nationale armée et à son instrument militaire, réadhésion à laquelle s’oppose la gauche socialiste au nom des traditions pacifistes et internationalistes du socialisme suisse (traditions quelque peu surévaluées pour l’occasion…). Les 26 et 27 janvier 1935, le PSS tient congrès à Lucerne. Nicole et Dicker sont absents, l’un et l’autre retenus à Genève par un débat parlementaire (depuis 1922, les socialistes détiennent la majorité des sièges au gouvernement cantonal, mais ils sont restée minoritaire au parlement, et chaque débat parlementaire est l’occasion pour la droite de prendre sa revanche sur ses vainqueurs de 1933). Les débats du congrès de Lucerne mettent clairement en lumière l’inconciliabilité des choix faits par les deux ailes du socialisme suisse à propos de la nécessaire unité antifasciste.

Pour Ernst Nobs et Robert Bratschi, l’antimilitarisme est désormais un facteur d’affaiblissement face à le menace fasciste : " La démocratie vaut la peine d’être détendue par les armes ! " , proclamera Ernst Reinhard. Par les armes, et donc, pour le " centre " et la droite du parti, par l’armée.
Pour Fritz Schneider et pour la gauche socialiste, par contre, l’armée suisse reste une armée de classe (une armée certes populaire au niveau des conscrits, mais bourgeoise dans son encadrement, et totalement bourgeoise dans son commandement), une armée dominée par une caste tentée par l’alliance avec le fascisme contre la classe ouvrière. Cet instrument n’est pas un instrument de la démocratie, mais un instrument de guerre civile contre les ouvriers, et au besoin contre la démocratie. Nulle confiance ne doit donc lui être accordée. E.-Paul Graber, par ailleurs aussi anticommuniste qu’il est pacifiste, défend la position antimilitariste traditionnelle du socialisme romand, où l’héritage chrétien se mêle aux désastreuses expériences faites en Romandie de l’usage intérieur de l’armée.
Si le congrès de Lucerne, par 382 voix contre 294, inscrivit au programme du parti le principe de la défense nationale, le " score " du vote indique assez clairement l’existence d’une très forte minorité d’opposants à ce ralliement. Une minorité fort peu monolithique, puisqu’à l’opposition " politique " de la gauche socialiste s’ajoute celle " morale " des pacifistes " intégraux ", mais une opposition qui, dans les grandes villes et en Romandie, pourra se trouver majoritaire. Le clivage se fait certes selon la " ligne de démarcation " gauche droite (ou plutôt gauche contre centre et droite), mais aussi selon la " frontière " culturelle (linguistique : En Romandie, les pacifistes à la Graber appartiennent à la fois à l’aile droite du parti et à son aile antimilitariste. Sur le thème de la défense nationale, ou face à l’armée, E.-Paul Graber et Léon Nicole sont côte à côte… Il n’en restera cependant guère de traces lorsque le temps des scissions et des exclusions sera venu -et il viendra tôt.
L’acceptation du principe de la défense nationale par le PSS ne signifiait pas, pour la direction du parti, adhésion à ce qui en tenait lieu, ni aux propositions présentées par le Conseil fédéral au nom de sa propre conception (celle de la droite bourgeoise) de cette " défense nationale ". Le parti se réservait donc la possibilité de refuser tel ou tel projet ne correspondant pas à sa propre définition du principe auquel il venait d’adhérer. Il y avait là, en même temps que la possibilité donnée à la gauche socialiste et aux pacifistes de prendre quelques revanches ponctuelles sur le vote de Lucerne, le germe de nouvelles divisions. On le vit bien en 1936, lorsque le Comité central décida le 16 mai d’accepter de soutenir un crédit militaire de 235 millions, et que le congrès du parti, deux semaines plus tard, désavoua sa propre direction en acceptant (par 263 voix contre 255) une motion " Schneider-Nicole-Nägeli-Graber " manifestant l’unité (sur ce point) de la gauche socialiste, des pacifistes chrétiens et des antimilitaristes romands. La décision du congrès fit elle-même long feu : 21 députés sur 50 votèrent le crédit auquel le parti avait finalement décidé de s’opposer. Le congrès avait désavoué la direction du parti ? La droite du groupe parlementaire désavoua le congrès… La crise provoquée par ce double désaveu (le premier infligé en parfait respect des statuts, le second en parfait irrespect) amena le Comité directeur à démissionner et le parti à transférer son siège à Zurich, ville où la gauche socialiste était particulièrement bien implantée. Hans Oprecht succéda à Ernst Reinhard à la présidence du parti, Emil Klöti, Maire de Zurich, accéda à la vice-présidence, mais le PSS ne modifia rien de ses choix réformistes ; mieux : à la faveur de l’aggravation de la menace fasciste, la gauche socialiste elle-même, très progressivement, se mit à considérer la défense nationale comme un principe " utilisable " dans la lutte contre l’adversaire principal, et en l’armée un instrument de ce principe. La Guerre d’Espagne ne sera pas pour rien dans ce revirement.
Mais revirement n’est pas reniement : acceptant finalement la " défense national ", la gauche socialiste n’y verra pas un principe fondamental, mais un principe instrumental. La lutte contre le fascisme reste l’impératif. Au sein du PS vaudois, c’est bien parce que le fascisme devient de plus en plus menaçant " que Maurice Jeanneret-Minkine prône la " collaboration du PSS pour la défense nationale ", le vote des crédits militaires et l’avancement en grade des ouvriers dans l’armée. Les pacifistes, eux, se divisent : Paul Golay s’effraie des " inconséquences ", des " faiblesses " et des " reniements " socialistes… Pacifistes chrétiens et socialistes de gauche, unis à Lucerne contre la défense nationale, se séparent lorsque les seconds finissent par l’accepter au nom de l’antifascisme. Ethique de la vérité (chrétienne et non-violente) contre éthique de la responsabilité (antifasciste et acceptant l’usage de la violence défensive) ? En janvier 1937, le PS vaudois adopte une résolution qui sanctionne son changement d’attitude :
Cité par Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission de 1939, op.cit. p. 77
Pour la gauche socialiste, désormais, la démocratie bourgeoise, si limitée soit-elle, vaut la peine d’être défendue face au fascisme, comme -pour le moins- un moindre mal un mouvement socialiste entravé par le droit bourgeois, cela veut mieux qu’un mouvement socialiste exterminé dans les camps nazis ou massacré par les bandes fascistes…
Quant aux socialistes genevois, plus opposés encore que leurs camarades vaudois à tout compromis avec le " militarisme ", ils y viendront pourtant eux aussi, et aboutiront malgré le traumatisme du 9 novembre aux mêmes conclusions que les Vaudois, malgré un chemin différent. La stratégie, encore une fois, divise : les uns adhèrent à celle de l’unité nationale (avec la droite démocratique, contre le fascisme) quand les autres privilégient l’unité de la gauche, le front populaire (avec les communistes, contre la droite), réalisé dans une certaine mesure à Genève dès le 9 novembre 1932 malgré la persistance de violentes attaques (rhétoriques) communistes contre Léon Nicole et le PSG. Le front populaire s’impose aux socialistes comme le recours face au fascisme, et ce choix va conduire Nicole et le PSG à identifier progressivement leur ligne politique à celle du mouvement communiste local, c’est-à-dire à celle du mouvement communiste international, c’est-à-dire à celle de l’Union Soviétique, du moins dès lors que les communistes occidentaux, et notamment les Français, reçoivent l’ " autorisation " du " centre " de pactiser avec les socialistes. Lorsque le PCS, se conformant aux choix staliniens, adhérera à son tour au principe de la défense nationale armée, Nicole et le PSG en feront autant. Hégémonique au sein de la gauche genevoise, le PSG calque donc son attitude sur celle du marginal PC… et l’apparente absorption du PC (lorsque celui-ci sera interdit à Genève) par le PS ressemblera furieusement à une officialisation de la " stalinisation " du PSG, à son adoption des choix stratégiques et donc des analyses d’où ces choix découlent : les choix et les analyses du Comintern, c’est-à-dire de la direction soviétique. L’exemple français a d’ailleurs un puissant écho à Genève, même si la stratégie de " Front Populaire " y fut concrétisée avant que de l’être en France. Le 2 mai 1935, un pacte franco-soviétique sembla faire de la France et de l’URSS deux alliées : le PCF se muera aussitôt en un " partisan ardent de la défense nationale patriotique " (Pierre Jeanneret, op.cit., p. 77). Il sera tout aussi prompt à embrasser un pacifisme absolu, jusqu’à friser le défaitisme, lorsque 4 ans plus tard, c’est avec l’Allemagne que l’URSS pactisera… et le PCF en reviendra au patriotisme révolutionnaire jacobin après l’invasion allemande de l’URSS en 1941.
A vrai dire, l’Union Soviétique n’aura cessé durant les vingt années de l’Entre-deux-guerres de poser problème au socialisme démocratique -un problème qui, en Suisse comme ailleurs, se traduisit tôt en dissensions et finit par se résoudre en une scission, de jure en 1939, mais de facto dès le début des années trente, entre la gauche " nicoliste " et la direction " centriste " du PSS (et, en Romandie, entre les majorités des PS genevois et vaudois, " nicolistes ", et leurs minorités). Depuis 1917, la Russie soviétique joue dans le débat politique helvétique le rôle du " méchant ", et dans la mythologie politique, celui de l’ogre cannibale. Le procès Conradi avait permis de mesurer le formidable capital d’antipathie dont les " bolcheviks " jouissaient en Suisse. La réaction soviétique au verdict d’acquittement de l’assassin de Vorovski n’avait en somme que consacré une absolue incompatibilité politique : l’URSS avait décidé de boycotter économiquement et diplomatiquement le " nain des Alpes ", jusqu’à refuser de participer à toute conférence internationale se déroulant sur territoire helvétique. Ce boycott eut finalement pour effet de convaincre d’influents milieux économiques, dont le Conseiller fédéral Schulthess se faisait le représentant, de la nécessité de reprendre avec l’URSS les relations à peu près normales auxquelles se refusait Giuseppe Motta. Le 14 avril 1927, l’accord de Berlin mit fin au boycott soviétique de la Suisse ; restait à rétablir les relations diplomatiques : il faudra attendre 1943, la capitulation allemande à Stalingrad, le changement du rapport des forces dans la guerre et la fin des espérances d’une chute du régime soviétique, pour que la Suisse tentât réellement un rapprochement -que l’URSS repoussera, la Suisse restant encore trop liée à l’Axe.
Pour la gauche, la " question soviétique " est un déchirement. La révolution de 1917 avait suscité un espoir immense, que la prise du pouvoir par les bolcheviks n’avait -du moins dans un premier temps- pas atteint. La dérive stalinienne de l’URSS, alors que la naissance de l’Etat soviétique avait été saluée par la plupart de ceux qui, à gauche, se feront les inlassables contempteurs de toute alliance avec les communistes, mais aussi, auparavant, la fondation de l’Internationale communiste et la valse-hésitation du PSS face à l’adhésion à cette IIIème Internationale, la répression brutale de toute opposition, même (ou surtout) socialiste et révolutionnaire, au nouveau régime, l’écrasement des mouvements nationaux en Géorgie et en Arménie (mouvement conduits par des forces socialistes), la substitution de la dictature du parti à la dictature du prolétariat, puis de la dictature de la direction du parti à celle du parti, puis de la dictature de Staline à celle de la direction -tout cela conduisit le PSS à prendre avec l’ " exemple " soviétique et ses partisans la plus large distance possible. Pierre Jeanneret discerne au sein du PSS des années trente trois tendances à propos de l’Union Soviétique :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission de 1939, op.cit. p. 86
Si la gauche " nicoliste " domine les partis genevois et vaudois, et la droite social-démocrate l’USS, c’est un " centre " qui donne le ton au PSS ; un " centre " dont Robert Grimm reste le représentant exemplaire. Le PSS va condamner la scission communiste du mouvement international, dénoncer les stratégies du Comintern, condamner les pratiques du pouvoir soviétique, la dictature, la terreur, les purges, les procès truqués… mais en même temps, le PSS reconnaît à la fois la valeur historique de l’expérience soviétique, qu’il ne renoncera à qualifier de " socialiste " qu’à la fin des années trente, et le rôle joué par l’URSS dans la lutte contre le fascisme ; il plaidera constamment pour l’établissement avec l’URSS de relations normales, considérant que son isolement contribue au durcissement de ses politiques. Robert Grimm ira plus loin encore, proclamant la solidarité de la classe ouvrière suisse avec une Union Soviétique dont, par ailleurs, il dénonce la politique :
in Droit du Peuple du 7 juin 1932
Depuis des années, le PSS se fait l’avocat d’une reprise de relations diplomatiques normales -sinon plus- avec l’Union Soviétique. Le 31 mai 1924 déjà, Johannes Huber avait déposé au Conseil national une interpellation qui faisait " le tour " de l’argumentation de la gauche " modérée " -une argumentation dont la visée tactique était de convaincre les milieux les moins conservateurs (et/ou les plus intéressés) de la droite : des rapports diplomatiques normaux favoriseraient l’établissement de relations économiques profitables à l’économie suisse ; d’autre part, le maintien de la paix en Europe suppose l’intégration de l’Union Soviétique dans le " concert des Nations " ; enfin, la Suisse ne peut rester isolée dans un splendide refus de l’évidence soviétique, alors que l’Italie fasciste, la France et la Grande-Bretagne ont reconnu le gouvernement " bolchevik " et que la neutralité de la Suisse suppose l’universalité de ses relations diplomatiques. Une telle argumentation implique une claire et nette distinction entre l’Etat soviétique (héritier de l’empire russe) et le Comintern. C’est au nom de la " raison d’Etat " qu’il faut reconnaître la Russie soviétique, et c’est un Etat qu’il s’agit de reconnaître, non la légitimité de ses fondements idéologiques. Quant aux communistes suisses, qu’il considère comme de simples " marionnettes de l’Etat soviétique ", le PSS ne manifeste à leur égard nulle propension à l’unité. Si le réalisme commande la reconnaissance du plus vaste Etat du monde, comme la reconnaissance d’une évidence, le même réalisme renvoie à la marge le très minoritaire mouvement communiste suisse. En juin 1931, le Comité central du PSS ne verra aucune contradiction à interdire aux membres du parti d’appartenir aux associations d’ " amitié avec l’URSS " tout en prônant la reconnaissance effective de l’URSS par la Suisse. Les grands procès staliniens eux-mêmes ne feront pas revenir le PSS sur ce point : lors même que sa condamnation du régime soviétique se durcit, sa conception des relations d’Etat à Etat ne change pas. Il faudra le pacte germano-soviétique de 1939, l’invasion de la Pologne, puis celle de la Finlande, par l’URSS pour que cette conception soit (mais pour deux ans seulement) révisée : l’URSS s’est alors " rangée du côté du fascisme ".
En Romandie, les deux quotidiens socialistes, Le Travail et le Droit du Peuple, contrôlés par Léon Nicole dès que la mort de Charles Naine, survenue le 26 décembre 1926, lui eût laissé place libre, se font les défenseurs de moins en moins critiques des thèses staliniennes. Là encore, il s’agit moins de fidéisme que d’un choix stratégique : l’Union Soviétique, " premier Etat socialiste ", est restée seule de son espèce (ce qui suppose évidemment que la qualité de " socialiste " lui soit toujours accordée) ; " bastion du socialisme ", elle est toujours en butte à diverses tentatives de déstabilisation (même si elle ne se prive pas elle-même d’alterner diplomatie traditionnelle et " agitation révolutionnaire ", le Commissariat du Peuple puis le ministère des Affaires étrangères se partageant la tâche internationale avec le Comintern) ; " camp de la paix ", enfin, et " forteresse " de l’antifascisme, elle est " incontournable " pour tous ceux qui considèrent le fascisme comme l’ennemi principal. Tel est précisément le choix de Nicole et des siens, jusqu’en 1939, malgré quelques " hoquets " leur faisant considérer par moment le fascisme et le nazisme comme des formes " primitives ", ou " viriles ", de socialisme. Le Travail et Le Droit du Peuple deviennent de véritables " éditions régionales romandes de L’Humanité : " le débat interne est en voie de disparition, les voix critiques n’ont plus aucun moyen de se faire entendre " constate Pierre Jeanneret, qui cite cette apologie du " réalisme socialiste " :
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. pp 89, 90
Faisant fond de la sympathie de la classe ouvrière romande à l’égard de l’Union Soviétique, la gauche " nicoliste " n’aura de cesse de transformer les campagnes antisoviétiques de la droite en autant d’arguments de la légitimité socialiste du stalinisme. Ces campagnes, il est vrai, se prêtaient assez idéalement à ce retournement, tant elles étaient empreintes de haine revancharde, ne le cédant guère en mensonge et en désinformation aux campagnes staliniennes. Le syllogisme s’imposait facilement : puisque la droite s’en prend aussi violemment à l’Union Soviétique, c’est bien que l’Union soviétique est socialiste…
En novembre 1927, une délégation de la gauche romande se rend en visite en Union Soviétique : 16 personnes (5 " sans parti ", 5 communistes, 6 socialistes) font le " pèlerinage en Terre Sainte " que représente le voyage vers la " Terre rouge du Premier Etat socialistes des paysans et des ouvriers ". De ce voyage d’un peu plus d’un mois (du 6 octobre au 18 novembre 1927), la délégation ramène un véritable panégyrique stalinien, émaillé d’attaques contre la social-démocratie. En février et mars 1939, faisant ce même voyage, Léon Nicole en tirera les mêmes conclusions à la veille du pacte germano-soviétique, et de sa propre exclusion du PSS.
Une telle absence de distance critique à l’égard de l’expérience stalinienne, un aussi franc abandon de toute autonomie idéologique à l’égard des analyses communistes, ne pouvaient qu’attiser la polémique interne au parti socialiste. En 1929, Léon Nicole et Paul Graber vont s’affronter par quotidiens socialistes interposés (Le Travail contre La Sentinelle). S’appuyant sur le Bulletin hebdomadaire d’information soviétique, Nicole accuse les sociaux-démocrates géorgiens de " trahison ", de " collusion avec la bourgeoisie capitaliste ", de connivence avec le fascisme. Le Bureau de presse géorgien de Genève, dirigé par le socialiste Khariton Chavichvily, porte plainte. Le débat entre socialistes va ainsi aboutir au Tribunal, où Nicole est condamné. Le PSS se distance du leader genevois, tout en dénonçant le recours du socialiste géorgien é la justice et à la presse " bourgeoise ". Au surplus, Paul Graber utilisera cette affaire pour attaquer Nicole dans La Sentinelle à la veille des élections genevoises, pratique dénoncée par les Genevois comme un " coup de Jarnac ".
De telles divergences, pour user d’un euphémisme, sont si fréquentes qu’à l’été et à l’automne 1932, la scission est à l’ordre du jour. Les procès " géorgiens " terminée, la droite socialiste romande exprime sa solidarité avec ceux qui ont traîné devant les tribunaux le leader de la gauche. Le PSG avait entre-temps refusé de soutenir une manifestation de protestation contre la terreur " fasciste " en Pologne et " stalinienne " en URSS ; Nicole avait de surcroît participé malgré l’interdiction du PSS au " Congrès de la Paix " d’Amsterdam -un congrès dominé par les communistes et leurs compagnons de route. Au sein du PSS, certains prêchent la rupture avec le PSG ; Grimm cependant n’est pas (encore) de cet avis : il rappelle que la presse du parti est aux mains des " nicolistes ", que ceux-ci sont majoritaires au sein du PSG et du PSV, et que leur exclusion pourrait bien à la fois affaiblir le PS en Romandie et renforcer le mouvement communiste local, et suisse (Pierre Jeanneret cite toutefois une lettre de Jenny Humbert-Droz à son époux, alors à Moscou, et qui fait de la situation genevoise une analyse différente : si Nicole est exclu du PSS, il ne rejoindra pas le PC mais fondera son propre parti socialiste, " et si tu n’es pas ici pour lui tenir tête, il aura beau jeu pour nous enlever tous nos éléments sur place " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 95).
Favorable à l’exclusion des " nicolistes ", le Président du PSS, Ernst Reinhard, trouve lui aussi le moment mal choisi. Des Romands le moins suspect de sympathie à l’égard de Nicole et de sa tendance, E.-P. Graber est lui aussi opposé à l’exclusion, craignant (à juste titre) l’éclatement du PS en Romandie : Nicole " tient " le PS genevois, la moitié du PS vaudois et jouit d’une influence certaine à Fribourg et en Valais (où Karl Dellberg pourrait se solidariser avec lui). L’exclusion attendra donc. Elle attendra sept ans, durant lesquels la gauche nicoliste ne cessera de parfaire son " alignement ", au moins apparent, sur les thèses soviétiques (ce qui ne le préservera d’ailleurs pas des invectives communistes). En 1936, la proclamation de la nouvelle constitution soviétique est présentée comme le terme et la perfection du processus révolutionnaire -d’un processus engagé en France en 1789- en même temps que le signe du passage de l’URSS elle-même du stade transitoire de la dictature du prolétariat à celui de la démocratie socialiste. Cette constitution est en effet un document remarquable par son souci (rhétorique, faut-il le préciser ?) des libertés, des droits démocratiques, des droits de l’Homme et, à la prendre à la lettre, elle décrit parfaitement le fonctionnement de la plus parfaite des démocraties. La gauche nicoliste et le PC chantent (à deux voix, mais sans retenue) les louanges de ce texte. Commentaire judicieux de Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission de 1939, op.cit. p. 95
Il est vrai que Nicole n’est guère plus marxiste qu’il convient à un socialiste de gauche de mimer l’être, et que son rapport à l’URSS tient plutôt d’un besoin de fidélité et d’une nécessité d’admirer que d’une " analyse concrète de la réalité concrète ". Nicole a un irrépressible besoin de voir (de croire) en l’URSS comme en un modèle de société, parce que l’URSS est la " forteresse du socialisme " et de l’antifascisme. La menace fasciste rassemble : simplifiant à l’extrême les choix et les comportements, elle pousse la gauche socialiste romande vers le communisme, " ennemi principal de l’ennemi principal " (le fascisme), puisque proclamé comme tel par ce dernier. Les fascistes et les nazis font profession d’anticommunisme `C’est donc que l’ " Etat des communistes " (et que ce concept soit totalement contradictoire importe peu) est l’Adversaire majuscule du fascisme. C’est pourtant en 1936 qu’André Gide, ancien " compagnon de route ", publie un Retour de l’URSS qui lui vaut d’être traîné dans la boue par la presse et les organisations communistes. La voix du témoin " décadent " et " cosmopolite " (d’autant plus perspicace, peut-être, qu’il est " décadent " et " cosmopolite ", ou du moins perçu comme tel par ceux qui l’insupportent) ne pèsera pas lourd quand, dans l’autre plateau de la balance, le poids est celui de la foi en un Etat (l’URSS), un parti (le PCbUS) et un homme (Staline).
La réalité soviétique importe moins que sa symbolique, et c’est moins l’URSS elle-même que le mythe mobilisateur en quoi elle est transformée qui est déterminant. Les grands procès staliniens suscitent certes quelques interrogations, mais elles sont vite balayées : si les " coupables " " avouent " leur " trahison ", c’est évidemment que " trahison " il y eut ; si Trotsky est dénoncé comme un " fasciste enragé ", un " traître abject des ouvriers et paysans ", c’est qu’en vérité fasciste et traître il est. Il l’est, car il doit l’être, puisque le pouvoir " soviétique " dit qu’il l’est, comme Toukhatchevski doit être le " bonapartiste " ambitieux et liquidateur du léninisme que l’on dénonce, comme l’opposition de gauche doit être ce " centre trotskiste " voué au " sabotage dans les mines et les usines ", l’assassinat et la trahison, et ayant pour projet la restauration du capitalisme, l’alliance avec le fascisme et la bourgeoisie. De tout cela, il ne peut être question de douter (sinon in petto, et encore) : douter des accusations portées par la direction soviétique, c’est douter de l’Union Soviétique ; douter de l’Union Soviétique, c’est douter du socialisme ; douter du socialisme, c’est accepter le fascisme. Sophisme pour une certitude : seule l’Union Soviétique peut fonder la résistance au fascisme. La Guerre d’Espagne confortera encore cette certitude.
Face au pronunciamiento espagnol, l’Union Soviétique semble en effet être le seul allié sûr de la République : la Société des Nations abdique devant l’Allemagne et l’Italie, la France devant la Grande-Bretagne, en cédant aux pressions pour une " non-intervention " qui " déchire " Léon Blum et que ne compense pas son contournement par des livraisons discrètes de matériel, le soutien humanitaire, la tolérance à l’égard du recrutement et du transit par la France des volontaires pour les milices anarchistes et républicaines, puis pour les Brigades Internationales ; le Mexique est trop lointain pour que sa réelle (et totalement désintéressée, elle…) solidarité avec l’Espagne républicaine soit d’un grands poids : ne reste à l’Espagne que le soutien soviétique -les révolutionnaires espagnols le paieront très cher.
Du 14 février au 14 mars 1939, Léon Nicole se rend en Union Soviétique en compagnie du communiste Karl Hofmaier. Ce voyage est un pèlerinage. Nicole en rend compte dans un ouvrage (Mon voyage en URSS, Editions du Faubourg, Genève, 1939) qui lui permettra non seulement de chanter les louanges de l’URSS (et de Staline) mais aussi de régler quelques comptes helvétiques, et de réaffirmer ses certitudes stratégiques -à commencer par l’unité d’action. Mon voyage en URSS est ainsi quelque chose comme un bréviaire du socialisme nicoléen : soutien acritique à l’Union Soviétique, appel à l’unité entre socialistes et communistes, primat de la lutte contre le fascisme (et la guerre) sur tout autres objectif… C’est la ligne du PSG que Nicole exprime dans le compte-rendu de son voyage soviétique -une ligne minoritaire au sein du PSS, mais hégémonique au sein du parti genevois, où elle est cependant combattue par une minorité cantonale faisant partie de la majorité nationale. L’un de ses ténors, l’ancien Conseiller d’Etat André Oltramare, considère que, s’agissant de l’Union Soviétique,
Cité par Pierre Jeanneret, in Léon Nicole et la scission…op.cit. p. 98
C’est ici le vieux débat entre jacobins et girondins, " enragés " et " indulgents "… Le récit par Nicole de son pèlerinage soviétique en rend pleinement compte, à sa manière. Il vaut la peine de faire un voyage dans ce voyage-là…
Il y a deux textes dans ce texte : le récit du voyage lui-même, et les apartés politiques, nombreux, dans lesquels Nicole exprime ses choix politiques, règle ses comptes, propose une stratégie au mouvement socialiste suisse. Le premier texte parle de la Russie soviétique ; le second, de la Suisse, de son mouvement socialiste, des menaces fascistes ; le mythe mobilisateur règne sur le premier, le principe de réalité sur le second. Il y a bien deux Léon Nicole : un " croyant " et un " militant ", et chacun a besoin de l’autre. Voyons donc le premier texte, celui du " croyant " sur le " mythe mobilisateur " soviétique. Dans l’URSS que voit, que veut voir Nicole, règle l’ordre et le calme :
Léon Nicole, Mon voyage en URSS, op.cit. pp 5-6 et 19
Un ordre paisible et un calme fraternel règnent donc à Moscou et Leningrad ; et même quelque chose comme de l’abondance :
Ibid. pp 27, 28
Un tel portrait de l’Union Soviétique, tracé en 1939, en pleine période de terreur stalinienne, peut avoir quelque chose d’accablant pour son auteur ; mais Nicole ne ment pas, c’est-à-dire ne trompe pas : il se trompe. Il n’est pas de mauvaise foi, mais de foi, tout simplement, avec tout ce que cela suppose de cécité . En Union Soviétique, " Léon " ne voit qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté, parce qu’il ne veut y voir que cela ; il y verra aussi le souci de la solidarité (" le racisme est inconnu en URSS "), celui de la vérité (" celui qui lit ou se fait traduire impartialement les articles politiques des journaux soviétiques, tels que la Pravda ou les Isvestia, est toujours frappé par le grand souci d’exactitude et la sûreté de l’information des journalistes ") et du respect des droits des composantes nationales de l’URSS, et notamment des juifs :
Léon Nicole, Mon voyage en URSS, op.cit. p. 67
Le gigantesque effort économique entrepris par l’URSS stalinienne fascisme Nicole, qui n’en voit -ou n’en veut voir- ni les soubassements policiers, ni les gaspillages. La Russie Soviétique est la terre du travail, quelque sens (Troud ou Rabot, prolétariat ou labeur) que l’on donne au mot :
op.cit. p. 6
Nicole ne se rend pas en URSS sans penser à la Suisse, à " son " mouvement socialiste, aux choix stratégiques unitaires qu’il défend, avec en arrière-fond constant la situation internationale. C’est, dans le récit du pèlerinage, le second texte, le plus intéressant -le plus politique aussi, car le moins (volontairement ?) naïf :
op.cit. p. 7
Le chef du PSG constate sans déplaisir que ses " amis russes " sont au courant " de la façon la plus exacte " de ce qui se passe et se trame en Europe occidentale, qu’ils connaissent les dirigeants politiques du monde capitaliste, " leurs tendances politiques et idéologiques ainsi que les mobiles qui les font agir ". Ils connaissent même, du moins certains d’entre eux, et non des moindres, ce qui se passe et se trame en Suisse et à Genève. Nicole rend ainsi compte d’un long entretien avec Dmitri Manouilski, représentant du PC soviétique à la direction du Comintern.
Manouïlski s’informe des raisons que peuvent avoir certains socialistes occidentaux de marquer comme ils le font leur opposition à la Russie soviétique. Je réponds que les socialistes occidentaux, politiquement orientés de cette façon, reprochent aux dirigeants soviétiques leur manque de libéralisme démocratique. Manouïlski réplique : " vous pouvez dire à vos amis socialistes que quand le capitalisme aura désarmé contre la Russie soviétique et quand la classe ouvrière n’aura plus à redouter le mortel ennemi qu’est le fascisme, les communistes russes seront alors les démocrates les plus convaincus qu’il soit possible. Mais pour le moment, ils n’oublient pas quelles sont leurs responsabilités écrasantes en face d’un capitalisme toujours prêt à l’agression et ne reculant pas devant l’emploi d’instruments tels que ceux que lui offrent les régimes courbant sous leur joug les travailleurs allemands et italiens ". J’ajoute que la tactique des travailleurs soviétiques, en face du fascisme et de ses tentatives de désagrégation intérieure, est parfaitement comprise par un nombre toujours plus grand de socialistes occidentaux. Ces derniers savent à quoi s’en tenir sur les campagnes de dénigrement et de calomnies déchaînées contre la Russie soviétique, campagnes dont on a malheureusement trouvé des échos, sous maints prétextes, jusque dans la presse socialiste (…).
Manouïlski m’indique qu’il suit avec un grand intérêt l’effort de la classe ouvrière de Genève et qu’on lui attache, à Moscou, une très grande importance. Il n’est pas indifférent qu’il se trouve, au siège de la Société des Nations, dans une ville d’un caractère très international, un mouvement politique qui demeure fidèle au socialiste révolutionnaire.
op.cit. pp 23, 25
L’auteur ne nous dit pas si " Manou " fut dupe de la version résolument optimiste qui lui fut donnée par " Léon " de la situation genevoise (et suisse). Cela est peu probable, encore qu’il ne faille pas surestimer la place prise par Genève et la Suisse dans les préoccupations d’un responsable du Comintern en février 1939… Une autre entrevue permit à Nicole d’exposer à des interlocuteurs soviétique, en l’occurrence Kolarov, directeur de l’Institut Agraire International de Moscou (et ancien étudiant en droit de l’Université de Genève), et un " camarade F. spécialiste de l’agriculture suisse ", sa vision de la situation helvétique -et de la résumer dans la relation de son propre voyage soviétique ; il s’agit ici de l’ " alliance ouvriers-paysans " et des rapports de classe en Suisse, ainsi que d’un portrait de la situation politique du pays :
Kolarov s’inquiète des perspectives politiques en Suisse et du rapport des classes entre elles. J’explique que, politiquement et économiquement, le pays est fortement organisé. Chaque groupement a ses chefs, sa bureaucratie, ses journaux, qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et de la finance, qu’il s’agisse aussi des patrons ou des salariés. Mais les dirigeants et la bureaucratie de ces organisations diverses ont tendance à se rapprocher les uns des autres et à former une classe à part. Ils s’éloignent de la masse des organisés et tendent à s’assurer une situation privilégiée dans l’économie du pays. Ces chefs et dirigeants ainsi que la bureaucratie qui les entourent ont parfaitement réussi à se mettre au bénéfice de longues vacances payées, de retraites vieillesse et invalidité fort confortables, alors que la masse des travailleurs suisses aussi bien à la campagne qu’en ville est à la merci des crises économiques, du chômage, de la mévente des produits agricoles et des misères de la vieillesse et de l’invalidité avec, comme unique ressource, la charité publique ou privée. Ainsi se creuse un fossé entre les administrateurs et les administrés des divers groupements économiques aussi bien à la campagne que dans les villes, ce qui explique les mécontentements séparant les dirigeants des dirigés.
op.cit. pp 136-138
Nicole étend donc à l’ensemble de la société helvétique l’analyse qu’il fait depuis des années du mouvement ouvrier : séparation entre " base " et " sommet ", bureaucratisation, naissance d’une classe dirigeante formée des dirigeants des grandes organisations sociales, économiques et politiques ; l’irone de l’Histoire (avec un grand H) veut que cette description de la naissance d’une Nomenklatura helvétique soit faite à des membres de la Nomenklatura stalinienne. Mais Nicole ne tient pas à Moscou un autre discours qu’à Genève, et n’y exprime pas une autre analyse des rapports de force internationaux et de leur jeu sur la Suisse : menace fasciste, nécessité de l’unité de toutes les forces socialistes, divergences au sein du PSS entre partisans de l’unité " à gauche " (front populaire) et partisans de l’unité " à droite " (unité nationale). Sur ces points, la convergence entre Nicole et ses interlocuteurs soviétiques est naturelle, pour ne pas écrire " automatique " (en ce sens, unique, que Nicole se cale sur la ligne soviétique) :
Le camarade F. (…) me montre toute l’inconséquence du rapprochement que l’on peut observer à Berne entre les paysans de l’ancienne tendance (donc paysans riches) et le Parti socialiste qui, par contre, paraît se détourner du Parti jeune paysan. Il ne peut s’expliquer que par le jeu d’ambitions personnelles mises au-dessus de la logique et du souci de la défense efficace des intérêts du monde du travail. Le simple bon sens, et l’honnêteté politique également, déclare F., veulent que les travailleurs suisses, membres des organisations à tendance socialiste, se rapprochent des Jeunes paysans (paysans pauvres) et luttent avec eux pour une politique nouvelle, qui doit nécessairement amener le renversement de ceux qui gouvernent le pays en ce moment. Je souscris, cela va sans dire, à cette manière de voir de F., et j’explique que l’effort des travailleurs suisses appartenant à la gauche socialiste, tend à un regroupement de toutes les forces productives du pays, aussi bien campagnardes que citadines, qui doivent être organisées dans un véritable mouvement populaire devant échapper aux influences de la ploutocratie financière, maîtresse en ce moment du gouvernement fédéral.
(…) Kolarov me demande quelles sont les principales préoccupations politiques du moment en Suisse. J’explique qu’elles sont de deux ordres, militaire et financier. La Suisse, qui se sait menacée par le Troisième Reich, complète hâtivement (fébrilement, peut-on dire) ses fortifications le long de la frontière et son outillage militaire. Des sommes énormes, si l’on tient compte de la puissance économique du pays, sont ainsi englouties au moment précis où il faut faire face à des difficultés financières considérables. La classe bourgeoise, qui a toujours poussé aux dépenses militaires aussi longtemps qu’elle crut pouvoir en rejeter le fardeau sur le peuple, s’inquiète aujourd’hui des conséquences de ces énormes dépenses. Elle sait qu’elle finira, bon gré mal gré, à en faire les frais sous une forme ou sous une autre. Mais, en attendant, la bourgeoisie suisse essaie de freiner la politique protectionniste indispensable au maintien de la production agricole sous sa forme actuelle. Ces économies que les partis du pouvoir voudraient voir réaliser sur la part du budget allant à l’agriculture, ont pour conséquence une désaffection des agriculteurs à l’égard des dits partis. On assiste de la sorte à un ébranlement interne du régime politique qui régit la Suisse depuis bientôt un siècle. La meilleure gardienne de ce régime, l’agriculture, est mécontente et s’en détourne. (…) la tâche de la bourgeoisie dirigeante suisse devient de plus en plus difficile. Il n’est pas aisé de faire face à des dépenses militaires doublées, triplées et quintuplées, sans toucher au capital ; et il est encore moins aisé de pressurer davantage le peuple travailleur dont les conditions d’existence tendent à s’aggraver d’années en années sous les effets de la crise. Enfin, comment faut-il assurer, au milieu de telles difficultés, l’existence normale de l’agriculture suisse qui dépend essentiellement de subventionnement de l’Etat sous des formes diverses ?
Il est difficile de contester dans ces conditions, que la Suisse ne soit à la veille de modifications profondes de sa structure politique. Les événements qui se précipitent en Europe peuvent hâter les choses, mais il faut malheureusement craindre que le regroupement populaire en formation ne soit pas achevé au moment où une autre équipe que celle au pouvoir serait indispensable pour sauver le pays.
Léon Nicole, Mon voyage en URSS op.cit. pp 138-141
Le Nicole qui s’exprime ainsi n’est encore, il s’en faut de deux ans, partisans de la défense nationale (antifasciste), mais il n’est pas encore non plus, et il ne s’en faut que de quelques mois, l’adversaire intransigeant de toute forme d’acquiescement à la défense armée de la Suisse, et le défenseur aveugle (puisque fidéiste) du pacte germano-soviétique ; or c’est précisément ce pacte qui conduira Nicole à repousser toute défense armée de la Suisse, et c’est précisément la rupture de ce pacte, c’est-à-dire l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, qui le conduira deux ans plus tard à rallier le camp " national " en opérant un virage à 180 °. Optimiste quand aux progrès de l’unité socialiste, Nicole est, logiquement, pessimiste (mais c’est encore, de son point de vue, être optimiste) quant aux chances de la classe dirigeante helvétique de résoudre la crise en laquelle le pays est plongé. Mais cet optimiste ne se fait guère d’illusion sur l’avenir immédiat : le " regroupement populaire en formation " ne sera probablement pas achevé à temps ; en d’autres termes : la menace est réelle d’une évolution de la Suisse vers le fascisme. Ses interlocuteurs soviétiques ne sont guère plus optimistes, et semblent avoir en piètre estime la classe dirigeante suisse. Ainsi, Kolarov :
Op.cit. pp 150, 151
Débattant avec Manouïlski et Kolarov de la situation helvétique et des tâches qui attendent le mouvement socialiste suisse, Nicole ne s’en tient pas là -nous avons déjà relevé que son horizon politique était, même voilé par son fidéisme stalinien, plus large que celui de la plupart de ses contemporains et compatriotes ; agissant en Suisse, Nicole " pense en Européen " -en Européen sectaire, certes, mais en Européen. Avec Georges Dimitrov, secrétaire général du Comintern, héros du procès de Leipzig et héraut de l’antifascisme communiste, la discussion se hausse à la stratégie internationale :
Dimitroff me dit qu’en effet il faut veiller à ce que rien dans les attitudes réciproques ne vienne augmenter les chances de friction entre les partis socialistes et communistes. Nous avons appris, ajoute-t-il, que les masses socialistes, en dépit de certaines erreurs commises par ceux qui les dirigent, demeurent attachées à leur parti. Ce que l’on sait aussi, c’est que dans leur immense majorité, les ouvriers se réclamant du socialisme le veulent vraiment.
Op.cit. p. 181
L’obsession unitaire de Nicole rencontre ici la compréhension du chef (nominal) de la IIIème Internationale -dont on peut douter qu’il pût exprimer une position divergente de celle de Staline. C’est dire le changement intervenu dans la ligne du Comintern depuis le temps des invectives contre les " sociaux-fascistes " : à Moscou, l’urgence est antifasciste (ou plutôt antinazie) ; elle ne le restera que jusqu’au Pacte, et le redeviendra (avec une inflexion " patriotique ") en 1941.
Répétons-le : pour Nicole et pour la gauche socialiste romande, l'Union Soviétique est le bastion de l'antifascisme. Sa défense est donc une condition de la victoire sur le fascisme et le nazisme (victoire impossible, en effet, sans l'apport de l'URSS, et qui n'interviendra qu'une fois l'URSS conduite, par l'Allemagne elle-même, à la guerre contre l'Allemagne). Cette vision " utilitaire " de l'Union Soviétique s'exprime aussi par l'éloge de sa force (y compris de sa force militaire) et par l'expression d'une solidarité indéfectible de la classe ouvrière avec " son " Etat. A moult reprises, Nicole va insister sur cette solidarité, tout en parsemant la relation de son voyage de notes édifiantes sur la solidité et la combativité soviétiques. C’est l’occasion d’un rappel des combats qui opposèrent, en août et septembre 1938, Soviétiques et Japonais en Extrême-Orient (notamment sur le lac Khassan), et qui tournèrent en faveur des Soviétiques, incitant les Japonais à s’abstenir désormais de se frotter à cet adversaire, ce qu’ils se gardèrent de faire jusqu’en 1945, lors même que leurs alliés nazis les prièrent d’ouvrir un " front asiatique " contre l’Union Soviétique. Mais pour Nicole, c’est aussi l’occasion d’une profession de foi :
Léon Nicole, op.cit. p. 78
Forte, l’Union Soviétique l’est pour Nicole en raison de la " fraternité des peuples " qu’elle réalise, comme un " commencement de la constitution des Etats-Unis du Monde " :
Op.cit. p. 64
À ses interlocuteurs soviétiques, Nicole assure que, rentré chez lui, il défendre l’URSS :
Op.cit. pp 96, 97
Promesse tenue : Nicole n’aura de cesse de défendre, comme d’ailleurs il le faisait déjà, en toute occurrence, l’Union Soviétique -jusqu’à se brouiller, au début des années cinquante, pour rompre ensuite, avec les communistes " officiels " suisses, maîtres de la direction du Parti du Travail et plus soucieux que lui de lui donner toutes les apparences, pour le moins, de la respectabilité démocratique -à quoi Nicole, par sa personnalité, ses conceptions, ses discours et son histoire personnelle, ne correspondait guère.
Dans la relation de son pèlerinage soviétique, Nicole n’omet pas de régler quelques comptes avec ses adversaires au sein du mouvement socialiste suisse, revenant par exemple sur la polémique " géorgienne " qui l’opposa si malencontreusement à la social-démocratie romande. Il le fait, symptomatiquement, au nom de la solidarité avec l’URSS, renvoyant ses adversaires (y compris les sociaux-démocrates géorgiens réfugiés à Genève) dans les ténèbres de l’alliance avec l’impérialisme désireux de " reconquérir les puits de pétrole de Bakou " :
Op.cit. p. 54
Et le droit des peuples à l’autodétermination, dira-t-on, ce droit dont on peut convenir qu’il ne fut guère respecté dans une Géorgie " bolchévisée " de force par Staline, son gouvernement menchevik (démocratiquement élu) renversé par l’Armée Rouge et la Tcheka, comme en Arménie le pouvoir établi par le Dashnaksoutioun ? Le droit des peuples à l’autodétermination, répond Nicole, n’est nulle part plus complètement respecté et appliqué qu’en Union Soviétique (et ceux qui affirment le contraire sont des ennemis de l’Union Soviétique, et donc du droit des peuples à l’autodétermination, puisque seule l’Union Soviétique le réalise réellement) :
Op.cit. p. 210
Ainsi le leader de la gauche socialiste romande, à la veille du pacte germano-soviétique -et de sa propre exclusion du Parti socialiste suisse- pose-t-il sur l’URSS stalinienne le regard du fidèle sur la Ville Sainte. Et c’est, quelques mois plus tard, ce rapport totalement acritique à l’URSS qui fournira au PSS l’occasion de se débarrasser du gêneur. Mais, au moins égale à la cécité volontaire de Nicole, il y a sa sincérité (la seconde n’excuse pas la première, mais peut-être l’explique-t-elle en partie), et son obsession de l’unité, face au capitalisme, et face au fascisme. Cette obsession le pousse à tout accepter de l’Union Soviétique, à suivre plus fidèlement que nombre de communistes les méandres de la ligne politique et de la stratégie du Comintern (Nicole " purgera " d’ailleurs le Parti socialiste des trotskistes…). On ne trouve guère de trace chez Nicole des doutes qu’exprime (certes a posteriori) un Jules Humbert-Droz, successivement militant socialiste, puis communiste, cadre du Comintern et enfin dirigeant du Parti socialiste suisse. Il faudra tout de même à Nicole et aux siens une dose assez considérable d’abnégation, et d’aveuglement, pour être fidèles à la fois à la ligne internationale du Comintern et à la volonté d’unité de la gauche, quand cette ligne excluait cette unité. Le PSG et la gauche socialiste romande resteront ainsi fidèles à la référence soviétique dans les pires moments du stalinisme, et fidèles à la ligne unitaire au plus fort des invectives et des injures communistes contre la social démocratie " traîtresse à la classe ouvrière " et " alliée objective du fascisme et de la réaction " -une social-démocratie que les communistes dénonçaient avec d’autant plus de virulence qu’elle était, en tel ou tel lieu (Genève, par exemple) dominée par son aile gauche et personnifiée par un Léon Nicole, spécificités qui la rendaient sur le terrain et dans les têtes maîtresse de l’ " espace politique " de l’anticapitalisme socialiste.
" La politique de l’Internationale (communiste) est faite de revirements et de contradictions ", constate Pierre Jeanneret (op.cit. p. 99). C’est en effet le moins que l’on puisse en dire : scandée par les différents congrès de l’IC, eux-mêmes préparés (et en fait, dès 1924, décidés) par les congrès du PCUS (et donc, progressivement, par la direction du parti soviétique), la ligne politique du Comintern alterne sectarisme et " unitarisme ", optimisme révolutionnaire et repli sur le " pré carré " de l’Etat soviétique, européocentrisme et " tiers-mondisme " de substitution.
La fondation de la IIIème Internationale et ses deux premiers congrès, en 1919 et en 1920, " s’inscrivent dans une perspective euphorique de révolutionnaire prolétarienne mondiale à court terme " (op.cit. ). Révolution mondiale ? Révolution européenne, plutôt. Mais c’est tout de même la rupture avec le " réformisme " de la IIème Internationale et ce sont les " 21 Conditions ". ‘échec des tentatives révolutionnaires européennes pousse à une première révision : les troisième et quatrième congrès (1921 et 1922) sanctionnent cette révision et proclament la stratégie du " front uni prolétarien ". Un front uni dont les frontières sont assez floues pour le Comintern y accepte, par exemple, le Kuomintang de Sun Yatsen, puis de Chang Kaïchek. La mort de Lénine, les luttes de faction à l’intérieur du parti soviétique, la (résistible ?) ascension de Staline, amènent lors du 5ème Congrès de 1924 la politique de " bolchévisation " de l’Internationale et des partis affiliés. Selon une tactique qui lui est chère, Staline élimine l’opposition de gauche pour reprendre, à contretemps, ses thèses stratégiques en les simplifiant à l’extrême. Le 6ème Congrès (1928) proclame la stratégie " classe contre classe ", dénonce la trahison de la social-démocratie et revient sur les tentatives unitaires précédentes. Le mouvement communiste s’auto-proclame unique représentant politique de la classe ouvrière et unique rempart contre le fascisme sous toutes ses formes (dont celle du " social-fascisme "). Cette ligne politique ne cassera pas seulement les fragiles tentatives unitaires des années précédentes : elle provoquera de graves conflits au sein des partis membres, à qui sont imposés des choix politiques en rupture complète d’avec les nécessités du moment (l’unité contre le fascisme) et les contexte socio-politiques. Le 5ème Congrès du PC suisse entérine ainsi une ligne politique qui le condamne définitivement à la marginalité. L’Opposition Communiste dirigée par le Maire de Schaffhouse, et Conseiller national, Walter Bringolf, quitte le PCS.
L’échec de la ligne " classe contre classe " est patent dès le début des années trente, éclatant dès 1934. Il est d’ailleurs sanctionné par un revirement politique et diplomatique de l’URSS elle-même, en tant qu’Etat, bien avant que la direction stalinienne de l’Internationale ne saigne faire avaliser par celle-ci le tournant déjà pris. En 1934, l’URSS entre (à la grande fureur du Giuseppe Motta) dans la Société des Nations, ce " cartel impérialiste " ; en 1935, elle conclut un pacte d’assistance mutuelle avec la France (à la grande fureur de l’Allemagne nazie, qui voit se reconstituer l’alliance franco-russe) ; le 12 février 1934, six jours après la sédition réactionnaire du 6 février, une immense manifestation " républicaine " rassemble à Paris, sur les valeurs de la démocratie " bourgeoise ", des centaines de milliers de personnes, radicaux, socialistes et communistes ensemble. Bref, lorsque le septième congrès (1935) de l’Internationale Communiste décide un nouveau changement de stratégie, ce changement est déjà à l’œuvre, et cette décision n’est en fait qu’une ratification. C’est une porte largement ouverte qu’enfonce en 1935 un mouvement " international " dont l’ " internationalisme " n’est déjà plus qu’un alibi de la raison d’Etat soviétique. Le VIème congrès du PCS suit le mouvement une année après l’IC : pour le mouvement communiste suisse, il est déjà trop tard. Dès 1937 commencent à pleuvoir les interdictions cantonales, préludes à l’interdiction nationale de 1940. La reconnaissance de la démocratie représentative, la défense de politiques économiques " rooseveltiennes " face à la crise, la dissolution de l’Opposition Syndicale Révolutionnaire et l’adhésion à la défense nationale n’y changeront rien : le PCS, sorti déjà minoritaire de la scission qui présida à sa création, se retrouvera totalement marginalisé -et en grande partie par sa propre faute- après une quinzaine d’années d’existence égrotante. A la seule exception genevoise (et dans des conditions très particulières), aucune politique d’unité ne pourra réellement se concrétiser entre communistes et socialistes, même de gauche.
C’est l’ensemble du mouvement ouvrier suisse qui s’est trouvé divisé par la scission communiste ; ce qui sépare les deux partis, la ligne de fracture entre social-démocratie et communisme, va provoquer dans toutes les organisations ouvrières des tensions aboutissant parfois à la scission, souvent à l’exclusion de la minorité communiste, mais toujours à une lutte interne pour le moins préjudiciable au mouvement socialiste -et cela sans que le mouvement communiste n’en tire le profit qu’il attendait. Les organisations culturelles et de formation, le mouvement sportif, les associations de loisirs, les syndicats, les organisations politiques, enfin, vont être le lieu de véritables combats politiques où l’invective et la condamnation sectaire (y compris de la part des sociaux-démocrates) tiennent lieu d’arguments. Minoritaires partout, défaits sur tous les terrains, les communistes vont constamment, par leur attitude, justifier les mesures d’expulsions individuelles ou collectives dont ils feront l’objet du début des années vingt à la fin des années trente.
Ni la tactique du noyautage, ni celle du " fractionnisme " à l’intérieur des organisations constituées, ni celle de la scission et de la création d’organisations nouvelles, ne seront couronnées de succès (sauf peut-être en ce qui concerne les organisations de jeunesse, ou dans les régions où le PC n’est pas réduit à l’insignifiance -mais ce sont des régions où le PCS est représenté par de futurs dissidents, comme à Schaffhouse). Après l’adhésion du mouvement syndical au mouvement des Lignes Directrices (qui refusera l’adhésion du PC, l’ostracisme dont les communistes sont à la fois les victimes et les auteurs sera tel que c’est la survie du mouvement communiste qui sera désormais en jeu. Les interdictions ne feront que précipiter les choses : les communistes n’avaient plus, dès le début des années trente, d’autre choix que le retour dans le giron socialiste -là où les socialistes voulaient bien d’eux- ou la disparition pure et simple. L’Union Syndicale aura pendant toute cette période pesé lourdement pour bloquer tout rapprochement entre les " frères ennemis " de la gauche helvétique, réussissant à convaincre le " centre " socialiste encore hésitant que " tout accord (avec les communistes) reste impossible tant que l’IC ne changera pas ses méthodes " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 104).
A vrai dire, " le problème des rapports avec les communistes se pose (aux socialistes) dès la scission et la constitution du PCS " (ibid.). En 1920 déjà, le congrès du PSS recommande l’exclusion des communistes qui " saperaient " le parti de l’intérieur, et la rupture des relations avec ceux qui auraient déjà quitté la " vieille maison " social-démocrate. En 1921 une première fois, en 1923 une seconde fois, le PSS refuse le " Front commun " proposé par le PC et y oppose une politique d’unité au sein du PS -ce qui suppose le retour des enfants prodigues communistes au sein du parti hégémonique du mouvement ouvrier suisse. Le 11 mars 1933, enfin, le Comité central du PSS (l’instance la plus " à gauche " du parti) tire un trait définitif sur les espoirs communistes de parvenir à une reconnaissance -une légitimation- du PC par le PS :
Cité par Pierre Jeanneret, in Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 104
La présence active du PC dans quelques centres urbains (essentiellement alémaniques : Zurich, Bâle, Schaffhouse), le choix de la stratégie de " Front populaire " par la gauche nicoliste, explique certes que le PSS fermera les yeux sur des accords conclu entre PS et PC, mais ces accords n’auront jamais de prolongement nationaux (jusqu’à la création de la Fédération Socialiste Suisse), quelque valeur d’exemple que les communistes voulurent leur donner, même si les deux organisations se retrouveront " objectivement " alliées face à la droite lors de débats politiques nationaux (les Lex Häberlin, la protection des locataires, la lutte contre les initiatives " frontistes "…).
Le PSS refuse donc toute alliance avec le PC, pour deux sortes de raisons ; d’abord, des raisons idéologiques et " éthiques ", qui renvoient aux conceptions contradictoires du socialisme que défendent les uns et les autres. Mais cette divergence, devenant progressivement un véritable fossé culturel entre le socialisme démocratique et le socialisme autoritaire, n’aurait sans doute pas empêché qu’une alliance se fasse, au nom du principe de réalité, si le mouvement communiste avait été autre chose qu’une secte et une marge, incapable d’abandonner les pratiques de la première et de s’extirper de la seconde ; la subordination du mouvement communiste " national " au Comintern (et du Comintern au PCUS, et du PCUS à Staline) n’est pas sans expliqué cette double incapacité, les choix stratégiques de l’Internationale étant de moins en moins adaptés aux situations politiques réelles. Le mouvement communiste aura pourtant tout essayé, et tâté de toutes les lignes politiques possibles (du " front commun " à l’affrontement " classe contre classe ", du sectarisme de la " bolchévisation " à l’ " unitarisme " du Front populaire) pour rompre son isolement. Mais, tombant systématiquement à contretemps, ces " lignes " se révéleront toutes plus inefficaces les unes que les autres, certaines aggravant même la situation du mouvement communiste et son exclusion du champ politique national. Lorsque le PC adoptera une ligne " modérée, nationale et même patriotique " (Jeanneret, op.cit. p. 105), il sera bien trop tard pour que cela change quoi que ce soit à sa situation. L’exclusion du PC du " champ de l’efficacité politique " s’accompagne d’ailleurs de celle de tout le mouvement lié à lui : secours Rouge, Ligue Antifasciste, Mouvement pour la Paix, Amis de l’URSS, tous seront proscrits par le PSS -ce qui n’empêchera d’ailleurs pas les " nicolistes " d’avoir de régulières relations avec ces mêmes organisations.
Les 8 et 9 avril 1933, le congrès du PSS confirme et fixe la conduite du mouvement socialiste à l’égard des communistes ; il s’y tiendra jusqu’à la création, dix ans plus tard, du Parti du Travail. La veille du congrès socialiste, celui de l’Union Syndicale avait donné le ton, en repoussant de manière catégorique toute alliance avec les communistes. Le PSS adoptera une attitude semblable, s’il l’exprimera de manière moins rigoureusement négative. La majorité du parti (la " droite " et le " centre ") récusera donc la stratégie de " Front Populaire " proposée par la minorité de gauche. Pour celle-ci, dont le porte-parole dut le secrétaire du PS zurichois Ernst Walter, l’unité du mouvement ouvrier est, compte tenu de la situation internationale, la condition de sa survie face au fascisme et au nazisme. La gauche socialiste s’étonne : " Pourquoi refuser de s’asseoir à la même table que les communistes si on accepte de le faire avec les bourgeois ? " (Jeanneret, op.cit. p. 107) et dénonce (comme Nicole ne cessera de le faire) la " bonzocratie " syndicale. Rien n’y fait : la motion " unitaire " de la gauche sera repoussée par 421 délégués contre 72 : une majorité écrasante, qui rend bien compte de la force de répulsion que les communistes suisses exercent sur leurs " frères " socialistes…
Cette majorité s’impose toutefois dans le parti suisse sans s’imposer dans tous les partis cantonaux. En 1934, la gauche socialiste zurichoise devra être purement et simplement exclue du PSS pour n’avoir pas respecté les décisions du congrès de Bienne. Il en sera fait autant de la gauche socialiste romande (et des partis genevois et vaudois en tant que tels) en 1939. En attendant, à Zurich, Bâle, Bienne, Lausanne et Genève, des accords sont conclu en socialistes et communistes : ententes électorales, manifestations communes, à tout le moins " pactes de non-agression " réciproque. Par ailleurs, le refus de l’unité avec le PC n’empêchera pas le PSS (y compris son aile droite) de protester, plus ou moins vigoureusement, au nom des droits démocratiques, contre les interdictions cantonales puis fédérale du PC -sans d’ailleurs que ces protestations ne conduisent le grand parti de la gauche à admettre en son sein, au plan national, les communistes désormais privée du droit de s’organiser légalement en parti politique distinct. Le PSS ne s’opposera certes pas à l’adhésion de communistes, mais il y mettra de telles conditions qu’en réalité l’admission collective des communistes au sein du PSS sera, au plan national impossible. Elle sera certes réalisée à Genève, mais contre le PS, et elle sera suivie de peu de l’exclusion collective du PSG du parti suisse.
Pour les socialistes, la démocratie est devenu le critère déterminant de toute stratégie politique : la démocratie à défendre contre la menace fasciste et nazie, et la démocratie comme condition du socialisme et ligne de partage entre alliés possibles et concurrents, sinon adversaires. " Pourquoi refuser de s’asseoir à la même table que les communistes si on accepte de le faire avec des bourgeois ", demandait Ernst Walter au congrès du PSS ? Parce que les bourgeois avec qui nous nous asseyons à la même table sont démocrates, et que les communistes ne le sont pas, répond implicitement le PSS.
La montée du fascisme, dont on sait la place qu’elle prend dans l’argumentation unitaire de la gauche socialiste, conduit celle-ci et la majorité du PSS à deux choix stratégiques contradictoires : Front Ouvrier, puis Front Populaire d’un côté, Front Démocratique de l’autre. Quand la minorité prône le rapprochement antifasciste de toutes les tendances de la gauche, la majorité pratique le rapprochement " démocratique " avec la bourgeoisie démocratique. Ni la gauche socialiste, ni -et encore moins- le PC n’auront la force d’inverser le rapport de force interne au mouvement socialiste, qui permit d’imposer rapidement la ligne majoritaire et de la concrétiser partout où cela fut possible. La situation genevoise apparaît ainsi comme totalement excentrique, dans la mesure où c’est la ligne antifasciste " ouvrière " de gauche qui s'y imposa, alors qu’elle fut défaite partout, et que partout s’imposa, plus ou moins ouvertement, la ligne antifasciste " démocratique " de droite. Paradoxalement, cette victoire de la gauche socialiste à Genève s’explique peut-être par la faiblesse d’un PC local, d’autant moins dangereux pour le PS genevois que celui-ci occupe l’essentiel de l’espace politique de gauche, y compris celui revendiqué par les communistes, de la " contestation radicale du système ".
A Genève, donc, va progressivement s’instaurer à gauche une stratégie de " Front Populaire " scandée par l’actualité locale et nationale, mais aussi par les développement de la situation internationale. Le " Front Populaire " genevois apparaît à première vue comme une alliance totalement déséquilibrée en un PS hégémonique et un PC marginal. Pierre Jeanneret (op.cit. p. 108) évalue les effectifs du PC genevois à une soixantaine de membres jusqu’en 1933. C’est dire la faiblesse numérique du parti, faiblesse qu’il compense par une suractivité militante (les organisations " gauchistes " des années septante en feront autant) qui s’ordonne en fonction d’une ligne qui la condamne à n’être qu’une clament épuisante et isolée (d’autant plus clamorosa qu’elle est solitaire), et très souvent dirigée contre les socialistes. Nicole, cible d’une dénonciation constante après le VIe congrès de l’IC, est ainsi l’accusé d’un véritable procès en trahison. Le 9 novembre 1932 genevois, le 6 février 1934 français, et entre ces deux commotions celle de l’arrivée des nazis au pouvoir, vont rendre possible un revirement implicite, qui attendra le revirement du Comintern lui-même pour devenir explicite. Les élections de 1933 vont consacrer le triomphe fragile d’un Nicole porté à la tête d’un gouvernement genevois au sein duquel le PS est majoritaire (il détient quatre sièges sur sept), mais qui ne dispose ni d’une majorité parlementaire, ni d’une réelle majorité populaire stable, ni des moyens économiques et financiers nécessaires au financement de son programme, ni d’ailleurs des compétences institutionnelles de l’appliquer. Lors de ces élections, le PC avait lancé, une fois encore, une consigne " antisocialiste " de " vote blanc ", en expliquant que " chaque voix donnée au Parti socialiste signifie soutenir le régime capitaliste " (Jeanneret, op.cit. p. 109). Position dérisoire, un an après la fusillade de Plainpalais, et que l’électorat communiste lui-même sanctionnera comme sans doute elle le méritait : il y eut en tout et pour tout 86 bulletins blancs dans tout le canton ; les électeurs communistes avaient voté aussi massivement que possible pour le PS, laissant les seuls militants assumer le choix dicté par la direction (alémanique) du parti suisse, en application du choix dicté par le " centre " (soviétique).
Le PC genevois n’est pas maître de ses décisions : elles lui sont imposées par la " centrale " suisse (alémanique) en fonction des choix internationaux du Comintern, déterminés de plus en plus exclusivement par les intérêts de l’Etat stalinien. Les communistes genevois sentent l’inconfort de leur position, l’impuissance de leur activisme, la stérilité de la ligne qu’on leur enjoint de suivre dans des conditions locales qui eussent exigé la ligne inverse. Ils n’auront de cesse, en fait, de tenter de " traduire " en termes locaux des ordres donnés en un suisse-allemand directement traduit du russe. Improbable exercice dont ils ne sortiront que par la grâce (cadeau de la droite et de l’extrême-droite) de leur interdiction légale et de leur entrée, imposée par les circonstances, dans un Parti socialiste lui-même à la veille d’être collectivement exclu du parti suisse. De cette " noce des exclus " naîtra en 1943 le Parti du Travail : d’un parti totalement marginal (le PC genevois), la droite genevoise aura fait en six ans le premier parti de la République…
Dès 1935, le PC genevois fait donc explicitement le choix du Front Populaire -des années après que le PS de Nicole en ait fait autant. Pierre Jeanneret note judicieusement que " l’adoption de la nouvelle ligne coïncide dans le PC genevois avec l’apparition d’une nouvelle génération de militants après les pionniers de 1921 " -des militants (Henri Trüb, Etienne Lentillon, etc.) qui seront également, aux côtés de Jean Vincent, mais aussi d’anciens membres du PSG (comme Roger Dafflon) les futurs cadres du Parti du Travail. La nouvelle ligne politique va se traduire en une (modeste) progression électorale du PC, qui passera de 1 % des suffrages en 1931 à 2,1 % en 1935. C’est toute de même vingt fois moins que le PS ! L’unité prônée, et qui se fera, doit s’établir entre deux organisations aux forces totalement inégales. Il faudra la cassure de 1939 pour que les communistes puissent, lentement, prendre le pas sur les socialistes nicolistes, jusqu’à les phagocyter et en arriver, en 1944, à faire présider par Léon Nicole un parti officiellement né de la réunion de l’ancien PC et de l’ancienne FSS, mais dominé par les héritiers du premier et au sein duquel Nicole et ses amis joueront de plus en plus les utilités, ce qui les conduira à rompre eux-mêmes, à leur tour, avec leurs alliés communistes.
Pourquoi ce choix unitaire de Nicole dans les années trente, un choix unitaire dont l’intérêt électoral était médiocre et les conséquences politiques négatives ? Par conviction, d’abord, et pour répondre à l’aspiration populaire à l’unité de toutes les forces de gauche, aspiration que Nicole perçoit et entretient. Et par antifascisme, ensuite. Communiste, Nicole ne l’était pas -s’il était prosoviétique. Il avait combattu ceux qui proposèrent l’adhésion du PSS à la IIIème Internationale et avait tout fait pour que la gauche révolutionnaire restât au sein du grand parti (réformiste) de la gauche helvétique. Réussissant dans cette entreprise en Romandie, il s’était trouvé en butte aux attaques continuelles de ceux qui ne lui pardonnaient pas d’occuper l’espace politique qu’ils convoitaient. Son choix unitaire, il dut le défendre non seulement face à ceux qui, au sein du PSS, n’en voulaient pas, mais aussi face aux communistes qui multiplièrent jusqu’en 1935 les occasions de diviser la gauche. Il n’en démordra pas : l’unité de la classe ouvrière est la condition nécessaire, sinon suffisante, de la victoire sur le fascisme, et l’URSS est un allié indispensable à cette victoire. Les années trente vont tragiquement illustrer la pertinence de ce choix (celui de l’unité, non celui de l’URSS -ou plutôt celui de l’URSS pour l’unité : la victoire du nazisme se construit en 1932 et 1933 sur les décombres d’un mouvement ouvrier " cassé " par l’affrontement de ses deux ailes ; au résistible pronunciamiento militaire de 1936, la République espagnole oppose une mobilisation populaire que les affrontements entre les différents courants du mouvement révolutionnaire espagnol vont tragiquement désarmer, face à un ennemi puissamment soutenu par l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie. La social-démocratie est incapable de répondre au défi lancé par l’extrême-droite : les " déchirements " pathétiques d’un Léon Blum entre la solidarité avec l’Espagne républicaine et la non-intervention face à l’agression dont elle est victime, en témoignent et illustrent la contradiction de la raison solidaire et de la raison d’Etat, ou d’une " éthique de la vérité " socialiste qui pousse à la solidarité, et d’une " éthique de la responsabilité " gouvernementale qui cantonne cette solidarité à la marge et à une quasi-clandestinité : on aidera certes l’Espagne républicaine, mais subrepticement, pauvrement, sans le dire. L’effondrement du mouvement socialiste en Italie et en Allemagne paraît illustrer la faillite définitive des héritiers de la IIème Internationale (mais sanctionne en même temps celle de la IIIème : il n’y a plus d’ " alternative " à gauche. Nicole ne cherche ni ne souhaite la rupture avec le PSS, mais ses choix l’en éloignent de plus en plus, au point de rendre cette rupture inévitable. Paradoxe : au moment où se réalise à Genève l’unité si longtemps attendue entre socialistes et communistes, c’est l’unité entre socialistes qui est irrémédiablement mise à mal -et ce moment est aussi celui de la chute du gouvernement socialiste. A vrai dire, Nicole ne porte guère le deuil de ses fonctions gouvernementales cantonales, tant ses préoccupations échappent aux limites locales :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission… op.cit. p. 113
L’événement national viendra conforter cette analyse, fondée sur les rapports de force internationaux, et sera interprétée en fonction d’elle. La fusillade du 9 novembre sera vue comme un épisode de cet affrontement planétaire. Mais avant le 9 novembre genevois, il y aura eu, plus tragique peut-être, parce que fratricide, le 15 juin zurichois : la police d’une municipalité socialiste ouvre le feu sur une manifestation communiste…
Depuis 1928, les socialistes dominent la municipalité zurichoise. Emil Klöti, social-démocrate réformiste, partisan convaincu d’un " socialisme municipal " conçu comme une " vitrine " de ce que peur réaliser une gauche pragmatique et respectueuse du Droit, mène une politique qui annonce celle que Nicole lui-même tentera de mener lorsqu’il tiendra les rênes du gouvernement cantonal genevois : une politique somme toute " keynésienne ", bien plus proche du New Deal rooseveltien que du socialisme soviétique. Mais, à la différence de Nicole, Klöti dispose des moyens parlementaires de sa politique : il s’appuie sur une majorité parlementaire, alors qu’elle fera cruellement défaut aux socialistes genevois, et il n’effraie pas le pouvoir économique qui, à Genève, fera tout -et y réussira- pour " saboter " l’expérience socialiste, en la privant de moyens financiers. La ville de Zurich va donc innover : assurance-chômage, assurance-vieillesse et (ce qui pourra malgré tout être aussi réalisé à Genève) urbanisme progressiste (destruction des taudis, construction de logements sociaux modernes, équipements sportifs). Le relatif succès d’une telle politique est une véritable provocation pour un PC bien implanté (du moins en comparaison de Genève). Les communistes vont donc tout tenter pour faire échouer l’expérience social-démocrate zurichoise (réformiste et pratiquant la " collaboration de classe "). La principale opposition au " gouvernement " municipal socialiste zurichois est le fait des communistes, quand la principale opposition au " gouvernement " cantonal genevois sera bourgeoise…
Le 23 janvier 1932, une émeute éclate à Zurich à la suite d’une manifestation communiste réprimée par la police cantonale (que contrôle la droite, alors que la police municipale, plus nombreuse, est contrôlée par les socialistes). L’émeute fait quatre blessés. En mai, les monteurs en chauffage se mettent en grève contre une convention collective diminuant leurs salaires horaires. Signataire de la convention, la FOMH condamne la grève, soutenue et encouragée par le PC local. De durs affrontements opposent grévistes et " jaunes " (comme à Genève, dans le bâtiment, syndicaliste de la FOBB et " kroumirs " des syndicats catholiques). La municipalité socialiste décide d’interdire toute manifestation de rue, en réponse à quoi les communistes appellent précisément à manifester dans la rue. Le 15 juin, une manifestation rassemble des milliers de personnes sur l’Helvetiaplatz. La police (municipale) tente de la disperser à coups de matraques, les manifestants répliquent, on se bat ; la police ouvre le feu. Il y aura deux morts et des dizaines de blessés. Instigateurs de la manifestation, les communistes vont subir de plein fouet la répression qui s’ensuivra : le journal du parti, der Kämpfer, est interdit, des responsables communistes sont arrêtés, le siège du PC est perquisitionné.
Le 9 novembre genevois sera un affrontement direct entre une manifestation antifasciste unitaire de la gauche locale et l’armée protégeant un meeting d’extrême-droite ; le 15 juin zurichois fut un affrontement fratricide, " à l’allemande ", entre des autorités social-démocrates et des manifestants communistes. C’est dire que l’événement zurichois provoquera au sein du PS une vaste et dure polémique. La direction du PSS soutiendra la municipalité zurichoise, dénoncée par contre par le PS genevois (plus précisément par le PS de la Ville de Genève, Nicole jouant des structures pour faire dire ce qu’il pense par le parti municipal sans que le parti cantonal en soit tenu pour responsable). Le Volksrecht réagit en accusant Nicole de n’être qu’un " bolchevik camouflé " -ce qui, on l’a vu, est pour le moins excessif. Lorsque le 16 juillet le débat arrive devant le Comité central du PSS, le clivage gauche-droite au sein du parti suisse se matérialisera dans le rapport de Klöti, défendant le droit des socialiste de faire régner l’ordre légal (ne serait-ce que pour éviter que le droite s’en charge, au besoin par des milices privées du genre des " gardes civiques " de la grève générale), dénonçant la tactique " putschiste " des communistes et reprochant amèrement aux Genevois de se faire les porte-parole des communistes dans leurs attaques contre la social-démocratie.
En août 1932, Nicole va donner à ses adversaires une nouvelle occasion de dénoncer son " alignement " sur les communistes, en participant au Congrès d’Amsterdam pour la Paix. Ce congrès avait pour but de lancer, au plus grand fracas publicitaire possible, un mouvement " unitaire " et " antifasciste " de défense de la paix -une paix menacée, selon les initiateurs (communistes ou " compagnons de route ") du congrès, par une guerre d’agression préparée par le capitalisme contre l’Union Soviétique. Mouvement unitaire dans son discours, communiste dans les faits, et dont la stratégie consistait à " recruter " le plus grand nombre possible de " compagnons de route " (notamment socialistes). C’est à Willi Münzenberg que revient, sinon la paternité du mouvement, du moins son façonnement médiatique. Le qualifiant de " génie de la propagande ", Pierre Jeanneret note qu’il avait su " s’entourer de personnalités, d’idéalistes généreux ou cherchant la popularité et prêts à cautionner toutes les thèses humanitaires et pacifistes, sans se poser trop de questions sur leurs origines et leurs buts réels " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 116). On retrouvera à l’avant-scène de ce théâtre politique des hommes comme Edouard Herriot, Pierre Cot, Romain Rolland, Henri Barbusse. Le congrès " contre la guerre et le fascisme ", prévu à l’origine à Genève, dut se replier à Amsterdam à la suite d’interdictions cantonale et fédérale. L’Internationale socialiste et, entre autres partis nationaux, le PSS, avaient interdit à leurs membres de participer à cette opération contrôlée par des communistes, mais Nicole ne tint aucun compte de cet avertissement et prit la parole devant 2000 congressistes pour les inciter à une " unité réelle et sincère " (ibid).
Le congrès d’Amsterdam se conclut par l’affirmation de la solidarité avec l’URSS des socialistes ainsi réunis avec les communistes, solidarité dans la lutte de l’URSS " contre les Etats capitalistes ". Le 8 octobre, Nicole doit s’expliquer devant le Comité central du PSS : il y justifie son choix par l’ " enthousiasme " ressenti devant " l’effort grandiose d’un peuple de 160 millions d’ouvriers et de paysans " et par l’ " espoir " suscité par ce mouvement d’ " unité antifasciste " (ibid. p. 117). C’est utiliser les mots mêmes de ceux à qui les adversaires de " Léon " veulent l’assimiler : les communistes.
Un mois après, le 9 novembre genevois va creuser encore un peu plus le fossé entre le PSG et le PSS, au-delà des discours tenus par les uns et les autres sur la solidarité ouvrière et le deuil commun. On l’a vu : le PSS dénonce crûment les erreurs commises par le gouvernement genevois, l’appel à la troupe, la politique d’intimidation du mouvement socialiste genevois menée par le pouvoir cantonal et les autorités fédérales, et relève la responsabilité de l’extrême-droite dans le drame du 9 novembre, mais c’est pour ensuite critiquer Nicole et le PSG. Une critique d’abord implicite (solidarité et deuil obligent), mais de plus en plus explicite au fur et à mesure que passent les mois. A l’intérieur du parti genevois, la " droite " social-démocrate, par la voix notamment de Charles Rosselet, dénonce la responsabilité d’un Nicole " débordé par les forces qu’il avait mise en mouvement " (ibid. p. 119).
Le drame survenu, le PSS et l’USS s’emploient à en limiter les conséquences et à canaliser la riposte, aidés en cela par les adversaires de Nicole au sein du PSG. On sait ce qu’il advint de la " grève politique de masse " envisagée pour le 12 novembre : un long débrayage de protestation et de deuil, exempt de velléités insurrectionnelles. A vrai dire, l’ambiance genevoise n’était guère à l’offensive et la classe ouvrière locale, " sonnée " par la fusillade, avait surtout pour projet immédiat d’honorer ses morts en donnant l’exemple d’une dignité et d’un calme dont la droite avait singulièrement manqué. Les troupes mises sur pieds par le gouvernement cantonal, dans le même souci d’intimidation qui fit traverser la ville par les soldats le 9 novembre, n’eurent pas à intervenir.
L’écho de la fusillade résonne encore que la répression s’abat sur ses victimes et les leaders de la gauche genevoise, Léon Nicole en tête. Dans La Sentinelle, Graber lâche (une fois de plus) son supposé camarade genevois, au moment même où celui-ci est en butte à la répression " bourgeoise " : " Au moment où Nicole, arrêté, est menacé d’une lourde condamnation, les articles du secrétaire romand (du PSS), repris complaisamment par la presse bourgeoise, apparaissent aux socialistes genevois comme une trahison " (Pierre Jeanneret, op.cit. p. 119), commente Pierre Jeanneret. Toujours dans La Sentinelle, les syndicalistes Achille Grospierre et Pierre Aragno prennent, sur le même mode, le relais de Graber. Le PSS devra s’entremettre entre les deux factions romandes, au nom d’une unité de plus improbable.
En fait, la tragédie du 9 novembre n’est que le révélateur d’une crise interne de plusieurs années plus anciennes, et elle oblige la plupart des protagonistes de cette crise à observer une pause dans le règlement de leurs comptes politiques. Mais au printemps 1933, comparaissant devant les Assises fédérales, Nicole accusera encore le PSS de l’avoir abandonné à la vindicte de la bourgeoisie…
Un mois avant que Nicole comparaisse devant ses juges, le congrès de Bienne du PSS (avril 1933) avait repoussé les offres communistes de " Front unique " (on n’en est pas encore au " Front populaire "). Quelques jours après le congrès suisse, le PSG propose néanmoins au mouvement syndical genevois d’accepter la participation des communistes, en tant que tels, à la manifestation unitaire du Premier Mai. Symboliquement, c’est dire au PSS le peu de cas que l’on fait de ses décisions -et qui plus est, de décisions prises au plus haut niveau de légitimité démocratique, celui d’un congrès national. Le 19 avril, la direction du PSS réagit durement, dans une lettre qui dresse le constat d’une crise déjà ancienne : le PSG a enfreint (souvent) la discipline du parti, participé (officiellement ou non) à des manifestations communistes et entretenu des liens permanents avec des organisations communistes, contre l’avis du PSS. Le parti suisse, sous la plume de son président Reinhard, va plus loin : il reprend les accusations portées par la droite du parti genevois (et la droite tout court) de " coresponsabilité " du PSG dans la tragédie du 9 novembre. Conclusion logique : " Les relations entre le Parti socialiste du canton de Genève et le Parti socialiste suisse sont interrompues " sur décision de la direction du PSS. En principe confidentielle, cette lettre est publiée par les Basler Nachrichten. On parle déjà, dans la presse de droite, d’exclusion de Nicole du PSS (elle viendra, mais on n’en est pas encore là). La lettre fait effet à Genève, et le 20 avril le PSG renonce au Premier Mai " unitaire " avec le PC. Il ne s’agira cependant que de lâcher du lest, et on en aura la preuve lorsque cinq jours plus tard, alors que lors d’une réunion commune entre le parti genevois et le parti suisse, le premier déclare se soumettre aux décisions du second. Léon Nicole dénonce dans Le Travail les " ukazes " du PSS. Trois jours plus tard, l’Assemblée générale du PSG plébiscite " Léon " à raison de 314 délégués sur les 320 présents. Le 1er mai 1933 est pour Nicole un véritable triomphe personnel. Comme le PSG s’y était engagé, les communistes n’interviennent pas lors de la manifestation, mais ils y participent, l’anarchiste Luigi Bertoni y intervient aux côtés de Nicole et, ultime pirouette (avec pied-de-nez au PSS), le vice-président du PSG, André Ehrler, rend hommage aux côtés du communiste Etienne Lentillon aux victimes du 9 novembre, devant la tombe du communiste Fürst.
Le PSS n'apprécie guère, on s’en doute, la désinvolture genevoise. Mais il sait aussi de quel soutien Nicole et ses partisans disposent au sein du PSG et de la classe ouvrière genevoise. Il mesure la popularité du chef socialiste genevois et son influence dans toute la Romandie. Agir contre les " Genevois ", soit, mais il faut de la subtilité -d’autant que Nicole va, " traîné " qu’il est devant les Assises fédérales, être inattaquable pendant toute la durée du procès (et au-delà), sauf à en faire un martyr et à donner l’impression d’un acharnement négocié avec la droite contre le chef incontestable de la gauche lémanique. Cette nécessaire subtilité ne convient guère à la droite du parti, qui voudrait que des sanctions immédiates fussent prises. Grimm, comme à l’accoutumée, joue le " centre " : si l’on condamne les " déviations de gauche " des Genevois, il faudra aussi combattre les " déviations de droite " d’autres, notamment du groupe parlementaire au Conseil national à propos des questions militaires. Le Comité directeur du PSS, le 2 mai, ne fera donc que confirmer les termes de la lettre du 19 avril, c’est-à-dire le " gel " des relations entre le parti suisse et le parti genevois. Pas d’exclusion, donc, mais l’exigence d’une soumission du PSG aux termes d’une déclaration qu’il signera le 15 juin -et s’empressera d’oublier sitôt signée. Il faut ici reproduire le texte de cette déclaration " solennelle " pour la comparer à la ligne politique que suivra le PSG dans les années à venir -et donc se rendre compte de la liberté prise par les Genevois à l’égard d’un engagement qu’ils considéreront toujours comme leur ayant été extorqué (et qu’ils n’eurent donc jamais réellement l’intention de respecter) :
2. Le P.S. de Genève s’engage, comme tous les partis cantonaux, à soutenir de toutes ses forces les actions politiques du PSS, il met sans réserve toutes ses organisations et sa presse au service de cette tâche. Cette disposition concerne en particulier le programme de crise et l’impôt fédéral de crise.
(…)
4. Le P.S. de Genève s’engage à exclure sans autre tout membre du Parti qui agirait contrairement aux dispositions de la présente déclaration.
(…)
6. A la condition que le P.S. de Genève respecte sur tous les points cette convention, le PSS soutiendra le P.S. de Genève de toutes ses forces et par tous les moyens dans sa lutte contre la réaction.
(…)
8. (la) double ratification de la présente déclaration (par le PSS et le PSG) liquide tous les incidents entre le P.S. de Genève et le PSS.
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. annexe 16
Le huitième point de cette déclaration affirme aventureusement (ou hypocritement ?) qu’un trait est désormais tiré sur les divergences entre socialistes genevois et suisses (ou, pour être plus précis, entre les majorités et les directions respectives du PSG et du PSS). Le parti suisse se faisait-il des illusions sur la fidélité des " nicolistes " à un tel engagement, si contraire à leurs choix et à leur sensibilité politique ? Il fallait en tous cas éviter une scission dont les plus avisés d’entre les dirigeants suisses savaient quels dégâts elle pouvait faire (et fera) en Romandie. Quant à Nicole, il n’était guère en position de refuser de signer un tel engagement, au risque précisément de la scission, alors que le jugeaient des Assises fédérales. Il y eut dès lors accord " objectif " entre les protagonistes du débat socialiste pour, au moins momentanément, éviter qu’il aboutisse à une rupture en situation de faiblesse partagée. Ce compromis, toutefois, ne tiendra pas longtemps : six ans.
Qu’un tel compromis fût illusoire, cela était évident avant même que le PSG ne signât l’engagement de se soumettre au PSS. Les décisions " anticommunistes " du congrès de Bienne n’avaient eu d’effet que sur les sections et les partis cantonaux qui étaient avant elles déjà convaincus de la malignité des intentions communistes. Mais la gauche du parti avait passé des accords, à différents niveaux et d’inégale importance, avec les communistes à Zurich, à Bâle et à Genève -les trois principales villes du pays, tout de même. C’est bien la crédibilité du PSS qui est en jeu : ses décisions les plus importantes, prises au plus haut niveau de légitimité démocratique, sont tenues pour nulles et non avenues par des organisations locales.
 En Romandie, l’impact de l’événement français provoque une particulière sensibilité aux offres unitaires des communistes, quoi qu’il en soit de leur sincérité. Toutes conditions politiques par ailleurs fort différentes, les progrès de l’unité " républicaine " en France face au danger fasciste nourrissent l’aspiration à un changement de ligne dans les rapports entre les deux principaux courants du mouvement ouvrier. L’imposante manifestation du 14 juillet 1935 à Paris, lors de laquelle des centaines de milliers de socialistes, de communistes et de syndicalistes portent le Front Populaire sur les fonds baptismaux (laïques, certes), est incontestablement ressentie comme un événement porteur d’espoir. Nicole s’en ouvrira au Comité directeur du PSS après la victoire électorale du Front Populaire et la formation, le 4 juin 1936, du premier gouvernement de Léon Blum :
En Romandie, l’impact de l’événement français provoque une particulière sensibilité aux offres unitaires des communistes, quoi qu’il en soit de leur sincérité. Toutes conditions politiques par ailleurs fort différentes, les progrès de l’unité " républicaine " en France face au danger fasciste nourrissent l’aspiration à un changement de ligne dans les rapports entre les deux principaux courants du mouvement ouvrier. L’imposante manifestation du 14 juillet 1935 à Paris, lors de laquelle des centaines de milliers de socialistes, de communistes et de syndicalistes portent le Front Populaire sur les fonds baptismaux (laïques, certes), est incontestablement ressentie comme un événement porteur d’espoir. Nicole s’en ouvrira au Comité directeur du PSS après la victoire électorale du Front Populaire et la formation, le 4 juin 1936, du premier gouvernement de Léon Blum :
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 125
Le septième congrès du Comintern (juillet/août 1935) avait entériné la ligne de Front Populaire, déjà " autorisée " par le " centre " au PCF dès la fin 1934. Le 8 septembre 1935, un grand meeting unitaire se tient à Genève, lors duquel Jean Vincent apporte l’ " appui total " des communistes au gouvernement socialiste genevois, élu en 1933. Le 7 mai 1936, à Lausanne, la victoire du Front Populaire français est fêtée par communistes et socialistes (y compris Graber…) ensemble.
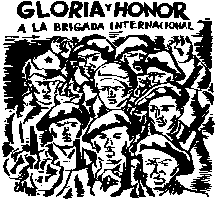 Mais ce qu’il peut y avoir d’euphorique dans les célébrations unitaires du Front Populaire sera rapidement éteint par les dramatiques nouvelles d’Espagne. La Guerre d’Espagne et la révolution espagnole (la révolution dans la guerre, la révolution malgré la guerre ou à cause de la guerre, puis la guerre contre la révolution) aura sur le processus d’unité entre communistes et socialistes deux effets contradictoires. Dans un premier temps, elle contribuera à renforcer cette unité face au danger commun (le fascisme). Mais le poids, et le rôle de plus en plus trouble, de l’Union Soviétique et du PC espagnol (qui se situe à la droite du Frente Popular, défend la propriété privée, combat les expropriations révolutionnaires et la collectivisation menée par les anarchistes, et ne cesse -pour finalement y réussir- de vouloir restaurer l’autorité de l’Etat " bourgeois " contre les organisations populaires et révolutionnaires, en particulier la CNT et la FAI anarchistes et le POUM communiste " dissident "), et cela jusqu’à la fin de la révolution, prélude à la défaite de la République elle-même, jouent contre l’unité, en accroissant encore le " philosoviétisme " des uns (l’Union Soviétique est le seul Etat à aider réellement la République espagnole, quoique le Mexique fasse un effort considérable -et désintéressé, lui- et que la France joue un double jeu entre une non-intervention proclamée et un soutien discret, mais insuffisant) et l’anticommunisme des autres (la révolution espagnole ne sera pas écrasée par Franco, mais par la République, dont le bras armé politique, policier et militaire) pour cette tâche sera le parti communiste espagnol et les conseillers soviétiques, notamment ceux de la Tcheka…). Pierre Jeanneret :
Mais ce qu’il peut y avoir d’euphorique dans les célébrations unitaires du Front Populaire sera rapidement éteint par les dramatiques nouvelles d’Espagne. La Guerre d’Espagne et la révolution espagnole (la révolution dans la guerre, la révolution malgré la guerre ou à cause de la guerre, puis la guerre contre la révolution) aura sur le processus d’unité entre communistes et socialistes deux effets contradictoires. Dans un premier temps, elle contribuera à renforcer cette unité face au danger commun (le fascisme). Mais le poids, et le rôle de plus en plus trouble, de l’Union Soviétique et du PC espagnol (qui se situe à la droite du Frente Popular, défend la propriété privée, combat les expropriations révolutionnaires et la collectivisation menée par les anarchistes, et ne cesse -pour finalement y réussir- de vouloir restaurer l’autorité de l’Etat " bourgeois " contre les organisations populaires et révolutionnaires, en particulier la CNT et la FAI anarchistes et le POUM communiste " dissident "), et cela jusqu’à la fin de la révolution, prélude à la défaite de la République elle-même, jouent contre l’unité, en accroissant encore le " philosoviétisme " des uns (l’Union Soviétique est le seul Etat à aider réellement la République espagnole, quoique le Mexique fasse un effort considérable -et désintéressé, lui- et que la France joue un double jeu entre une non-intervention proclamée et un soutien discret, mais insuffisant) et l’anticommunisme des autres (la révolution espagnole ne sera pas écrasée par Franco, mais par la République, dont le bras armé politique, policier et militaire) pour cette tâche sera le parti communiste espagnol et les conseillers soviétiques, notamment ceux de la Tcheka…). Pierre Jeanneret :
Comme celle de l’adversaire, qui exaltait sa croisade contre le bolchevisme athée, la vision de la gauche était manichéenne : au Mal (les généraux rebelles soutenus par une Eglise catholique rétrograde) s’opposait le Bien, incarné par les " campesinos " en armes, luttant pour la légitimité républicaine et le démocratie. Après des années de reculades et de défaites devant Mussolini et Hitler, la victoire -une victoire qui eût marqué le premier recul du fascisme- semblait en Espagne possible.
Pierre Jeanneret, op.cit. pp 125, 126
Une victoire sur le fascisme était en effet possible, et il faudra attendre 1938 pour que l’on en abandonne l’espoir. Mais les conditions de la victoire firent défaut, et de ce défaut, la gauche -les gauches- ne fut -ne furent- pas innocente(s) : le gouvernement français de Front Populaire, piégé par l’alliance britannique et par sa propre composition politique (les radicaux faisant tout pour empêcher l’engagement de la France aux côtés de l’Espagne républicaine) se réfugia dans une officielle non-intervention que l’aide officieuse à la République espagnole ne put guère compenser. Les Soviétiques, de leur côté, et avec et derrière eux les communistes espagnols, consacrèrent une partie considérable de leur temps, de leur énergie et de leurs moyens à combattre les " trotskistes " du POUM et les anarchistes de la CNT et de la FAI plutôt que les fascistes italiens, les nazis allemands et les franquistes espagnols. Finalement, l’antifascisme unitaire des débuts de la Guerre d’Espagne se dissout dans les polémiques entre courants concurrents ou adversaires au sein même du mouvement international -et de chaque mouvement national. La désunion de la gauche, sur ce terrain comme avant sur d’autres, fit en grande partie le lit du fascisme (le franquisme n’étant d’ailleurs pas totalement " assimilable " au fascisme, si sa victoire lui fut due) ; en grande partie, mais non en totalité : sans l’aide massive de l’Italie et de l’Allemagne, sans la connivence du Portugal, sans le jeu particulièrement trouble de l’Angleterre, les " séditieux " espagnols n’eurent pu vaincre la République, même sur une République divisée et en révolution. Face à l’Italie et à l’Allemagne (et au Portugal), l’Espagne républicaine ne bénéficia que du soutien loin et idéologiquement sélectif de l’Union Soviétique, plus lointain encore (si idéologiquement plus unitaire) du Mexique, et, chiche et clandestin, de la France.
La menace fasciste, dans les premiers temps de la guerre d’Espagne, conduisit les socialistes suisses à dénoncer la politique de " non-intervention " adoptée (sur pression britannique) par le gouvernement français. En août 1936, Léon Nicole annonce avec quelque prescience les conséquences des faiblesses des démocraties :
Jeanneret, op.cit. p. 126
On verra plus loin comment, dans la pratique, put se traduire la solidarité manifestée par la gauche helvétique avec la République espagnole, de l’envoi de matériel sanitaire à la participation au combat dans les rangs des Brigades Internationales, des milices de la CNT-FAI, de celles du POUM ; de l’armée régulière ou des troupes basques et catalanes. Mais la Guerre d’Espagne, avant que de s’achever par la victoire du franquisme, dégénéra en de sanglants règlements de comptes au sein même du camp antifasciste : avant l’écrasement de la République espagnole, il y eut celui de la révolution espagnole, par la République elle-même. Ce fut une véritable " guerre civile dans la guerre civile ", menée pour l’essentiel par les communistes espagnols et leurs conseillers soviétiques, avec la volonté d’éliminer tout mouvement qui pût contester au PC la suprématie, puis l’hégémonie, sur la gauche (et une gauche qui ne sera même plus révolutionnaire, le PC espagnol ayant explicitement abandonné tout projet révolutionnaire en Espagne, et s’étant rangé du côté de la " bourgeoisie républicaine ", de la propriété privée et de l’ordre…). Or cette menace était réelle, si réelle qu’au début du conflit le PC était une force marginale, totalement minoritaire, non seulement face aux socialistes, mais aussi aux anarchistes : le grand mouvement révolutionnaire espagnol n’est alors pas communiste mais anarchiste ; le principal syndicat espagnol n’est ni communiste, ni socialiste (ou social-démocrate), mais anarcho-syndicaliste ; la grande organisation révolutionnaire espagnole, ce n’est pas le PC, mais la CNT. Et le mouvement communiste lui-même n’est pas unifié : à côté du PC (ou face à lui), il y a le POUM, trop rapidement assimilé au trotskisme, et qui participe plutôt d’une opposition communiste de gauche où les trotskiste ne prennent leur place qu’au même titre que les " conseillistes " à la Kollontaï (ou à la Pannekoek). Communistes " de gauche " (et l’expression n’est qu’en apparence tautologique) et anarchistes furent donc les victimes désignées de l’épuration stalinienne. Face à ce " dérapage ", les différents courants du mouvement socialiste suisse firent preuve d’un égal aveuglement, trotskistes et anarchistes étant les seuls à dénoncer les pratiques communistes. Les " nicolistes " se signalèrent d’ailleurs par une particulière propension à reproduire sans aucune distance critique les plus invraisemblables accusations staliniennes. Les " chefs du parti trotskiste " (le POUM) furent ainsi dénoncés comme ayant voulu organiser un soulèvement… phalangistes, de concert avec Franco lui-même (Jeanneret, op.cit. p. 127).
La direction " nicoliste " du PSG va d’ailleurs se mettre elle-même à " purger " le parti de ses éléments " trotskistes " (ou supposés tels), éléments peu nombreux, souvent étrangers et plutôt actifs au sein de la Jeunesse Socialiste. En 1936, plusieurs membres d’un petit groupe trotskiste, vaguement lié à la Marxistische Aktion der Schweiz alémanique, sont purement et simplement exclus du PSG " à l’instigation de Nicole et sur son intervention directe ", précise Pierre Jeanneret, qui ajoute que " cette participation de Léon Nicole à la lutte contre le " virus trotskiste mondial " (sic) fut interprétée par les communistes comme un gage de sincérité à leur égard " (op.cit. p. 128).
Résumons : on passe donc dans les années trente, du moins à Genève et à Lausanne, d’une politique d’affrontement " classe contre classe " à une politique d’alliance de type " Front populaire ", avec l’engagement des socialistes et des communistes dans une politique d’unité, rendue possible par le revirement des communistes. Cette politique se poursuivra jusqu’à la scission de 1939, malgré tout ce que le PSS tentera pour l’empêcher, puis, ensuite, se traduira par la création d’organisations politiques (légales ou non) rassemblant les socialistes " de gauche ", majoritaires à Genève et Lausanne au moment de la scission, et les communistes. Il en sortira le Parti du Travail. Le PSG ne tiendra donc, dans les faits, aucun compte de son engagement de 1933 à l’égard du PSS, et à Genève s’établira ainsi " un véritable Front Populaire (…) en rupture avec toutes les décisions du parti suisse " (op.cit.). Ce " Front Populaire " n’empêchera certes pas la chute du gouvernement socialiste genevois, pas plus qu’il n’empêchera ni ne retardera (bien plutôt la favorisera-t-il) la rupture entre le PSG et le PSS en 1939, mais il rendra possible les " retrouvailles " de 1944 entre la gauche socialiste regroupée autour de Nicole et la gauche communiste. De ces retrouvailles naîtra le Parti du Travail -un parti qui tiendra du populisme nicoliste sa base ouvrière) et du parti communiste ses chefs réels.
En janvier 1936, 5000 personnes participent à Genève, à Plainpalais, à une manifestation commune socialo-communiste, dont Jean Vincent exprime le contenu et exalte la signification :
Cité par Pierre Jeanneret, op.cit. p. 128
La résolution adoptée à l’issue de la manifestation demande à tous, " sans distinction de tendances " (trotskistes exceptés, sans doute…) de rejoindre le " mouvement politique de la classe travailleuse, reconstituée sous le signe de l’unité ". Ce mouvement politique, Nicole l’a toujours conçu sur le mode d’un vaste rassemblement populaire englobant non seulement la classe ouvrière et les petits employés, mais aussi " la petite bourgeoisie artisanale, commerçante et paysanne ". C’est dans la logique d’un tel rassemblement que s’inscrivent les rapports entre socialistes et communistes : comment en effet " jeter l’exclusive " sur les communistes à l’heure de la menace fasciste, et même si les communistes, eux, " jettent l’exclusive " sur leurs propres dissidents trotskistes ?
L’unité antifasciste, le PSS la veut aussi -mais sur sa droite, avec la bourgeoisie démocratique. Pierre Jeanneret :
Pierre Jeanneret, Léon Nicole et la scission de 1939 op.cit. p. 130
Cet aggiornamento réformiste du projet politique socialiste suisse -dont on répétera ici qu’il correspond en fait à une remise de la théorie au niveau d’une pratique réformiste constante, quelque révolutionnaires fussent les discours- rend effectivement fort improbable une alliance au niveau suisse entre socialistes désormais explicitement réformistes et communistes dont le virage " unitaire " est guidé pat un souci stratégique qui n’entame guère, sinon leurs certitudes révolutionnaires (s’il en remet la concrétisation à plus tard) du moins leurs réflexes sectaires (s’ils changent d’objet : les socialistes " nicolistes " ne sont plus des " sociaux-traîtres ", mais les trotskistes restent des " hitléro-trotskystes " et les anarchistes des " aventuristes "). La structure du pays, la réalité de ses forces politiques, la culture politique dominante, rendent illusoire une reproduction en Suisse d’un Front Populaire " à la française " -un front populaire dont le " déchirement " face à la Guerre d’Espagne permet d’ailleurs de mesurer les faiblesses et les contradictions. Au surplus, le PC est une secte en Suisse quant il est une force en France. Enfin, les perspectives de la gauche nicoliste et de la majorité du PSS sont, par nature, différentes. Le PSS a des visées nationales, définit ses stratégies et prend ses décisions en fonction du contexte et d’objectifs suisses ; l’horizon et les références de Nicole, par contre, sont internationaux -comme ceux des communistes. Et c’est en fait sur le terrain de la solidarité internationale (de la " politique internationale du mouvement ouvrier ") que la ligne de " Front Populaire " aura à Genève le plus de matérialité : solidarité avec l’Espagne républicaine, solidarité avec l’Union Soviétique, " bastion de l’antifascisme ". A court terme, les seules conséquences de l’unité de la gauche genevoise seront l’entrée au parlement cantonal des communistes Vincent et Pons, élus sur la liste socialiste en novembre 1936 -au moment où tombe le gouvernement Nicole et peu avant l’interdiction du PC au plan cantonal.
A plus long terme, la crise de 1939 aidant (exclusion collective de la majorité des socialistes genevois et vaudois du PSS, scission entre les ailes " gauche " et " droite " des partis genevois et vaudois, interdiction du nouveau parti socialiste (re) créé par Nicole, et de la Fédération socialiste suisse…), le Front populaire aura pour conséquence la création d’un nouveau parti, le Parti du Travail, qui, " communiste sans le dire " (du moins sans le dire clairement) deviendra pour un quart de siècle le principal parti de la gauche genevoise.
En 1937, le Parti communiste est interdit à Genève, après l’acceptation par 60,3 % des citoyens (ce qui implique l’acceptation par une partie des socialistes) d’une loi anticommuniste contre laquelle le PSG avait lancé un référendum abrogatif. Sitôt ce vote acquis, le PS réagit en décidant d’accepter sans condition, sans exclusive et collectivement les membres du PC dans ses rangs ; décision s’inscrivant dans la stricte logique de celles prises précédemment par les socialistes genevois, mais évidemment contradictoire de celles prises par les socialistes suisses, comme le soulignera E.-P. Graber, présent à l’assemblée lors de laquelle, à l’unanimité (les abstentions ne brisant pas l’unanimité) les délégués du PSG décidèrent d’ouvrir leur parti aux communistes. Pour les socialistes genevois, il s’agissait là d’une décision historique, revêtant une importance plus grande à leurs yeux qu’à ceux des communistes (du moins de leurs dirigeants), dont le parti n’était pas encore interdit au plan suisse et qui restaient, même en leur nouvel état de membres du PS genevois (et donc du PS suisse !) soumis aux décisions de la " centrale " (et du Comintern). Jean Vincent, tout membre qu’il était devenu du PSG et de son groupe parlementaire cantonal, restait ainsi membre du Comité central du PCS…
Le PSS était mis devant le fait accompli. Il ne se résolvait pas encore à la rupture totale avec le parti genevois et avec la gauche socialiste. Il publia donc le 18 septembre 1938 de strictes directives concernant l’adhésion des " anciens communistes " (qui, à Genève, étaient encore des communistes " tout court ") : chaque candidat à l’adhésion (celle-ci devant être individuelle, mais elle fut collective à Genève) devait s’engager à respecter les statuts et les décisions du PSS ; aux dirigeants du PC était imposée une période " probatoire " avant que leur adhésion pût être acceptée, et le parti suisse s’arrogeait le droit de décider en dernier ressort. Mais là encore, la réaction du parti suisse tombe trop tard ; l’entrée des communistes genevois dans le PSG est à la fois la manifestation ultime de la ligne de " Front Populaire " imposée par Nicole et le prélude à la recomposition de la gauche socialiste toute entière.