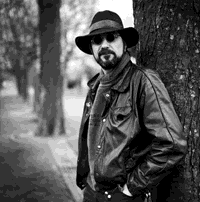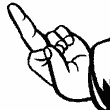

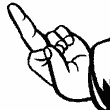

La « guerre du
renseignement »

S’il est un terrain sur lequel pendant la guerre la Suisse a pu jouer un rôle important (moins déterminant, toutefois, qu’elle fit mine de le croire après coup), c’est sans doute celui de la « guerre du renseignement ». La neutralité, ou plutôt la neutralisation, de la Suisse entre 1939 et 1945 la transforma en un véritable « nid d’espions », en un centre d’activités souterraines allant de l’espionnage à la résistance au nazisme, les deux activités trouvant d’ailleurs moult connivences : dans l’une et l’autre de nombreux Suisses furent actifs, dont une bonne part de socialistes, de communistes, d’anarchistes, de syndicalistes sans affiliation politique. Guisan lui-même, ni les services de renseignement de l’armée, dirigés par le très réactionnaire colonel Masson, ne l’ignoraient pas, qui fermaient plus souvent qu’à leur droit les yeux sur les activités de ces « soldats de l’ombre » dont indirectement le travail leur profitait : Si l’attitude du Général et du Service de renseignement fut empreinte de prudence et d’ambiguïté, c’est bien que des réseaux dirigés par des Suisses (Hans Hausamann, par exemple) ou des étrangers résidant en Suisse (Rudolf Roessler, par exemple) faisaient un travail, à la frontière de l’officieux et du clandestin, que le modeste appareil officiel de renseignement n’aurait pu assumer.
Guisan entretenait d’excellentes relations avec l’Ambassadeur britannique à Berne, David Kelly, et les Anglais trouvèrent bon et utile de profiter de la situation particulière (et privilégiée) de la Suisse pour y développer intensément leurs activités de renseignement (les Soviétiques en firent d’ailleurs autant, mais avec plus de difficultés et plus de risques, compte tenu des relations détestables que la Suisse entretenait avec l’URSS) ; par contre, les Britanniques s’intéressaient fort peu à l’aspect « politique » (antifasciste, antinazi) de la « guerre de l’ombre » qui, au contraire, mobilisait la gauche helvétique et auquel étaient consacrés une grande partie des efforts du Büro Ha de Hans Hausamann. A l’insu (semble-t-il) des gouvernements suisse et alliés, des initiatives furent prises dans ce domaine, initiatives que, lorsqu’il en avait connaissance (du fait de Hausamann lui-même), Guisan réprouva parfois, mais n’entra guère. La police fédérale, par contre, fut constamment sur la brèche : les militants ouvriers et les militants chrétiens antifascistes furent surveillés, parfois arrêtés pour ce type d’activités, du moins jusqu’en 1943 (là aussi, les défaites allemandes desserrèrent l’étreinte, opportunisme oblige). Il s’agissait non seulement de propager un « esprit de résistance » en Suisse, et de lui donner une coloration un peu plus progressiste que celui, franchement conservateur, voire réactionnaire, à la propagation duquel était vouée la division « Armée & Foyers », mais aussi de soutenir les mouvements de résistance européens, principalement dans les pays voisins (en France et en Italie, mais aussi en Allemagne même) et d’aider les victimes du nazisme et du fascisme à trouver un asile au moins temporaire en Suisse. Des centaines de militants suisses firent ainsi œuvre de solidarité clandestine en aidant des prisonniers de guerre évadés, des soldats déserteurs, des juifs persécutés (on oubliait les Tziganes, dont les « cousins » suisses, les Yenischs, étaient eux aussi victimes de mesures de persécution en Suisse même) et des résistants en fuite, ou devant se rendre hors du pays occupé pour organiser la résistance, à franchir la frontière suisse.
Les contacts établis, les amitiés nouées en ces occasions furent d’une indéniable utilité, non seulement dans le cadre de la lutte antifasciste, mais aussi dans celui de la guerre de renseignement (et parfois dans les luttes d’après-guerre, notamment le combat solidaire avec les mouvements de libération nationale, par exemple le mouvement algérien). La solidarité humanitaire, par l’action constante de centaines de « résistants suisses », fut également l’un des moyens de la lutte contre le nazisme, parfois à l’insu même des organisations de « bienfaisance » impliquées. A tout le moins, cette solidarité tisse des réseaux qui peuvent servir non seulement à faire passer la frontière à des fuyards, mais aussi à faire circuler des informations –et non seulement à faire rentrer des réfugiés en Suisse, mais aussi à faire rentrer des résistants en France ou en Italie. Jon Kimche constate (le constat est d’évidence) la très forte implication des socialistes dans ce combat :
ü A une période où les Britanniques restaient seuls et où la victoire alliée semblait de plus en plus problématique, des leaders suisses du Parti socialiste, tels que Hans Oprecht, Kägi et sa femme, Stocker et beaucoup d’autres, affirmèrent publiquement leur foi en la cause démocratique, ce qui, étant donné la position qu’ils occupaient, était faire preuve d’une grande conscience et de beaucoup de courage. Cependant, les représentants alliés qui étaient alors en Suisse s’en aperçurent à peine et n’y attachèrent que peu d’importance.
Jon Kimche, Un général suisse contre Hitler, Fayard, Paris, 1961
Cette ignorance des « représentants alliés » (en 1940, lesdits « Alliés » se réduisaient en fait aux seuls Britanniques, et aux forces marginales –polonaises, norvégiennes, belges, hollandaises, françaises- qui les avaient rejoints après la défaite et l’occupation de leurs pays) s’explique par le fait que les socialistes, contrairement à eux, étaient moins « anti-allemands » qu’antinazis ; la défense nationale était certes devenue pour la gauche réformiste l’instrument de la lutte contre la « bête immonde », mais elle était une fin en soi pour les forces de la droite démocratique et pour les Britanniques, engagés dans une lutte contre l’Allemagne (et l’Italie), plus que contre le nazisme (et le fascisme). Une lutte contre une Allemagne où l’opposition à Hitler était fragile, sporadique, hésitante, et se refusait à toute collaboration avec les Etats ennemis du IIIe Reich.
« Objectivement », l’antinazisme de la gauche rejoignait donc la défense de l’indépendance nationale ; Guisan lui-même en prit conscience, quelque prévention qu’il eût contre les socialistes, et semble avoir fini par admettre que la défaite et la chute du nazisme étaient le seul moyen de sauvegarder l’indépendance et la sécurité de la Suisse, à quoi il était voué par fonction et par conviction personnelle. Il était illusoire d’attendre de l’opposition allemande à Hitler, qu’il s’agisse de l’opposition militaire (« prussienne » et conservatrice), de l’opposition social-démocrate ou communiste, ou de l’opposition chrétienne, qu’elle se manifestât avec efficacité tant que l’évidence de la défaite allemande ne se serait pas faite. Dans l’intérêt de la Suisse, y compris de la Suisse bourgeoise, il fallait donc contribuer à cette défaite. La Suisse avait peu de moyens pour cela, mais elle en avait tout de même quelques uns, du fait de sa « neutralisation » par l’Axe. C’est à cette tâche –hâter la défaite allemande que se consacrèrent les « résistants » helvétiques et les réseaux mis sur pieds en Suisse, notamment par Hans Hausamann, par les Britanniques, par les gaullistes et par les Soviétiques.
Pour Hausamann, il fallait que fût vaincue l’Allemagne nazie pour que survive la Suisse ; les Britanniques tenaient le même raisonnement pour leur propre cause, et les gaullistes pour la leur. Pour les socialistes, il fallait que le nazisme et le fascisme fussent défaits pour que survive la démocratie –et Suisse et partout ailleurs. Pour les communistes, enfin, dès l’entrée en guerre de l’URSS (mais avant, déjà, pour les plus lucides d’entre eux, dont les trotskistes), le combat antifasciste engagé dès 1922 contre Mussolini, 1933 contre Hitler et 1936 contre Franco, se poursuivait –et ils avaient pris en peu de temps l’habitude de la clandestinité à laquelle ils avaient été théoriquement préparés, à laquelle ils avaient été contraints par les interdictions dont ils faisaient l’objet, et à laquelle les structures même de leur parti fournissaient des moyens d’action dont les sociaux-démocrates eussent été singulièrement dépourvus. Pour tous, en somme, l’ennemi était le même, quoique pour des raisons différentes. Ainsi se constitua une alliance dont les protagonistes ne craignaient guère, au contraire du Conseil fédéral, que le IIIe Reich intervînt militairement contre la Suisse pour la punir des activités antinazies qu’elle abritait malgré elle, et songeaient moins encore à la préserver d’une éventuelle intervention alliée –que quelques uns souhaitaient même. Or, dès 1941, l’évidence s’était faite jour que l’Allemagne ne pouvait être vaincue qu’en Russie –ou, pour mieux dire, qu’elle ne pourrait être vaincue si elle était victorieuse en Russie. Il fallait en tous cas qu’elle soit défaite à l’Est, quoi que l’on pensât du régime soviétique. On sait les préventions nourries par la Suisse officielle (Guisan compris) à l’encontre de l’URSS, préventions d’ailleurs réciproques dès l’ « affaire Conradi » et les vertueuses philippiques de Motta contre l’admission du régime bolchevik à la SdN. Les réseaux de renseignement soviétique en Suisse, qu’ils fussent effectivement soviétiques ou « indigènes » et pris en charge par des militants communistes (ou « nicolistes ») suisses (souvent en dépit des instructions reçues du « centre » moscovite et de la plus élémentaire prudence) furent constamment réprimés par les services fédéraux et cantonaux, civils et militaires, jusqu’en 1944 (avec une inflexion vers de plus en plus de laxisme au fur et à mesure de la retraite allemande). Guisan, dont le moins que l’on sache est qu’il était assez solidement anticommuniste et antisoviétique, savait pertinemment que certains de ces réseaux travaillaient au su de Hausamann (avec qui Guisan travaillait), et parfois en collaboration avec ses réseaux (échanges d’informations, division du travail, collaborateurs communs).
La guerre du renseignement en Suisse illustre ainsi la connivence établie entre la droite patriotique et la gauche réformiste suisses : non seulement les forces dominantes du mouvement ouvrier suisse s’engagèrent aux côtés de « bourgeois » aussi peu progressistes que Guisan ou Minger, mais ceux-ci finirent par rompre avec l’interprétation conformiste donnée généralement de la neutralité suisse dans leurs milieux –interprétation dont ils étaient pourtant de fervents partisans lorsque Motta s’en faisait l’inlassable héraut. Cette interprétation avait poussé les gouvernants d’avant-guerre à rejeter tout ce qui pouvait avoir une ressemblance quelconque avec un réseau de renseignement ; dans les faits et la pratique, elle fut rendue caduque par le soutien accordé par Guisan à Hausamann. Celui-ci avait jeté les bases de son « bureau » bien avant la guerre, avait noué des contacts en Allemagne même, les avait développés en Autriche, en Scandinavie, en Finlande, et relayés en France et en Italie. Parallèlement à la mise en place de ce véritable réseau de renseignement, Hausamann, qui avait été choisi par le PSS comme expert en matière de défense nationale, soutenait activement les activités tendant à insuffler l’ « esprit de résistance » au sein de la population civile. Dans le développement de ces deux activités (le renseignement et l’agit-prop), le patriotisme des uns ne pouvait que rencontrer, circonstances historiques obligent, l’antinazisme et l’antifascisme des autres. Hausamann n’avait pas été long à s’apercevoir que les plus fervents partisans de la résistance aux menaces allemandes ne se recrutaient pas au sein de la droite bourgeoise, mais au sein de la gauche. Quant aux socialistes, ils s’aperçurent qu’après tout, certains « patriotes » n’étaient pas moins antinazis qu’eux-mêmes, si ce choix avait d’autres raisons.
La guerre survenant, et Hausamann ayant constitué son réseau (le Büro Ha), celui-ci s’engagea dans la surveillance des diplomates, fonctionnaires et ressortissants notables des Etats de l’Axe, puis, progressivement, de tous ceux qui, en Suisse, pouvaient être suspectés de servir l’Allemagne ou de vouloir en hâter la victoire. Quant à l’espionnage proprement dit, le Büro Ha réussit à obtenir des informations du QG de la Wehrmacht , puis de l’entourage immédiat de Hitler. Ces informations profitèrent, directement ou non, au Service de renseignement suisse, en même temps d’ailleurs qu’aux Soviétiques. La « Ligne Roessler », réseau soviétique en Suisse, était en effet sur bien des points connexe, et parfois connectée, au Büro Ha : constituée d’émigrés allemands, de réfugiés antifascistes et de militants socialistes et communistes suisses (ces derniers agissant contre les consignes de Moscou, lesquelles excluaient l’activité de militants communistes dans les réseaux de renseignement), la « Ligne Roessler » (le « réseau Rado ») était à la fois réseau de renseignement et réseau de soutien à l’opposition allemande ; comme réseau de renseignement, elle fit profiter Hausamann des fruits de son travail, et comme réseau de soutien, elle semble avoir eu quelques contacts avec les services spéciaux américains.
Services spéciaux et organes de propagande allemands n’étaient pas, tant s’en faut, absents du terrain de la « guerre souterraine », et « travaillaient » la Suisse, relayée et renforcés par les porte-parole et les militants fascistes (italiens et tessinois) et pétainistes (français et romands), chacun dans sa langue et sa zone culturelle. Les partisans de l’Allemagne nazie (ou de ses vassaux) diffusaient sa « bonne parole » et s’activaient à recueillir des renseignements de toutes natures sur la Suisse et, en Suisse, sur leurs adversaires alliés. Les Allemands, en particulier, plaçaient des agents, faisaient pression sur le Conseil fédéral, évaluaient la réalité de la volonté helvétique de résistance, ses failles et ses lacunes. L’ennemi apparaissait ainsi aux militants socialistes et syndicalistes d’une part, aux « patriotes » conservateurs (ou même réactionnaires) d’autre part, sous la double figure de l’adversaire étranger et du « traître » indigène. Cette situation ne sera pas sans conséquences, la guerre terminée, sur la définition de la neutralité –une nouvelle définition, une nouvelle conception de la neutralité. A la fin de la guerre, Guisan exprimera le version « bourgeoise » de cette redéfinition de la neutralité, à partir de son expérience des années précédentes (ou plutôt de ce qu’il voulait qu’il en soit perçu) et de sa lecture des événements : le neutralité n’est pas « une mission dévolue aux Suisses par la Providence ni un principe qu’ils sont chargés d’enseigner au monde » (Jon Kimche, op.cit. ) mais une forme de politique extérieure déterminée par la situation internationale, et par conséquent adaptable à celle-ci. Quant à la gauche, elle en viendra progressivement à proposer de substituer à la neutralité le non alignement « modèle Bandoeng » (l’indépendance et l’équidistance à l’égard des deux blocs issus de la Guerre Mondiale). Comme elle-même devait s’en douter, ce modèle ne sera jamais adopté par la Suisse, lors même que sa politique extérieure fut assumée de 1965 à 1993, sans interruption, par des ministres socialistes (successivement : Willy Spühler, Pierre Graber, Pierre Aubert, René Felber). La Suisse continua à se référer à une « neutralité » qui, en réalité, ne fut jamais si efficace que lorsqu’elle fut pour le moins relative, et dépassée. Guisan lui-même se rendit « coupable » de ce dépassement et de cet irrespect, jouant en coulisses la carte de la « conciliation » avec les vainqueurs potentiels (Français en 1939, Allemands en 1940, Alliés dès 1942), couvrant les activités de Hausamann, et revenant sur ses préventions politiques anti-socialistes. Ainsi, la « neutralité » suisse consista à se ranger systématiquement du côté du plus fort ; les rapports avec l’Union Soviétique en sont un exemple flagrant. Etat faible, isolé, menacé puis envahi, l’URSS n’était pas « reconnue » par la Suisse ; Etat fort, offensif, déferlant sur l’Europe orientale jusqu’à faire camper ses troupes à Berlin, l’URSS devenait « incontournable », et la « neutralité » commandait la reconnaissance, toute honte bue, d’un Etat dont on avait pendant trente ans nié la légitimité. C’était le même Etat, ni plus ni moins « honorable », dirigé par le même homme, à la tête du même parti –mais en 1945, il était triomphant.