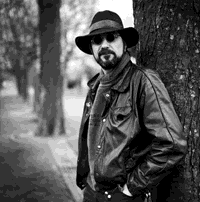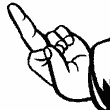

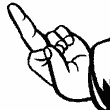

Genève, 9 novembre 1932
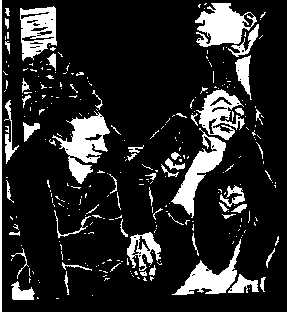
Genève, 9 novembre 1932 : l’armée tire sur une manifestation antifasciste et fait 13 morts et 65 blessés.
Un "
centre " introuvableUne gauche
modérée dépassée par les événementsAu départ, rien d’une
émeute, tout d’une échauffouréeLa
grève générale du 12 novembre : un jour d’hommage plus que de colèreLendemains du 9 novembre : arrestation de Léon
Nicole, protestations de gaucheCharles Rosselet : les
syndicats font l’impossible pour " calmer le jeu "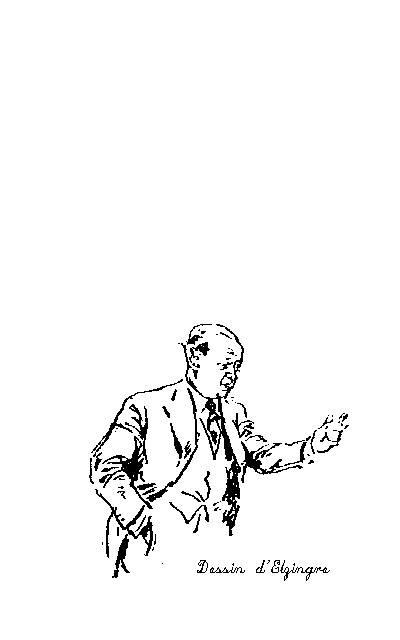
Le 9 novembre 1932, l’armée fédérale, appelée en renfort par un gouvernement genevois saisi de panique, tire sur une foule (houleuse, mais non dangereuse) de manifestants appelés par la gauche -toute la gauche- à protester contre -et si possible à empêcher- une parodie de " jugement " montée par l’extrême-droite locale contre les chefs du Parti socialiste, Léon Nicole et Jacques Dicker. Genève est ici plus exemplaire qu’exceptionnelle du climat des années trente. Sans doute les affrontements politiques y prirent-ils plus souvent qu’ailleurs en Suisse un ton paroxystique, mais la toile de fond de la crise politique et de son moment culminant de l’automne 1932 n’est pas peinte de couleurs différentes que dans le reste du pays : chômage, crise économique, scandales financiers, montée du fascisme, réduction stalinienne des espoirs révolutionnaires, forment l’ " ambiance " qui va provoquer les " événements " du 9 novembre 1932. Ces événements eux-mêmes vont révéler au pays les dangers encourus, révéler aussi à l’étranger la gravité de la situation en Suisse même ; s’ils restèrent exceptionnels, et n’ouvrirent ni processus révolutionnaire, ni écrasement " fasciste " du mouvement ouvrier, ils durent réellement vécus par leurs acteurs comme une tragédie -ce qu’ils étaient, avec ce que le genre présuppose de méprise fondatrice du drame : ici, la méprise d’un gouvernement prenant une manifestation antifasciste pour le prodrome de la révolution.
13 morts (manifestants antifascistes et passants, mais aucun soldat, ni aucun fasciste), 65 blessés : au soir du 9 novembre 1932, à Genève, le débat politique pèse de son poids de victimes. Et de craintes : on a, à droite, cru arrivé le soir du Grand Soir :
Pierre Aragno, Les journées du 9 novembre 1932 à Genève, Imprimerie Coopérative, La Chaux de Fonds, 1932, p. 3
L’événement ne tombe pas du ciel : y préparent non seulement le contexte général, européen, de la crise et du grand affrontement de la gauche et du fascisme (des gauches et des fascismes…), mais aussi, plus spécifique, le " climat " genevois. Le même témoin syndical (et membre de l’aile droite du syndicalisme suisse) pose le décor :
Pierre Aragno, op.cit. pp 4-5
Peu sympathisant (et c’est un euphémisme) de Léon Nicole, Aragno ne résiste guère à l’envie de rendre le leader socialiste genevois quelque peu responsable de la catastrophe ; non pas seul responsable, comme le voudront voir et croire les chefs de la droite bourgeoise, mais co-responsable : " c’est le choc d’une idée ou deux, de deux ou trois chefs -ils n’en ont pas beaucoup, d’idées- qui est à l’origine des journées du 9 au 12 décembre " (Aragno, op.cit. p. 5)…
Le 9 novembre 1932, les murs de Genève se sont couverts d’une affiche qui fait sensation : l’Union Nationale (le parti fasciste local) convoque pour le soir même une réunion de " mise en accusation publique des Sieurs Nicole et Dicker ". Les " juges " de cet étrange tribunal se nomment Steinmetz, Testuz, Droin et Oltramare : l’Union Nationale s’érige en juge de ses adversaires politiques. Commentaire de Pierre Aragno :
Pierre Aragno, op.cit. p. 6
Erreur de perspective : Le " centre ", à Genève, en cette fin de 1932 ? Improbable, introuvable. L’ " arc " politique s’est si fort tendu qu’il semble prêt de se rompre, et les forces politiques qu’Aragno renvoie dans deux extrémismes comparables, l’extrême-droite fasciste d’Oltramare et la gauche stalinienne de Nicole, ont pris tant d’importance (politique pour les deux, électorale, en sus, pour le PS de Nicole, premier parti du canton) que tout ce qui se trouve " entre-deux " est poussé vers l’un ou l’autre : la droite démocratique est manipulée par l’extrême-droite (c’est un Conseiller d’Etat " libéral ", Frédéric Martin, qui appelle l’armée pour briser la manifestation antifasciste), et la gauche réformiste est subjuguée par la gauche " révolutionnariste ". A gauche, le Parti socialiste, dominé par la personnalité et le discours de Léon Nicole, et les conceptions politiques de Jacques Dicker, partisans de l’unité d’action (voire d’organisation) avec les communistes, et aussi prosoviétiques qu’eux, dénonce inlassablement les scandales financiers et les compromissions bourgeoises, accumulant les procès (perdus) et les manifestations publiques (massives), étendant son influence et revendiquant le pouvoir. A droite, les forces " bourgeoises " sont constamment menacées d’être débordées par les fascistes de l’Union Nationale de Georges Oltramare. Ebranlées par la montée du Parti socialiste, la droite tente par tous les moyens, y compris l’alliance avec l’extrême-droite, de freiner cette montée. Les conservateurs catholiques ont basculé dans la référence au corporatisme et les radicaux sont (déjà…) écartelée entre une aile droite à la fois compromise dans les scandales financiers et liée à la droite libérale, et une aile gauche que seuls la rhétorique révolutionnariste et le fidéisme stalinien de Nicole retiennent de rejoindre le PS dans un " Front populaire " (ou un " cartel des gauches ") " à la française.
L’aile modérée du PS et des syndicats (eux-mêmes confrontés à l’activisme d’une aile révolutionnaire, anarcho-syndicaliste celle-là, incarnée par Lucien Tronchet) semble totalement dépassée par la montée de l’orage, dont elle craint qu’il remette en cause les droits sociaux et les libertés politiques sur quoi se fondent désormais les stratégies du Parti socialiste et de l’Union syndicale (malgré quelques équivoques, qui seront levées entre 1935 et 1937). Aragno :
Pierre Aragno, op.cit. p. 6
Les syndicats, d’ailleurs, ne sont pas moins que le parti traversés de division (si ce ne sont pas les mêmes). Si un Charles Rosselet se trouve effectivement sur la ligne dominante du syndicalisme suisse, réformiste, gradualiste, " conventionnel ", un Lucien Tronchet maintient vivaces les traditions et les pratiques libertaires d’action directe, de grève et de recours à l’interdit (c’est-à-dire au boycott des patrons récalcitrants) -bref, d’opposition frontale et parfois violente au patronat et à l’Etat.
Or donc, l’extrême-droite entend juger elle-même les chefs socialistes. Le Parti socialiste demande au Conseil d’Etat d’interdire la conférence fasciste, compte tenu du caractère de " tribunal d’exception " que ses organisateurs lui donnent ; le gouvernement a beau jeu de se poser en défenseur des libertés d’expression et de réunion face à une gauche qui ne cesse de les invoquer lorsqu’elle-même est victime d’interdictions de ses manifestations. Le quotidien socialiste (nicoliste, nicoléen et nicolologue) Le Travail annonce une contre-manifestation sur les lieux mêmes du " jugement " fasciste. Le Conseil d’Etat s’affole -inutilement : le fait même que la contre-manifestation soit claironnée à tous vents par ses organisateurs en démontre déjà clairement le caractère " non-insurrectionnel ". Le gouvernement cantonal fait placer des chaînes aux points stratégiques, fait appel à la troupe et la fait défiler en plainte ville, à des fins d’intimidation (non atteintes). Au soir de la " mise en accusation publique des Sieurs Nicole et Dicker ", la Salle communale de Plainpalais est solidement gardée par des cordons de gendarmerie. On ne peut entrer dans la salle qu’avec une certes de l’Union Nationale ou une invitation, ce qui ne laisse pas d’attiser encore la colère -calme- de la foule des contre-manifestants.
Quelques contre-manifestants de gauche réussirent à entrer dans la salle. Ils ne purent guère y porter longtemps la contradiction aux orateurs (dont un Conseiller d’Etat, Turettini), et leur " sortie " de ce " tribunal " rendit la foule des antifascistes plus houleuse. Un barrage policier est rompu, un autre houspillé. Confondant échauffourée et insurrection, le Conseiller d’Etat Frédéric Martin croit venu le moment de l’affrontement et requiert du colonel Lederrey l’intervention de la troupe pour renforcer un service d’ordre policier -qui n’en avait guère besoin, et surtout pas de la part de l’armée, et qui dans l’ensemble gardait le contrôle de la situation. On fit donc appel à de " pauvres gens de l’école de recrues " parce que l’on avait " surestimé les rodomontades toutes inoffensives de manifestants " (Aragno, op.cit. pp 17, 18). Pour pouvoir se frayer un chemin au milieu d’une foule hostile, les recrues durent y serpenter en file indienne, fusil à l’épaule. Quelques soldats sont désarmés par des manifestants, d’autres verbalement pris à partie, quelques fusils sont rompus, quelques casques arrachés, puis défoncés. Rien d’une émeute, tout d’une échauffourée. Impréparés à une telle situation, les officiers croient nécessaire de faire usage de la force et du feu pour dégager de la foule les soldats qui n’y risquaient que de symboliques égratignures et quelques blessures d’amour-propre. Les sommations sont faites dans un brouhaha tel que personne ne les entend lorsqu’elles sont criées, et que personne ne les comprend lorsqu’elles sont claironnées. Et c’est ensuite la fusillade : treize personnes sont tuées et soixante-cinq blessées dans une foule où manifestants et curieux se mêlent, et où les seconds paieront un lourd tribut à leur curiosité. Il n’y a de morts que dans les rangs des manifestants et dans la foule des curieux.
Les morts du 9 novembre sont-ils morts d’un malentendu ? Les témoins " objectifs " l’affirment : des sommations faites au clairon face à une foule qui ignore le langage des sonneries militaires ; la crainte d’une émeute insurrectionnelle quand on n’avait affaire qu’à un mouvement de colère ; le maintien de l’ordre confié à des recrues inexpérimentées quand la police suffisait à cette tâche… L’armée a tiré dans la foule, dans le dos de la foule, alors que celle-ci refluait, et le pouvoir a fait ainsi des victimes qui, l’ " ambiance politique " du moment aidant, ne tardèrent pas à devenir des martyrs. Ainsi du communiste Fürst, un " mystique du communisme intégral " pour Pierre Aragno, qui poursuit le portrait : " Au demeurant, l’homme le plus doux et le plus tranquille qui soit " et en tire morale : " ce sont de ces doux-là qui se font toujours casser la tête quand ça chauffe. Les rodomonts de la politicaille, eux, f…… le camp et se dégonflent " (Aragno, op.cit. p. 20). Aragno trouve une preuve de la " placidité " de la foule dans la liste des morts " innocents " (y en eut-il de coupables ?) : un maître boulanger, membre du Conseil de sa paroisse ; un batelier ; le père du recrue voulant voir son fils " dans cette même Cp1 d’où partit le feu, et qui tira lui-même " (op.cit.), un instituteur campagnard passant par là, un employé de l’Armée du Salut, en employé de la banque De la Harpe… Ce n’étaient pas là les émeutiers anarchistes et bolcheviks que la droite et l‘extrême-droite crurent ou prétendirent voir. Sitôt le drame consommé, la police reprend les rênes imprudemment remis à l’armée, et l’ " ordre " revient -un ordre à le mesure, tout de même, de ce qui vient de se produire. Le leader communiste Lebet peut ainsi, sans être inquiété, parler pendant plus d’une heure en divers rassemblements improvisés dans la ville, et protester (en des termes relativement modérés, pour cet orateur) contre l’assassinat perpétré par panique, puis demander que la foule se découvrît en l’honneur des morts. Aragno commente : " la police genevoise eût été suffisante, amplement, pour tenir tête à l’échauffourée " (op. cit. p. 22) et relève l’erreur commise d’appeler des recrues pour mater une manifestation qu’eût parfaitement pu contenir la maréchaussée cantonale. Le colonel Lederrey reconnaît d’ailleurs lui-même, implicitement, cette erreur dans son premier rapport au Département militaire fédéral : " Je crois tout de même que des recrues, même bien formées, ne sont pas aptes à une tâche de ce genre, les cadres sont généralement trop jeunes et trop inexpérimentés " (cité par Pierre Aragno, op.cit. p. 23).
La fusillade de Genève, ses treize morts, sa septantaine de blessés, provoqua " la stupeur et une vive émotion dans la Suisse ouvrière et même au delà de nos frontières ". écrit Pierre Jeanneret (Histoire du Parti socialiste vaudois 1890-1950, PSV, Lausanne, 1982, p. 16), qui ajoute cependant que " l’indignation reste sans lendemain, si l’on fait exception de ses importantes conséquences électorales. En rien, en tous cas, elle n’ouvrit un processus révolutionnaire " (op.cit.). L’on peut cependant considérer que l’épisode eut pour conséquence de raffermir à Genève un antimilitarisme latent, faisant de la République l’une des " bases " (avec le Jura) de l’opposition à l’armée : le souvenir du 9 novembre 1932 fut ainsi largement utilisé à chaque occasion fournie par le calendrier référendaire de " voter contre l’armée " (et d’accepter, à Genève -et dans le Jura- l’idée de son abolition).
Sans plus de conclusion révolutionnaire qu’ils n’en avaient eu d’intentions, les " événements " ne furent pas sans susciter de vigoureuses réactions, à Genève bien sûr (où ils amplifièrent la victoire des socialistes lors des élections cantonales de 1933, où ils obtinrent une majorité au gouvernement -sans majorité au parlement), mais aussi dans le reste de la Suisse, quoique fut évidente, et couronnée de succès, la volonté des directions du PSS et de l’USS de " calmer le jeu ", de maîtriser une riposte modérée, et de tout faire notamment pour éviter le déclenchement d’une grève générale de protestation qui eût pu avoir des conséquences pires que celle de 1918. A Genève, toutefois, la grève générale fut proclamée, mais sous l’espèce d’un jour de deuil plutôt que de colère. Le 10 novembre, le comité de l’Union des Syndicats du canton, puis les présidents des différents syndicats affiliés à l’USS, débattent de la réaction ouvrière à la fusillade. Les présidents des syndicats repoussent à une forte majorité la proposition de grève générale, après que le Comité central élargi du Parti socialiste genevois en ait fait autant. " Sonné " par ses morts, le mouvement ouvrier genevois cherche ses marques. Le même soir, le comité de l’Union syndicale suisse, puis le lendemain la Commission syndicale suisse, réunis à Lucerne, déconseillent vivement à leurs camarades genevois la proclamation d’une grève générale qui pourrait, craignent-ils (à tort) devenir incontrôlable. Le 11 novembre, pourtant, l’Assemblée des délégués de l’Union des syndicats du canton de Genève prend précisément la décision redoutée de proclamer la grève générale -mais une grève générale contrôlée, et limitée. La gauche du mouvement semble avoir réussi à imposer sa proposition de riposte, mais la grève décrétée par les 225 délégués de l’USCG (par 85 voix contre 58 et 60 abstentions) n’a rien d’une grève insurrectionnelle : il s’agit d’honorer les morts, de prendre date, de " marquer le coup ", d’exprimer un refus calme de l’engrenage répressif autant que de manifester l’opposition de la gauche politique et syndicale au fascisme coupable d’avoir provoqué le drame et aux autorités cantonales coupables d’avoir cédé à la panique. Le grève fut ainsi prudemment proclamée pour le samedi, jour fréquemment à moitié férié, et ne fut générale qu’en intentions, puisque les journaux parurent et que le fonctionnement des services publics essentiels fut assuré.
Au soir du samedi 12 novembre, la grève prenait officiellement fin sans que le moindre affrontement ait été signalé, malgré le caractère dramatique des événements qui l’avaient provoquée, et que les obsèques des victimes de la fusillade mirent en pleine lumière. " Tout est maintenant calme à Genève ", relève avec satisfaction Aragno (op.cit. p. 26), qui constate que " ce calme, ce n’est pas l’armée qui l’a apporté. C’est l’ensemble des citoyens, conscients de la valeur de la liberté ", manière de dire que les directions syndicales et politiques de la gauche sont parfaitement capable de contrôler les ouvriers sans que la bourgeoisie ne s’en mêle. Si la manifestation antifasciste du 9 novembre n’avait eu aucun caractère insurrectionnel, l’hommage de la gauche aux victimes de la répression en fut tout autant dépourvu. L’aile droit du mouvement s’en réjouit hautement, non sans profiter de l’occurrence pour régler (à fleurets encore mouchetés) quelques comptes avec les dirigeants de l’aile gauche, à commencer par Léon Nicole. Aragno : " Les ouvriers ont compris l’erreur de se créer eux-mêmes trop souvent, par leurs réactions intempestives et mal dirigées, des mythes et des croque-mitaines : Fascisme, camelotisme, tant d’autres " (op.cit. p. 27).
Un mythe, le fascisme, en 1932 ? Le syndicaliste " modéré " pèche ici pour le moins par optimisme, si ce n’est pas cécité. A tout le moins, le fascisme est perçu comme une menace majeure par le mouvement ouvrier -tout le mouvement ouvrier, et pas seulement son aile gauche, une menace pour les droits et libertés conquis de haute lutte par le mouvement lui-même. Et ceux-là même qui affectent de mépriser ces droits et ces libertés, ou de les péjorer en les réduisant à des " hochets " offerts (pour la calmer) à la classe ouvrière par le capitalisme, ne tardent pas à reconnaître plus justement leur valeur. Le 9 novembre 1932, événement paroxystique de l’affrontement du fascisme et du socialisme en Suisse, aura ainsi un retentissement immédiat dans tout le pays -immédiat, et durable, en tous cas en Romandie.

Le 10 novembre, tandis qu’à Genève l’on arrête Léon Nicole et que des troupes (valaisannes…) occupent la ville, la gauche lausannoise se mobilise. Le Parti ouvrier socialiste lausannois (POSL, c’est-à-dire le PS local), le PC, l’Union Syndicale et la FOBB créent un comité de lutte et appellent, eux aussi, à une grève de protestation. Elle sera presque absolue dans la bâtiment. La question de la grève générale est posée. Les directions du PSS et de l’USS feront tout pour qu’il n’y soit pas répondu positivement, sachant que le gouvernement fédéral et les gouvernements cantonaux s’y préparent et que " les organes d’une éventuelle répression sur une grande échelle sont en place " (Pierre Jeanneret, Histoire du PSV, op.cit. p. 16). Contre les communistes et les socialistes de gauche qui, à Genève, Lausanne ou Zurich, tentent de provoquer la grève générale nationale, le PSS et l’USS jouent la carte de la " modération ", de la dignité affligée, et invitent au calme, à la " force disciplinée ", à la " maîtrise des nerfs " de la classe ouvrière. L’historiographie d’extrême-gauche fera de cette attitude la même analyse, quelque peu sommaire, que celle produire à propos de la grève de 1918 ; une analyse qui tient en un mot, un concept -moral : " trahison " ! Trahison de quoi ? De l’espérance révolutionnaire et de la volonté insurrectionnelle ? Les " masses " en étaient sans doute dépourvues, et les organisations plus encore -et de capacités révolutionnaires et insurrectionnelles plus encore que de volontés. On ne peut trahir que ce à quoi l’on a fait allégeance : en 1932, la classe ouvrière suisse (ni même la classe ouvrière en Suisse, immigrés compris) n’est pas révolutionnaire, si les discours de quelques uns de ses chefs peuvent l’être.
En réalité, les choix fondamentaux qui conduisent sûrement les directions socialistes et syndicales à l’intégration dans une " démocratie suisse " menacée par les fascismes, ont déjà été faits et excluent toute riposte " radicale " aux bourdes du gouvernement genevois et des militaires appelés à son secours. Au surplus, la ligne de gauche suivie par le PSG a suscité assez de réticences, puis de condamnations, de la part du parti suisse pour que celui-ci ne résiste pas à la tentation de donner aux chefs socialistes genevois une " leçon " aussi fraternelle qu’implicite : " voyez où vous conduisent vos erreurs "… La fusillade genevoise put ainsi être officiellement considérée comme un " accident " local, dramatique mais isolé. La vision " gauchiste " d’une " trahison " des directions social-démocrates tient sans doute à l’espérance d’une situation rendue insurrectionnelle par la répression militaire d’une manifestation antifasciste. L’historiographie trotskiste en rend clairement compte :
Frédéric Gonseth, Novembre 1932 - L’armée au service du Capital, Cedips, Lausanne, 1972
Cependant, comme le relève Pierre Jeanneret, " les conditions objectives ne se prêtaient certainement pas à une entreprise révolutionnaire " (Pierre Jeanneret, Histoire du PSV, op.cit. p. 18). Le choc du 9 novembre 1932 n’en fut pas moins considérable, et l’émotion. Le 10 novembre, à Lausanne, le Président du PS local, Maurice Jeanneret-Minkine, prononce un discours vengeur où le drapeau suisse est qualifié de " panosse fédérale " et dont le ton est à l’unisson des réactions de la gauche socialiste, communiste, et syndicaliste-révolutionnaire.
L’année suivante, la gauche socialiste triomphera lors des élections municipales à Lausanne, et cantonales à Genève (mais sans toutefois y obtenir une majorité parlementaire, alors qu’elle obtiendra une majorité gouvernementale). Léon Nicole sortant de prison pour prendre rien moins que la présidence du Conseil d’Etat genevois et celle du Département de Justice et Police : belle revanche sur ceux qui, à l’intérieur même du PSG -et des syndicats- le rendaient politiquement responsable de la catastrophe du 9 novembre et crurent possible de le déloger du leadership socialiste genevois. Les analyses de l’événement fournies par l’une et l’autre aile du mouvement socialiste n’avaient, on s’en doute, guère de points communs. Le 16 novembre, Charles Rosselet, président de l’Union des syndicats du canton de Genève, et leader de l’aile " droite " du PSG, prononce un discours qualifié par son ami Pierre Aragno d’ " objectif et émouvant ", manière de dire qu’il exprimait ce que la " bureaucratie réformiste " (pour reprendre la langue de bois trotskiste) tenait pour la réalité de l’événement et des rôles qu’y jouèrent les différentes forces politiques locales (et nationales) :
Charles Rosselet, discours du 16 novembre 1932 au Grand Conseil genevois, cité par Pierre Aragno, op.cit. p. 27
Dans sa présentation des " événements " et du rôle qu’il joua pour éviter qu’ils ne " dégénèrent ", Rosselet, député socialiste, s’exprime au Parlement en tant que responsable syndical. C’est dire que le clivage passe à la fois entre les organisations (le parti et les syndicats) et à l’intérieur de chacune d’entre elle. La majorité dont disposent les " modérés " dans les syndicat répond à celle dont disposent les " durs " dans le parti, et les uns et les autres ont affaire à leurs minorités (social-démocrate dans le parti, syndicaliste-révolutionnaire dans le syndicat). Quant au PSS, sa direction doit compter avec la pugnacité et l’implantation locale et régionale d’une aile gauche plus forte que l’aile gauche des syndicats, en grande partie " purgée " des cartels cantonaux. Le PSS fera, qu’il l’ait choisi ou qu’il y ait été contraint par ses cadres militants, du 9 novembre genevois un exemple politique. La brochure éditée sous sa responsabilité " au bénéfice des victimes de Genève " (" La nuit sanglante de Genève "), largement diffusée dans toute la Romandie, adopte un ton résolument offensif et rend la bourgeoisie responsable du massacre. La bourgeoisie, et sa presse :
La nuit sanglante de Genève, Imprimerie Coopérative, La Chaux de Fonds, s.d. (1932 ?), p. 4
Plus " haut ", le PSS vise le Président de la Confédération, Giuseppe Motta, qui, s’il parle " abondamment de paix et de désarmement " à Genève (mais dans le cadre de la SdN), " s’est rangé sans hésitation du côté de la guerre civile et des mesures sans conscience prises par les officiers ", toujours à Genève, mais dans la rue. Et le PSS de renvoyer ces coupables du massacre devant leurs respectifs juges naturels : les tribunaux pour le colonel Lederrey, le " mépris de l’opinion publique " pour les journalistes Payot et Fabre, le " jugement du peuple " pour Motta (La nuit sanglante de Genève, op.cit. p. 4).
Le PSS, d’une plume qu’on croirait tenue par le PS genevois, décrit le contexte local de la crise : une ville devenue " forteresse de Mammon ", où prospèrent les " manœuvres d’argent " et où se succèdent les scandales ; le parti suisse rappelle au passage que le PS genevois, " dirigé par Léon Nicole, eut la rude tâche de découvrir cette corruption, de la dénoncer, de la poursuivre " (Ibid. p. 5), alors que la bourgeoisie demeurait passive, " voire même animée de bienveillance envers les fautifs ". Constatant la " forte poussée du parti socialiste de Genève " et " ses étonnantes avances ", sentant approcher le moment de l’arrivée d’une majorité socialiste, le PSS reconnaît -c’est bien le moins- l’existence de " divergences de tendances et de jugements à l’égard de la tactique du parti socialiste " (Ibid. p. 6) ; il s’agissait évidemment de bien plus : de divergences fondamentales… Bref, le PSS attribue à l’ " anxiété " de la bourgeoisie face aux progrès du socialisme dans la ville siège de la SdN, et à sa crainte de voir ce symbole du libéralisme devenir une " cité rouge ", les provocations dont les socialistes allaient être l’objet, et dont le drame du 9 novembre serait le fruit. Les socialistes suisses désignent le coupable : Giuseppe Motta, allié des fascistes (" les représentants de Mussolini, de Gomboës, de Titulesco) et les banquiers suisses, qu’ils accusent d’avoir chargé l’ancien Conseiller fédéral Jean-Marie Musy de " préparer la voie de la réaction agressive ". En clair : les responsables politiques cantonaux de la fusillade, à commencer par le Conseiller d’Etat Frédéric Martin, ne sont que " les marionnettes dont Musy et les grosses banques tirent les ficelles ".
C’est là, sous la signature officielle du PSS, le discours même de Léon Nicole -à quelques précautions oratoires près, dont le leader genevois n’était pas homme à s’encombrer. Pour se concilier la base " gauchiste " de Genève (et, au-delà, de Lausanne et d’une partie de la Romandie et des villes alémaniques), le PSS tient le langage et produit l’analyse de son aile gauche, comparant la fusillade genevoise au massacre colonial commis par les Anglais en Inde, à Amritsar, regrettant au passage que les responsables suisses et genevois du 9 novembre n’aient pas eu la décence de démissionner après les " événements ", à l’exemple du général anglais Dyer :
La nuit sanglante de Genève, op.cit pp 11, 12
Et de poursuivre, sur le même mode de la comparaison coloniale :
Ibid. p. 16
Sous le vocabulaire de l’époque, et sous les non-dits (on a fait pire, quoi qu’en dise le PSS, aux " nègres " et aux " coolies "…), la stupéfaction : ainsi, cela est possible, dans notre pays (et pas en Afrique…), aujourd’hui (et pas au Moyen-Age…), contre nos concitoyens (et pas contre les nègres ou des coolies…). ..
A la dénonciation de la barbarie bourgeoise va, logiquement, répondre l’éloge de la civilité ouvrière ;
Ibid. p. 19
Là, le PSS ne cède plus rien aux socialistes genevois, et cet éloge du sang-froid de la classe ouvrière tranche avec les multiples reprises du discours " nicoliste " dans la description des événements que fournit cette même brochure, conclue par un satisfecit réformiste. C’est qu’il faut ménager la chèvre de gauche et le chou de droite, ne pas (encore…) couper les ponts avec l’aile gauche du parti, maîtresse du parti genevois, ni blesser les certitudes de l’aile droite, vigoureusement opposée à toute riposte " excessive ". Ainsi le 9 novembre 1932 met à nu, au-delà de son aspect purement (et tragiquement) événementiel, les grandes contradictions qui traversent le mouvement socialiste et que symbolisent les rhétoriques et les conduites politiques respectives des directions socialistes genevoise et suisse. En 1918, Léon Nicole et Robert Grimm, respectivement responsable syndical local et leader du Comité d’Olten, se trouvaient du même côté de la ligne de partage au sein du mouvement ouvrier ; en 1932, cette ligne les sépare.