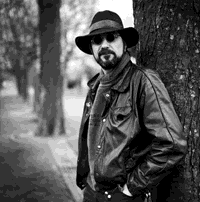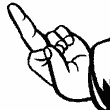

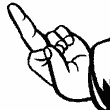

Antifascisme, solidarité ouvrière, défense nationale (1925-1945)
Un quart de siècle de désastres
Du modèle bolchevik à sa caricature fasciste
L’ " arc patriotique ", de Nicole à Guisan
Le triple défi des années trente pour la Suisse
1932 : le paroxysme de la crise économique et sociale
Le choc de la crise en Suisse
19 juillet 1937 : la " paix du travail "

Lorsque le fascisme prit le pouvoir en Italie, le mouvement ouvrier européen (et le mouvement ouvrier suisse comme les autres -au Tessin plus vite qu’ailleurs- dénonça à la fois les buts, les méthodes et les racines mêmes (parce qu’elles avaient " quelque chose de socialiste " ?) du nouveau régime romain. Pour autant, et perçut-il les prolongements possibles ? Comprit-il que Mussolini inaugurait un quart de siècle de désastres et que son avènement était le prélude à un massacre à l’échelle du monde ? Il faut bien répondre ici par la négative. Sans doute, socialistes, communistes, anarchistes et militants syndicaux ne furent-ils pas avares de dénonciations et s’engagèrent-ils très rapidement dans une politique de solidarité active avec les victimes du fascisme, mais il faudra que s’accumulent les alertes, les défaites et les ruptures pour que, à gauche, se fasse jour cette conviction que l’avènement des fascismes remet radicalement en cause les certitudes et les attitudes passées, y compris celles qui semblaient les plus évidentes et les plus profondément ancrées dans la conscience collective des militants et de leurs organisations. Le fascisme, il est vrai, prit la gauche à rebrousse-poil, et son succès même -son succès populaire surtout, si " théâtral " qu’il parût- ne laissa pas de la stupéfier, quand il ne l’ébranlait pas. Georges-Henri Pointet l’exprimera, à propos du nazisme (que nous nous garderons de confondre avec le fascisme, mais qui était à l’époque perçu comme une " variante ", germanique et extrémiste, du fascisme italien ; et Pointet ne fait pas mystère d’une certaine fascination :
cité par Jean Liniger, in Georges-Henri Pointet (...), op.cit.biblio, p. 30
Il y eut incompréhension de la nature même du fascisme : mouvement de masse disposant d’une réelle base sociale (la petite bourgeoisie, le sous-prolétariat, une partie même du prolétariat), exprimant par des moyens révolutionnaires (et une structure empruntée, en la caricaturant, au bolchevisme) un projet politique réactionnaire, le fascisme fut caricaturé par la quasi-totalité de ses adversaires de gauche comme une force sans racine sociale, totalement manipulée par le Grand Capital et étouffant les droits démocratiques parce que menacée par eux (alors qu’au contraire, il savait en faire usage). Au surplus, sitôt le nazisme apparu, confusion fut faite entre le mouvement italien et le mouvement allemand, confusion qui s’étendit ensuite à l’ensemble des mouvements autoritaires et antidémocratiques nés de la crise, qu’ils fussent civils ou militaires, populistes ou oligarchiques, catholiques ou antireligieux, monarchistes ou " pseudo-républicains ". Tous fascistes, donc, les adversaires de droite de la démocratie bourgeoise...
Ce qui rendit, paradoxalement, plus difficile la compréhension du phénomène fasciste par le mouvement socialiste est bien la parenté de l’un à l’autre -la parenté de la caricature fasciste à son modèle bolchevik. Le fascisme, de fait, est une caricature de socialisme, en même temps que, comme l’écrit Zeev Sternhell, une synthèse de nationalisme et de socialiste :
Zeev Sternhell, in Le Monde Dimanche, 11-12 mars 1984
Il faut toutefois constater que, même si sa prise de conscience du phénomène fasciste fut lente et difficile, le mouvement ouvrier s’opposa avant, bien avant, les organisations " bourgeoises " à le menace qu’il représentait. Si tardive que fut sa compréhension de ce qu’il signifiait réellement (une sorte " d’anticapitalisme des imbéciles "...), su réductrice (parce qu’économiciste) que fut l’explication qu’il donna de cet adversaire nouveau et de ses succès, le mouvement ouvrier comprit que le fascisme (puis le nazisme) était l’ " ennemi principal ", dès lors qu’il étendait son emprise et celle de sa symbolique dans toute l’Europe -et dans toutes les classes sociales, y compris, porteuse du virus mais pas forcément atteinte profondément par la maladie- la classe ouvrière. A nouveau, les immigrés -les réfugiés antifascistes, en l’occurrence- furent pour beaucoup dans cette prise de conscience de la réalité de la menace fasciste, et de la nécessité de la solidarité antifasciste. En témoignent ces militants anarcho-syndicalistes genevois, un demi-siècle plus tard, liant d’ailleurs stalinisme et fascisme dans la même condamnation :
La vie quotidienne et les luttes syndicales à Genève, 1920-1940, op.cit.biblio p. 154
Ce qu’apprirent et comprirent ces militants anarchistes de la réalité soviétique et de la réalité nazie, tous les militants ouvriers (socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes) l’apprirent et le comprirent de la réalité fasciste (italienne) bien avant que l’ " opinion publique " dans son ensemble, ou sa majorité, n’en perçoive quoi que ce soit. Il y eut certes, dans cette prise de conscience, la grande hémiplégie idéologique de la fidélité communiste (et des socialistes " nicolistes ") à l’Union Soviétique ; il y eut certes aussi quelques tentations d’ordre plus esthétique que politique à l’égard du " socialisme viril ", certes autoritaire, nationaliste et raciste, mais que l’on croyait déceler en le nazisme, mais dans l’ensemble, la gauche militante (non la gauche électorale) sut assez tôt en quoi le fascisme et le nazisme étaient une menace. Sans doute les militants étaient-ils, par leur statut même de militants, plus et mieux à même de recevoir et de comprendre l’information nécessaire ; il n’empêche que, très tôt (dès 1923) les organisations et les publications du mouvement ouvrier s’engagèrent dans la lutte contre le fascisme, alors que les complaisances et parfois les complicités actives furent la règle du côté " bourgeois ". Face au nazisme, le mouvement ouvrier dut faire des choix douloureux, et les faire dans la division, pour ensuite (mais trop tard) les concrétiser dans l’unité. Du moins fit-il ces choix, ce qui ne fut guère le cas des partis et des organisations " bourgeoises " qu’à partir du moment (1942-1943) où le sort des armes commença à tourner en défaveur des régimes de Rome et de Berlin. Relevant les responsabilités des " hommes au pouvoir " dans la montée du fascisme, Georges-Henri Pointet en dénoncera les complaisances en 1932, la même année où à Genève une manifestation antifasciste réprimée par l’armée semblera illustrer tragiquement une " alliance " de la droite libérale et de l’extrême-droite antidémocratique :
in Jean Liniger, Georges-Henri Pointet, op.cit. pp 59, 60
Il est vrai que le fascisme construisait aussi (surtout ?) son succès sur les faiblesses et parfois les scandales de la démocratie " bourgeoise ", les aggravant quand les chefs de cette démocratie semblaient eux-mêmes ne plus croire au système qu’ils personnifiaient. Et ce fut bien là toute la difficulté du choix des socialistes : défendre contre les menées de l’adversaire fasciste un système que les socialistes eux-mêmes avaient dénoncé pendant des années pour ce qu’il avait d’amputé, de mensonger et de vain ; mais si cette démocratie est incomplète, instable, corrompue même, elle vaut toujours mieux que l’absence de toute démocratie. Les communistes tarderont plus encore que les socialistes à choisir entre démocratie bourgeoise et fascisme(s), les assimilant l’une aux autres pendant plus d’une décennie (et en y assimilant la social-démocratie elle-même), et trouvant même parfois (rarement, il est vrai) quelques raisons ou quelques prétextes de ménager le " socialisme national " des fascistes, puis des nazis. On sait avec quelle surprenante facilité des milliers de membres du KPD le quittèrent pour s’approcher du NSDAP, passant du bolchevisme caricaturé par Staline au bolchevisme caricaturé par Hitler et Goebbels.
Or donc, entre 1930 et 1945, l’affrontement au fascisme et au nazisme poussa progressivement les organisations ouvrières à redéfinir leurs politiques étrangères, leurs conceptions de la solidarité et leurs réponses à la " question nationale " et à la " question militaire ", les communistes mettant plus de temps, et prenant un chemin plus tortueux que les socialistes et les syndicalistes majoritaires pour arriver là où leurs " frères séparés " avaient abouti : à la fusion empirique du patriotisme et de l’antifascisme. L’entrée en guerre de l’URSS aux côtés des " démocraties bourgeoises " (et de la Chine) provoquera l’entrée des communistes (et, " objectivement ", des exclus de la gauche socialiste, comme Léon Nicole) dans un vaste front antifasciste de fait. Les quinze années 1930-1945 sont déterminantes : elles marquent l’intégration du mouvement ouvrier, et qui plus est de toutes ses composantes (aux seules et de plus en plus marginales exceptions des anarchistes et des trotskistes) dans un " arc patriotique " qui va identifier la défense des droits de la classe ouvrière à celle de la démocratie bourgeoise et la défense de celle-ci à la défense de la patrie, le tout permettant aux socialistes, aux syndicalistes et même aux communistes (quoique du bout des lèvres) de faire coïncider les intérêts de la classe ouvrière à ceux de la " nation " suisse dont la guerre mondiale rendra indispensable la formation. La formation, car cette nation n’existe pas encore réellement, ainsi que l’illustra le " fossé " creusé par la Grande Guerre entre Romands et Alémaniques. La Nation comme volonté de vivre ensemble, et non comme acceptation plus ou moins stoïque du fait accompli, c’est-à-dire la nation telle que l’avaient posée les théoriciens français (de Voltaire à Renan) ; la nation comme contrat entre citoyens libres, comme la voyait Rousseau ; la nation comme communauté de culture (et non de langue) fondée sur une communauté de destin, telle que théorisée par les austro-marxistes ; la nation, enfin, telle que les révolutionnaires jacobins et les populistes russes l’identifièrent au peuple. Le mouvement ouvrier suisse face au fascisme opère précisément cette identification et la prolonge. Désormais, la défense nationale, en étant défense du peuple contre l’ennemi absolu, nazi ou fasciste, est défense de la classe ouvrière elle-même. Et ce n’est plus à la classe ouvrière, et au prolétariat, que vont se référer les programmes économiques et syndicaux nés du grand ébranlement des années trente, mais au peuple entier. Le Parti socialiste se concevra comme le grand parti du peuple, toutes classes confondues, abandonnant définitivement ses références marxiennes au seul prolétariat : " Nous sommes le parti de tous ceux qui ne sont pas les gros ", résumera dans les années ’80 le président du PSS d’alors, Helmut Hubacher : cette définition, c’est déjà celle que donne de lui-même le PSS de la fin des années trente. Ainsi naît du combat contre le fascisme et le nazisme une communauté nationale dont la gauche se voudra -et dans une grande mesure se fera- le creuset, et dont elle n’exclura que les " traîtres ", en particulier les " gros ", ceux qui, officiers supérieurs ou grands industriels, travaillent à la victoire de l’Axe.
La guerre froide dissoudra ce front, rejetant les communistes dans la marge. Il n’en aura pas moins été réel, original et, insistons y, déterminant dans la définition d’une nouvelle perception du monde et d’une nouvelle politique de solidarité du mouvement ouvrier ; déterminant aussi dans l’invention d’une " Suisse nouvelle ", pour reprendre le titre du programme socialiste du moment. Cette solidarité nouvelle, c’est la solidarité antifasciste, en laquelle on verra progressivement poindre, encore ponctuelles, hésitantes, timides, les premières manifestations d’un anticolonialisme et d’un anti-impérialisme allant au-delà des discours. Anticolonialisme, anti-impérialisme parce qu’antifascisme : ce sera moins pour défendre les " Abyssins " ou les " Tripolitains " que pour combattre les fascistes italiens que la gauche helvétique se retrouvera " objectivement " solidaire de Haïlé Sélassié ou des Sénoussi.
1930-1945 : ces quinze années sont celles des pires crises que le monde " développé " (occidental et européen " ait eu à connaître depuis les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Crises de tous ordres : politiques, économiques, sociales, culturelles et, finalement, militaires ; remise en question globale de tous les cadres, de toutes les structures, de toutes les habitudes et de toutes les références nés de l’ " invention " (française) de la démocratie moderne et de celle " anglaise " du capitalisme développé. Il s’agit bien, au strict sens du terme, d’une catastrophe, d’une convulsion d’où naît un monde -le nôtre, encore-, et où en meurt un autre, lui-même né de semblables convulsions. Le massacre à venir accouchera d’un ordre mondial, comme on l’avait cru du massacre précédent (comme s’il n’avait pas été suffisant pour mettre à bas ce qui devait l’être, et mettre bas ce qui devait naître). Les premières années de l’entre-deux-guerres avaient fait illusion : en 1930, l’ " esprit de Genève " agonise et la révolution bolchevique s’est résorbée en Staline. Rares sont ceux qui mesurent sur le moment l’importance du bouleversement qui s’opère (et ceux qui le mesurent sont plus souvent artistes, écrivains, philosophes, que politiques). Rares, aussi, au sein du mouvement ouvrier, sont ceux qui s’affranchissent des catéchismes (nombreux et contradictoires) pour regarder en face cette réalité bouleversée. Le stalinisme, il est vrai, impose une formidable réduction conceptuelle et symbolique, fonctionnant (et faisant fonctionner) à partir de l’exclusif précepte : " qui n’est pas avec nous est contre nous ". " Contre nous ", c’est-à-dire contre lui : les sociaux-démocrates, et notamment les pires de tous, les sociaux-démocrates de gauche qui " trompent le prolétariat ", les trotskistes, les anarchistes... Elle est exceptionnelle, l’attitude d’un Pointet qui, en réponse au " conseil " qu’on lui donne de ne pas " se perdre dans le trotskisme ", répond : " Je suis sans cesse ma propre ligne, ma propre philosophie, ma propre politique " (cité par Jean Liniger, op.cit. p. 24).
La crise, il est vrai, accroît les séductions des pensées simples. Et d’abord la crise économique, qui peut apparaître comme celle, définitive, du capitalisme. L’ordre économique mondial, revu et corrigé en 1918 par l’affirmation de la puissance des Etats-Unis, est le premier à s’effondrer en 1929. La révolution russe l’avait sans doute déjà mis à mal, mais la Russie (malgré le formidable " boom " économique des dernières années du tsarisme, avant 1914), n’avait jamais été réellement intégrée à la normalité capitaliste internationale, et pesait de peu de poids (sinon comme débitrice) dans l’économie internationale. L’instauration du pouvoir des Soviets, les années de guerre civile, le communisme de guerre, rompront les ponts jetés entre les économies développées d’Europe et la Russie " en voie de développement " (mais sur cette voie depuis Pierre le Grand...) ; ces ponts ne furent d’ailleurs jamais tels que leur rupture pût à elle seule remettre en cause l’ordre économique -si douloureuse qu’elle fut pour ceux qui avaient souscrit des " emprunts russes ". Ce que la révolution russe et la prise du pouvoir par les bolcheviks ne suffisaient pas à provoquer, le krach de 1929 le provoquera, faisant le lit du nazisme en Allemagne, élargissant celui du fascisme en Italie et favorisant le développement de multiples formes d’autoritarisme réactionnaire, du corporatisme catholique de Salazar au totalitarisme, révolutionnaire et réactionnaire tout à la fois, de Hitler, en passant par les dictatures militaires d’Europe centrale, le populisme autoritaire du " caudillisme " sud-américain, le conservatisme inquisitorial du franquisme -et nous en oublions. Quant à l’ " esprit de Genève ", ce qu’il en restait de réalité ou d’illusion ne tardera pas à succomber sous les coups conjugués de la crise économique, des crises politiques et de la crise culturelle des valeurs démocratiques sur lesquelles il était fondé, pour finir par s’engloutir dans la crise militaire : la guerre.
Pour la Suisse, tant " officielle " qu’ " ouvrière ", le bouleversement de l’ordre international représente un défi formidable ; un triple défi, en fait : économiquement, il va s’agir d’intégrer les effets de la crise en facilitant la restructuration de l’appareil de production helvétique et le redéploiement des échanges internationaux de la Suisse, tout en palliant aux effets sociaux dévastateurs de la crise (chômage, paupérisation) et à ses conséquences politiques (montée des extrêmes) ; politiquement et diplomatiquement, la Confédération va tenter de s’adapter à la " nouvelle donne européenne, en ménageant (sous l’influence déterminante de Motta) les nouveaux régimes autoritaires -du moins jusqu’à ce que l’émergence d’un " front de résistance " antifasciste et patriotique n’impose quelques précautions dans ce qui pouvait apparaître comme une faveur excessive faite au fascisme ; culturellement,, enfin, la " montée des périls " va provoquer la " fabrication " d’un " nationalisme suisse " dont la méthode sera l’intégration des quatre cultures nationales à une conscience collective unique.
La Suisse se fait, ou se parfait, nation à la faveur de ces quinze années de crises multiples. Elle était addition de cantonalismes et de survivances féodales, où la référence au " pays " était d’abord référence à la ville, à la commune, tout au plus au canton. Elle sera en 1945 entité collective fondée sur un réel sentiment national, exprimant en quatre langues et par les concepts d’une pluralité de cultures politiques, des références et des mythes communs. Cet accouchement se fera dans la douleur, la polémique et le conflit, mais il se fera. En 1935, Paul Golay dénonçait en termes véhéments le " ratatinement national " de la Suisse :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. biblio p. 143
À Golay, vitupérant en 1935 le " ratatinement " devant le fascisme répond le sentiment de fierté, à tout le moins de satisfaction, qu’un témoin " bourgeois " retire du bilan de ces mêmes années, et de celles, suivantes, de guerre -mais de guerre ailleurs :
Weber-Perret, Fin de siècle, in 45 ans plus tard, Alliance Culturelle Romande, op.cit.biblio, p. 201
La vision qu’a Weber-Perret de la naissance d’une nation suisse est si paisible qu’on pourra la trouver euphorique : vision qui en homme le tragique et le conflit, elle rend tout de même un peu compte, sur le mode idyllique, de ce passage d’une " pratique " de la Suisse par les Suisses, à une autre. Les choix faits entre 1930-1933 et 1943-1945, dans les trois domaines de l’économie, de la politique intérieure et de la politique extérieure, comme les discours légitimant ces choix, la Suisse actuelle en vit toujours les conséquences -si elle en ignore l’origine : la conception encore dominante de la " neutralité ", la pratique institutionnelle du " consensus ", et jusqu’à la " formule magique " de composition du Conseil fédéral (formule qui n’est rien d’autre que celle de l’adaptation aux temps de paix, ou de guerre froide, de l’union patriotique des temps de guerre), le Sozialpartnerschaft en matière de relations socio-économiques, le rôle dominant, enfin, du secteur tertiaire (notamment bancaire et financier) dans l’économie du pays, tout cela nous parait naître de cette période de " refonte " où les organisations dominantes du mouvement ouvrier (USS, PSS) scellent leur intégration à une " communauté nationale " qu’ils contribuent en retour à forger, et à laquelle leurs adversaires politiques (la droite bourgeoise) et économiques (le patronat) leur reconnaissent une place légitime. Ainsi se modifient les contours institutionnels et culturels de cette " communauté nationale " que la Grande Guerre et la Grève Générale avaient rendue improbable, et que la Guerre Mondiale rendra nécessaire, après qu’elle ait été rendue légitime pour la gauche par la montée des fascismes.

Economiquement, d’abord, la crise de 1929 " casse " la Suisse traditionnelle et la contraint à un bouleversement structurel dont les effets -différés par la Guerre Mondiale- se feront pleinement sentir dès la paix revenue et les marchés extérieurs pleinement retrouvés -et changés, eux aussi). Le 24 octobre 1929, le krach de Wall Street révèle l’ampleur des déséquilibres économiques, les traduisant en faillites et en ruines individuelles, provoquant une crise financière qui, accompagnant la crise économique, va plonger le monde capitaliste dans la dépression (le " monde socialiste ", réduit à la seule URSS, n’en est, lui, jamais sorti). Le paroxysme de la crise est atteint en 1932 : 12 millions de chômeurs aux USA, 6 millions en Allemagne (le nazisme saura en faire usage). En Suisse, le nombre des chômeurs ne cessera de croître entre 1929 et 1936 pour atteindre cette année là la centaine de milliers, soit un taux de chômage officiel d’un peu moins de 5 % de la population active. Apparemment, donc, les travailleurs suisses (les travailleurs de la Suisse, routes origines confondues) auraient eu moins à souffrir de la grande crise que leurs voisins européens... Mais si les chiffres y sont moins désespérants qu’ailleurs, ne serait-ce que parce qu’ils ne comptabilisent qu’une partie des chômeurs, la Suisse n’en subit pas moins le choc du chômage, de la paupérisation des couches populaires, de l’insécurité, celui, aussi, de la " montée des extrêmes ", de la remise en cause de la démocratie et des droits, individuels ou collectifs, pour la défense desquels le mouvement ouvrier va devoir se mobiliser.
L’industrie suisse d’exportation subit de plein fouet la grande crise : de 1930 à 1932, les exportations de l’industrie des machines chutent de 332 à 134 millions de FS, celles du textile de 555 à 165 millions. La Suisse orientale et l’arc horloger du nord-ouest deviennent des zones économiques sinistrées. Licenciements, augmentations des cadences de travail, baisses de salaires se conjuguent et se succèdent. La fonction publique n’échappe pas à la crise : le Conseil fédéral procède à une baisse de 7,5 % des salaires des employés de la Confédération, malgré un veto populaire qui sera surmonté par un arrêté fédéral urgent, non soumis à référendum. Les cantons et les communes s’installent dans la crise financière et procèdent aux mêmes mesures que la Confédération. Les travailleurs vont, pour des années, avoir la précarité pour " toile de fond ". Les effets politiques de la crise économique sont rapides et développent (ou renforcent, quand elles préexistent) les tendances autoritaires de droite (fascistes, nazies, corporatistes), beaucoup plus d’ailleurs que celles de gauche (staliniennes). Le gouvernement central procède de plus en plus souvent à des décisions d’autorité - des décisions " arbitraires " au strict sens du terme- par le moyen des arrêtés fédéraux urgents (un seul en 1929, seize en 1934...) qui lui permettent de contourner les oppositions populaires en les privant du moyen du référendum : les partis de gauche et les syndicats se trouvent ainsi privés d’une arme institutionnelle.
Mais en même temps qu’elle pousse aux extrêmes (du moins à ceux de droite), la crise amène au centre une partie de la gauche. Centrifuge autant que centripète, elle " radicalise " aux marges et rassemble dans le texte. L’urgence du secours aux victimes de la crise va d’abord, toute stratégie à long terme provisoirement remise à un examen ultérieur, pousser les organisations ouvrières à user des moyens du droit et des positions acquises dans les communes, les cantons, puis au niveau fédéral, pour développer les secours aux chômeurs, engager de grands travaux, lancer des actions de solidarité entre travailleurs d’abord, de contribuables à travailleurs ensuite. Se bricole ainsi, avec les moyens du bord et sans grande intervention de l’Etat central, un succédané de New Deal à la petite semaine. La révélation de l’ampleur et de la durée de la crise va ensuite poser très concrètement le problème du changement de l’ordre économique et social, et surtout des moyens à employer pour le provoquer : c’est le temps des grands programmes réformistes et planistes, plus " rooseveltiens " que " socialistes " : l’ " initiative de crise " du PSS en 1934, le " plan de travail " syndical de 1935, le " mouvement des lignes directrices " de 1936-1937, le projet de la " communauté professionnelle " de 1940-1941... Le corporatisme lui-même précise, détaille et théorise son projet en termes de " changement ", comme une " troisième voie " entre un capitalisme dont la crise semble illustrer la faillite définitive et un socialisme que le stalinisme peint aux pires couleurs. Et parallèlement à ces tentatives de penser un ordre autre, s’affinent et se concrétisent les rapprochements entre l’aile la plus réformiste du mouvement ouvrier et les dirigeants patronaux les plus perspicaces. Le 19 juillet 1937, le convention de " paix du travail " dans la métallurgie affirme à sa manière une volonté de changer les règles du " jeu social " en substituant durablement le partenariat à l’affrontement. Tout l’ " air du temps " souffle dans le préambule de ce texte historique :
Cité par Pierre Reymond-Sauvain, Le syndicalisme en Suisse, op.cit. biblio p. 86
L’air du temps souffle, écrivions-nous, dans ce texte : c’est pour maintenir une " paix sociale " qu’ils savent menacée par la crise que les réformistes des deux bords non seulement s’engagent à laisser désormais " les couteaux aux vestiaires " (ils s’y engageaient, pour eux-mêmes, depuis des années, et la FTMH en particulier avait conçu dès les années vingt une stratégie, une conception de l’action syndicale, que le " paix du travail " ne fera que formaliser), mais arrivent à convaincre leurs organisations de s’y engager solennellement.
Dans toute l’Europe, la crise économique attise la crise politique et renforce les mouvements qui, à la droite de la droite, y répondent en proposant le passé comme alternative au présent (le " retour aux sources ") et la logique du bouc émissaire comme méthode. Xénophobie (au mieux) et racisme (au pire) se développent sur la base d’un anticapitalisme spontané à qui fascistes et nazis (mais aussi catholiques réactionnaires) vont désigner l’ennemi juif, franc-maçon, communiste, socialiste, cosmopolite ou, tout simplement, " autre ". Les unes après les autres, les démocraties vacillent, les plus fragiles les premières, et sont remplacées par des régimes autoritaires pour le moins, totalitaires pour le plus -ou le projet. En 1938, il ne reste d’Etats démocratiques (" bourgeois ") dans toute l’Europe que, d’ouest en est et du nord au sud, l’Irlande (elle-même tentée par une forme d’autoritarisme catholique), la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, les Etats scandinaves, la Suisse et, pour moins d’une année encore, la Tchécoslovaquie. La frontière française est la dernière que la Suisse ait encore avec un Etat démocratique : au sud, au nord et à l’est, le fascisme d’abord, le nazisme ensuite, ont triomphé. Cet " encerclement ", qui sera complet de 1940 à 1944, va renforcer la tendance intérieure à la remise en cause des traditions démocratiques par les " extrêmes ", mais aussi forger progressivement, autour de ces mêmes traditions (quoi qu’il en soit de leur interprétation et du système de valeurs que les diverses forces concernées y rattachent), et contre ces mêmes extrêmes, un consensus en forme d’union nationale, démocratique et patriotique.
Ce processus ne sera pas exempt de convulsions, attisées par les relations pour le moins ambiguës que la Suisse entretient avec les régimes autoritaires ou totalitaires de droite qui couvrent progressivement l’Europe. Contre cette évolution, le mouvement ouvrier réformiste va construire, seul d’abord, puis en alliance avec une part de plus en plus importante des forces politiques du " centre " et de la droite démocratique, un véritable " front antifasciste et patriotique " ; la gauche privilégiera le premier de ces deux qualificatifs, la droite le second, mais le " front " n’en sera pas moins uni sur l’essentiel dès 1940. L’essentiel : l’indépendance nationale et la démocratie (formelle, certes, mais valant à ce titre infiniment plus que son absence...).
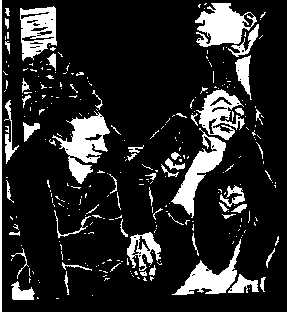
Auparavant, cependant, c’est dans la violence que se seront réglés les comptes entre la gauche socialiste, communiste et anarchiste et l’extrême-droite fasciste, ainsi que l’illustre le célèbre et dramatique épisode du 9 novembre 1932. Il vaut le peine de se pencher plus en détail sur cet événement paroxystique, qui fait " charnière " entre deux époques : celle qui se clôt dans l’affrontement de Plainpalais, et celle qui s’ouvre, en 1935, par l’adhésion du PSS à la défense nationale et sa revendication de participer au Conseil fédéral, et en 1937 par la signature de la Paix du Travail. Les " journées " genevoises de 1932 sont un tel exemple du climat, des enjeux et des politiques suivies à l’époque par les socialistes -ceux de l’aile gauche, tel Léon Nicole et la majorité du PS genevois, comme ceux du " centre " (Grimm) ou de l’aile " droite " (Aragno, Ils, Rosselet)- qu’il nous paraît indispensable d’en faire ici quelque relation, et quelque analyse.