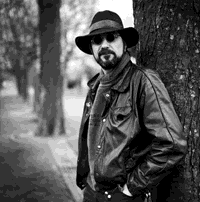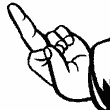

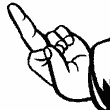

L’entre-deux-guerres :
À la recherche du chemin vers le socialisme
Le socialisme
chrétienLe manifeste du Soviet de
Petrograd (mars 1917)L’
appel à la révolution mondiale (janvier 1918)Le traité de
Brest-LitovskLa
défaite de la révolution allemande et l’échec de la révolution à l’ouestLa conférence de reconstruction de l’Internationale (Berne,
février 1919)L’invitation au congrès
constitutif de la IIIème InternationaleLe Congrès des Peuples d’Orient (Bakou, septembre 1920) et le
transfert de l’espoir révolutionnaire sur la périphérieQue faire du
mouvement anticolonial ?Le " congrès de
disparition " de la Deuxième Internationale (juillet 1920)L’appel international du "
centre " socialisteLa première (et dernière) conférence de l’Internationale " Deux et
demie " (février 1921) Cronstadt et la NEP (mars 1921)La ligne de " front uni " et la conférence de
Berlin (avril 1922)Fin de l’Internationale " Deux et demie ", création de l’Internationale Ouvrière et Socialiste (
IOS)La
gauche socialiste, ennemie principale des communistesLe léninisme : une extraordinaire capacité de
récupération des mouvements populairesRéformisme démocratique contre
volontarisme révolutionnaireLes deux stratégies communistes face à la social-démocratie : la
scission et l’" unité à la base "1918 : fondation du premier Parti communiste suisse ("
vieux communistes ")Le Congrès du PSS décide l’adhésion du parti à la
Troisième Internationale, mais ne change rien à la structure et à la politique du partiLes " 21
conditions "Les " 21 Conditions " : un "
épouvantail contre les réformistes "Le " Congrès d’
unification " des communistes suisses (mai 1921)La
situation dans le mouvement syndicalLa proposition de " Front
unique " (1921)Les
directives du PC sur le travail dans les syndicats (1921)La
crise économique du début des années vingtLe
repli social-démocrate sur la " démocratie suisse " comme réponse aux " totalitarismes étrangers "1922 : la gauche "
pèse " un quart de l’électoratL’" humanisme
gauchiste " du programme du PSS de 1920Pérennité
libertaire en RomandieLe "
malaise " dans la politique étrangère suisseLa social-démocratie international au
rythme genevoisL’opposition de droite à l’engagement de la Suisse dans l’ "
arène internationale "Le débat sur la "
sécurité collective " et l’alliance objective de la droite isolationniste et de la gauche communisteLe "
malentendu " de Locarno1922-1936 : une
succession de prises de pouvoir par l’extrême-droite dans toute l’EuropeLe passage d’une
ligne pacifiste à une ligne de combat antifascisteLe
serpent de mer de la reprise des relations diplomatiques avec la RussieLa "
question italienne "La Suisse ratifie le pacte
Briand-Kellogg (1929)De la crise et de la
guerre européennes à la crise et la guerre mondialesUne nouvelle solidarité internationale : quand la solidarité avec l’ " autre " est une défense de
soi-mêmeSuccès
électoraux du PSS à la fin des années vingt1929 : la question de la participation socialiste au Conseil fédéral. Les positions (contradictoires) de Léon
Nicole et de Robert BratschiLa
contradiction entre les stratégies du Comintern et les situations concrètes des communistesL’
autocritique des communistes suisses en 1929 : nous avons été trop unitaires...

Tournant bien plus que rupture, la grève générale n’est en tous cas pas, pour le mouvement ouvrier suisse, une table rase : les débats qu’elle suscite, les contradictions qu’elle révèle, lui préexistent. Pour beaucoup de socialistes, même pour certains de ceux qui ont " vibré " à l’exemple de l’octobre russe, la lutte menée par le mouvement ouvrier helvétique est la poursuite de cette engagée par la bourgeoisie radicale du XIXème siècle. Paul Golay :
Paul Golay, Discours au Grand Conseil vaudois du 9 novembre 1919 sur l’interdiction des manifestations socialistes, in Terre de Justice, op.cit.biblio p. 238
Les années d’entre-deux-guerres sont également celles de l’affirmation d’une nouvelle convergence entre christianisme social et socialisme. Le premier, fort critique à l’égard des affirmations politiques majoritaires des églises (le conservatisme catholique, le libéralisme protestant), va progressivement donner naissance à la fois à une aile gauche, relativement autonome (et en certains cas franchement indépendante) des partis catholiques conservateurs et au courant socialiste chrétien au sein du PSS. Ce courant émerge au début du siècle, à peu près en même temps chez les protestants et chez les catholiques, et exprime une volonté de réconcilier le message évangélique et le projet socialiste considéré comme sa traduction possible en termes d’organisation des sociétés humaines. Les buts exprimés en 1908, en France, par l’Union des socialistes chrétiens (protestants, en l’occurrence), témoignent de cette volonté :
cité par Jean-François Martin, Les socialistes chrétiens, in Tribune Socialiste Vaudoise (Lausanne), 7 juin 1984
Projet réformiste donc, qui est également celui de groupes suisses, constitués avant la Grande Guerre (en Romandie : à Saint-Imier, Sonvilier, Genève et Lausanne dans les années 1910, puis dans le reste de la Suisse romande où, en mars 1914, se constitue la Fédération Romande des Socialistes Chrétiens). Mais, processus désormais traditionnel, en même temps que se développe le mouvement, se développent en son sein des divergences sur sa mission et son projet : société meilleure pour les uns, nouvelle société pour les autres.
Ces socialistes chrétiens passent leur temps d’engagement entre prière, formation, conférences et activités au sein du PSS et de l’USS auxquels ils ont le plus souvent adhéré. On les voit après la grève générale organiser des " écoles du dimanche populaires " pour accueillir les enfants que leurs parents ne veulent plus confier à des prêtes ayant condamné le mouvement ; on les voit aussi " tracter " à la sortie des églises au moment des élections, invitant les fidèles à voter socialistes pour " libérer les âmes de ceux qui étouffent sous le capitalisme oppresseur, donner à tous du travail et du pain, une place au banquet de la vie et au soleil de Dieu " (cité par J.-F. Martin, art.cit.). La Grande Guerre voit la Fédération Romande des Socialistes Chrétiens s’engager dans le pacifisme socialiste, sous l’impulsion (notamment) de Jules Humbert-Droz (qui passera ensuite à l’antimilitarisme révolutionnaire), Pierre Cérésole et Hélène Monastier. Lors de la grève générale, les socialistes chrétiens se rangent aux côtés de la classe ouvrière et le futur syndic de Renens, Ernest Gloor, est arrêté pour avoir incité les soldats à l’insoumission.
Les socialistes chrétiens vont subir, comme l’ensemble du mouvement socialiste, les effets de la grande scission du mouvement ouvrier au moment de la création de la IIIème Internationale. Jules Humbert-Droz et les socialistes chrétiens " de gauche " quittent à la fois la Fédération romande et le Parti socialiste pour rejoindre le mouvement communiste. En 1928, au Locle, se constituera une Ligue Internationale des Socialistes Religieux que présidera Leonhard Ragaz et dont Hélène Monastier sera la secrétaire. La Fédération romande des socialiste chrétiens change de nom et devient la Fédération romande des socialistes religieux, poussant l’œcuménisme jusqu’au syncrétisme gandhien (tel sera le chois personnel de Pierre Ceresole et d’Edmond Privat, par exemple).
L’histoire de ces socialistes chrétiens sera désormais celle de l’une des cultures du socialisme démocratique suisse, participant pleinement de celle du PSS et de ses contradictions. Ainsi, enquêtant sur les événements meurtriers du 9 novembre 1932 à Genève, la Fédération romande des socialistes religieux renverra dos à dos le leader socialiste genevois et le gouvernement cantonal : " dans les voies du bolchevisme, ne peut se récolter que malédiction, rien en tout cas qui soit digne du socialisme " -voilà pour Léon Nicole-, mais le gouvernement genevois a employé contre lui des moyens disproportionné, au lieu de favoriser la réconciliation sociale : " Si le pauvre ne peut aller au riche, le riche doit aller au pauvre " -voilà pour la droite.
Le socialiste chrétien (" religieux ") des années trente sera vivace, et nombre de ses " fidèles " seront aussi des acteurs importants de la vie politique (comme les Vaudois Arthur Maret et Ernest Gloor , Leonhard Ragaz et Pierre Ceresole s’illustrant quant à eux par la constance d’une option antimilitariste qui en fera de vigoureux critiques de la réadhésion, en 1935, du PSS à la défense nationale. Cette ligne antimilitariste, les " socialistes religieux " continueront de la défendre lors de la Guerre Mondiale, lors même que le péril fasciste convainc finalement jusqu’aux communistes de l’utilité de la défense militaire de l’indépendance nationale d’une démocratie bourgeoise... La scission en Romandie entre la Fédération socialiste suisse de Léon Nicole et les socialistes fidèles au PSS affectera le socialiste chrétien : Ernest Gloor suivra Nicole alors que la plupart des socialistes " religieux " resteront au sein du parti suisse et s’y battront pour la réadmission des " dissidents ". En 1945, c’est un membre des socialistes religieux, Samuel Thevoz, qui présidera le Parti ouvrier et populaire (POP, Parti du Travail) vaudois. Dans les années cinquante, le mouvement socialiste chrétien va s’affaiblir, se marginaliser, réduire ses activités et se mettre quelque peu en sommeil. La spécificité chrétienne, il est vrai, n’en est plus vraiment une au sein du mouvement ouvrier, dont le fonds anticlérical et " antireligieux " s’est affadi au fur et à mesure que la société elle-même se " déchristianisait ". Une Fédération romande des socialistes chrétiens existe cependant toujours à la fin du XXème siècle, implantée essentiellement en Pays de Vaud et publiant la revue " L’Espoir du Monde ".
Sociaux-démocrates soucieux de pousser à son terme historique (l’ " Etat social ") me mouvement révolutionnaire bourgeois du XIXème siècle, socialistes chrétiens à la recherche d’une synthèse du projet socialiste et du message évangélique, socialistes révolutionnaires fascinés par l’espérance de bouleversement mondial née de la Grande Guerre et des révolutions qui la conclurent, tous eurent dans les années vingt à affronter les conséquences, sur le mouvement ouvrier national comme sur le mouvement ouvrier international, de la naissance d’un mouvement communiste irréductiblement séparé de sa " matrice " social-démocrate. La révolution russe sera ainsi l’événement analyseur décisif de l’ " état de l’internationalisme " au sein du mouvement ouvrier suisse. Le pouvoir pris et la paix faite sur le front allemand, les bolcheviks se sont retrouvés face à l’impérieuse nécessité de briser l’isolement en lequel les vainqueurs de la Grande Guerre et les alliés d’occasion (les partisans des anciens régimes vaincus d’Europe centrale et orientale) voulaient tenir la Russie des Soviets. La constitution de la Troisième Internationale est à la fois la concrétisation des espoirs de révolution mondiale (et d’ " exportation ") de la révolution russe) et la conclusion logique des thèses léniniennes sur la faillite de la Deuxième Internationale. L’expansion de la révolution vers l’Europe occidentale, et d’abord vers l’Allemagne, apparaît aux dirigeants soviétiques comme la pierre de touche de cette double ambition : briser l’encerclement de l’Etat révolutionnaire et construire l’instrument de la révolution mondiale.
Lors de sa première réunion plénière, en mars 1917 (février selon le calendrier russe), le Soviet de Petrograd avait adopté un manifeste adressé " aux peuples du monde entier ", leur enjoignant de mettre immédiatement fin aux guerres sur la base d’une paix " sans annexions ni réparations " et du droit des peuples à l’autodétermination. L’enthousiasme suscité par cet appel auprès des " gauches " zimmerwaldiennes est à l’exact inverse de la consternation qui s’empara des chancelleries de Paris et de Londres. L’appel du Soviet de Petrograd, c’était en effet " la paix séparée ", le retrait de la Russie de l’alliance, le passage des forces allemandes du front de l’est vers le front de l’ouest. Mais c’était aussi, après les deux conférences socialistes de Zimmerwald et de Kienthal, l’acte de naissance d’un nouvel internationalisme. Les sociaux-patriotes de l’Entente sentent le danger et envoient en Russie des délégations chargées d’éloigner, si faire se peut, le gouvernement provisoire de Kerenski des positions exprimées par les " gauchistes " qui tiennent le Soviet de Petrograd. Marcel Cachin et Albert Thomas pour les socialistes français, Henderson et Thome pour les travaillistes anglais, Vandervelde, de Brouckère et de Man pour les Belges, font le voyage. Voyage couronné de succès, dans un premier temps : le gouvernement provisoire refuse en effet de se plier aux exigences exorbitantes de l’Allemagne, et décide de poursuivre la guerre. Mais sur le front, le désastre menace : les soldats et les marins en ont assez. " La paix immédiate " devient la revendication première de centaines de milliers d’hommes, qui désertent et se mutinent en masse. Lénine va tirer parti de ce mouvement : " La paix immédiate ", intégrée au programme bolchevik, va lui permettre de s’appuyer sur la masse des soldats refusant la guerre. Méthode bien léninienne, que cette "récupérations des revendications essentielles : il en va de la paix pour les soldats comme de la terre pour les paysans, du pain pour les ouvriers, de la liberté pour les nations dominées de l’empire. La révolution russe, et son terme bolchevik, sera faite de la réunion de ces quatre mouvements de révolte (la révolte des soldats pour paix, des paysans pour la terre, des ouvriers pour le pain, des nations pour la liberté) dont Lénine aura saisi mieux que tout autre l’immense importance stratégique, sans pour autant que l’on puisse le croire convaincu de leur légitimité historique. Les bolcheviks, dont la majorité était dans un premier temps favorable à la poursuite de la guerre, vont changer d’avis sous le pression de Lénine. En avril (mars) 1917, lors d’une conférence " unitaire " entre bolcheviks et mencheviks, Lénine s’en prendra avec violence à ceux de ses camarades qui sont partisans de la réunification avec ceux qu’il considère, lui, comme des " sociaux-patriotes " masqués, des centristes réformistes, des " alliés de la bourgeoisie ". Au plan international, Lénine, tout en se tenant soigneusement au courant de ses développements, refuse la participation des bolcheviks à la conférence socialiste de Stockholm :
Cité par Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, Dietz Verlag, Berlin, p. 97

La conférence de Stockholm on le sait, n’aboutira pas. Le 5 septembre 1917, elle constate l’impossibilité de la renaissance de la vieille Internationale. Mais deux mois plus tard, au lendemain du renversement par les bolcheviks du gouvernement provisoire, le Soviet adopte un décret rédigé par Lénine qui, reprenant l’appel de mars, invite les ouvriers des pays en guerre à tout faire pour y mettre fin. Et au mois de janvier 1918, c’est un appel à la révolution mondiale qui est lancé par le Conseil des Commissaires du peuple (gouvernement de la Russie soviétique), lorsque sont connues les conditions draconiennes imposées par l’Allemagne à la Russie pour mettre fin à la guerre entre elles. Des grèves de masse sont déclenchées à Vienne pour protester contre les revendications territoriales exorbitantes des " centraux ", et au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En février 1918, de nouvelles grèves, et des mutineries, se produisent en Allemagne et en France. En Grande-Bretagne et en Italie aussi, on manifeste sa solidarité avec la Russie révolutionnaire. Ces mouvements sont spontanés : ni les directions syndicales, ni les directions des partis socialistes, ni -et encore moins- le Bureau Socialiste Internationale, n’y ont la moindre part. Les " appareils ", comme en Suisse, mais plus à contrecœur, doivent " suivre " une base qui prend sans eux l’initiative d’une lutte que, toujours comme en Suisse, la " bourgeoise " fait mine de considérer comme suscitée par les " agents ennemis ".
La Russie devra accepter les conditions allemandes, faute de pouvoir continuer une guerre qu’elle sait perdue. Lénine et Trotsky assument les conséquences du programme qui les a conduit au pouvoir : " La paix immédiate ", c’est, le 2 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, imposé par les deux dirigeants soviétiques à l’aile gauche des socialistes révolutionnaires et à une grande partie des bolcheviks partisans d’une guerre révolutionnaire contre l’Allemagne -un " Valmy de l’Est " auquel Lénine et Trotsky ne croient pas : ils savent dans quel état est l’armée russe, ils savent surtout que la " priorité des priorités " est la consolidation de leur révolution et que, pour ce faire, ils ont besoin de toutes les énergies et de toutes les forces que la poursuite de la guerre consumerait. Pour autant, ni Lénine, ni Trotsky ne rabattent de leurs espérances et de leurs volontés révolutionnaires " internationales ", et ce n’est pas un traité qui pourrait les y inciter. L’article 2 de celui de Best-Litovsk impose aux Soviets de s’abstenir de " faire de la propagande ou de l’agitation contre le gouvernement ou l’Etat de l’autre partie contractante " ? l’encre des signatures n’est pas sèche que cet engagement est déjà consciemment violé. Rien n’était plus étrangers aux bolcheviks que le respect d’une telle " clause de neutralité ". Adolf Joffe, représentant diplomatique des Soviets à Berlin, n’aura de cesse d’organiser la révolution allemande, en distribuant des fonds aux " socialistes révolutionnaires " de l’USPD. Ceux qui accusaient les bolcheviks de financer la subversion avaient raison -mais c’est la subversion en Allemagne qu’ils financent et soutiennent, non la subversion en France ou en Grande-Bretagne. Pour Lénine, la révolution dans le pays où le mouvement ouvrier est le plus fort est la condition de la révolution mondiale ; ce pays, c’est l’Allemagne ; la révolution allemande garantirait en outre la révolution soviétique.
La révolution allemande aura bien lieu, mais après la défaite et la désagrégation du système impérial. Et elle s’achèvera tragiquement, par la défaite des révolutionnaires et la victoire d’une improbable alliance entre la droite social-démocrate et les forces politiques bourgeoises, soutenues par l’armée vaincue sur le front occidental, mais victorieuse sur ce qui fut le front oriental, et victorieuse surtout dans les villes allemandes, contre les forces révolutionnaires allemandes. L' " avant-garde " des prolétariats allemand, autrichien et hongrois, les conseils ouvriers qui en furent l’émanation, seront à leur tour défaits en 1919. Les régimes impériaux sont renversés, certes, mais ce qui leur succède, au terme d’un processus sanglant, c’est, en Allemagne et en Autriche, de fragiles républiques démocratiques " bourgeoises ", et en Hongrie un régime " protofasciste ". La majorité de la classe ouvrière des empires centraux avait adhéré au projet de " démocratie sociale ", non à celui de la dictature du prolétariat, et en Europe, la Russie soviétique restait seule de son espèce.
En Allemagne, les sociaux-démocrates majoritaires (Ebert, Scheidemann, Noske) s’allient aux corps-francs, commandés par des officiers monarchistes, pour étouffer dans le sang l’insurrection spartakiste. Le 12 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés par ces mêmes corps-francs, sans que cela ne déplaise à leur ancien camarade Noske, ministre de l’Intérieur de la toute jeune République bourgeoise. En Autriche, la droite social-démocrate s’allie également avec la droit tout court pour réprimer le mouvement révolutionnaire en juin 1919. En Hongrie, si la révolution soviétique semble victorieuse au début de 1919, les révolutionnaires conduits par Bela Kun, auxquels cette fois les sociaux-démocrates se sont alliés, doivent affronter la paysannerie et une intervention militaire roumaine, qui met en place pour un quart de siècle le régime " protofasciste " de l’Amiral Horthy.
La certitude léninienne de la possibilité d’une révolution mondiale (à tout le moins européenne) à la suite de la révolution russe et de la fin de la guerre s’avère, en 1920, fausse. L’appel à l’insurrection n’a été suivi -et l’insurrection écrasée- que dans les Etats " centraux " et si la France, l’Italie et la Grande-Bretagne connurent de durs et forts mouvements de lutte sociale, cette lutte jamais ne contint de " péril révolutionnaire " pour la classe dominante. Une révolution avait bien éclaté à l’ouest, mais à la marge, en Irlande -et il s’agissait avant toute chose d’une lutte de libération nationale. Les grèves et manifestations de solidarité avec la révolution soviétique furent nombreuses, mais elle ne débouchèrent nulle part, à l’ouest, sur une insurrection, ni même ne purent empêcher l’intervention des alliés (et du Japon) aux côtés des contre-révolutionnaires russes. Enfin, en Allemagne et en Autriche, la scission entre la " gauche " et la " droite " du mouvement socialiste s’est prolongée en un affrontement armé, suscitant une haine réciproque rendant illusoire toute tentative unitaire et désagrégeant le mouvement ouvrier des deux grands Etats germaniques -libérant ainsi un espace politique que le fascisme et le nazisme sauront occuper.
La volonté de reconstruire l’Internationale reste pourtant vivace. Début février 1919 à Berne est organisée une conférence de réunification à laquelle participent 102 délégués de 26 mouvements socialistes nationaux. Mais, nés de la guerre et des révolutions, les clivages sont désormais insurmontables entre eux. Les Belges refusent de participer à la conférence bernoise aux côtés de socialistes " majoritaires " allemands n’ayant pas protesté contre l’occupation de la Belgique en 1914 ; les Italiens, les Suisses et les Roumains refusent de délibérer sur d’autres bases que celles de Zimmerwald ; les bolcheviks et les socialistes-révolutionnaires de gauche russes refusent de s’en tenir à Zimmerwald, qu’ils considèrent comme une " page tournée ". Il résulte de cette cascade de refus que la conférence, à la légitimité douteuse, fut majoritairement orientée " à droite ". Une résolution condamnant la principe de la dictature du prolétariat est adoptée, malgré les protestations des " centristes " Friedrich Adler et Jean Longuet. Les bolcheviks interprètent -à juste titre- ce vote comme un acte d’hostilité à leur égard, et condamnent toute tentative de faire renaître de ses cendres une Deuxième Internationale qu’ils considèrent comme défunte. S’agissant de la paix, la conférence de Berne réaffirme les principes socialistes de " communauté des peuples " et d’autodétermination nationale, et son soutien au projet d’une Société des Nations en laquelle elle voit une association des peuples, et non de ce sera la SdN : un cartel des vainqueurs excluant les vaincus, les colonies et la Russie soviétique.
La Commission socialiste permanente, qui siège à Amsterdam quelques semaines après la conférence de Berne, établit un " catalogue de revendications " à l’intention de la conférence de paix de Versailles et réaffirme le droit à l’autodétermination des peuples vivant sur des territoires " litigieux " en Europe, mais ne souffle mot des colonies extra-européennes. Le droit de l’Irlande à l’autodétermination est reconnu, trois ans après l’insurrection de Pâques 1916. La résolution affirme également le droit des juifs à un " centre national " en Palestine, mais ne dit rien des droits de la population arabe de Palestine (qui, d’ailleurs, s’en souciait alors ?). Enfin, l’annexion par les puissances de l’Entente des anciennes colonies allemandes est dénoncée, sans que cette dénonciation n’amène à reconnaître les droits des peuples " indigènes " à jouir, eux aussi, de l’indépendance nationale revendiquée pour les peuples dominés d’Europe.
De la conférence de Berne semble pouvoir renaître la Deuxième Internationale -mais une Internationale qui ne ressemble plus guère à celle d’avant-guerre. Un sensible virage à droite de la social-démocratie se constate : l’Internationale d’avant-guerre exprimait une volonté de changer les règles du jeu social et politique, son héritière présomptive exprime désormais l’ambition de s’insérer dans ce jeu en en respectant, pour l’essentiel, les règles. A l’ambition de prendre le pouvoir succède celle d’y participer. Sans doute la ligne politique qui s’impose dans les années d’après-guerre ne tombe-t-elle pas du néant : la " droite " social-démocrate d’avant-guerre participait déjà de cette conception " démocratique bourgeoise ". Mais l’expression publique du projet socialiste international manifestait alors, ne fût-ce que rhétoriquement, une ambition de bouleversement social et politique que la social-démocratie d’après-guerre fera de moins en moins mystère d’avoir abandonnée. Dès 1918, d’ailleurs, les révolutionnaires les plus déterminés ont rompu avec la social-démocratie (y compris avec son aile gauche) et ont commencé à créer des organisations " communistes " en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. En Suisse même se créée en 1918 un premier parti communiste (qu’il conviendrait d’ailleurs plutôt de qualifier d’ " anarcho-communiste "), celui dit des " Vieux communistes " -lesquels étaient d’ailleurs de jeunes militants.

En janvier 1919, le parti bolchevik lance officiellement les invitations à participer au congrès constitutif d’une nouvelle Internationale, la troisième, qui sera fondée en mars à Moscou par quelques " embryons de partis communistes " et une trentaine d’organisations en devenir. La nouvelle Internationale est à l’image du parti soviétique : contre le " spontanéisme " luxemburgiste, Lénine impose sa conception d’un parti révolutionnaire international, centralisé -et donc contrôlé par la seule force communiste qui compte, le parti au pouvoir à Moscou. Sa tâche première : encourager, organiser, financer les forces révolutionnaires dans les pays capitalistes avancés, afin que celles-ci soient en mesure de provoquer une insurrection victorieuse. Lénine est persuadé que la condition de la survie de la Russie soviétique réside en une révolution européenne, et le manifeste du premier congrès de l’IC (Manifeste de l’Internationale Communiste aux prolétaires du monde entier) est tout entier tourné vers cet objectif. Il faudra attendre la fin de toute espérance révolutionnaire au centre, du moins à court terme, pour que l’on s’attache sérieusement aux mouvements révolutionnaires à la périphérie. En 1919, les communistes disent encore aux peuples colonisés d’attendre la révolution dans les pays colonisateurs : " Esclaves coloniaux d’Afrique et d’Asie ! L’heure de la dictature du prolétariat sera aussi l’heure de votre libération ! " (cité par D. Boersner, The Bolcheviks and the National Question, IUHEI, Droz, Genève, 1957, p. 66).
En attendant l’heure de la dictature du prolétariat, on dénonce vigoureusement la social-démocratie renaissante, et tout aussi vigoureusement le " centre amorphe " qui tente encore de réunifier le mouvement socialiste international éclaté, sur une autre base que celle de la droite social-démocrate. Pour l’IC, seule une rupture totale avec les leaders du mouvement ouvrier social-démocrate peut faire progresser le mouvement ouvrier tout court (elle s’accommodera pourtant de l’arrivée en son sein, sous de fraîches couleurs " communistes ", d’anciens responsables sociaux-démocrates compromis dans la " social-patriotisme ", comme le Français Marcel Cachin...). Le Comintern appelle donc les révolutionnaires de tous les pays à se séparer immédiatement des " complices des assassins de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg " et dénonce l’Internationale que la conférence socialiste de Berne tente de reconstituer comme une " Internationale jaune, briseuse de grève ", un " instrument de la bourgeoisie " contre le mouvement révolutionnaire.
Succédant au premier congrès de l’IC, une vague de mouvements de revendication et de révoltes ouvrières déferle en Europe, semblant confirmer l’intuition optimiste d’une accélération des luttes sociales par la rupture d’avec la social-démocratie. Fin mars 1919, la République des Soviets est proclamée à Budapest ; début avril, un gouvernement ouvrier est formé en Bavière ; à Vienne, c’est une véritable guerre civile qui oppose communistes et socialistes de gauche aux sociaux-démocrates ; des affrontements sanglants éclatent à Leipzig, Eisenach, Erfurt, dans la Ruhr et à Berlin ; mi-avril, des mutineries éclatent dans la flotte française de la Mer Noire et à Paris des dizaines de milliers d’ouvriers en grève affrontent violemment les " forces de l’ordre " ; le 21 janvier 1919, le parlement nationaliste clandestin d’Irlande, la Dail Eireann, a proclamé l’indépendance et la République, et une nouvelle organisation armée, l’Irish Republican Army (IRA) prend la tête de la lutte militaire de libération. En avril 1920, le mouvement de grève atteint en France son apogée, tandis qu’en Italie se multiplient les grèves sauvages. E n 1919, les partis socialistes italien, norvégien et bulgare décident d’adhérer à la nouvelle Internationale (les minorités opposées à cette adhésion créant derechef des partis fidèles à l’ancienne Internationale en voie de renouvellement). Après eux, des congrès socialistes français (SFIO), allemand (de l’USPD) et britannique (ILP) décident d’entamer des négociations avec le Comintern en vue d’une affiliation ; le mouvement socialisme français se casse en deux : les minoritaires choisissent, à l’appel de Léon Blum, de " garder les clefs de la vieille maison ".
Pourtant, lorsque se réunit en juillet 1920 le second congrès de l’IC, la vague révolutionnaire a déjà reflué et la majorité de la classe ouvrière ouest-européenne est restée fidèle aux partis sociaux-démocrates " centristes " (comme le PS-SFIO) ou " droitiers " (comme le SPD). Par ailleurs, la Russie soviétique se sent moins menacée : les armées " blanches " sont battues sur tous les fronts, et l’élimination progressive de toute opposition a renforcé le pouvoir bolchevik : majoritaire dans la Constituante de 1917, les socialistes-révolutionnaires ne le sont plus que dans les premiers camps ouverts par la Tcheka. De la défaite révolutionnaire en Europe occidentale et de la victoire révolutionnaire en Russie naît un intérêt nouveau pour les " colonies " et les peuples de la périphérie : en septembre 1920 se tient à Bakou le " premier congrès des peuples d’Orient " auquel participent, selon Zinoviev (président de l’IC et président du congrès) 1891 délégués de 32 nations. Mais malgré un manifeste appelant les peuples de l’ " Orient " à se soulever dans une " guerre sainte " contre les impérialistes (l’IC joue ici d’une ambiguïté de traduction permettant de faire passer la lutte de classe pour le Djihad -et réciproquement, manière de tendre la perche révolutionnaires aux mouvements d’émancipation dans le monde musulman), aucune décision d’importance n’est prise à Bakou, sinon celle de fonder (mais à Moscou) un institut d’études orientales. La conférence de Bakou n’en témoigne pas moins de la fin des espérances révolutionnaires européennes, et d’un " transfert d’espoir " sur la périphériene majorité des délégués du PS français décide au congrès de Tours, en décembre 1920, d’adhérer à l’IC ;, préfiguration du " tiers-mondisme compensatoire " qui s’emparera d’une partie de la gauche révolutionnaire dès les années cinquante, à la mort des espoirs nés de la Libération et de la victoire sur le fascisme et le nazisme, et dans les années septante, l’ " illusion lyrique " de 1968 dissipée.
Faute de perspectives révolutionnaires à court ou moyen terme à l'ouest, l'IC s'intéresse donc aux mouvements révolutionnaires nationaux en Perse, en Turquie et en Indonésie, et au mouvement révolutionnaire (à la fois national, politique et social) chinois. Lors du deuxième congrès de l'IC, les " problèmes coloniaux " sont à l'ordre du jour, et nombre de délégués attendent de la nouvelle Internationale une politique anticoloniale plus active et plus cohérente que celle de la précédente. N. Roy, d’origine indienne, et Sneevliet (" Maring "), président du syndicat hollandais des cheminots d’Indonésie, se font les porte-parole de ceux qui attendent du mouvement communiste international qu’il s’engage dans un soutien révolutionnaire aux luttes menées à la périphérie. Lénine et Radek soutiennent quant à eux que les communistes doivent appuyer les mouvements bourgeois et démocraties dans les colonies, dans la mesure où leur ligne est révolutionnaire et anti-impérialiste. Ils restent donc attachée au primat marxiste de la révolution prolétarienne au centre, et n’attendent en fait des mouvements révolutionnaires " périphériques " que ce que Marx attendait du mouvement révolutionnaire irlandais : un affaiblissement décisif des grands capitalismes impérialistes. D’autres, notamment Serrati et Rosmer, défendent un point de vue à la charnière de l’anarcho-syndicalisme et du " luxemburgisme " : toute discussion sur les mouvements nationaux est du temps perdu, tout soutien à de tels mouvements est de l’énergie gaspillée, car ils sont d’essence et de direction bourgeoises et comme tels, des adversaires du mouvement ouvrier ; c’est au nom de l’internationalisme même qu’il faut combattre les mouvements nationaux : les bourgeoisies nationales ne sont pas des alliées possibles pour le mouvement révolutionnaire international, mais des adversaires réels des prolétariats naissant à la périphérie. Au vote, ce sont les thèses de Lénine qui s’imposeront. L’IC va constamment par la suite tenter de concilier l’attente de la révolution européenne et le constat de l’irrésistible émergence des mouvements révolutionnaires à la périphérie. Conciliation périlleuse, que la Troisième Internationale ne réussira pas.
En juillet 1920 se tient à Genève le " congrès de disparition " de la Deuxième Internationale dans sa forme d’avant-guerre. Le but de la réunion genevoise, dans le droit fil des tentatives " centristes " initiées pendant toute la guerre afin de faire renaître l’internationalisme social-démocrate, était de reconstituer l’organisation internationale, éclatée et divisée, dont Huysmans et Vandervelde avaient " gardé les clefs " (pour la fermer aux Allemands et aux Autrichiens) entre 1914 et 1918. Mais le congrès n’est pas encore ouvert que tous savent déjà son terme : la scission du mouvement ouvrier international est consommée, dans la quasi-totalité des pays européens coexistent et s’affrontent désormais deux partis se réclamant du socialisme et de l’internationalisme, et la Deuxième Internationale ne peut simplement se reconstituer sur des bases antérieures à la guerre. Le mouvement socialiste international est divisé en trois factions, dont une seule (la communiste) est réellement structurée internationalement : la " droite " héritière des " sociaux-patriotes " se réclame toujours de la Deuxième Internationale, quoi qu’elle ait fait de son héritage pacifiste en août 1914 ; la " gauche " léniniste et anarcho-syndicaliste a adhéré, est en passe de le faire ou demande à le faire, à la Troisième Internationale ; un " centre " fidèle aux thèses de Zimmerwald, " social-pacifiste " (" social-confusionniste ", dira plutôt Lénine...) souhaite se maintenir à équidistance des deux Internationales adversaires, dans l’espoir d’arriver, sinon à leur unification, du moins à leur coordination. Ce troisième groupe, dont participent les Suisses, tente lui aussi de se structurer au plan international. C’est la tâche à laquelle vont s’atteler les travaillistes indépendant britanniques, les sociaux-démocrates indépendants allemands et les sociaux-démocrates/socialistes (selon qu’on les nomme en allemand ou en français et en italien) suisses.
L’USPD, l’ILP et le PSS convoquent, peu après l’échec de la conférence social-démocrate de Genève, une réunion de " pré-conférence " à laquelle participent, outre leurs représentants, ceux des " minoritaires " français qui réprouvent la décision du congrès de Tours d’adhérer à l’IC. La social-démocratie autrichienne, les mencheviks russes et les socialistes allemands de Tchécoslovaquie participent également à cette " pré-conférence " internationale du " centre " socialiste.
La tâche principe que s’assignent les " centristes " qui vont créer l’éphémère " Internationale deux-et-demie " consiste en la formulation de principes permettant la reconstitution d’une Internationale universelle et unitaire. Un appel aux partis socialistes de tous les pays est lancé peu après la réunion ; il analyse le contexte : le capitalisme anglo-saxon (américain et britannique) et les militarismes français et japonais tentent ensemble, malgré la concurrence qui les anime et les sépare, d’ériger un système de domination mondiale destiné à écraser les révolutions prolétariennes en Europe, la révolution des Soviets et les mouvements d’indépendance des peuples colonisée. L’appel invite le prolétariat à opposer à la politique impérialiste sa propre politique internationale, afin " de défendre l’URSS contre les attaques des puissances occidentales, de contrecarrer les intrigues contre-révolutionnaires de l’impérialisme français en Europe de l’Est, de soutenir les nationalités et les peuples coloniaux en lutte contre le système de domination capitaliste et d’unir ainsi toutes les forces révolutionnaires du monde contre la domination de l’impérialisme " (in Braunthal, op.cit. T2 p. 565). S’agissant de la Deuxième Internationale, l’appel constate qu’elle ne regroupe plus que l’aile la plus réformiste du mouvement ouvrier et ne peut donc plus prétendre à l’universalité ; quant à la Troisième Internationale, les " centristes " ne la considéreront que comme un cartel de partis communistes aussi longtemps qu’elle maintiendra les décisions de son deuxième congrès, en particulier les " 21 conditions ", et lui reprochent de vouloir imposer partout un modèle révolutionnaire unique (bolchevik) sans tenir compte des conditions locales et des différences de situation. Finalement, l’appel des " centristes " se prononce sur la question de la dictature du prolétariat, et la justifie comme méthode défensive au cas où la bourgeoisie se révolterait contre le pouvoir d’Etat conquis par le prolétariat -cette conquête, est-il précisé, pouvant se faire aussi bien par la voie des urnes que par celle de la grève générale, et cette dictature, est-il assuré, prendra forcément la forme d’une dictature des organisation de classe prolétariennes, par le moyen de conseils ouvriers, paysans et de soldats, des syndicats et des organismes d’entreprise.
Rédigé semble-t-il en grande partie par Robert Grimm, cet appel se réclame de l’ " esprit du marxisme révolutionnaire " et se conclut par une invitation, adressée à tous les partis socialistes, à se réunir en février 1921 à Vienne pour fonder l’Internationale révolutionnaire universelle réconciliant le " centre " et la gauche du mouvement socialiste international. Il n’est guère question des alliances dans cette invitation, sinon de celle, organisationnelle, entre les partis réunis à Genève et ceux désormais organisés à Moscou. La révolution à laquelle les " centristes " font allusion, ils la conçoivent, dans le droit fil de l’orthodoxie marxiste, comme ouvrière et européenne. Si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est proclamé, y compris celui des peuples colonisés de la périphérie, ce n’est pas d’eux dont on attend le grand ébranlement. D’une certaine manière, tout en reprochant à la Troisième Internationale de céder à la tentation de proposer un modèle unique (léniniste) de passage au socialisme, le " centre " participe lui aussi d’une conception réductrice (parce qu’européocentriste et ouvriériste) du socialisme. Il est vrai que ce défaut est bien à l’époque le mieux partagé entre toutes les forces qui se réclament du socialisme et du mouvement ouvrier, de la droite social-démocrate à la gauche léniniste, les anarchistes eux-mêmes n’y échappant pas.
La première (et dernière) conférence de l’Internationale " Deux et demie " se réunit comme prévu en février 1921 à Vienne. Y participent les délégués de 20 partis socialistes de 13 pays, dont le PSS (représenté par Robert Grimm, E.-Paul Graber et Ernst Nobs). S’intitulant elle-même " Communauté de travail " (Arbeitgemeinschaft), la conférence ne se considère que comme le noyau constitutif d’une Internationale à venir, mais dont elle projette tout de même la structure : celle d’un Conseil ouvrier mondial, au sein duquel tous les courants du socialisme devraient être représentés, du réformisme travailliste britannique au bolchevisme russe. Ce " Conseil " serait composé de partis dont l’autonomie ne serait limitée que par des décisions majoritaires.

La conférence de Vienne ne s’est terminée que depuis quelques jours que, le 1er mars 1921, les marins de Cronstadt, fer de lance du mouvement révolutionnaire russe, se rebellent contre le pouvoir soviétique. Lénine voit, ou dit voir, injustement, dans ce mouvement situé sur sa propre gauche un mouvement " thermidorien ", contre-révolutionnaire, qu’il décide de faire " contre-thermidoriser " par Trotsky et Toukhatchevsky. La révolte de Cronstadt noyée dans le sang, Lénine impose un brutal virage à la révolution soviétique : le 15 mars, il proclame la " Nouvelle politique économique " (NEP, parfois traduite par " nouvelle économie politique "), afin de ranimer une économie paralysée par la guerre civile, une collectivisation forcenée et une mainmise brutale des services d’Etat sur le commerce et les échanges. En même temps, l’espoir d’une révolution mondiale s’amenuisant et le mouvement révolutionnaire européen étant hors d’Etat de provoquer le renversement du capitalisme " au centre ", c’est toute la stratégie de l’Internationale qui va changer. Pour assurer la viabilité de l’expérience soviétique, il importe d’assurer un minimum de coexistence (et d’échange) avec les puissances capitalistes. D’autre part, afin d’ancrer les partis communistes dans la réalité de leurs pays respectifs, l’alliance -répudiée il y a peu- avec la social-démocratie s’avère nécessaire. Le sectarisme révolutionnariste de 1919-1920 va céder le pas à une ligne de " front uni ", qui fait espérer nombre de responsables socialistes " centristes ", acteurs de l’Internationale " Deux et demie ", en une réunification du mouvement ouvrier sans création d’une nouvelle Internationale, mais par conjonction de la deuxième et de la troisième. La Deuxième Internationale est d’ailleurs elle-même tentée d’entamer des négociations directes avec l’IC, le départ de toute son aile gauche et d’une partie de son centre l’ayant considérablement affaiblie. Une conférence composée de représentants des trois Internationales se réunit à Berlin le 2 avril 1922. L’IC, représentée notamment par Karl Radek et Clara Zetkin, précise ce qu’elle entend par " front uni " et par " unité d’action " : non pas l’unification organisationnelle de mouvements contradictoires du triple point de vue de la théorie, de la stratégie et de la pratique, mais une alliance à la base. La Deuxième Internationale, représentée notamment par Mac Donald et Vandervelde, qui se méfie d’une alliance qui permettrait aux communistes d’endormir la vigilance des sociaux-démocrates pour mieux les annihiler, adhère elle aussi au projet d’ " unité à la base ". L’exemple de la Géorgie, récemment occupée par l’Armée Rouge, son gouvernement menchevik (disposant d’une majorité électorale et parlementaire) renversé au profit de bolcheviks ultra-minoritaires, et son indépendance d’Etat confisquée au profit d’une improbable union fédérative avec la Russie, cet exemple est là, tout récent, pour confirmer les sociaux-démocrates en leurs craintes. Quant à l’Internationale " Deux et demie ", celle des " centristes ", elle n’existe pas encore qu’elle est déjà, par l’accord " objectif " des deux autres pour en nier la légitimité et l’utilité, condamnée à la disparition. Il n’y aura finalement ni réunification du mouvement socialiste international, ni création d’une Internationale équidistante de la deuxième et de la troisième : en mars 1923, à Hambourg, la " droite " et le " centre " socialistes créent, ensemble, l’Internationale Ouvrière et Socialiste (IOS) -une Deuxième Internationale rénovée, mais la Deuxième Internationale, toujours.
L'IOS se donne pour objectif la réunion de toutes les tendances du socialisme démocratique, défini (au moins implicitement) par opposition au bolchevisme. Mais ce socialisme démocratique est multiple, et cette " nouvelle " Deuxième Internationale rassemble des partis de cultures politiques fort contrastées : marxistes orthodoxes et révisionnistes " bernsteiniens ", centriste réformistes et nationalistes s’y côtoient dans l’inlassable recherche d’un improbable consensus. Des thèmes essentiels sont passés sous silence, faute de synthèse possible entre des positions profondément contradictoires : ainsi de la " question coloniale ". La structure choisie, très décentralisée, ne limite pratiquement pas l’autonomie des partis affiliés, pas même par les décisions des congrès, rien n’étant réellement conçu pour que ces décisions puissent s’imposer aux partis réticents. Le PSS trouvera d’ailleurs les perspectives de l’IOS si peu prometteuses qu’il refusera dans un premier temps d’y adhérer, ne s’y résolvant qu’en 1927, au prétexte que l’IOS aurait alors pris des positions plus " radicales ", en réalité parce que le PSS lui-même aura alors rompu avec le " radicalisme " rhétorique qui fut le sien dans les années suivant la Grève Générale.
Quant au Comintern, il s’en prend d’abord et surtout à la gauche socialiste et social-démocrate (c’est-à-dire à la gauche de la social-démocratie), dont l’implantation entrave la sienne. Cette condamnation de la gauche socialiste par la gauche communiste sera d'ailleurs l'un des thèmes récurrents des diatribes par lesquelles les partis communistes d'Europe occidentale vont scander l’alternance de lignes unitaires et de lignes sectaires, dictées d’en haut par le Comintern (pour aboutir à ne plus être dictées que par la seule direction, puis le seul Chef, de l’Union Soviétique). On verra ainsi les communistes suisses traiter la gauche socialiste en général, les PP.SS genevois et vaudois spécialement, et Léon Nicole en particulier, d’ennemis plus dangereux pour la classe ouvrière que les " sociaux-démocrates droitiers " -qui eux ne sont en rien une " concurrence " pour le parti communiste. Bref, le Comintern salue la renaissance de la Deuxième Internationale par la condamnation de son aile gauche, c'est-à-dire de l'ancien " centre " de l’ancienne Internationale (l’USPD allemand, l’ILP britannique, le PSS même...) :
DEGRAS, The Communist International, 1919-1943, Document, London, 1960, T2, pp 30, 31
Quoi qu’il en soit, au printemps 1923, le mouvement ouvrier international s’est installé, et pour longtemps, dans la division. Division à tous les niveaux, dans tous les domaines. Division structurelle, organisationnelle, en deux Internationales rivales, souvent adversaires, parfois à deux doigts d'être ennemies. La Grande Guerre et la révolution d’Octobre ont bouleversé le champ du socialisme internationale. La " secte " bolchevique maîtrise à la fois le plus vaste Etat du monde et la Troisième Internationale, l’imaginaire des forces révolutionnaires mondiales et les instruments d’un pouvoir dictatorial, les symboles d’une société nouvelles ou affirmant l’être, et les pratiques des despotismes anciens. La social-démocratie, quant à elle, confiante (encore) en le caractère inéluctable du passage au socialisme, en a déduit une stratégie non seulement réformiste, mais surtout gradualiste, de plus en plus " pragmatique " et insérés dans le jeu " normal " des institutions politiques et sociales des démocraties bourgeoises, une fois les " spontanéistes " éliminés (qui, comme Rosa Luxemburg, pouvaient être et se dire à la fois sociaux-démocrates, révolutionnaires, anti-léninistes et anti-réformistes). Ce ne sont pas seulement deux stratégies, deux conceptions du socialisme et deux types de méthodes qui s’affrontent par l’affrontement des deux Internationales de l’entre-deux-guerres : ce sont aussi deux cultures politiques, et deux conceptions de l’histoire. Les sociaux-démocrates croient voir le monde capitaliste évoluer graduellement, pacifiquement, vers le socialisme, de par ses propres lois et les effets de ses propres créations, et ils se donnent pour tâche de maîtriser cette évolution, voire de la hâter -mais sans la brusquer. Lénine, lui, affirme la valeur du volontarisme révolutionnaire -en quoi il est, effectivement, un héritier de Blanqui. Certes, le capitalisme porte en lui la possibilité du socialisme, mais cette possibilité ne deviendra réalité que par le fait d’une rupture provoquée. Jacques Droz :
Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, op.cit.biblio pp 6643-644
Au vrai, Lénine n’a pas " découvert " l’impérialisme, ni n’a été le premier à en faire la théorie : Hilferding, Kautsky, Rosa Luxemburg, Boukharine en avaient déjà traité, d’un point de vue marxiste. Mais Lénine a fait du concept une stratégie dont l’efficacité fut telle qu’elle concourut à la prise (au " ramassage "...) du pouvoir par les bolcheviks.
Lénine avait pris la mesure du clivage apparu, au sein du mouvement ouvrier, entre des appareils engagés dans un système complexe de rapports officiels ou officieux avec le patronat et le pouvoir d’Etat, et des masses à qui le discours révolutionnaire continuait d’être tenu -et qui continuaient elles-mêmes à y trouver espérance. Il prit également la mesure de la force des aspirations paysannes dans les pays les moins développés d’Europe (dont le sien) et des aspirations nationales des peuples colonisés et dominés, d’Irlande à la Géorgie. Il sut enfin saisir l’occasion de la Grande Guerre pour en faire l’accoucheuse de la révolution. En réalité, la stratégie de prise du pouvoir par les bolcheviks repose moins sur ce qu’en écrivit Lénine que sur cette extraordinaire capacité de récupération de revendications impensées par le marxisme classique. La révolution d’octobre, et par voie de conséquence la Troisième Internationale, se fondent sur la rencontre et l’utilisation, extraordinairement habiles, de mouvements de révoltes contradictoires, dont aucun n’aurait sans doute pu aller au-delà de la révolution de février, mais dont la conjonction fit basculer celle-ci vers ce que Lénine en attendait : révolte des soldats sur le front, pour la paix ; révolte des ouvriers dans les villes, pour le pain ; révolte des paysans dans les campagnes, pour la terre ; révolte des nations opprimées, pour la liberté... La paix, le pain, la terre, la liberté : le programme bolchevik (dans son aspect et son expression les plus immédiatement perceptibles par ceux à qui il s’adressait est là, tout entier. Et toute entière, aussi, son efficacité.
Cette capacité léninienne de comprendre la réalité et d’en saisir au bond les occurrences et les opportunités (ce qui, effectivement, étymologiquement et historiquement fait de Lénine un opportuniste, au plein sens du terme) n’avait pas d’équivalent au sein du mouvement social-démocrate (Deuxième Internationale), ni même au sein du mouvement bolchevik. Le développement du mouvement communiste international put ainsi se nourrir des faiblesses " intellectuelles " d’un mouvement socialiste et social-démocrate qui ne manquait pourtant pas de théoriciens remarquables Kautsky, Bernstein, Bauer, Rosa Luxemburg...), mais qui fut totalement dépassé par les événements, incapables d’en prévoir les développements et d’en tirer les leçons.
Lénine toutefois savait qu’il ne serait pas possible à la seule Russie soviétique de " réaliser le socialisme " sans que l’Europe développée (l’Allemagne, l’Angleterre, la France, pour n’en citer que les principaux Etats) ne fasse elle aussi ne pas -ou qu’à tout le moins s’y développât un mouvement révolutionnaire puissant et efficace :
Jacques Droz, op.cit. p. 645
Le Comintern était l’outil de cette formidable attente. Et lorsqu’elle fut déçue en Europe, c’était à la périphérie qu’on se mit à en chercher les moyens. En même temps que la " tempête orientale " prit le pas sur la révolution occidentale dans l’imaginaire révolutionnaire européen, une ligne politique unitaire succédait à la ligne " classe contre classe " qui dressait face à face, irréductibles, les deux parts séparées du mouvement ouvrier international, et ses deux Internationales.
En dépit des mouvements révolutionnaires en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et des grèves de masse dans la quasi totalité de l’Europe, en dépit aussi de la " tempête " qui secoue la Chine et du réveil des nations colonisées -réveil dont l’importance stratégique ne sera perçue que lorsque tout espoir révolutionnaire aura à peu près disparu en Europe, le mouvement de contestation radicale du système marque le pas dès 1920 sans qu’à première vue se fussent produits des bouleversements fondamentaux. Mais ces mouvements ont néanmoins eu deux conséquences importantes : ils ont mis au monde l’ " Etat social ", comme moyen de désamorcer en " occident " la contestation radicale du système (et d’autres termes, ils ont " socialisé le capitalisme " pour le renforcer face à sa négation) et ils ont consacré la division du mouvement ouvrier en un mouvement social-démocrate (ou socialiste démocratique) et un mouvement communiste disposant chacun de " leur " Internationale. Le Comintern exigeait la transformation de tout mouvement de revendication en mouvement révolutionnaire, et liait systématiquement luttes nationales et luttes internationales, même lorsque les conditions de cette transformation et de ce lien n’étaient nullement remplies. Par opposition à ce volontarisme révolutionnariste, le mouvement socialiste international et les mouvements socialistes nationaux limitent l’extension de la contestation populaire à des revendications et des objectifs précis, concrétisables sans bouleversement radical d’un système social et politique qu’il s’agit de changer par une succession de réformes inscrites dans un cadre national (quoique le socialisme démocratique participât pleinement de l’espérance mondialiste et pacifiste exprimée par l’ " esprit de Genève ". L’Internationale socialiste n’est dans l’entre-deux guerres qu’un lieu d’information et de discussion, au mieux de concertation, ne ressemblant en rien à l’ " Etat-major révolutionnaire " que veut être le Comintern. Dès lors, les débats et les confrontations entre les deux fractions (ou factions ?) du mouvement ouvrier, les tentatives unitaires et leurs échecs, vont dominer les vingt années qui séparent la Grande Guerre de la Guerre Mondiale, et peser lourdement sur les choix internationaux des mouvements nationaux -au point de déterminer leurs politiques nationales. La gauche suisse n'échappera pas à cette détermination internationale de ses conduites nationales.
Les espoirs révolutionnaires de 1918 dissipés (défaite immédiatement imputée à la " trahison " de la droite social-démocrate et syndicale), la gauche socialiste et communiste tente de répondre au contrôle exercé sur les grandes organisations ouvrières par leurs ailes " modérées " (dites " droitières "), de deux manières et par deux stratégies différentes : la scission et l’ " unité à la base ". La scission : recréer, à côté des anciennes structures une nouvelle organisation politique et une nouvelle structure syndicale (au sein de l’USS dans un première tentative, au-dehors ensuite), capables de concrétiser la volonté de rupture insatisfaite en 1918. Plus subtile, l’ " unité à la base " : puisque les " appareils " sociaux-démocrates et trade-unionistes empêchent l’expression concrète de la volonté révolutionnaire, et dans l’hypothèse (optimiste) d’un fort courant " radical " à la base, on tentera d’unir les forces syndicales et politiques de la gauche révolutionnaire dans des actions concrètes sans passer par des accords ou des négociations d’organisation à organisation (ou de tendances à directions) -d’autant que le rapport des forces entre les deux ailes du mouvement est de toute évidence très largement défavorable aux " révolutionnaires ". Pratiquées alternativement, et parfois conjointement (la dénonciation de la " trahison des chefs " sociaux-démocrates s’accompagnant d’un appel aux militants socialistes à collaborer sur le terrain avec les militants communistes), ces deux méthodes vont se succéder, se " chevaucher " même, jusque dans les années de la Guerre Mondiale, avec une brusque inflexion unitaire dès l’apparition de la menace fasciste, et plus encore au moment de la constitution du gigantesque front international au sein duquel, dès 1941, l’Union Soviétique se retrouve alliés des " impérialistes anglo-saxons ", puisqu’agressée par le même ennemi.
Dans chacune des tentatives " unitaires ", comme lorsque chacune des scissions qui se produisirent entre 1918 et 1939-1940, la " question internationale " -et tout particulièrement l’attitude à l’égard de l’Union Soviétique- jouera un rôle primordial. Au sein du PSS, le débat s’engage en 1918, avec les prémices que l’on sait dès 1917. Un premier Parti communiste suisse se crée l’année même de la Grève Générale : c’est le parti des " vieux communistes ", très minoritaire, sans implantation réelle, sans organisation efficace, et à vrai dire plus anarchiste que communiste, et qui fera long feu. La question de l’adhésion à la Troisième Internationale sera d’une toute autre ampleur : elle provoquera de fait l’éclatement du mouvement socialiste, et celui de la gauche socialiste elle-même, non seulement par la création d’une section suisse de la Troisième Internationale, mais aussi par le refus d’une partie de l’aile gauche du PSS de quitter la " vieille maison ", d’où une aggravation des contradictions au sein du PSS, et dans une moindre mesure de l’USS, entre les majorités " modérées " et les minorités de gauche, affaiblies par le passage d’une bonne partie de leurs cadres et de leurs militants au PCS, mais restant néanmoins souvent majoritaires dans certaines sections urbaines -du moins au sein de leurs directions.
A Bâle, le congrès du PSS avait décidé par 459 voix contre une de quitter le Deuxième Internationale, et par 318 voix contre 147 d’adhérer à la Troisième, mais, ajoute Jules Humbert-Droz,
Jules Humbert-Droz, mon évolution... op.cit. biblio p. 314
La décision de rompre avec la " vieille maison " ne posait évidemment pas -et le résultat des votes sur les deux questions l’indique clairement- des problèmes d’ampleur comparable à celle de l’affiliation à la Troisième Internationale : la première décision fut acquise à la quasi unanimité (on sait l’état dans lequel se trouvait la Deuxième Internationale su sortir de la guerre, et l’image lamentable qu’elle avait donné d’elle-même pendant les quatre années du conflit) ; la seconde décision fut combattue par une forte minorité du congrès. Dans un congrès du parti, c’est-à-dire l’instance où la gauche est la mieux représentée, où ses militants tiennent le haut du pavé et de la tribune, et parviennent souvent à imposer leurs choix aux " notables " et aux membres " inactifs ", il se trouve tout de même un tiers des délégués (147 sur moins de 500) pour s’opposer à l’adhésion à l’Internationale de Lénine, aux conditions de Lénine. Cette forte minorité sais pouvoir s’appuyer sur les secteurs traditionnels, réformistes, " patriotiques ", du parti -sur sa base " grutléenne ", en somme. Les délégués de la minorité feront usage de leur droit statutaire de référendum et provoqueront une consultation générale de tous les membres du PSS, comptant bien que ce corps électoral se révélera bien moins " révolutionnaire " que les cadres militants partisans de l’adhésion au Comintern.
Le vote du Congrès fut en effet annulé par la " base ", qui se prononça clairement, par 14'364 voix contre l’adhésion à la Troisième Internationale, 8'599 votes y étant favorables. Les sections de la " gauche " (Zurich, Genève, notamment) confirmèrent le choix du congrès, mais le " parti profond " le désavoua. La publication, en 1920, des " 21 conditions " posées par Lénine à l’adhésion au Comintern sonnera le glas des espoirs de la gauche révolutionnaire. Ces conditions, en effet, auraient, si le PSS les avaient accepté, provoqué un véritable bouleversement de la stratégie, de la pratique, des structures, du projet politique même, et de toute la culture et de la symbolique politique du PSS. Qu’on en juge :
1.
La propagande et l’agitation quotidiennes doivent avoir un caractère effectivement communistes et se conformer au programme et aux décisions de la Troisième Internationale. Tous les organes de la presse du parti doivent être rédigés par des communistes sûrs, ayant prouvé leur dévouement à la cause du prolétariat. Il ne convient pas de parler de dictature prolétarienne comme d’une formule apprise et courante ; la propagande doit être faite de manière à ce que la nécessité en ressorte pour tout travailleur, pour toute ouvrière, pour tout soldat, pour tout paysan, des faits mêmes de la vie quotidienne, systématiquement notés par notre presse. La presse périodique ou autre et tous les services d’édition doivent être entièrement soumis au Comité central du Parti, que ce dernier soit légal ou illégal. Il est inadmissible que les organes de publicité mésusent de l’autonomie pour mener une politique non conforme à celle du Parti. Dans les colonnes de la presse, dans les réunions publiques, dans les syndicats, dans les coopératives, partout où les partisans de la Troisième Internationale auront accès, ils auront à flétrir systématiquement et impitoyablement non seulement la bourgeoisie, mais aussi ses complices, réformistes de toutes nuances.
2.
Toute organisation désireuse d’adhérer à l’Internationale communiste doit régulièrement et systématiquement écarter des postes impliquant tant soit peu de responsabilité dans le mouvement ouvrier (organisations de Parti, rédactions, syndicats, fractions parlementaires, coopératives, municipalités) les réformistes et les " centristes " et les remplacer par des communistes éprouvés -sans craindre d’avoir à remplacer, surtout au début, des militants expérimentés par des travailleurs sortis du rang.
3. (nécessité de l’action illégale)
4. (agitation dans l’armée)
5. (agitation dans les campagnes)
6.
Tout parti désireux d’appartenir à la Troisième Internationale a pour devoir de dénoncer autant que le social-patriotisme avoué, le social-patriotisme hypocrite et faux ; il s’agit de démontrer systématiquement aux travailleurs que, sans le renversement révolutionnaire du capitalisme, nul tribunal arbitral, nul débat sur la réduction des armements, nulle organisation " démocratique " de la Ligue des Nations ne peuvent préserver l’humanité des guerres impérialistes.
7.
Les partis désireux d’appartenir à l’Internationale Communiste ont pour devoir de reconnaître la nécessité d’une rupture complète et définitive avec le réformisme et la politique du centre et de préconiser cette rupture parmi les membres des organisations. L’action communiste conséquente n’est possible qu’à ce prix.
L’Internationale Communiste exige impérativement et sans discussion cette rupture qui doit être consommée dans le plus bref délai. L’Internationale Communiste ne peut admettre que des réformistes avérés, tels que Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet, Mac Donald, Modigliani et autres aient le droit de se considérer comme des membres de la Troisième Internationale, et qu’ils y soient représentés. Un pareil état de choses ferait ressembler par trop la Troisième Internationale à la Deuxième.
8. (question coloniale)
9.
Tout parti désireux d’appartenir à l’Internationale Communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés, dont le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme. Leur devoir sera de révéler à tout instant la trahison des social-patriotes et les hésitations du " centre ". Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l’ensemble du parti.
10. (lutte contre l’Internationale des syndicats d’Amsterdam)
11.
Les Partis désireux d’appartenir à l’Internationale Communiste ont pour devoir de réviser la composition de leurs fractions parlementaires, d’en écarter les éléments douteux, de les soumettre, non en paroles mais en fait, au Comité central du Parti, d’exiger de tout député communiste la subordination de toute son activité aux intérêts véritables de la propagande révolutionnaire et de l’agitation.
12.
Les partis appartenant à l’Internationale Communiste doivent être édifiés sur le principe de la centralisation démocratique. A l’époque actuelle de guerre civile acharnée, le Parti communiste ne pourra remplir son rôle que s’il est organisé de la façon la plus centralisée, si une discipline de fer confinant à la discipline militaire y est admise et si son organisme central est muni de larges pouvoirs, exerce une autorité incontestée, bénéficie de la confiance unanime des militants.
13.
Les partis communistes des pays où les communistes militent légalement doivent procéder à des épurations périodiques de leurs organisations, afin d’en écarter les éléments intéressés et petit-bourgeois.
14. (soutien des partis communistes aux Républiques soviétiques dans leur combat contre les forces contre-révolutionnaires)
15. (adaptation des programmes des partis)
16.
Toutes les décisions des congrès de l’Internationale Communiste, de même que celles du Comité exécutif, sont obligatoires pour tous les partis affiliés à l’Internationale Communiste. Agissant en période de guerre civile acharnée, l’Internationale communiste et son Comité exécutif doivent tenir compte des conditions de lutte si variées dans les différents pays et n’adopter de résolutions générales et obligatoires que dans les questions où elles sont possibles.
17. (modification de l’appellation du nom des partis membres)
18.
Tous les organes dirigeants de la presse des partis de tous les pays sont obligés d’imprimer tous les documents officiels importants du Comité exécutif de l’Internationale Communiste.
19. (obligation de discuter des 21 conditions dans un congrès extraordinaire de chacun des partis)
20.
Les partis qui voudraient maintenant adhérer à la Troisième Internationale mais qui n’ont pas encore modifié radicalement leur ancienne tactique, doivent préalablement veiller à ce que les deux tiers des membres de leur Comité central et des institutions centrales les plus importantes soient composées de camarades qui, déjà avant le Deuxième congrès, s’étaient ouvertement prononcés pour l’adhésion du Parti à la Troisième Internationale. Des exceptions peuvent être faites avec l’approbation du Comité exécutif de l’Internationale Communiste. Le Comité exécutif se réserve le droit de faire des exceptions pour les représentants de la fraction centriste mentionnés dans le paragraphe 7.
21. Les adhérents qui rejettent les conditions et les thèses établies par l’Internationale Communiste doivent être exclus du Parti. Il en est de même des délégués au Congrès extraordinaire.
Thèses, manifestes et résolutions adoptées par les Ier, IIe, IIIe et IVe congrès de l’Internationale Communiste (1919-1923), Maspero, Paris, 1970
Lénine et la direction du parti bolchevik avaient ainsi fait le choix de la cohérence et de l’épuration, contre celui de la représentativité et du compromis avec les " centristes " (quoique la 20ème condition permît d’accepter quelques uns d’entre eux). Il fallait s’assurer de la qualité des sentiments révolutionnaires des adhérents, et plus encore de ceux des cadres et des dirigeants, et cela en éliminant le plus possible de " modérés ", de " centristes ", de " réformistes " et, bien entendu, de " social-patriotes " (encore que l’on admit, mais avec quelques hésitations, un homme comme Marcel Cachin, dont le passé politique " social-patriote " ne plaidait guère en faveur de ses nouvelles convictions communistes). Le PSS eut-il confirmé le choix de son congrès d’adhérer à la IIIème Internationale que celle-ci, sans doute, n’en aurait pas voulu, le repoussant comme elle repoussa le PS italien et comme elle faillit repousser l’adhésion de la majorité du PS-SFIO français (du moins de la majorité de son congrès de Tours), devenu PC-SFIC. Pourtant, un double discours pouvait être tenu, au sommet même du Comintern. Au Congrès des Peuples de Bakou, Zinoviev lance en ces termes son " Adresse inaugurale " :
Le Congrès des Peuples de l’Orient à Bakou, Maspero, Paris, op.cit.biblio pp 29, 30
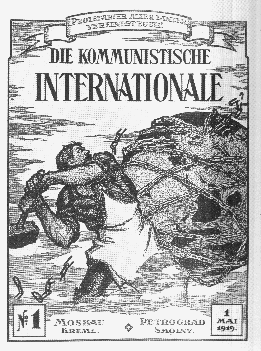
Les " 21 conditions " et le Congrès de Bakou marquent ensemble l’année 1920, mais par deux discours différents, et sur certains points contradictoires : à l’ " avant-garde ", au mouvement ouvrier du centre, est imposée la scission ; aux " masses colonisées ", au mouvement de libération nationale de la périphérie, est proposé le rassemblement. C’est bien évidemment le premier de ces discours qui est entendu par le mouvement suisse, parce qu’à lui adressé comme aux mouvements des pays voisins. Et le congrès de Berne du PSS, du 10 au 12 décembre 1920, repousse définitivement la proposition, désormais totalement minoritaire, d’adhésion au Comintern, après de violentes discussions lors desquelles les " 21 Conditions " jouent à plein le rôle d’ " épouvantail contre les réformistes " que Lénine lui-même leur assignait ; le Volksrecht le confirme, à sa manière :
Volksrecht du 16 décembre 1920
Par 350 voix contre 213, le Congrès refusa l’organisation internationale centralisée, verticale, hiérarchisée, que les bolcheviks proposaient comme état-major de la révolution mondiale. Un nouveau référendum est organisé, qui confirme le refus d’adhésion, avec une majorité plus massive encore que lors du précédent : par 25'475 voix contre 8'477. La gauche révolutionnaire ne se tenant pas encore pour vaincue provoqua un troisième référendum, au niveau des sections, sur la proposition de création d’une section suisse de la IIIème Internationale. Elle y fut plus nettement battue encore (mais il ne s’agissait plus que de se compter, non de gagner), seules les cantons de Schaffhouse et de Bâle-Ville acceptant la proposition, Genève elle-même la refusant à une majorité des deux tiers (ce qui donnait tout de même la proportion acceptante la plus forte de Romandie). La gauche socialiste se trouva alors elle-même divisée, entre ceux qui ne désespéraient pas, malgré tout, de changer le parti de l’intérieur, et décidèrent d’y rester, et ceux qui, considérant l’affaire comme réglée et le PSS définitivement " perdu ", décidèrent de le quitter pour former la section suisse de la nouvelle Internationale. En décembre 1920, la gauche révolutionnaire avait quitté le congrès de Berne en claquant la porte, faisant savoir haut et fort qu’elle n’en acceptait pas la décision et qu’en faisant appel aux sections, elle entendait préparer la création d’un Parti communiste suisse :
Le mouvement ouvrier suisse, op.cit. pp 202, 203
Le 6 mai 1921 eut lieu le " Congrès d’unification " entre les socialistes de gauche en rupture de PSS et le Parti Communiste Suisse, dit des " Vieux Communistes ". Bâle fut choisie comme siège du PCS et Franz Welti élu à sa présidence )il sera démis de cette fonction en 1929 par le Comintern, sur intervention notamment de Jules Humbert-Droz). Le PC s’attendait à " engranger " la plupart des militants de la gauche socialiste : il fut déçu. Aux quelques centaines de " vieux communistes " s’ajoutèrent tout au plus 4000 nouveaux membres ; moins de la moitié des partisans de la nouvelle Internationale au sein du PSS (les 8877 " oui " à l’adhésion lors du deuxième référendum interne) firent le choix de la scission. Dans un canton comme Genève, où la gauche socialiste était fortement et durablement implantée, où le second référendum interne avait produit le résultat le moins écrasant de Romandie, et où, enfin et surtout, des hommes comme Jacques Dicker et Léon Nicole donnaient au parti une tonalité plus radicale qu’ailleurs (malgré une aile droite vivace), le PC ne compta pas plus d’une centaine de membres, et ne sera jamais soutenu, jusqu’à sa fusion de fait avec le PSG " nicoliste ", par plus de 3 % des électeurs. La gauche socialiste genevoise, favorable à l’adhésion du PSS au Comintern, ne l’était pas à la scission et fit le choix de rester au sein d’un parti dont elle désapprouvait la ligne, la stratégie et la méthode d’action, mais auquel elle ne concevait pas d’alternative viable. Les membres du PCS se recrutèrent ainsi surtout dans les villes industrielles du nord de la Suisse, en particulier à Schaffhouse et à Bâle, parmi les ouvriers du bâtiment et de la métallurgie et au sein de l’Intelligentsia " gauchiste ". Les cadres du nouveau parti, l’essentiel de ses militants, provenaient du PSS. Si une bonne moitié de la gauche socialiste décida de rester au sein du parti " originel ", ceux qui le quittèrent étaient tout de même parmi les plus actifs de ses militants, et parmi les plus sensibles à la " problématique internationale ". Il s’en suivit un certain repli du socialisme suisse sur les questions intérieures, une certains désaffection à l’égard de l’Internationale -ce que l’expérience malheureuse de l’ " Internationale deux-et-demie " et le triste état de la Deuxième Internationale ne furent pas sans encourager. Les crises des années trente allaient cependant " remettre les pendules à l’heure " et susciter à nouveau débats et encouragements internationaux.
Pendant des décennies, les deux ailes du mouvement ouvrier vont se combattre. Au moment de la fondation du PCS, certains cartels syndicaux (Zurich, Bâle, Schaffhouse) se retrouvent, sinon contrôlés, du moins fortement influencés par la gauche révolutionnaire devenue communiste. Les directions syndicales restaient toutefois aux mains de l’aile " modérée " de l’USS, c’est-à-dire de l’aile droite du mouvement ouvrier suisse. Les communistes vont donc tenter de former des cellules dans les organisations syndicales où ils sont présents, puis de s’organiser en fraction au sein de l’USS, comme le Comintern puis la Profintern (l’ " Internationale Syndicale Rouge ") les y incitaient. Les directions syndicales réprimèrent sèchement ces tentatives " fractionnistes ". En 1920, la proposition de création d’une " Union Ouvrière Suisse " fut présentée par la gauche syndicale au congrès de Neuchâtel de l’USS -avant même que les " minoritaires " du PSS aient quitté le parti. La gauche syndicale s’appuyait sur des unions ouvrières locales pour faire pièce aux fédérations syndicales tenues par la droite, et obtenaient par ce moyen une représentation lors des congrès qui dépassait de loin sa représentativité réelle au sein du mouvement syndical. Après que l’on eût refusé (statutairement) d’accorder le droit de vote à tous les représentants des unions ouvrières, le cartel syndical bâlois proposa la constitution d’une Union Ouvrière Suisse, dont les décisions eussent été obligatoires pour le PSS et l’USS, proposition appuyée (sous une autre forme) par la Fédération des ouvriers du commerce, des transports et de l’alimentation (FCTA), mais repoussée finalement par le congrès en un vote serré (132 voix contre et 92 pour). L’alerte fut suffisante pour que la droite syndicale obtienne une modification des statuts de l’USS, privant les unions ouvrières et les cartels locaux du droit de représentation lors des congrès. Pendant plusieurs années, la lutte au sein de l’USS va mettre aux prises une gauche révolutionnaire désormais identifiable comme communiste et les directions syndicales, situées à l’aile droite du mouvement ouvrier national. Après la création du PCS, les fédérations de la métallurgie (FOMH) et des typographes (FST) procédèrent purement et simplement à la dissolution de celles de leurs sections qui étaient contrôlées par les communistes -ce fut le cas à Zurich en 1922.
En 1921, le PCS lança une proposition de " Front unique prolétarien " au PSS, à l’USS, à l’Union fédérative du personnel fédéral et aux cartels syndicaux cantonaux, proposition directement inspirée des consignes stratégiques unitaires données par le Comintern :
Le mouvement ouvrier suisse, op.cit. pp 204, 205
Comme prévisible, quelques mois seulement après la fondation du PCS par scission du PSS, la réponse de celui-ci à cette proposition (dont les auteurs n’attendaient d’ailleurs pas qu’elle fût acceptée) sera négative :
Le mouvement ouvrier suisse, op.cit. pp 205, 206
Les syndicats, de même, et plus rudement encore, refusent la proposition communiste. Plus rudement, car le conflit au sein des syndicats de l’USS -où les communistes sont restée, portant à l’intérieur le fer de la controverse qui les oppose au PSS de l’extérieur- a pris des formes pernicieuses. En 1921, le PCS édicte des " directives " sur l’activité des communistes au sein des syndicats. Le " fractionnisme " s’y avère, sans précaution de style :
I. Nos tâches :
(...)
3. Lutte contre la politique réformiste des communautés de travail. Lutte contre les conventions salariales, dans la mesure où leur contenu signifie un empêchement à participer aux grèves et aux actions de solidarité.
4. Propagation des actions de solidarité et des actions de masse politiques.
(...)
6. Propagande pour le contrôle de la production par la classe ouvrière.
7. Propagande pour le retrait de l’Internationale d’Amsterdam et l’adhésion à l’Internationale syndicale rouge des conseils.
8. Contrôle de la bureaucratie syndicale et lutte contre les réformistes à l’intérieur des syndicats.
II. Organisation :
Le mouvement ouvrier suisse, op.cit. p. 207
Le projet syndical des communistes est clair : constituer à l’intérieur du mouvement syndical réformiste une organisation qui en soit structurellement le calque (fractions syndicales à tous les niveaux de l’organisation, regroupées géographiques et socio-professionnellement, face à chaque instance de l’USS, et dirigées par un comité central qui fera face à la direction de l’USS). Tentative évidement inacceptable pour l’USS, qui va dès lors se " débarrasser " des communistes en les excluant et en dissolvant les instances syndicales qu’ils contrôlent pour pouvoir ensuite les reconstituer sans eux. La perte ultime par le PC, début 1924, de la direction du cartel syndical zurichois marque la fin des espoirs communistes de conquérir une place déterminante dans l’organisation syndicale. L’alternative, pour les communistes, se résume dès lors en la marginalisation au sein de l’USS (sans plus de possibilités de s’y organiser spécifiquement) ou en dehors de l’USS (par la création, avortée, d’un nouveau mouvement syndical, communiste et révolutionnaire, concurremment à l’USS social-démocrate et aux syndicats chrétiens.
Ces luttes fratricides se déroulent sur fond de crise : crise internationale, crise nationale. Depuis 1920, les économies occidentales ont plongé dans la déflation. En 1922, le nombre des chômeurs atteint les 100'000 et les pertes de salaires deviennent la règle pour ceux des travailleurs qui ont conservé leur emploi. Après les années de privation dues à la Grande Guerre, après l’échec (même relatif) de la Grève Générale, le mouvement ouvrier suisse est affaibli -et de plus, en état de scission. Les effectifs syndicaux diminuent, alors même que le réseau des conventions collectives s’élargir et que les détenteurs bourgeois du pouvoir politique prennent conscience de la nécessité de mener une politique sociale capable de prévenir les effets politiques de la crise économique. En 1923, le Cartel syndical neuchâtelois et la FOMH, sous l’impulsion d’Edouard Spillmann, de René Robert et de Pierre Aragno, présente un projet ambitieux, significativement intitulé " Restauration de l’industrie horlogère " : Face à la crise, et après avoir consulté non seulement des militants syndicaux et des responsables politiques socialistes, mais aussi des chefs d’entreprise, il ne s’agit plus de proposer un autre modèle de société mais de restaurer la prospérité d’un secteur économique, en développant certes un système de protection sociale digne de ce nom, en associant les syndicats à la définition des politiques des entreprises et des secteurs économiques, mais sans changer les règles du jeu économique et social. Le projet neuchâtelois accorde une importance capitale à la rationalisation de la production et à la concertation entre patronat et syndicats. Accueilli avec indifférence ou suspicion par les dirigeants de l’industrie horlogère, avec une franche hostilité par la gauche syndicale et socialiste, dénoncé comme une trahison par les communistes, Restauration de l’industrie horlogère préfigurait à la fois la Paix du Travail, les politiques économiques concertées entre organisations patronales et ouvrières et les projets corporatistes des années à venir. En 1924, le patronat de l’horlogerie créée la Fédération Horlogère ; en 1926 est fondée Ebauches S.A. et en 1931 le " superholding " de la Société générale de l’industrie horlogère, au sein de laquelle siégeait, comme représentant de la Confédération, le syndicaliste René Robert. De 1925 à 1930 se créent par ailleurs de nombreux holdings dans d’autres branches, dont ceux de l’industrie chimique et, dans l’industrie électro-mécanique, Brown Boveri.
Dès le début des années vingt, les conflits ouvriers diminuent en nombre et en intensité, et portent pour l’essentiel sur le maintien des droits acquis entre 1918 et 1921. Entre 1920 et 1925, les effectifs de l’USS fondent, passant de 223'572 membres en 1920 à 149'997 en 1925. Ceux du PSS tombent de 53'910 membres en 1920 à 30'742 en 1924. La scission communiste est très loin d’être seule, ou même principale, responsable de cette " plongée " : absence de perspectives politiques et crise économique se conjuguent pour " démoraliser " la classe ouvrière. Ni le PCS, ni l’Opposition syndicale révolutionnaire ne profitent de ce recul de l’influence social-démocrate -un recul qui ne se traduit d’ailleurs pas en un recul électoral, puisque le PSS qui avait obtenu 23,5 % des suffrages lors des élections fédérales de 1919 en obtiendra toujours 23,3 % en 1922, et passera à 25,8 % en 1925, le PCS stagnant péniblement à 1,8 % en 1922 et 2 % en 1925). Les travailleurs désertent les syndicats et le parti, mais continuent de voter pour le parti (sans doute faute de mieux...).
L’aile la plus réactionnaire du patronat et des partis bourgeois va tenter de profiter au maximum de la situation, que contribue encore à dégrader l’ambiance internationale : stalinisation de l’URSS, prise du pouvoir par les fascistes en Italie, instauration un peu partout en Europe de régimes au moins autoritaires, souvent dictatoriaux, parfois totalitaires -mais toujours réactionnaires. Les références étrangères se multiplient, aux ailes " extrêmes " de l’ " arc politique " national (communistes à gauche, ultra-réactionnaires fascistes ou fascisants à droite). Les socialistes " modérés " et leurs alliés de l’USS sont dès lors de plus en plus tentés de voir en un repli sur la " démocratie suisse ", si imparfaite qu’elle soit, le moyen le plus efficace de préserver les droits politiques et sociaux acquis par et pour les travailleurs, et de préparer le passage pacifique et harmonieux à une société différente (puisqu’ils expriment toujours cette ambition, au moins rhétoriquement). Ces premières " rectifications " de la ligne officielle du socialisme suisse, dont l’expression finale sera le programme du PSS de 1935, annoncent le grand tournant des années trente : l’intégration des deux organisations hégémoniques du mouvement ouvrier suisse dans le consensus politique créé autour de l’idée et de la pratique de la démocratie telle qu’elle est, dans l’état où elle est. Parallèlement à cette intégration, le rapport au monde extérieur, tant au plan symbolique que pratiquement, connaîtra une nouvelle métamorphose : après la solidarité pacifiste des années de guerre, après les tentations révolutionnaires des années 1917-1925, la solidarité internationale va se trouver placée sous le signe de l’antifascisme. Pour la social-démocratie, mais aussi pour une part croissante de la gauche socialiste, la démocratie bourgeoise ne sera plus l’adversaires à abattre, mais, pour les uns la citadelle en laquelle on se repliera face à un ennemi nouveau, et pour les autres un instrument du combat contre cet ennemi.
Dès 1922, donc, le climat change : l’avènement du fascisme suscite à la fois l’engagement de la part majoritaire du mouvement ouvrier suisse dans la défense des libertés démocratiques, si insuffisantes qu’il les considère, et les tentatives de la " droite de la droite " de renégocier les conditions mêmes de ces libertés, par leur restriction. Le 24 septembre 1922, le peuple est appelé à se prononcer sur un projet de loi (la " Lex Häberlin " première mouture -il y en aura une autre) se donnant pour objectif la répression de la " subversion ", et soumis à référendum facultatif à l’appel de la gauche. La droite patronale, par la voix de l’Union Suisse des Arts et Métiers prend fait et cause pour la loi :
In Neue Zürcher Zeitung du 23 septembre 1922
Malgré la campagne massive de la droite, la " Lex Häberlin I " succombe à l’offensive référendaire de la gauche, unie pour l’occasion face à une tentative de restriction des libertés de manifestation et de réunion qui eût permis une répression accrue, et plus efficace, des activités de toutes les organisations de gauche, y compris le PSS et l’USS. Vote de gauche, que ce vote populaire ? Votre démocratique, plutôt, provoqué par la gauche mais que la gauche seule n’eût pas remporté : elle pesait alors un quart de l’électorat, en la même année, le PSS subit une défaite face au peuple lorsque son initiative fiscale, instituant un impôt unique sur la fortune, succomba en votation, non pour son contenu propre mais pour le caractère " communiste " que la propagande de la droite réussit à lui attribuer...).
Au lendemain du refus de la " Lex Häberlin I ", la droite ne se tint pas pour battue. Les agrariens bernois invoquent l’exemple fasciste et menacent de s’en inspirer :
* Le fascisme ? Attendons... pas encore... Quand il sera temps... mais la tentation est là, pour le moins. Et la menace explicite.
in Berner Tagwacht du 25 novembre 1922
Les agrariens bernois attendent les élections fédérales de l’automne 1922 pour savoir si le " danger révolutionnaire " (qu’ils voient manifesté par la représentation parlementaire de la gauche en général, de l’aile droite de la social-démocratie aux communistes) se révélera plus pressant... Inquiétudes pour le moins excessives (et curieux instrument de mesure), formulées à usage d’ " agit-prop " plus que par conviction intime ; inquiétude que les résultats électoraux auraient été de nature à calmer, à supposer qu’ils pussent être considérés comme un " thermomètre " crédible pour les fièvres politiques, et à supposer aussi que les agrariens bernois aient in instant cru en leur propre discours. En 1919, le PSS avait obtenu 23,5 % des suffrages et 41 sièges ; en 1922, PSS et PCS ensemble totalisent 25,3 % des suffrages et 45 sièges (deux pour le PC). Pas de " poussée révolutionnaire ", mais une légère progression de la gauche, et une grande stabilité du PSS, lors même que ses effectifs chutaient et que ceux du PCS stagnaient. Second parti du pays en importance électorale et parlementaire, le PSS se retrouve toujours isolé, minorisé par la " triple alliance " des radicaux, des agrariens (le nouveau Parti des Paysans, Artisans et Bourgeois) et des catholiques-conservateurs. Contre ce bloc, uni sur l’essentiel, c’est-à-dire contre elle, la gauche reste d’autant plus minoritaire qu’elle est au surplus divisée (entre PSS et PCS et, au sein du PSS, entre gauche socialiste et droite social-démocrate). Le rapport des forces parlementaires et électorales entre la gauche et la droite, tous partis confondus, est d'ailleurs resté en Suisse d'une remarquable stabilité depuis trois quarts de siècle : la gauche " pèse " entre un quart et un tiers de l’électorat, selon que l’on prend ses moments de plus grande faiblesse (1987) ou de plus grande force (1947).
On l’a vu, les effets de la scission communiste pèsent sur l’action nationale du mouvement ouvrier suisse. On en verra également les effets sur ses choix et ses pratiques internationalistes. La contradiction est double : non seulement le PCS et l’Opposition syndicale révolutionnaire combattent " de l’extérieur " (du moins en ce qui concerne le PC et le PS) les deux organisations hégémoniques du mouvement ouvrier suisse, le PSS et l’USS, mais à l’intérieur même de ces deux organisations, il y a conflit entre l’aile gauche (restée dans l’ " organisation-mère " au moment de la scission), rendue plus minoritaire par le départ ou l’exclusion des communistes, et la majorité " modérée " (Grimm) ou " droitière " (Ilg) convaincue que les proclamations révolutionnaires encore inscrites dans les textes fondamentaux ne font de mal à personne (pour l’instant) à condition de n’être suivies d’aucun effet. Le programme " gauchiste " de 1920 du PSS permet d’ailleurs toutes les interprétations, et s’il se réfère à la dictature du prolétariat, il participe aussi d’une espérance humaniste parfaitement compatible avec le réformiste social-démocrate :
in Socialisme Jurassien, Le Peuple Jurassien ed. s.l.n.d., p. 38
D’agissant des débats et des contradictions au sein du mouvement ouvrier, la situation romande présente d’ailleurs un caractère original, qui la distingue nettement de la situation alémanique. Il y a en Romandie à la fois persistance d’un assez fort courant libertaire au sein du mouvement ouvrier, et échec plus prononcé de la scission communiste. Persistance libertaire : en 1922, Luigi Bertoni convoque à Saint-Imier un congrès anarchiste de commémoration du cinquantième anniversaire de l’Internationale " antiautoritaire ", et le fait suivre d’une assemblée anarchiste internationale à Bienne, le 16 septembre : " les anarchistes sont toujours là ! "... Quant au PC, il se trouve en Romandie dans la situation paradoxale d’être parfois confronté (notamment à Genève et Lausanne) à des socialistes plus " à gauche " qu’ailleurs, et en conflit ouvert avec le PSS, et s’être dans ces mêmes villes plus faibles que dans les villes alémaniques. Alors qu’en Alémanie la plupart des militants de la gauche révolutionnaire et internationaliste du PSS ont, au moins pour un temps, rejoint le PC (quitte à revenir ensuite au PS, comme le feront Walter Bringolf ou Jules Humbert-Droz, par exemple), en Romandie la majorité de ces militants sont restée au sein du PS. De la coexistence (parfois fort peu pacifique) au PS d’une tendance " droitière " (Naine, Robert) et d’une tendance " gauchiste " (Jeanneret-Minkine, Nicole) vont naître d’innombrables frictions, allant souvent jusqu’au conflit ouvert et parfois jusqu’à la scission, pour culminer en 1939 dans l’exclusion pure et simple, et collective, des " nicolistes " du PSS, au prétexte de leur acceptation du pacte germano-soviétique (acceptation en effet injustifiable, mais prétexte néanmoins). En 1924 éclate au sein du parti vaudois l’une de ces crises : lors du procès Conradi (cf infra), Maurice Jeanneret-Minkine, leader lausannois de la gauche socialiste vaudoise, était le correspondant des Izvestia soviétiques (l’organe du gouvernement, la Pravda étant celui du parti). Naine, leader de l’aile droite du PSV, l’accepte si mal qu’il fait carrément scission et créée un mouvement dissident, le Parti socialiste démocratique. En janvier 1924, le congrès du PSV, contre l’avis de la section de Lausanne, vote l’exclusion de Jeanneret-Minkine, prononcée le 30 octobre par le Comité central du PSS. Naine réintègre alors les rangs du PSV, et c’est au tour de Jeanneret-Minkine de créer une nouvelle organisation, curieusement baptisée " Parti travailliste " (curieusement, puisque l’étiquette " travailliste " renvoie au Labour britannique, qui se situe plutôt sur la droite du mouvement socialiste international, alors que Jeanneret-Minkine se situe sur sa gauche). Finalement réadmis au sein du PSV, Jeanneret-Minkine restera fidèle à ses choix " prosoviétiques ", à l’instar de Léon Nicole (mais celui-ci contrôlait le parti genevois, alors que Jeanneret était minoritaire dans le parti vaudois) et de la majorité (mais non de la totalité) de l’aile gauche du PSS.
De tels épisodes sont nombreux, récurrents. Ils témoignent des effets directs des événements internationaux sur la vie " intérieure " des organisations nationales. La révolution russe et ses répercussions nous avaient permis déjà de vérifier cette sensibilité -sans pour autant nous convaincre qu’elle se soit toujours traduit par un sens solidaire accru : l’ " effet international " est souvent plus symbolique que pratique. Les années vingt et trente confirment cette hypothèse : à défaut d’être un modèle d’internationalisme, le mouvement ouvrier suisse est un exemple de sensibilité aux aléas de la politique internationale. Comme ce fut le cas lors de la Grande Guerre, les débats à l’intérieur des sections " tenues " par la gauche socialiste portent fréquemment sur les événements " extérieurs " :
Pierre Jeanneret, Histoire du Parti socialiste vaudois, PSV, Lausanne, 1982, p. 15
On dira que l’époque s’y prête ; sans doute, mais elle se prêtait aussi à un " repli national ", à une priorité absolue accordée à la lutte et aux enjeux intérieurs. L’aile droite du parti ne cesse, d’ailleurs, de l’exiger... mais elle-même cède plus souvent qu’à son tour aux charmes du " débat international " : sur le rôle et la nature de l’Union Soviétique et du pouvoir qui y règne, sur l’ " esprit de Genève " et la SdN, sur le fascisme dès 1922, puis sur les menaces pesant sur la démocratie " bourgeoise ". Héraut éloquent d’un socialisme humaniste et réformiste, à la fois pacifiste " rollandien " et porte-parole de l’ " antibolchevisme " socialiste, Paul Golay en appellera par exemple à la raison d’Etat pour combattre les menées fascistes :
Paul Golay, intervention au Grand Conseil vaudois (23 janvier 1923) concernant la " Ligue Nationale ", in Terre de Justice, op.cit.biblio, pp 238-240
Si Golay fait l’éloge de la révolte, il conclut cet éloge par un rappel à l’ordre démocratique et à la nécessité de le défendre face aux menées fascistes : en un seul mouvement oratoire, on passe ainsi d’une à l’autre des deux attitudes qui se sont succédées dans les conduites du mouvement ouvrier suisse (et singulièrement du PSS) de 1918 à 1935, de l’appel au changement par le moyen de la grève générale à la défense de la démocratie " bourgeoise " par le moyen de la loi, mais surtout par la fidélité aux principes proclamés de cette démocratie " bourgeoise "elle-même. Le même Golay, d’ailleurs, dénoncera l’attitude du Conseil d’Etat vaudois en cette même année 1923, lorsque fut signé à Lausanne un traité qui avalisait le génocide des Arméniens par les Turcs :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 193-4
Le socialisme de Golay s’arqueboute sur la morale politique de la démocratie pour dénoncer les errements et les fautes des gouvernants bourgeois : il s’agit désormais moins de changer le système que de le contraindre à être fidèle à ses propres valeurs (celles, du moins, qu’il proclame). Cette attitude va, progressivement, devenir celle du mouvement socialiste suisse tout entier, notamment en ce qui concerne les " questions internationales " et la politique extérieure de la Confédération. Sur le PSS et l’USS aussi, du moins sur leurs majorités " modérées ", souffle quelque chose comme " l’esprit de Genève ".
La Suisse officielle elle-même s’était dès la fin de la Grande Guerre ouverte au monde. Son entrée dans la SdN avait modifié, et pas seulement formellement, la conception de la neutralité que défendait et pratiquait son gouvernement. Les rapports de la Suisse avec les autres Etats n’en furent pas moins, parfois, empreints, particulièrement avant 1925, d’une tension particulière -qui aurait quelque apparence de ressemblance avec celle qui prévalait dans les années quarante du siècle, lorsque la Suisse apparaissait aux gouvernements héritiers de la Sainte-Alliance comme un foyer de subversion. Nulle analogie, évidemment, avec la situation elle-même : le reproche d’être une " base révolutionnaire " eût tenu du fantasme s’il avait été adressé à la Suisse des années 1920, dont la politique étrangère était encore moins " progressiste " que la politique intérieure, et qui, si elle était une " base ", était plutôt celle de l’anticommunisme (ou de antisoviétisme). Mais il y avait pour le moins malaise dans les relations extérieures de la Confédération. Méfiante à l’égard de la SdN à laquelle elle avait pourtant adhéré, la Suisse officielle y vit semble-t-il moins le moyen de la paix qu’un rempart contre le " bolchevisme ". La marque de Giuseppe Motta fut de " développer la neutralité différentielle jusqu’à l’extrême limite de la participation " (selon Roland Ruffieux, in La Suisse de l’entre-deux guerres, op.cit.biblio p. 183), tant que cette participation (à la SdN et à l’action commune internationale) lui parut de quelque efficacité contre l’Ennemi (avec la majuscule de la personnification diabolique du Mal) soviétique. Par contre, lorsqu’il s’agira de sanctionner l’Italie fasciste, la Suisse refusera. Pour l’Etat abritant le siège de la SdN, ce choix ne pouvait que susciter quelque méfiance de la part des autres membres de la (mal nommée) " Communauté internationale ".
L’ " esprit de Genève " était, à sa manière et dans ses limites, " internationaliste ", et les " modérés " du PSS et de l’USS n’avaient pas tort de lui trouver quelque parenté avec l’internationalisme socialiste tel qu’ils pouvaient le concevoir. L’ " internationalisme genevois " était sans doute partiel, ethnocentriste, européocentriste même, mais dans les années vingt et trente du siècle, seul le Comintern (non sans mal, hésitations et échecs) avait quelque conscience de l’importance des luttes pour l’émancipation de ce que l’on n’appelait pas encore le " tiers-monde " et qui était encore le " monde colonial " ; le Comintern, et quelques individualités, exceptionnelles. Ainsi, encore, Paul Golay, en 1925, à propos de la guerre marocaine conduite par le Cartel des Gauches françaises (dont par ailleurs le PCF n’était pas) :
Paul Golay, Terre de Justice, op.cit. pp 97-8
Discours au souffle tout à la fois libertaire et nourri du Livre... Mais le Maroc est loin, et rares sont les socialistes qui comme Golay se préoccupent du réveil des peuples de la périphérie et dénoncent les guerres menées par les puissances coloniales (avec, dans celle du Rif, l’assentiment de la social-démocratie) contre le droit des peuples (tels qu’ils sont) à disposer d’eux-mêmes (comme ils le veulent). Les communistes, eux, en parlent, et, le cas échéant, les soutiennent (le plus souvent sans que leurs stratégies soient à la hauteur de l’enjeu, mais du moins prise en compte de l’enjeu y-a-t-il), et y investissent leurs espoirs révolutionnaires déçus en Europe... pendant que la social-démocratie internationale et les PS nationaux vivent la politique internationale et la solidarité internationaliste au rythme genevois de la SdN -ce qui d’ailleurs les obligera à découvrir, ou à redécouvrir, la périphérie lorsque la SdN menacera d’éclater face au défi lancé par les invasions italiennes en Afrique et japonaise en Chine. Le socialisme suisse ne fait pas exception à la règle : son horizon international est européen, et c’est l’engagement international de la Suisse officielle (par la SdN) qui fait débat.
Fort conservateur quant à son contenu politique et idéologique, excessivement prudent quant à sa forme, cet engagement de la Suisse dans l’ " arène internationale " ne se fit pourtant pas sans opposition ; une opposition portant cependant moins sur son contenu (quoique les socialistes, et plus encore les communistes, le dénoncèrent pour son antisoviétisme obsessionnel et ses complaisances à l’égard du fascisme italien) que sur sa légitimité même : la droite de la droite contestait que la Suisse dût avoir quelque activité internationale que ce soit, sinon celle de la Croix Rouge. Le Volksbund isolationniste et conservateur avait mené -et perdu- le combat contre l’adhésion à la SdN, mais les forces politiques qu’il représentait n’avaient pas désarmé. La politique étrangère de la Suisse devint l’un des principaux thèmes de débat, de polémiques et de conflits politiques en Suisse. Les uns, à gauche, étaient partisans d’un engagement international accru -mais pas de celui proposé par le Conseil fédéral- et les autres, à droite, partageaient les choix anticommunistes du Conseil fédéral (et de Giuseppe Motta en particulier) mais refusaient tout engagement international.
L’admission de l’Allemagne au sein de la SdN, si elle ne fut pas céder toutes les résistances à l’égard de l’organisation genevoise, leva une objection : la Société des Nations n’était plus, désormais, l’instrument exclusif des vainqueurs de 1918 et sa prétention à l’universalité s’en trouvait quelque peu raffermie. L’Union Soviétique, pourtant, restait " sur la touche " -mais ce n’était évidemment pas pour déplaire à la droite de la droite, dont l’ " ultra-neutralisme " se faisait de plus en plus ouvertement " philofasciste ". La SdN n’avait sans doute pas les moyens de ses ambitions, mais nul conflit ne vint le confirmer avant les expéditions africaines de l’Italie fascistes (expéditions que la Suisse se garda de condamner). L’organisation genevoise restait d’ailleurs un " club européen " : les masses des pays colonisés n’y étaient d’aucune manière représentées (qui d’ailleurs s’en souciait, hors les internationalistes révolutionnaires ?) et même les Etats Unis étaient restée hors de cette Société dont leur Président avait été l’initiateur. La présence de la Suisse au sein de la SdN semblait poser de moins en moins de problèmes ; il n’en était évidemment pas de même du rôle qu’elle y jouait, et que dénonçait vigoureusement la gauche : le consensus fragile et partiel qui aurait pu s’édifier entre la " droite de la gauche " et la " droite éclairée ", sur la " neutralité différentielle " conçue par Motta, était à la merci de la moindre crise internationale impliquant des Etats voisins de la Suisse, ou des intérêts suisses.
Une première alerte survint en 1923 : le 11 janvier, des troupes françaises et belges occupèrent la Ruhr afin d’obliger l’Allemagne à payer les " réparations " qui lui étaient imposées par le traité de Versailles, et que la République de Weimar, plongée dans une crise sociale, politique et économique catastrophique, ne pouvait assumer. L’économie suisse fut affectée par l’occupation franco-belge de la Ruhr : le charbon qui y était produit ne parvenant plus en Suisse, il fallut s’en procurer d’Angleterre, de France et de Belgique, à des prix plus élevés. Le boycott commercial imposé à l’Allemagne par ses vainqueurs toucha les régions industrielles du nord-est de la Suisse, et le patronat dénonça (trouvant des porte-voix politiques au sein des partis de droite) les tentations " hégémonistes " de la France en même temps que l’impuissance (ou la mauvaise volonté) de la SdN à les combattre. Le débat sur la présence de la Suisse à la SdN reprit de plus belle, le Volksbund relançant la campagne isolationniste alors que l’Association Suisse pour la SdN et les socialistes demandaient au contraire une intervention de la Suisse dans le cadre " genevois " pour aider à la résorption de la crise franco-allemande. On put craindre de voir renaître les contradictions, voire les conflits, qui avaient opposé durant la Grande Guerre les Romands (et une partie des Tessinois) aux Alémaniques. De larges milieux de Romandie approuvaient en effet l'action de Poincaré, que dénonçaient non seulement le patronat et le bloc bourgeois, mais aussi, officiellement, la gauche (socialiste et communiste), fondamentalement opposée au système des " réparations " (qui désignait un seul responsable et coupable de la Grande Guerre : l’Allemagne) et par conséquent à la " prise en otage " de la Ruhr. Un conflit extérieur, à nouveau, provoquait à l’intérieur un conflit purement politique, où l’on s’accusait de part et d’autre de la Sarine d’être à la solde d’un Etat étranger, et de part et d’autre de la ligne de " front " politique gauche-droite, de brader les intérêts communs de tous les Suisses. Il y eut ainsi d’étranges " alliances objectives " en cette occasion, comme celle des anciens adversaires de la Grève Générale, Robert Grimm et le " clan " Wille, dont le moins que l’on puisse écrire est qu’ils ne s’étaient pas épargnés depuis 1914. Lorsque l’Allemagne " capitula ", sous la double pression de sa propre crise intérieure et de la France, le 26 septembre 1925, les partisans de la SdN poussèrent un soupir de soulagement : l’organisation genevoise n’avait pas eu à intervenir. Elle en aurait été incapable, et y aurait perdu toute légitimité. La suite des événements le démontrera.
La crise franco-allemande passée, le débat reprend sur le thème de la " sécurité collective ". Le 27 septembre 1922 déjà, la SdN avait adopté une résolution envisageant un plan général de réduction des armements, doublé d’un accord général de défense accessible à tout Etat membre et impliquant l’obligation d’assistance en cas d’agression. Un premier projet d’accord élaboré par la commission permanente (consultative) de l’organisation, chargée des questions militaire, avait échoué en 1923 : il subordonnait le devoir d’assistance à une reconnaissance unanime de la situation de guerre par le Conseil de la SdN, condition qui (avec raison) parut au Premier ministre travailliste de Grande-Bretagne, Mac Donald, de nature à rendre l’accord général illusoire. La Suisse ne fut pas fâchée de l’échec d’un texte difficilement compatible avec la conception officielle (et " bourgeoise ") de la neutralité ; le Conseil fédéral déclara qu’il n’avait jamais été question de prendre un quelconque engagement pouvant entraîner la Suisse dans un conflit avec un Etat tiers. Les délégués suisses à la SdN s’étaient d’ailleurs abstenus de soutenir même le principe d’un traité d’assistance. Face à ceux qui, opposés à la SdN en tant que telle, crurent pouvoir dénoncer une tentative de renforcer le " système de Versailles ", le Conseil fédéral put protester de sa fidélité à la neutralité. La volonté " pacifiste " dont témoignait la résolution de 1922 avait par contre rencontré l’adhésion de la majorité des socialistes, leur aile gauche et les communistes considérant qu’en l’absence de l’URSS, la SdN n’était qu’un " instrument de l’impérialisme " et que tout ce qui en pouvait venir était à traiter avec une suspicion au moins égale à celle que manifestait la droite isolationniste. La possibilité de concrétisation éventuelle de cette volonté " pacifiste " (celle du projet d’accord général de défense de 1923) laissa toutefois les socialistes très sceptiques, et nul n’intervint en Suisse avec quelque force pour soutenir un projet que le travailliste Mac Donald avait fait échouer.
En 1924, pourtant, la question revint en débat : L’Assemblée de la SdN décida de mettre au point un accord plus modeste, visant au règlement pacifique des différends entre Etats et instituant le principe de l’arbitrage -deux objectifs que les congrès de l’Internationale socialiste d’avant 1914 avaient constamment affirmée dans les programmes successifs du mouvement ouvrier internationale. Le " protocole de Genève " que proposait la SdN ne faisait pas projet différent de ceux de la IIème Internationale d’avant-guerre, et de nombre des contributions au débat socialistes pendant le conflit : prévention des conflits par l’arbitrage obligatoire, traitement des différends par la Cour permanente de Justice (à laquelle la Suisse avait adhéré en 1921) ou par l’arbitrage conventionnel et, ultime recours, action militaire internationale, concertée, de la " communauté des Etats " contre ceux qui auraient déclenché des hostilités en refusant l’arbitrage ou en méprisant ses résultats (le mouvement ouvrier international d’avant-guerre, lui, menaçait les " agresseurs " de la grève générale...). Les intentions d’un tel projet avaient tout pour séduire les socialistes : elles avaient été les leur, quelques années auparavant.
Cependant, le gouvernement britannique (le conservateur Chamberlain ayant succédé au travailliste Mac Donald en novembre 1924) fut à nouveau mauvais sort à la tentative d’instituer des règles de droit international capables de promouvoir la " sécurité collective ". En Suisse, la droite isolationniste avait combattu les deux projets, " objectivement " aidée en cela par la gauche communiste (pour des motifs politiquement opposés). Entre ces deux oppositions, sociaux-démocrates et " mondialistes " bourgeois se retrouvèrent dans l’impossibilité de faire soutenir par la Suisse les initiatives de la SdN, et ne purent qu’en regretter le double échec. Le Conseil fédéral n’avait d’ailleurs guère manifesté d’enthousiasme : Motta s’opposait à la ratification par la Suisse d’un " protocole " prévoyant des sanctions, et continua à défendre la thèse " ultra-neutraliste " selon laquelle la Suisse ne pouvait en aucune manière être tenue de s’associer à des mesures de sanctions collectives contre un Etat tiers, quelle que soit la nature (économique, diplomatique ou, à plus forte raison, militaire) de telles sanctions.
En 1925, nouvelle tentative d’instaurer un système de " sécurité collective " : L’Allemagne propose à ses vainqueurs européens de 1918 un acte par lequel les uns (la Grande-Bretagne, la France et l’Italie) et l’autre (l’Allemagne) renonceraient solennellement à la guerre, les Etats-Unis (et non la SdN...) devant être garants de cette intention et de son respect. Une négociation franco-allemande était la condition préalable à toute négociation multilatérale autour d’un tel projet ; elle eut lieu : Stresemann et Briand tentèrent donc de jeter les bases d’une paix européenne durable, sinon définitive. L’adhésion de l’Allemagne à la SdN devait être le sceau de cette réconciliation et à Locarno, du 5 au 16 octobre 1925, Briand, Stresemann, Chamberlain et Mussolini, auxquels s’ajouta Vandervelde, paraphèrent les traités de la réconciliation européenne : les frontières entre la Belgique, l’Allemagne et la France sont garanties, l’Italie (déjà fasciste...) et la Grande-Bretagne s’engagent à intervenir aux côtés de la France et de la Belgique en cas de violation du traité par l’Allemagne (pas encore nazie...), laquelle voit se lever les obstacles à sa " réintégration dans la communauté internationale ".
Accord " pacifiste ", Locarno est aussi, et surtout, un énorme malentendu, qui survivra (mais pas très longtemps) à ses auteurs. Entre Versailles et Munich, la conférence tessinoise semble sceller la réconciliation européenne ; elle n’est pourtant qu’un répit, et de courte durée. Humiliée par sa défaite et par le traité de Versailles, rançonnée par ses vainqueurs, l’Allemagne cherchait avant tout à sortir du " système de Versailles " ; saignée par sa victoire, à la recherche éperdue de la sécurité européenne, c’est-à-dire de la sienne propre, la France voulait se donner le temps de rétablir une hégémonie perdue à l’ouest du continent ; l’Italie fasciste était en quête de reconnaissance et d’une " dignité " internationale que l’assassinat récent du socialiste Matteotti par les fascistes avait grandement mise à mal ; la Grande-Bretagne, enfin, obstinément méfiante à l’égard de toute tentative " européenne ", n’y participait (déjà) que pour avoir la possibilité d’en contrôler, au besoin d’en freiner, voire d’empêcher, la concrétisation. Deux ans après la crise de la Ruhr et la menace *séparatiste " de création par la France d’une " République Rhénane " à elle soumise, Locarno pesait du poids des ressentiments et des inquiétudes nées de la brutale " paix " de 1918 et, en arrière fond, des révolutions surgies du grand massacre.
Stresemann proposa donc de garantir internationalement les frontières occidentales de l’Allemagne (et donc les frontières allemandes de la France et de la Belgique), en échange de quoi la France renoncerait aux mesures de force du type de celles prises en 1923 dans la Ruhr. Briand aurait voulu étendre cette garantie internationale des frontières à l’Europe orientale, mais acceptait, pour le moins, d’entrer en matière sur les propositions allemandes. A Locarno du 5 au 16 octobre 1925 se réunit donc la première " vraie " conférence internationale de paix depuis celle de Versailles -laquelle était d’ailleurs plus une conférence de victoire qu’une conférence de paix. Incident : Vandervelde refusa, en socialiste, de serrer la main de Mussolini, responsable de l’assassinat de Matteotti.
Les accords de Locarno satisfirent à ce qu’en pouvaient attendre, au minimum, les participants à la conférence : s’il n’y eut pas réellement d’accord sur les frontières orientales (il eût fallu que, d’une manière ou d’une autre, directement ou non, l’Union Soviétique entrât dans le jeu), la France obtint de pouvoir secourir la Tchécoslovaquie et la Pologne si elles étaient attaquées (en 1936, Hitler prit prétexte de cet accord pour dégager unilatéralement l’Allemagne de ses obligations, en accusant la France d’avoir " violé Locarno " en signant un pacte d’amitié avec l’Union Soviétique). L’Allemagne obtint une garantie mutuelle et générale de ses frontières occidentales et vit s’ouvrir les portes de la réintégration dans le " concert des nations ". Briand se fit lyrique : " Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la réconciliation, à l’arbitrage, à la paix ! " (cité par Jacques Willequet, L’Allemagne cesse de faire peur..., in Le Monde-Dimanche 13-14 octobre 1985), ce qui ne l’empêcha pas (au contraire) d’être durement pris à partie par la presse nationaliste (pour ne plus écrire " chauvine ") qui l’accusa d’avoir été " roulé " par Stresemann et de s’être fait le complice d’une remise en cause du traité de Versailles. A vrai dire, c’est bien de cela, implicitement, dont il s’agissait pour l’Allemagne de Weimar, que les chaînes versaillaises étouffaient et qui attendait la fin de l’occupation de la Rhénanie, le retour de la Sarre, la rectification des frontières avec la Pologne et la fin des " réparations ". La droite nationaliste allemande ne fut pas moins fulminante à l’égard de Stresemann que la droite nationaliste française à l’égard de Briand, et elle lui reprocha d’avoir sanctionné l’ " annexion " de l’Alsace-Lorraine par la France et d’avoir admis l’alliance franco-polonaise. Stresemann dut se défendre de l’accusation de " bradage " et écrivit au Kronprinz (fils de Guillaume II, et icône improbable du nationalisme allemand) une lettre dans laquelle il affirmait que son objectif n’était autre que d’amener les " étrangleurs " de l’Allemagne à lui laisser revenir tout ce qui était allemand. Lettre qui, publiée en France, eut l’effet désastreux qu’on imagine. Locarno, un " énorme malentendu ", donc : chacun en revint persuadé qu’il avait fait céder l’autre. En 1926, Briand et Stresemann se réuniront à nouveau : les contrôles militaires français en Allemagne seront abolie en 1927, et en 1928 le pacte Briand-Kellogg contre la guerre semblera ouvrir une période de paix " définitive " en Europe. En 1930, les troupes alliées évacueront la Rhénanie alors que crise économique et crise politique se conjuguent déjà pour réduire à néant les efforts pacifistes de cinq années précédentes.
Les accords tessinois furent accueillis avec un évident soulagement par l’opinion publique suisse : trois des quatre Etats frontaliers du pays y étaient impliqués et, dans la mesure où ils paraissaient garantir la paix entre Français et Allemands (avec la garantie des Italiens), les Suisses ne pouvaient que se féliciter d’une apparence d’harmonie retrouvée. La droite isolationniste et la gauche pro-soviétique (dans et hors du PSS) n’étaient évidemment pas de cet avis, mais leurs critiques et leurs doutes, pour un temps, parurent à l’opinion publique, y compris à leurs sympathisants, excessives et infondées. La Suisse n’était sans doute présente à Locarno que par l’helvéticité du lieu, et n’était pas partie prenante de l’accord, mais elle pouvait s’en estimer bénéficiaire. La menace d’un conflit franco-allemand au portes de la Suisse semblait écartée, celle d’un conflit opposant la France et l’Italie paraissait relever de l’absurdité, et l’Autriche, absente de la conférence, n’était pas en état de menacer qui que ce soit, hors le Liechtenstein. Les échanges économiques se trouvèrent encouragés par les perspectives de paix et l’ " esprit de Genève " y trouva matière à se ragaillardir. Au sein de la gauche socialiste, on put croire possible la réalisation d’un désarmement unilatéral de la Suisse, désormais sans ennemi potentiel à ses frontières. Ragaz proposa donc, suivi en cela par de nombreux socialistes -et par les communistes dont tout ou presque le séparait- la suppression pure et simple de l’armée, et l’affectation des crédits de défense militaire à des tâches de solidarité sociale. Sans doute cette proposition n’avait-elle aucune chance d’être acceptée, ni même reprise par le PSS, mais elle témoigne éloquemment des espoirs mis en la Société des Nations par la gauche démocratique, reconnaissant l’esprit de ses congrès dans ce qu’elle percevait de celui de Genève, et pouvant croire le jour venu de la pacification de l’Europe -son monde. Au surplus, les idées exprimées par la SdN et par ses textes avaient " quelque chose de suisse ", en ce qu’elles reprenaient les thèmes traditionnels de la culture politique helvétique " progressiste " : l’arbitrage, la fédération... et même, sous certains aspects, des thèmes " conservateurs " mais qu’en matière de politique internationale l’aile droite de la social-démocratie avait intégrés à son " bagage théorique " : le consensus, le respect du Droit...
La proposition pacifiste de Ragaz est ainsi la manifestation d’une volonté d’aller plus loin encore, par une décision symbolique de désarmement unilatéral au moment où le Conseil fédéral proposait au contraire l’augmentation du budget militaire. L’Allemagne posant sa candidature à la SdN et sachant d’ores et déjà qu’elle y serait admise, la Suisse n’avait plus de frontières qu’avec des Etats membres (l’Autriche depuis novembre 1920) d’une organisation qui se posait en garante de la paix. Toute menace directe semblant écartée, les socialistes et les et les syndicalistes pressèrent le gouvernement d’adopter une attitude plus ouverte en matière de politique extérieure, les communistes faisant de la reconnaissance de la Russie soviétique, puis du soutien à son admission à la SdN, la condition préalable de toute attitude positive à l’égard des choix internationaux de la Suisse -mais la position des communistes comptait en ce débat pour fort peu. Si le souci " patriotique " de la défense nationale, auquel le PS ne se ralliera à nouveau officiellement qu’en 1935, pouvait être rendu obsolète par une " sécurité collective " instaurée sous l’égide de la Société des Nations, la Suisse pourrait dès lors agir à plus long terme, et à plus large champ d’action, afin de contribuer activement à une rénovation pacifiste et globale des relations internationales. Ce " mondialisme " dont la gauche démocratique se faisait l’écho n’était pas du goût d’un Conseil fédéral aux prises avec l’isolationnisme du Volksbund, et qui n’entendait nullement aller plus loin qu’il n’était déjà allé, sur la voie qu’il avait lui-même tracée d’un engagement politique international à la fois très prudent et très violemment antisoviétique.
Le consensus sur lequel le gouvernement croyait pour faire reposer sa politique étrangère était donc fragile. Politiquement incertain, il se heurtait également, à nouveau, à l’héritage de la division " linguistique " (mais non moins politique) de la Suisse, division que l’avènement du fascisme en Italie compliqua encore : les " italophiles " tendaient en effet à être de plus en plus souvent ouvertement fascistes, ou fascisants. On put croire, à l’automne 1926, au réveil de l’antigermanisme militant de la Romandie lorsque, posant sa candidature à la SdN, l’Allemagne la posa également au Conseil de l’organisation. Une opposition se dessina au sein même de la SdN à cette candidature allemande à l’exécutif de la Société, opposition portée par le Brésil au nom des Etats latino-américains -qui avaient à plusieurs reprises tenté de faire accéder l’un des leurs au Conseil et voyaient avec déplaisir la puissante défaite en 1918 tenter d’investir la direction de l’organisation des vainqueurs, dans le même temps où elle était admise au sein de l’organisation. La décision d’admission de l’Allemagne en fut retardée, et la dispute provoqua une modification statutaire élargissant la composition du Conseil. Le 8 septembre 1926, l’Allemagne était solennellement admise au sein de la SdN ; la " réconciliation " européenne parut alors achevée (sans que l’Union Soviétique, elle, ne soit encore admise à y prendre part). Pourtant, cette admission de l’Allemagne dans le " concert des nations " ne fut pas en Suisse du goût de tout le monde. Les francophiles ne désarmèrent qu’en apparence de leur germanophobie, et les " italophiles " (se confondant de plus en plus avec des " philofascistes " ou des fascistes déclarés) regrettèrent haut et fort qu’il ait fallu que l’Espagne et le Brésil s’effaçassent devant la Pologne et l’Allemagne dans l’accession à l’exécutif de l’organisation genevoise. Nulle trace. évidemment, de quelque " tiers-mondisme " (avant la lettre) dans ce regret exprimé au nom de la " latinité ", et peu importait que le caractère européen de la SdN eût été réaffirmé par les choix de l’automne 1926. L’extrême-droite ne disposait d’ailleurs pas d’un grand capital de sympathie, ni même de compréhension (au contraire des socialistes) à l’égard de l’Allemagne weimarienne, où le rôle de la social-démocratie était déterminant et où le Parti communiste était une force considérable (bien plus qu’en France, par exemple). Les structures et la culture politiques de la République de Weimar étaient à l’opposé de ce que les premiers fascistes suisses préconisaient et souhaitaient, et qui s’inspirait déjà, explicitement, du fascisme italien. Raison de plus pour la gauche réformisme de se féliciter de ce que cette Allemagne là, et la Pologne antisoviétique (parce que russophobe) de l'ex-socialiste Pilsudsky pussent parler de la même voix que l’Italie mussolinienne. Restait, évidemment, l’hypothèque soviétique : les socialistes, si antisoviétiques qu’ils fussent (et que le PCS les poussait " objectivement " à être) considéraient l’admission de l’Union Soviétique à la SdN comme une condition nécessaire, sinon suffisante, de la " normalisation " des relations européennes et de l’universalité de la Société -position qui n’était, de loin, pas partagée par le maître d’oeuvre de la politique étrangère suisse, Giuseppe Motta, qui s’illustrera par une opposition aussi irréductible à l’adhésion de l’URSS que furent éloquents ses plaidoyers pour celle de l’Allemagne.
Les 8 et 9 novembre 1923, une tentative de putsch d’extrême-droite avait eu lieu à Munich. Mal préparée, rapidement étouffée par les autorités, elle était l’œuvre d’Adolf Hitler et d’Erich von Ludendorff. Peu perçue en Romandie, cette tentative eut par contre quelque écho en Alémanie, alarmant les socialistes et suscitant de la sympathie à la droite de la droite. L’Allemagne admise à la SdN, on la crut plus forte contre ses propres " démons intérieurs ", mais on la savait désormais autant menacée par son extrême-droite qu’on l’avait dite menacée par l’extrême-gauche dans l’immédiat après-guerre. Les années 1925-1930, par le fait " incontournable " de la situation européenne et de la montée des fascismes, des corporatismes, des " réactions révolutionnaires " (ou des " révolutions réactionnaires "), sont marquées par une nouvelle modification du rapport au monde entretenu par la gauche helvétique, en même temps que des rapports internes à la gauche. La " crise de la démocratie " est scandée par une succession de putschs (civils ou militaires) et de prises du pouvoir qui voient les extrêmes-droites européennes accéder les unes après les autres au pouvoir dans des Etats de toutes natures, en des contextes fort différents : l’Italie en 1922, la Bulgarie (putsch militaire) et l’Espagne (dictature de Primo de Rivera) en 1923, la Lituanie en 1926 (dictature de Voldemaras), le Portugal en 1932 (Salazar), l’Allemagne et l’Autriche en 1933 (quoique Dolfuss, incontestablement d’une droite fort réactionnaire, était un adversaire du national-socialisme allemand et autrichien), l’Espagne, enfin, en 1936 (même si la République ne sera vaincue qu’après trois ans d’une guerre qui " ouvre " la Guerre Mondiale). Dans le même temps, l’Union Soviétique s’installe dans le stalinisme, la Chine dans la guerre civile et, en 1923, Atatürk commence à " forcer " la Turquie à la modernité, par les moyens de la dictature. Toute l’Europe orientale, à l’exception de la Tchécoslovaquie (mais elle ne perd rien pour attendre) vit au rythme des " coups " autoritaires. En 1926, l’ancien socialiste Pilsudsky a pris le pouvoir en Pologne par un putsch militaire. La démocratie est " expulsée " des Balkans avant même que d’avoir pu s’y ancrer. Dès 1933, la Suisse n’a donc plus de frontière avec une démocratie qu’avec la France -et elle s’en méfie. Détenteurs et défenseurs d’un modèle démocratique de société, participant d’une culture politique antiautoritaire et pluraliste, les socialistes suisses voient leurs références concrètes s’effondrer les unes après les autres autour d’eux. La montée des périls fascistes contribuera puissamment à une rectification d’importance des choix socialistes, rectification dont la manifestation ultime sera, comme en 1914 -mais avec une force et une légitimité considérablement accrues- l’engagement du mouvement ouvrier (par ses organisations hégémoniques) dans la défense de l’ " acquis national " face aux pestes brunes : fascisme, nazisme, corporatisme, conservatismes autoritaires, dictatures militaires réactionnaires, tout mouvements que nous ne pouvons confondre dans une même dénomination qu’au prix de la simplification, et qui diffèrent profondément les uns des autres par leurs méthodes, leurs motivations, leurs structures, leurs racines et leurs symboles, mais qui ont pour point commun de n’avoir de cesse d’abolir les libertés démocratiques, et de réprimer le mouvement ouvrier.
Deus débats marquent ce passage de la social-démocratie (USS et PSS) d’une ligne pacifiste à une ligne de combat antifasciste, c’est-à-dire d’une conception de la solidarité à une autre, la première plaçant au dessus de tout l’objectif de la paix (avec des accents inégalement " révolutionnaires " selon les lieux, les moments et les tendances) et la seconde privilégiant la défense de la démocratie (même bourgeoise) contre la menace fasciste. Ces deux débats portent l’un et l’autre à la fois sur l’attitude de la Suisse à l’égard d’un Etat tiers, et du mouvement politiquement dont il se proclame et est le siège, et sur le rôle de la Suisse dans la SdN, en même temps que sur le rôle de la SdN elle-même : il s’agit de la " question italienne " et du fascisme, d’une part, de la " question soviétique " et du communisme d’autre part.
L’Union Soviétique, que seule l’Allemagne de Weimar avait réellement reconnue comme partenaire alors qu’elle-même était marginalisée, était encore, au milieu et à la fin des années vingt, la " brebis galeuse " de l’Europe, celle contre laquelle un " cordon sanitaire " devait être tiré. L’Italie fasciste, quant à elle, auto-légitimée par un nationalisme vindicatif aux ambitions impériales non dissimulées, et à la symbolique " latine " peu soucieuse du respect des frontières, suscitait certes quelque perplexité, et quelque inquiétude, mais elle était reconnue internationalement (Mussolini avait signé les traités de Locarno, l’Italie était membre de la SdN, elle faisait partie du " camp des vainqueurs " de 1918, et le pouvoir fasciste était, quoi qu’il en soit des discours, tenu pour le pouvoir réel et légitime du Royaume). De plus, si l’Union Soviétique se proclamait elle-même le bastion du camp révolutionnaire, c’est-à-dire affirmait une ambition de bouleversement des règles du jeu international (tout en agissant plus discrètement pour entrer dans ce même jeu), l’Italie ne revendiquait nul bouleversement de cette ampleur, mais une " place au soleil " des grandes puissances, ce qui, on en conviendra, n’impliquait nullement une remise en cause de l’ordre du monde -mais simplement un nouveau partage des pouvoirs. Les rapports de la Suisse avec chacun de ces deux Etats furent donc pour le moins inégaux -d’une inégalité que ne pouvaient suffire à expliquer ni la situation géographique (voisinage de l’Italie et éloignement de l’URSS), ni la politique intérieure (l’ " irrédentisme " italien au Tessin,), ni les nécessités du commerce extérieur. Les choix politiques, idéologiques, sont au cœur de la différence de traitement par la Suisse de l’Italie fasciste et de la Russie léninienne, puis stalinienne. Le chef de la diplomatie suisse, et l’un des hommes forts du Conseil fédéral, Giuseppe Motta, ne cachait ni sa sympathie (plus culturelle que politique, mais devenue politique dès lors que culturelle) pour l’Italie (fasciste ou non, mais elle était fasciste), ni ce qu’il faut bien appeler sa haine de l’Union Soviétique. La " neutralité différentielle " dont il se faisait le chantre, c’était aussi le cousinage avec Rome et le conflit avec Moscou.
La reprise des relations diplomatiques avec la Russie devenue soviétique était un véritable serpent de mer des débats politiques, tant parlementaires qu’extra-parlementaires. L’affrontement était constant entre la gauche et la droite sur ce thème, lors même que le PSS avait à de réitérées reprises, et avec une vigueur croissante au fur et à mesure que s’appesantissait le stalinisme et que se dissolvaient (pour ceux qui acceptaient de constater cette dissolution) les illusions du léninisme, condamné le système instauré en Union Soviétique, dès avant la mort de Lénine (pour qui, malgré tout, les dirigeants socialistes -dont plusieurs, tel Grimm, l’avaient connu- avaient quelque respect).
Le 10 mai 1923, un événement particulier avait enflammé les passions à l’égard de la Russie soviétique : ce jour là, Vorovski, le délégué soviétique à la conférence de Lausanne sur la " succession de l’Empire Ottoman " (conférence qui, entre autres, prétendit tirer un trait sur la question arménienne après sa " solution " (finale ?) par le génocide et l’exil), était assassiné par un Suisse rapatrié de Russie après la révolution et qui voulait par son acte " venger " ses parents et ses compatriotes victimes des " Soviets ". Le Conseil fédéral présenta certes des excuses à Moscou, mais les autorités soviétiques ne tinrent pas Berne quitte de l’événement, d’autant que le meurtrier, Conradi, fut acquitté par le tribunal qui le jugea, sous les applaudissements de la presse conservatrice et de l’extrême-droite pour qui le geste du " tyrannicide " était celui d’un nouveau Guillaume Tell. La fille du délégué soviétique demanda réparation financière à la Suisse ; le Conseil fédéral refusa, au nom des Suisses rapatriés de Russie qui, eux aussi, demandaient réparation... mais au gouvernement soviétique. Celui-ci n’apprécia guère cette rebuffade supplémentaire venant d’un pays qui, au sein de la SdN et sur tous les théâtres de débats internationaux, se faisait le chantre de la réconciliation, de l’arbitrage et de l’universalité des relations entre Etats.
Progressivement, pourtant, les Etats européens avaient admis la légitimité du pouvoir soviétique, au moins du point de vue (formel et restrictif) du droit. La France, la Grande-Bretagne, l’Italie fasciste elle-même avaient reconnu l’URSS. Aux Chambres fédérales, de nouvelles interpellations de la gauche socialiste s’ensuivent. Le Conseil fédéral négocie, en avril 1927 à Berlin, un compromis en matière de commerce extérieure, levant les mesures de boycott : l’Union Soviétique est un marché considérable et, tout à sa reconstruction, prometteur... Critiquée par la droite la plus réactionnaire qui accuse le gouvernement de mettre à mal le " cordon sanitaire " placé dès 1918 autour de la Russie des Soviets par les puissances occidentales -les mêmes, France et Grande-Bretagne, qui levèrent ce " cordon " en reconnaissant le pouvoir soviétique, cette politique l’est aussi par la gauche, qui reproche au Conseil fédéral de n’avoir de politique étrangère que celle du commerce extérieur (ce reproche, la gauche l’exprimera constamment jusqu’à nos jours, faisant projet, avant que de changer de politique étrangère, de faire en sorte que la Suisse ait une politique étrangère autonome des préoccupations commerciales). En somme, la gauche reproche au Conseil fédéral de n’avoir pas le " courage " de reconnaître l’évidence soviétique ; pour Motta, il s’agissait bien évidemment d’un choix politique : c’est sans nuance que le gouvernement suisse condamne la révolution bolchevique, le pouvoir des Soviets et, bien sûr, l’Internationale Communiste. Et c’est sans plus de nuance qu’à la haine de la droite répond l’hagiographie de la gauche communiste. Entre ces deux catéchismes, le PSS et l’USS tentent, malaisément, de poser sur l’Union Soviétique un regard qui soit à la fois critique -et il le sera d’autant plus facilement que l’activité des communistes, en Suisse même, du moins jusqu’à la période des " fronts populaires ", l’y encourage- et analytique. Au Parlement, dans sa presse, dans ses textes, le PSS réclame en tous cas la reconnaissance de l’Union Soviétique par la Suisse, tout en exprimant son antipathie pour le régime stalinien.
Quant à l’Italie, les termes du débat sont posés à l’inverse de ceux de la " question russe ", et la question est posée par les différents blocs politiques de manière rigoureusement antithétique de la précédente. C’est à " fronts renversés " que le débat se tient ici : l’Italie fasciste, bénéficiant de la sympathie active de l’extrême-droite et d’une partie importante de la droite traditionnelle (notamment au sein de la droite paysanne, du Volksbund, des catholiques conservateurs, voire même d’une partie du mouvement syndical catholique), est honnie par l’ensemble de la gauche, communistes, socialistes et anarchistes ensemble, syndicats et partis d’une même voix -ou presque. Motta, lui, ne manque pas une occasion de témoigner de sa sympathie à l’égard de l’Italie de Mussolini, pour des raisons culturelles et affectives plus que politiques : c’est l’Italie, et c’est un régime anticommuniste (malgré les relations qu’il entretient avec l’URSS, et quoique le fascisme ait, par ses structures, ses pratiques, ses méthodes, assez emprunté au bolchevisme pour en être la caricature). En Suisse même, les organisations de l’immigration italienne, progressivement contrôlées par les fascistes, et les services culturels de l’Ambassade et des consulats d’Italie, travaillent à rendre sympathique le régime mussolinien. Enfin, les mouvements irrédentistes au Tessin accroissent le sentiment de menace ressenti par le mouvement ouvrier helvétique (et le mouvement ouvrier tessinois d'abord, bien sûr), pour qui la solidarité avec ses organisations tessinoises et avec ses camarades italiens sera, très tôt, un moyen privilégié de défendre les droits et les libertés démocratiques dont il a besoin en Suisse.
Le 10 juin 1924, le député socialiste italien Matteotti est assassiné par les fascistes. Pour la gauche suisse, comme pour celle de toute l'Europe, les responsabilité du régime mussolinien sont évidentes. Au Conseil national, Graver demande l’envoi par le Parlement suisse d’un télégramme de condoléances ; la majorité bourgeoise le lui refuse (par 94 voix contre 38, le 20 juin). Une interpellation de Robert Grimm est pareillement rejetés : elle protestait contre les menées irrédentistes du fascisme italien au Tessin. En janvier 1925, le Conseil fédéral lui-même donne à la gauche l’occasion de manifester cette solidarité antifasciste qui sera, pour les vingt années à venir, l’un des axes de sa " politique étrangère " : un réfugié antifasciste italien, Tonello, attaque dans le quotidien socialiste tessinois La Libera Stampa le régime en place à Rome. Le Conseil fédéral lui rappelle sur le ton de la remontrance les " devoirs de réserve " du réfugié politique. Le PSS prend vigoureusement la défense de Tonello, accuse Motta de régler un compte personnel avec le quotidien socialiste, tout en tolérant l’irrédentiste Squilla Italica, et proteste contre la tolérance excessive manifestée par le Conseil fédéral à l’égard des agissements fascistes en Suisse. Motta justifiera son attitude é l’égard du réfugié antifasciste avec bien plus d’énergie qu’il n’en marquera à défendre plus tard le Tessinois Peretti, antifasciste lui aussi, mais arrêté et emprisonné en Italie. Jusqu’à la chute de Mussolini, la gauche ne cessera de dénoncer les " complaisances du Conseil fédéral " à l’égard du Duce et de son régime. L’extrême-droite elle-même encouragera, par ses actes, la gauche à cette dénonciation, en déversant des tombereaux de fleurs sur le fascisme " romain ", le félicitant d’avoir préservé l’Italie et de contribuer à préserver la Suisse du fléau communiste (et du danger socialiste). La presse d’extrême-droite, comme Le Pilori du Genevois Georges Oltramare, mais aussi (du moins dans les premières années du fascisme) la grande presse de droite (de la Neue Zürcher Zeitung à la presse conservatrice tessinoise) expriment à l’égard de l’ " Italie nouvelle " une attitude qui va de la sympathie complaisante du grand quotidien radical zurichois à l’adulation effervescente du périodique genevois. Un peu par contrecoup, beaucoup par solidarité avec les victimes du fascisme, surtout par attachement de la majorité du PSS et de l’USS à la démocratie politique, la gauche réagit vigoureusement à ce " philofascisme " délétère, et fait de Motta son adversaire privilégié pour tout ce qui touche à la politique extérieure (ce qui se justifiait pleinement, puisqu’il en était le maître d’œuvre), mais aussi, souvent, dans les domaines les plus sensibles de la politique intérieure, mettant en contradiction le discours " universaliste " et " démocratique " tenu par le ministre dans les enceintes internationales, et l’exclusive manifestée à l’égard de la Russie soviétique, parallèlement à la sympathie affichée à l’égard de l’Italie fasciste, et à des pratiques pour le moins conservatrices et sectaires à l’intérieur du pays.
Dès 1925, un renouveau du débat sur la sécurité collective vient s’ajouter aux deux débats internationaux, " soviétique " et " italien ", qui nourrissaient déjà les affrontements entre la gauche et la droite. Un précaire état de paix s’est instauré en Europe après les tourmentes révolutionnaires qui suivirent la Grande Guerre. Cette paix fragile, il va s’agit de la renforcer, de l’inscrire dans la durée. Certains -les plus chauds partisans de la SdN, et il y en a dans toutes les grandes " familles " politiques (à l’exception de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite) espèrent encore en une " paix éternelle " par le moyen de l’organisation genevoise. D’autres, en particulier parmi les socialistes, sans se faire d’illusions sur la " qualité d’une paix à la merci des humeurs des gouvernements et des changements de majorité dans les Etats démocratiques (il y en a d’ailleurs de moins en moins en Europe) ou de groupes dirigeants dans les Etats autoritaires ou totalitaires, veulent jouer la carte de la SdN " parce que la SdN existe ", et qu’on n’a rien à perdre à tenter d’en faire usage, voire de la renforcer. Dans les années vingt, les socialistes poursuivent ainsi un double objectif : le soutien à la Société des Nations et son renforcement d’une part, la renaissance de la IIème Internationale d’autre part, la question de l’affiliation à la troisième ayant été réglée par le refus, et la scission.
En avril 1917, Briand propose un engagement mutuel de la France et des Etats-Unis à renoncer à la guerre. Kellogg, au nom des USA, répond en élargissant la proposition française à l’ensemble du " monde civilisé " (ce qui, dans l’esprit des gouvernants des Etats du " centre ", exclut la plus grande partie du monde et la majorité des humains -mais une partie et une majorité dont rares étaient ceux qui, comme le Comintern, se souciaient). Le 27 août 1928 à Paris, un pacte de renonciation commune à la guerre est signé : c’est le " Pacte Briand-Kellog ", déclaration d’intentions pacifistes que la montée en agressivité extérieure du fascisme, puis l’avènement du nazisme, rendit tôt illusoires. Le pacte sera finalement signé par 57 Etats, dont 9 (les USA et l’URSS en tête) n’étaient pas membres de la SdN au moment de leur adhésion au texte. La Suisse, elle aussi, signera : " renoncer à la guerre " ne signifiait évidemment pas, pour le Conseil fédéral, renoncer à l’armée (70 ans plus tard, il ne l’a toujours pas fait...), mais seulement renoncer à mener une guerre d’agression -ce qui enfonçait une porte ouverte, la neutralité " perpétuelle " faisant depuis 1815 à la Suisse obligation de ne jamais se lancer dans un conflit armé autrement qu’en situation d’agressée. Pourtant, les réticences furent nombreuses : à droite, si l’on se félicite de l’adhésion américaine en y voyant le signe de la fin de l’ " isolationnisme " manifesté par le refus de la SdN, on déplore hautement que l’adhésion soviétique ait été acceptée et puisse signifier une reconnaissance au moins implicite du régime soviétique (et de sa politique extérieure) par les 56 Etats dont la signature côtoie celle des " bolcheviks ". A gauche, si l’on se félicite de l’initiative française, de son prolongement américain et de l’entrée de l’Union Soviétique dans une sorte de " normalité " internationale, on déplore la présence de l’Italie fasciste dans la liste des signataires, et l’on condamne son double jeu. Il est vrai que les formations d’extrême-droite voient quant à elles dans l’adhésion de Mussolini au pacte une manifestation de bonne volonté de la part de l’Italie " nouvelle ", alors que, plus trivialement, l’Italie était politiquement " condamnée " à s’associer à la démarche du pacte, faute de pouvoir assumer les conséquence de ce qui serait apparu, en cas de refus, comme une déclaration d’intentions bellicistes. La mise en valeur de la " bonne volonté " de son " Etat phare " par chaque camp politique " extrême " sera ainsi fort bien partagée par l’extrême-gauche communiste (et la gauche socialiste pro-soviétique) et l’extrême-droite fasciste. La première, d’ailleurs, ne cessera jamais de voir en l’URSS la " place forte du camp de la paix ", sinon pour en faire, de 1941 à 1945, le " Bastion de la lutte antifasciste " -ce qu’à vrai dire elle fut réellement en ces quatre ans, mais contrainte et forcée, et après moult compromissions.
Le 17 décembre 1928, le Conseil fédéral publie son rapport aux Chambres à propos de la ratification par la Suisse du pacte de Paris. Le Conseil fédéral, c’est-à-dire Motta, voit dans ce texte un pas supplémentaire vers l’éradication de la guerre en Europe. Un mois plus tard, le Sénat américain ratifie le pacte et le 1er mars, la Chambre française en fait autant. Le 6 juillet 1929, le législatif helvétique ajoute sa signature à toutes celles qui approuvent déjà la démarche franco-américaine. Le texte est soumis à référendum facultatif, mais ses adversaires virtuels ne feront pas usage de ce droit : l’adhésion paraît sans risque et n’entraîne aucune obligation pour la Suisse, sinon celle, évidente en droit depuis 1815 et en faits depuis 1515, de se refuser à toute aventure militaire. Par ailleurs, le fait même que le pacte soit signé par toute l’Europe lui donne une force symbolique évidente : la Grande Guerre n’est pas si éloignée )dix ans...) que le souvenir de ses charniers ait pu s’estomper, même en Suisse. Le pacte satisfait à bon compte le désir de paix, et au surplus vient équilibrer la " balance diplomatique " européenne en la faisant un peu moins pencher du côté français (même si l’initiative du pacte est française). Enfin, le Parti socialiste voit, dans l’accord qui vient d’être ratifié, un argument supplémentaire pour demander une réduction des crédits militaires, les menaces de guerre semblant s’éloigner. Il ne se passera pas six ans avant que le même PSS, face à l’agressivité italienne en Afrique, japonaise en Asie, allemande en Europe, n’admette pour le première fois en vingt ans le principe de la défense nationale et la nécessité de l’effort financier qui doit lui être consenti.
Le pacte qui porte son nom est à peine signé que Briand fait un pas de plus : celui de l’unification européenne. Le 4 septembre 1929, lors de la Xème Assemblée générale de la SdN, il propose " une sorte de lien fédéral " entre les Etats européens démocratiques. Faite à Genève, la proposition d’une " Confédération européenne " aurait dû avoir tout pour plaire à la Confédération suisse, y compris aux plus conservateurs d’entre les Suisses (qui sont aussi les plus " fédéralistes "), c’est-à-dire ceux-là même qui à chaque engagement de la Suisse au plan international crient à l’abandon de la neutralité aussi fort qu’ils crient à l’abandon du fédéralisme à chaque tentative de renforcement de la capacité politique de la Confédération, par rapport aux cantons.
Faut-il s’étonner de ce que l’initiative française fut mail accueillie par le gouvernement suisse ? Elle ne faut en fait soutenue que par le seul Stresemann : les deux principaux adversaires de la Grande Guerre, l’Allemagne et la France, furent aussi -leurs gouvernants du moment, du moins- les plus fervents partisans de tout projet susceptible d’éviter la répétition de la boucherie qui les avait saignés (et saignée, la France le fut plus que l’Allemagne, ce qui contribue à expliquer le dynamisme dont elle fit preuve dans toutes les tentatives " pacifistes " des années vingt. Les autres Etats européens ne refusèrent pas a priori la proposition de Briand : ils se contentèrent de la renvoyer à l’expéditeur, en le chargeant de préparer un mémorandum. Envoyé le 17 mai 1930, ce texte, rédigé en grande partie par le Secrétaire général du Quai d’Orsay, Alexis Léger (Saint John Perse) ne suscite pas, tant s’en faut, l’enthousiasme de ses destinataires. Il prévoyait l’extension à toute l’Europe des clauses de l’accord de Locarno (garantie des frontières, sécurité collective, intervention commune des signataires aux côtés de l’un des leurs s’il était agressé...) et la création d’une organisation politique européenne, garante des traités et " surveillante " de la sécurité et de la paix sur le continent. Ces propositions suscitent une méfiance quasi-unanime : l’Allemagne est opposée à une extension orientale du système mis en place à Locarno ; la Grande Bretagne rappelle qu’elle est liée par les obligations du Commonwealth ; l’Italie dénonce une opération " hégémonique " de la France, tout en proposant sa propre version d’un accord limité à des formes réduites de coopération et de consultations régulières. Quant à la Suisse, elle considère l’exercice comme inutile et lui reproche, au surplus, de " doubler " la SdN au plan politique. Finalement, la SdN elle-même renvoie le projet à une commission d’étude qui, la mauvaise volonté des Etats aidant, et la dégradation du contexte international s’y ajoutant, fut le meilleur moyen d’enterrer le projet sans vexer ses auteurs.
Ce dernier acte de la dernière tentative de fonder une Europe " nouvelle " par le biais de la SdN se joue au moment où le monde " développé " plonge dans une crise dont il ne sortira, seize ans plus tard, qu’au terme (sinon par le moyen) d’un nouvel holocauste et d’une nouvelle guerre, réellement mondiale celle-là. De la crise économique en laquelle s’abîment les sociétés capitalistes, et en laquelle les sociétés non-capitalistes sont plongées par contrecoup (à l’exception, toutefois, et considérable, de l’Union Soviétique, paradoxalement " protégée " de la crise capitaliste par le fait même de l’isolement en lequel le capitalisme -objectivement aidé en cela par le stalinisme- voulut la maintenir), sortira une crise politique majeure (l’avènement du nazisme) qui poussera l’Europe au bord du gouffre, et dont à vrai dire elle ne s’est toujours pas relevée. C’est donc d’une guerre mondiale qu’il va s’agit, et c’est une crise mondiale qui survient, alors que le Grande Guerre, malgré l’intervention américaine et la mobilisation massive des " indigènes " des colonies dans les troupes des puissances coloniales, était restée pour l’essentiel une guerre européenne. Les forces politique du Vieux Continent, celles de gauche comme les autres, dont se trouver dès 1929 forcées de constater l’élargissement au monde entier du théâtre des opérations économiques, politiques, militaires enfin, et de tirer quelque conclusion de ce constat. Pour la gauche, pour le PSS et l’USS mais aussi pour le mouvement communiste (qui en avait, le Comintern aidait, pris concrètement conscience plus tôt que les sociaux-démocrates, dont la perception " mondialiste " s’exprimait plutôt par des textes que par des actes, et se limitait pour l’essentiel à l’Europe et à l’Amérique), la rupture des années trente est brutale, catastrophique au plein sens du terme. La solidarité devient une nécessité vitale face aux entreprises autoritaires, fascistes et nazies. La perception socialiste (au sens large) du monde, qui était malgré tout restée le fait d’une minorité de dirigeants, d’intellectuels " organiques " et de cadres du mouvement ouvrier, devint un fait de masse (le développement des media de masse n’y étant pas étranger : le medium, c’est le changement : sinon celui de la réalité, du moins celui de sa perception). Au XIXème siècle, et jusqu’à la scission de 1920-1921, on attendait des luttes étrangères un " exemple ", un mythe mobilisateur, une raison supplémentaire d’agir " ici " -et encore cette attente n’était-elle pas généralement partagée : on sait les réticences du Grütliverein à l’égard de l’internationalisme. Dans les années vingt, l’Union Soviétique pour les uns, la SdN pour les autres (et l’Italie, puis l’Allemagne, pour les antifascistes) inversent le sens de la solidarité : on n’est plus solidaire des " autres " parce que leur combat est légitime, on en est solidaire parce qu’ils combattent notre propre ennemi. De plus en plus nombreux sont les militants qui comprennent que la défense des antifascistes italiens, des révolutionnaires chinois, des antinazis allemands, des républicains espagnols, est défense de soi-même contre un ennemi commun. Le mouvement ouvrier n’est pas seulement antifasciste par principe, il l’est par urgence ; il combattra pour l’Espagne républicaine (et/ou libertaire) parce que l’Espagne combat l’ennemi principal du mouvement ouvrier, et dès lors que " la bête immonde " est une menace pour tous, le combat de tous est un combat unique. En même temps, la perception de l’ " autre " s’élargir : l’Ethiopie agressée par l’Italie et la Chine par le Japon apparaissent en pleine lumière : on " découvre " ainsi deux des plus vieux Etats, deux des plus anciennes civilisations pérennes du monde. On a vu avec quelles difficultés le mouvement ouvrier suisse avait admis l’ " autre européen ", et pris conscience de l’interdépendance des réalités politiques nationales et étrangères et de la nécessité d’une solidarité active entre mouvements ouvriers nationaux -solidarité dont l’Internationale devait être l’instrument. Mais il ne s’agit plus, dès 1929, et il s’agit de moins en moins ensuite, de la seule Europe : la conscience des luttes en Afrique et en Asie se fait jour ; elle avait été le fait, rare, de quelques uns ; le Comintern avait aidé, au fil de ses propres errances stratégiques, à la faire naître. Elle sera, dès la fin des années vingt, le fait de militants de plus en plus nombreux, même si elle ne sera jamais " conscience collective ", conscience de classe internationaliste (à la seule exception peut-être du " moment " de la Guerre d’Espagne). Il n’empêche : les années trente élargissent considérablement les champs de vision politique de milliers de responsables socialistes et syndicalistes -et dès 1936, l’Espagne est à l’ordre du jour de toutes les réunions de toutes les instances de toutes les organisations du mouvement ouvrier.
Ce passage d’une vision du monde (et de la solidarité) à une autre se fait, à gauche, alors que le problème de l’unité entre la composante socialiste et la composante communiste du mouvement se pose de manière de plus en plus aiguë, au fur et à mesure que la crise, que les crises se développent et que les menaces se précisent. Deux débats vont donc se tenir en même temps, s’imbriquer, et deux luttes se mener : le débat (et la lutte) sur (et pour) l’unité ; le débat (et la lutte) sur (et pour) la solidarité. Une fois reconnue (théoriquement du moins) la nécessité de l’une et de l’autre, c’est à la question du " comment ? " qu’il faudra répondre : l’unité, la solidarité, certes... Mais quelle unité, quelle solidarité, par quels moyens ?
L’hostilité entre les deux courants, communiste et socialiste, à l’intérieur du mouvement ouvrier (politique et syndical) crut constamment durant la décennie qui suivit la scission. Le tournant " classe contre classe " opéré par l’Internationale communiste lors de son VIème congrès (1928) entama la période la plus âpre de la lutte entre les deux partis et leurs partisans respectifs au sein du mouvement syndical. L’énergie consacrée à cette lutte, au moment même de la poussée des mouvements autoritaires de droite, rendit le mouvement ouvrier incapable de pousser son analyse de la réalité nationale et internationale plus loin que ce qui avait déjà été dit et pensé au début des années vingt, et d’élaborer les stratégies de solidarité rendues nécessaires par les triomphes successifs de l’extrême-droite dans toute l’Europe. Au mitan de la décennie, cependant, le PSS et l’USS virent à nouveau affluer les adhésions et le programme issu des débats paroxystiques des années précédentes (ce même programme où le PSS reconnaît la dictature du prolétariat, prône la démocratie des conseils et récuse la défense nationale...) pourrait lui donner les moyens théoriques d’approfondie sa réflexion. En fait, le premier moment de " radicalisation " passé, et les congrès mis à part, le PSS n’a guère changé et sous une phraséologie révolutionnaire, il poursuit patiemment la conquête des postes politiques dans les municipalités, les cantons et le parlement fédéral. L’opposition au militarisme va entraîner le refus systématique du vote des crédits militaires, mais une minorité croissante des responsables du parti exprimera son opposition à cette attitude -minorité qui deviendra majorité au congrès de Lucerne de 1935. En 1926 déjà, Robert Grimm, l’ancien leader du Comité d’Olten, le zimmerwaldien, l’homme des contacts avec les révolutionnaires russes et de la grève générale, avait posé sa candidature à la présidence du Conseil national. Il lui faudra renoncer, après une campagne virulente de la droite et des sociétés militaires, mais cette campagne avait visé un homme qui, comme son parti, n’étais plus ce qu’il avait été, ou qu’on avait cru qu’il était, et qu’il avait lui-même peut-être cru être.
Vers la fin de la décennie, le PSS enregistre d’importants succès électoraux. En 1925, la gauche était devenue majoritaire au législatif municipal zurichois ; trois ans plus tard, elle conquiert la majorité des sièges de l’exécutif de la ville. A Bâle, Berne, Bienne, La Chaux de Fonds et au Locle, la gauche (unie ou, le plus souvent, non) obtient des majorités. Ces succès locaux accroissent l’intégration du PS (et des syndicats) dans les administrations municipales, puis cantonales, enfin, progressivement, " par le bas " de la hiérarchie, dans l’administration fédérale. De cette intégration " administrative " (qui contribue à changer profondément la base même du parti), le courant favorable à une intégration politique va tirer à la fois argument et base sociale (les fonctionnaires socialistes et les responsables syndicaux devenant responsables de services publiques et agents de politiques à la définition desquelles leur parti ou leur syndicat ne concoure encore que marginalement, quand il ne s’y oppose pas franchement). Il y a désormais dichotomie entre l’insertion professionnelle des cadres du mouvement ouvrier dans l’application de décisions politiques que le mouvement a combattues, d’une part, et le projet politique du parti, d’autre part. Le mouvement ouvrier n’aura de cesse, désormais, de réduire cette distance entre l’exécution et la décision, et cette contradiction entre ce qu’il dit et ce que font -dans le cadre de leur travail- ceux d’entre ses militants qui sont fonctionnaires ; il réduira cette distance et résorbera cette contradiction en se rapprochant du lieu de décision politique, et en mettant une sourdine à l’opposition qu’il manifestait.
En même temps que se renforce la tendance à l’intégration politique des principales organisations ouvrières, renaît pour un temps (la fin des années vingt et le début des années trente) le conflit entre " patriotes " et " internationalistes " au sein du PSS -conflit que les menaces fascistes et nazies contribueront " objectivement " à résoudre en identifiant la défense de la démocratie " ici ", et donc la défense " nationale ", et la lutte contre le fascisme et le nazisme et la solidarité avec les victimes. En 1929, le congrès du PSS fait un pas important (plus important que décisif, plus symbolique que réel, quoi qu’on en ait pu croire) en acceptant le principe de la participation minoritaire au Conseil fédéral -principe qui ne sera concrétisé qu’à la faveur de la Guerre Mondiale (et une fois acquise la certitude que l’Allemagne allait y être vaincue), et qui ne cessera d’être combattu par une minorité importante des cadres militants locaux et cantonaux du PS, et donc des délégués aux congrès nationaux du parti, ainsi que des membres de son " parlement ", le Comité central. Le principe même de la participation minoritaire de socialistes à un Conseil fédéral très majoritairement de droite, s’il fut et fait encore problème et débat, n’est au fond que la concrétisation d’un rapport au pouvoir dont les termes et les conditions furent admis il y a soixante ans, au bout d’un long processus d’intégration et sous la pression des menaces extérieurs. Mais les mots du débat ont encore résonance, et l’on pourrait, toute évolution du style des discours politiques mise à part, entendre encore sans trop d’efforts auditifs et intellectuels l’écho des débats du congrès de 1929. Le Genevois Léon Nicole s’y exprime contrer la participation minoritaire au Conseil fédéral que défend le Bernois Robert Bratschi ; en 1984 encore, les Genevois seront les plus fervents partisans d’un retrait des socialistes du Conseil fédéral, et les Bernois les plus larges contributeurs à la formation d’une majorité acquise au maintien du PS dans la coalition gouvernementale. Léon Nicole, en 1929 :
(Le Travail, 28 novembre 1929)
Face à la position défendue par Léon Nicole, celle défendue par Robert Bratschi, et soutenue par E.-P. Graber :
(La Sentinelle du 2 décembre 1929)
La participation gouvernementale comme moyen de la défense des droits démocratiques et sociaux : cette position l’emportera au congrès de Bâle du PSS, les 30 novembre et 1er décembre 1929, par 324 voix contre 137. Mais comme le rappelait Graber, la droite n’était pas (encore) prête à accepter la présence d’un socialiste au Conseil fédéral (55 ans plus tard, elle clamera haut et fort qu’elle y souhaite le maintien de la présence de deux socialistes...). Le PSS devra encore attendre quinze ans pour faire entrer l’un des siens (Nobs) au gouvernement central et, dans le temps où nous écrivions ces lignes (1990), attendait toujours de pouvoir y faire entrer le candidat ou la candidate choisi(e) par le parti, et non le candidat ou la candidat(e) choisi(e) ou préalablement accepté(e), sinon adoubé(e), par la droite...
Quant au Parti communiste, pendant que le PS peaufine son intégration sociale et politique, il échoue à améliorer son implantation dans le pays et à sortir de la marche politique où ses propres choix le confinent ; ses effectifs même ne cessent de diminuer, au fur et à mesure des purges et des virages théorico-stratégiques imposés par un Comintern qui se confond désormais avec la direction stalinienne du PCUS, laquelle se résume de plus en plus au seul Staline. Jean Vincent :
Jean Vincent, Raisons de vivre, op.cit.blblio pp 104, 105
Relisant l’histoire du mouvement dont il fut l’un des cadres, puis l’un des chefs, relisant en même temps sa propre histoire, Jean Vincent cède peut-être à la tentation de l’autojustification, mais s’il semble ce faisant " brûler les étapes " (le parcours d’un Jules Humbert-Droz n’est pas si simple, ni si direct, qu’il paraît à le lire décrit par Jean Vincent...), il met fort justement en lumière la profonde contradiction qui paralyse le PCS depuis sa création -et le paralysera jusqu’à son interdiction par le Conseil fédéral-, entre les mots d’ordre et les stratégies imposées depuis le " centre " (international et moscovite ou national et alémanique) et les situations concrètes, " sur le terrain ". Si pour Lénine il fallait être capable de produire " l’analyse concrète de la situation concrète ", le Comintern imposait, lui, une " stratégie abstraite aux acteurs concrets " -ou plutôt, une stratégie totalement déterminée par les seuls intérêts (ou ce qu’elle concevait comme tels) de la direction soviétique et stalinienne de l’Internationale. Le " radicalisme " du PCS ne fut ainsi qu’une mauvaise traduction (mauvaise, parce que mot-à-mot) des injonctions soviétiques ; ce strict alignement des communistes suisses sur le Comintern stalinien les priva de toute possibilité d’appréhension autonome et réaliste de la spécificité nationale, phénomène qu’en retour la marginalité du parti accentua encore. En 1929, à la suite du VIème congrès de l’Internationale communiste, la social-démocratie devient l’ " ennemi principal du mouvement révolutionnaire ". Sous prétexte d’ " unité à la base ", le travail fractionnel dans les syndicats reprend avec un nouvel élan, et avec pour conséquence de nouvelles mesures de rétorsion et de répression de la part des directions syndicales à l’encontre des militants communistes. La démocratie bourgeoise n’étant plus considérée que comme la " dictature de la bourgeoisie ", plus aucune différence de fond n’est faite entre elle et le fascisme, dont la social-démocratie se retrouve au surplus qualifiée d’alliée " objective " : " la social-démocratie est la main gauche de la bourgeoisie, le fascisme sa main droite ".
Le tournant " classe contre classe " rend plus illusoire encore toute tentative d’unité de la gauche, au moment même où cette unité aurait été la plus nécessaire. Le VIème congrès de l’Internationale communiste imprima une ligne sectaire à la politique suivie par les partis " nationaux " à l’égard de la social-démocratie, des syndicats, et de la démocratie bourgeoise. Les délégués du PCS avait certes exprimé des " réserves " sur ce changement dont il percevaient bien les conséquences désastreuses pour eux, mais, sur injonction du Comité exécutif de l’IC, le Comité central du PCS n’en décréta pas moins en 1929 l’application de la ligne " classe contre classe ", autocritique à la clef :
in Le Drapeau Rouge (Genève) du 8 juin 1929
On ne saurait être plus clair, ni plus " décalé " de la réalité politique et de ce qu’elle implique en termes stratégiques, que le PCS en 1929 ; on ne saurait non plus faire si exemplairement fi de l’impératif léninien : l’analyse concrète des situations concrètes : battant sa coulpe et s’accusant d’avoir été par trop " opportuniste " à l’égard d’une social-démocratie désormais définie comme le mariage de la carpe bourgeoise et du lapin prolétarien (un parti " ouvrier-bourgeois "), le PCS, tout en proclamant sa volonté d’unité " à la base " avec les ouvriers sociaux-démocrates trahis par une direction passée sous les ordres de la bourgeoisie, assigne à cet unité un objectif à la fois absurde (l’unité avec les ouvriers sociaux-démocrates contre la social-démocratie), hors d’atteinte (compte tenu du rapport des forces entre le PC et le PS) et hors de propos : alors que pour les socialistes l’heure est à la défense des droits démocratiques " bourgeois " contre les menaces fascistes et autoritaires, le PCS affirme l’inutilité d’une telle défense et la vacuité de ces droits, et se donne pour objectif la dictature du prolétariat : " Le jour où nous serons au pouvoir, nous commencerons par proclamer la dictature "... Encore faut-il y arriver, au pouvoir : outre que le chemin pris par le PCS ne l’y mène pas vraiment, le but fixé (même s’il était encore proclamé dans le programme officiel du PSS...) paraît, dans la Suisse de 1929, aussi fantasmagorique que l’analyse qui le précède et justifie sa proclamation. A tant en faire, et à le faire ainsi, le PCS se condamne non seulement à la marginalité, mais perd progressivement toute crédibilité politique. Le militant révolutionnaire de vieille date, et communiste de la première heure (quoique anarchisant) Fritz Brupbacher, s’en rend compte :
in Le Mouvement ouvrier suisse, op.cit. p. 233
Analyse et stratégie absurdes : le PCS fit les frais de ses erreurs, notamment en Romandie, où il devait affronter la " concurrence " d’un PS très marqué à gauche, et de toute évidence irréductible au portrait-charge fait par les staliniens de la social-démocratie. Comment en effet convaincre les ouvriers genevois et vaudois, notamment, que Léon Nicole était un traître à la classe ouvrière et un allié de la bourgeoisie, quand la bourgeoisie elle-même le poursuivait de sa haine (une haine d’ailleurs réciproque) et le jetait en prison ? Jean Vincent :
Jean Vincent, Raisons de Vivre, op.cit. p. 111
Mais Vincent se réfère là aux années 1936 et suivantes, sept ans après que la ligne " classe contre classe " ait été imposée au PCS. En sept ans, cette ligne eut le temps de faire des dégâts considérables, et les plus sagaces d’entre les responsables communistes le temps de s’en apercevoir, sinon le courage de le dire clairement. Depuis la scission, en fait, la ligne zigzaguante du PCS, imposée depuis Moscou et appliquée depuis Zurich, aboutit à de continuelles autocritiques, suivies d’exclusions et de démissions, le tout rendant illusoires les campagnes volontaristes d’adhésions périodiquement lancées par le parti. En 1930, c’est toute la section de Schaffhouse qui, avec Walter Bringolf, est poussée hors du PC ; se constitue alors une " opposition communiste " qui, n’acceptant pas la ligne sectaire imposée par le Comintern, tente la réconciliation avec le PSS -qui cependant commit à son tour l’erreur de n’en pas vouloir, jusqu’au moment où ces dissidents le rejoignirent purement et simplement, en 1935, au moment même où il rompait officiellement avec les derniers vestiges de " radicalisme révolutionnaire " hérités de son programme de 1920-21. La disparition des derniers reliefs de démocratie interne au sein du Comintern, l’alignement de toute l’Internationale communiste (et de chacune de ses sections nationales, " bolchévisées ", avec plus ou moins de subtilité et de précautions de style, selon les cas), la substitution du " patriotisme soviétique " à l’internationalisme prolétarien, feront perdre au PCS toute capacité d’agir (et de réfléchir) sur la réalité suisse, tout en le dressant contre les directions et les militants du PSS et de l’USS. Une ambiance de polémiques incessantes s’installe au sein du mouvement ouvrier, en Suisse comme ailleurs, et le fragilise au moment même où il a besoin de toute sa force.
Le fascisme et la nazisme auront raison de cette situation et, la crise économique aidant, les différentes forces du mouvement seront contraintes à l’unité -aidées d’ailleurs en cela par la répression qui va s’abattre sur les communistes dès la seconde moitié des années trente. Depuis 1922, en effet, une menace nouvelle, imprévue, impensée pèse à la fois sur le mouvement ouvrier et sur la démocratie bourgeoise : le fascisme. Le développement de cette force en Europe, ses expéditions militaires en Afrique, les entreprises japonaises en Asie et, surtout, l’avènement du nazisme en Allemagne, remettront à l’ordre du jour à la fois la question militaire (et le débat sur le pacifisme), celle de la démocratie (et de la nature même de sa forme " bourgeoise "), la solidarité internationale et l’unité des forces de gauche au plan national. C’est une nouvelle époque qui s’ouvre, celle d’une perception changée, et élargie, du monde.