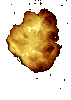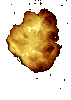

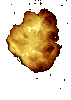

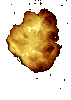






![]()
Cliquez ici pour souscrire a notre liste de diffusion (informations, débats) sur l'Algérie
![]()
Cliquez ici pour participer à la liste Forum Socialiste
Accord multilatéral sur l’investissement :
GARDONS-NOUS DE CET A.M.I

Introduction
A. Les
négociationsB. Le
contenu de l’AMI1.
Synthèse2.
divergencesC. Les
conséquences1. Politique
économique2. Politique
sociale3. Politique de l’
Environnement4. Politique
culturelle5. Politique
extérieure, rapports nord-sud6. Droits de l’
Homme, solidarité internationale
D. L'AMI et les
droits démocratiques1. Démocratie
localeE.
ConclusionEt
maintenant ?

Négocié dans la plus grande discrétion au sein de l’OCDE, le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) a soulevé un tollé général lorsqu’il a été placé sur le devant de la scène par des mouvements de citoyens et des organisations non-gouvernementales.
De quoi s’agit-il ? d’obliger les Etats et toutes les collectivités publiques infra-étatiques (les communes, par exemple) à accorder aux investisseurs étrangers les mêmes conditions qu’aux investisseurs indigènes, et à interdire d’accorder à des investisseurs d’une origine (fût-ce celle de la collectivité publique concernée) des avantages qu’on n’accorderait pas à d’autres.
Les conséquences concrètes de ce qui apparait, exprimé comme nous venons de le faire, comme un principe général, pour ne pas écrire un prédicat idéologique, sont considérable. En fait, il s’agit d’une négation globale et radicale de toute capacité de décision et d’action politiques.
A cette négation des droits démocratiques, la Suisse, qui par ailleurs cultive sa "démocratie directe" comme les géraniums sur les fenêtres de ses chalets, adhère : aucun autre pays n’exporte autant de capital qu’elle (en termes absolus, elle est le sixième exportateur de capitaux dans le monde, avec 150 milliards de dollars placés entre 1985 et 1995; en termes relatifs, par habitant, elle est le premier exportateur de capitaux au monde).
A projet global, opposition globale : un peu partout, des mouvements citoyens, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des acteurs culturels se sont élevés contre la prétention des marchés à dicter une loi totalitaire (au sens le plus précis du terme) à toute la société -et à toutes les sociétés.
Le 13 décembre 1997, les Occidentaux ont obtenu l’ouverture des marchés de la banque et de l’assurance, dans le cadre de l’OMC. Cet accord "historique" (et qui, d’une certaine manière, l’est en effet) ouvre à la libre spéculation 95 % des services financiers de la planète, sans que les institutions politiques des pays concernés -qu’elles soient ou non démocratiques- n’y puissent plus apposer de limites. L’AMI naît des mêmes prémices, et de la même volonté politique, s’inspirant notamment de l’ALENA (Accord de libre-échange USA-Canada-Mexique), auquel les syndicats américains (AFL-CIO) attribuent la responsabilité de la perte de 2 millions d’emplois.
Le champ de tels accords est considérable : à l’heure actuelle, l’investissement direct étranger (IDE) -ce, précisément, sur quoi porte l’AMI- augmente plus rapidement que les échanges de marchandises, et a atteint 300 milliards de $ (en 1997, les flux de capitaux ont atteint le niveau record de 349 mias $). 35 % de l’IDE va dans des pays du sud (mais les trois quarts de cet investissement nord-sud se concentre dans 12 pays), les IDE ont atteint 259 milliards de $ en 1996 dans les seuls 29 pays membres de l’OCDE. Environ 40’000 sociétés contrôlent 80 % du commerce mondial, les 200 sociétés principales pesant à elles seules un bon quart de l’activité économique globale, le chiffre d’affaires des grandes sociétés multinationales (et des plus grandes sociétés nationales) dépasse le produit national brut de pays développés. Ce sont ces sociétés, ces investisseurs, que l’AMI entend servir, et auxquels il entend ouvrir la voie, en réunissant en un seul accord les 1630 traités bilatéraux de la zone OCDE.
L’AMI est certes "négocié", mais il ne l’est qu’entre les 29 pays les plus riches (ceux de l’OCDE, ainsi que le Brésil, l’Argentine, le Chili et la Slovaquie, mais avec le statut d’observateurs). Les autres ? L’accord leur sera purement et simplement imposé, et s’imposera à eux, comme il s’imposera comme cadre contraignant (et, le cas échéant, comme critère de renégociation) pour les 2641 accords bilatéraux sur l’investissement signés, au 1er janvier 1997, par 152 pays. On rappellera à ce sujet que de ces 2641 accords bilatéraux, 637 ont été signés par les membres de l’Union européenne. Or ces accords, et l’AMI, ne consistent pas à lier entre eux des pays développés, à la fois exportateurs et importateurs de capital, mais liens les pays en développement (y compris ceux de l’Europe centrale et orientale) aux pay<s développés. Des 637 accords signés par les pays de l’Union européenne, seuls 15 lient ces pays entre eux ou à d’autres pays développés : les 622 autres accords ont été signés avec des pays en développement...
La date butoir initiale pour la conclusion de l’accord avait été fixée aux 27-28 avril. La mobilisation citoyenne, l’opposition des milieux culturels européens, le débat lancé finalement sur l’accord, ont rendu ce délai impossible à tenir. Les réticences, voire l’opposition franche et ouverte, des organisations non-gouvernementales ont également joué leur rôle dans le ralentissement du processus de négociation : elles ont en effet préconisé une étude des conséquences écologiques et sociales de l’accord, et la suspension des négociations jusqu’à la fin de cette étude. Elles ont également critiqué le fait que les négociations aient été menées "sans la participation -qui aurait été bénéfique- des Etats non-membres de l’OCDE et des organisations de la société civiles, y compris celles qui représentent les travailleurs, les consommateurs, les agriculteurs et celles qui se consacrent à l’environnement, au développement et aux droits de l’Homme". Bref : ce que les ONG n’acceptent pas, et ce que nous mêmes n’acceptons pas, c’est une négociation entre riches sur le dos des pauvres, entre investisseurs sur le dos des consommateurs, entre multinationales sur le dos des travailleurs, entre puissants sur le dos des faibles. L’Internationale syndicale des services publics, par exemple, exige une renégociation totale de tout l’accord.
Le 28 avril, donc, les ministres de l’OCDE s’accordaient un "délai de réflexion" dans les négociations officielles sur l’AMI, après deux jours de discussions où les divergences entre eux se sont ajoutées aux critiques "extérieures". Une réunion du groupe de travail de l’AMI a été agendée pour le mois d’octobre 1998. Le communiqué de la réunion d’avril annonce clairement l’intention des négociateurs de ne pas classer "sans suite trois années de travail", mais la France, par exemple, menace de "bloquer dans six mois" si des "discussions sérieuses" ne sont pas menées sur les points de divergence (et encore ne s’agit-il là que des divergences entre les négociateurs, non des divergences entre les négociateurs et les ONG, par exemple).
Les obstacles à la négociation au sein de l’OCDE laissent sourdre une nouvelle menace : le transfert de la négociation d’un traité de type AMI de l’OCDE vers l’OMC, transfert soutenu par l’Union Européenne (en l’espèce, par la Commission et le Parlement européens) et par le Canada, au prétexte (entre autres) que l’OMC serait un forum plus "démocratique" que l’OCDE puisque les pays en développement sont représentés dans la première. Les ministres réunis en avril dans le cadre de l’OCDE ont d’ailleurs émis une déclaration soutenant "le programme de travail actuel de l’OMC sur l’investissement" et déclarer rechercher "le soutien de tous leurs partenaires pour passer à la phase suivante, visant à créer un cadre réglementaire sur l’investissement au sein de l’OMC. L’opposition citoyenne à l’AMI pourrait donc fort bien avoir réussi à empêcher sa négociation au sein de l’OCDE, mais pour la provoquer au sein de l’OMC, sans que le contenu et les présupposés de l’accord ne soient remis en question par ses promoteurs.
En fait, le passage de l’AMI (ou de tout accord qui en reprendrait le contenu sous un autre nom) de l’OCDE à l’OMC aggraverait encore ses conséquences pour les pays en développement, dont la plupart sont membres de l’OMC et devront donc signer un accord conclu dans le cadre de l’OMC, sans avoir pu réellement peser sur son contenu : la représentativité de l’OMC a beau être formellement plus large que celle de l’OCDE, les rapports de force y sont les mêmes, et nul ne peut sérieusement croire que le Burkina Faso, le Vanuatu ou le Nicaragua y pèsent du même poids que les USA, l’Union Européenne ou le Japon. D’ailleurs, les véritables négociations au sein de l’OMC se font dans des réunions "informelles" auxquelles ne participent que les pays les plus influents.
Il faut donc y insister : le blocage de la négociation de l’AMI au sein de l’OCDE n’éloigne pas la menace de l’AMI : l’Union européenne, le Canada et le directeur de l’OMC vont peser de tous leur poids pour accélérer une négociation au sein de l’OMC et les discussions du groupe de réflexion sur le commerce et l’investissement, qu’ils vont tenter de transformer en groupe de négociation d’un AMI, ou tout autre accord qui reprendrait de l’AMI ses points fondamentaux. Parallèlement, le secrétariat du FMI et certains pays du G7 (les sept pays les plus riches du monde) vont tenter de modifier les statuts du FMI pour y intégrer, comme objectif et activité du fonds, la libéralisation des mouvements de capitaux. A cela aussi, il conviendra de s’opposer, pour les mêmes raisons que nous nous opposons à l’AMI -qu’il soit négocié dans le cadre de l’OCDE ou dans celui de l’OMC.
"Nous écrivons la Constitution d’une économie mondiale unifiée" : cette phrase, présomptueuse mais révélatrice, du directeur général de l’OMC, Renato Ruggiero, décrit assez clairement l’ambition de l’AMI. Plus précisément, l’objectif de l’accord est, selon le secrétaire général de l’OCDE, Donald J. Johnston, de "garantir aux investisseurs un cadre juridique clair, équitable et stable, et de leur offrir des mécanismes destinés à résoudre d’éventuels conflits qui les opposeraient au gouvernement du pays d’accueil". On va le voir, le projet propose en effet un cadre juridique "clair" (les investisseurs sont systématiquement privilégiés par rapport aux collectivités publiques) et "stable" (la signature de l’accord n’est pratiquement pas révocable, un pays signataire de l’AMI ne pourrait pas s’en retirer avant vingt ans, le temps de rendre irréversibles les dégâts qu’il causerait, et les réserves que l’on pourrait faire à la signature de l’accord ne peuvent tenir que quelques années, après quoi elles sont réputées caduques), afin (ou au prétexte) de donner aux investisseurs étrangers les mêmes droits que les investisseurs locaux dans les pays signataires.
Il s’agit donc, formellement, de créer un cadre juridique unique de promotion et de protection des investissements, la définition de ceux-ci étant assez large pour englober à tous les domaines et tous les modes de l’activité sociale, biens corporels et incorporels, investissements directs et indirects, activités économiques au sens strict et activités sans but économique : pour l’AMI, est considéré comme investissement tout ce qui peut faire l’objet de transaction marchande et non-marchande. Or nous sommes ("nous", ici et maintenant, dans le monde "développé") dans un monde où tout, absolument tout, peut faire l’objet de transaction "marchande ou non-marchande". Une définition si large et une protection si absolue de l’investissement rendent finalement totalement illusoires toute intervention publique, à quelque niveau que ce soit, pour atteindre quelque objectif socio-économique que ce soit -d’autant que l’investissement est présenté "en soi", indépendamment de l’investisseur : ce n’est pas l’intérêt de l’investisseur qu’il s’agit prioritairement de sauvegarder, mais l’investissement en tant que tel, et sa rentabilité : la garantie de l’investissement implique certes le protection de l’investisseur, mais comme la fin implique le moyen.
Celà étant, et puisqu’il faut garantir les droits des investisseurs pour garantir la rentabilité des investissements, on va s’y attacher, sans mégotter : l’investisseur aura à peu près tous les droits économiquement concevables, et le droit d’investir sera à peu près absolu : acheter des terrains, des matières premières, des ressources naturelles, des biens, des services, et tout cela avec la garantie gouvernementale -puisque si les investisseurs n’ont aucune obligation, les gouvernements ont, eux, l’obligation de garantir la "pleine jouissance" des investissements....
Ce qui dans l’AMI exprime le mieux à la fois la logique et les intentions de l’accord est le déséquilibre extraordinaire qu’il contient entre les droits et les devoirs respectifs des investisseurs et des collectivités publiques : pratiquement tous les droits qu’il reconnaît le sont aux investisseurs, pratiquement tous les devoirs qu’il impose le sont aux collectivités. Le projet ne prévoit ainsi aucun mécanisme par lequel un Etat (ou une région, ou une commune) puisse se plaindre du comportement d’un investisseur, celui-ci n’ayant aucune obligation particulière à respecter (même pas une obligation de résultat : peu importe qu’un investissement soit productif ou non, peu importe également ce qu’il produise éventuellement : c’est l’investissement que l’on protège, pas ce à quoi il pourrait éventuellement aboutit); le projet prend même la peine de préciser que "la pratique des firmes n’est pas du ressort de l’accord"; en revanche, les possibilités pour les investisseurs de trainer les collectivités publiques devant une instance de sanction ad hoc sont nombreuses, garanties et explicites, et visent non seulement l’Etat central mais également les collectivités locales et régionales.
Nous sommes là au coeur du problème, et du débat. Au coeur de la contradiction entre deux positions de principe : celle des Nations Unies, dont la Charte sur les droits et devoirs économiques (1974) proclame que "chaque nation a le droit inaliénable de réglementer les investissements étrangers et d’exercer son contrôle sur les investissements" et celle des multinationales, qu’exprime fort bien le président du Conseil américain pour le commerce international (US Council for International Business) : "Nous nous opposerons à toute mesure tendant à créer ou même impliquant des obligations contraignantes pour les entreprises... en ce qui concerne l’environnement ou le travail" (21 mars 1997). Objectif atteint en ce qui concerne l’AMI, dont le projet prévoit même la possibilité pour les investisseurs d’exiger (en lui donnant tous les moyens de l’obtenir...) une compensation pour toute action publique réduisant les bénéfices réels ou escomptés d’un investissement, ou ayant "un effet semblable à une expropriation indirecte", concept particulièrement élastique qui peut par exemple englober une hausse des impôts. Et il s’agit même pas ici de réparation d’un dommage subi : pour donner droit à une compensation, "le dommage, bien qu’imminent, ne doit pas nécessairement avoir été subi"...
Derrière l’AMI, et se manifestant par lui, il y a un projet : rendre le plus rapidement possible le monde entier le plus directement et le plus généralement accessible, aux multinationales du Nord. Et ce n’est pas tant le monde déjà développé, celui qui est déjà le monde des multinationales, qui les intéresse, mais le monde en émergence économique de l’Asie et de l’Amérique du sud : quatre milliards de personnes en situation de "sous-consommation", mais potentiellement consommatrices de tout ce dont le nord regorge, et de tout ce qu’il dégorge. La multinationale helvéto-suédoise ABB va doubler ses activités en Asie ces prochaines années. Nestlé sait qu’elle ne pourra accroître ses profits qu’au sud. Et pour que ces investisseurs-là, les plus puissants d’entre les investisseurs, puissent conquérir ces marchés émergents (tout en supprimant des emplois dans les marchés déjà conquis), un AMI n’est pas de trop, afin de démanteler les lois et d’abolir les pratiques de protection des marchés nationaux, y compris les lois de protection des droits des travailleurs indigènes ou de protection de l’environnement (quand des lois de ce type existent et sont appliquées).
Les ambitions initiales des promoteurs de l’AMI ont certes été quelque peu réfrénées à la fois par les divergences entre Etats et du fait de l’opposition populaire à l’accord mais, au prix de quelques renoncements (le nouveau projet d’accord n’évoquera sans doute pas les problèmes de taxation) et de quelques sacrifices rhétoriques (évocation de normes minimales en matière d’emploi et d’environnement), le coeur du dispositif proposé reste inchangé : abolir les barrières limitant l’investissement direct étranger, dont le secrétaire général de l’OCDE proclame qu’il apporte "prospérité, croissance et emplois", mais que l’AMI entend favoriser en démantelant les dispositifs de défense de l’emploi local, régional et national, et de définition des modalités et des contenus de la croissance et de la prospérité. La prospérité dont il s’agit pour les promoteurs de l’AMI est celle des investisseurs, non celle des sociétés; la croissance qui est leur objectif est celle des profits des investisseurs, non celle des économies nationales, régionales et locales.
(cette synthèse est effectuée à partir du texte français de la version du 10 octobre 1997 du texte et des commentaires consolidés du projet d’AMI)
Préambule
L’accord proclame dans son préambule la volonté de ses parties contractantes de "promouvoir entre elles une coopération économique plus étroite" et souligne leur conviction que "des régimes d’investissement justes, transparents et prévisibles complètent le système commercial mondial et sont bénéfiques pour ce système". Le but de l’accord est d’"établir pour l’investissement international un large cadre multilatéral comportant des normes élevées de libéralisation des régimes d’investissement et de protection de l’investissement". Les parties contractantes n’en réaffirment pas moins "leur attachement à la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement" -mais certaines délégations se sont opposées à cette référence, comme à celle de l’investissement en tant que "moteur de la croissance économique" dont il peut assurer la "viabilité" s’il "s’accompagne de mesures environnementales adéquates veillant à ce qu’il respect l’environnement". La même opposition s’est exprimée à l’expression de l’"attachement" des signataires au "respect des normes du travail reconnues au niveau international", et plus encore à ce que soient évoqués "la liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective, l’interdiction du travail forcé, l’abolition des formes de travail des enfants qui constituent une exploitation et la non-discrimination dans l’emploi".
Le préambule de l’accord affirme sa qualité d’"accord autonome ouvert à l’adhésion de tous les pays" et déclare que les signataires "prennent note" ou "expriment leur soutien" (les délégations divergaient sur cette formulation) des/aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
B.2 Les divergences sur le contenu
L’ambition même de l’accord a provoqué des divergences entre ceux qui le négociaient, c’est-à-dire entre les Etats membres de l’OCDE, sans parler des divergences entre les négociateurs (collectivement considérés) et les ONG et mouvements de citoyens qui, de l’extérieur de l’OCDE, ont dénoncé à la fois la méthode de négociation, le contenu et la "philosophie" de l’accord.
Les Etats négociateurs ne divergeaient guère sur le fond, mais sur les modalités; ces divergences furent cependant suffisemment nombreuses et importantes pour remettre en cause toute la négociations, et empêcher que soit respecté le délai initial qui fixait à fin avril 1998 la conclusion de l’accord.
Les Européens rejettaient les lois américaines (Hels-Burton et d’Amato), qui autorisent (voir obligent) le gouvernement des USA à prendre des sanctions contres les sociétés étrangères opérant aux Etats-Unis si ces sociétés investissent dans des Etats soumis à un embargo américain (Cuba, l’Iran ou la Lybie) -disposition en effet pour le moins contraire aux proclamations "libre-échangistes" des Etats-Unis.
Les Français, les Canadiens, les Belges, les Italiens, les Espagnols et les Australiens demandaient, voire exigeaient, la reconnaissance de l’"exception culturelle", c’est-à-dire la soustraction du domaine culturel au champ de l’accord. À raison, l’OCDE n’y voyait pas un obstacle majeur (la logique de l’accord n’en était pas affectée, et son champ d’application était à peine écorné), mais cette revendication a permis une mobilisation des milieux culturels contre l’ensemble du projet, et poussé le gouvernement français à lui opposer une critique plus générale, jusqu’à menacer finalement de claquer la porte si ses positions étaient ignorées: fin avril, les négociateurs français, exprimant leur satisfaction de la suspension des négociations, déclaraient qu’ils souhaitaient certes toujours un accord, mais à leurs conditions : "La France exige des discussions sérieuses, sinon on bloquera dans six mois", avertissait le Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Jacques Dondoux.
Mais l’exception culturelle n’a pas été la seule à être revendiquée, et presque tous les pays ont inscrit des exceptions dans leur offre d’adhésion à l’accord : les USA doivent composer avec les règles de discrimination positive à l’embauche ou à l’investissement là où ces règles existent, et avec les décisions des Etats fédérés, voire des villes, prises à l’encontre de certains investisseurs (les banques suisses, par exemple, en relation avec l’"affaire des fonds juifs") ou au profit d’investisseurs locaux.
L’inclusion de clauses sociales et environnementales a été exigée par les ONG et les syndicats, pour empêcher une surenchère à la dérégulation afin d’attirer des investisseurs. Relayée par certains Etats partie à la négociation (la France, notamment), ces clauses ont été récusées par d’autres (la Grande-Bretagne, le Mexique, l’Australie).
Enfin, les Etats européens (la Grande-Bretagne exceptée) tiennent à s’assurer qu’ils pourront continuer à bâtir l’union économique européenne y compris en favorisant les investisseurs européens à l’intérieur du Marché Unique.
Ces divergences ont été exprimées lors de la négociation même du texte. Celui-ci prévoit que les parties contractantes (les Etats signataires) réaffirment "leur attachement à la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement" -mais certaines délégations se sont opposées à cette référence, comme à celle de l’investissement en tant que "moteur de la croissance économique" dont il peut assurer la "viabilité" s’il "s’accompagne de mesures environnementales adéquates veillant à ce qu’il respect l’environnement". La même opposition s’est exprimée à l’expression de l’"attachement" des signataires au "respect des normes du travail reconnues au niveau international", et plus encore à ce que soient évoqués "la liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective, l’interdiction du travail forcé, l’abolition des formes de travail des enfants qui constituent une exploitation et la non-discrimination dans l’emploi".
Au bout du compte, il est désormais pratiquement certain que l’AMI (ou l’accord reprenant l’essentiel de son contenu sous un autre nom, et négocié dans une autre instance) n’évoquera pas les problèmes de taxation et fera place rhétorique à l’exception culturelle ainsi qu’à quelques clauses environnnementales et sociales Cela étant, et même compte tenu de reculs de ce type, la colonne vertébrale de l’accord reste entière.
Il est toutefois possible de miser sur les oppositions qui se sont (tardivement, et une fois le projet rendu public) manifestées pour faire échouer l’AMI. "Mieux vaut pas d’accord qu0un mauvais accord", a déclaré en février le ministre français de l’économie, Dominique Strauss-Kahn, en affirmant que le France refuserait de signer l’AMI s’il entérinait les lois américaines d’Amato et Helms-Burton, si l’exception culturelle n’était pas acceptée, si l’accord impliquait un dumping social et écologique, des entraves à l’intégration européenne ou la remise en cause de lois et de réglementations existantes. On ne sait si le gouvernement français tiendra cette position jusqu’au bout, mais si tel devait être le cas, l’AMI devrait soit se passer de la signature de la France -ce qui est peu vraisemblable), soit abandonner son ambition première et fondamentale de briser les entraves à l’investissement, ce qui est moins vraisemblable encore. On peut dès lors imaginer qu’une position de ce type, tenue par l’un des acteurs importants de la négociation, pourrait faire définitivement capoter celle-ci. Reste que si l’AMI ne se conclut pas sous la forme où il a été négocié, ses partisans ne vont pas renoncer à un traité de libéralisation des investissements. -et que, par conséquent, les adversaires de toute politique de ce type ne doivent pas désarmer.
A l’extérieur du groupe de négociation (et de l’OCDE), une opposition s’est également fait jour au sein des ONG et des organisations syndicales internationales, notamment. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le TUAC (Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE) ont revendiqué l’adoption d’une clause sociale contraignante, assez fondamentalement contraire à l’"esprit" de l’AMI, et qui obligerait au respect des normes internationales fondamentales du travail : interdiction du travail forcé, du travail des enfants, de la discrimination entre les salariés, garantie des libertés syndicales et d’association et des droits des travailleurs, force contraignante des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales (principes qui devraient être inclus dans l’accord) etc... Les syndicats réclament en fait l’interdiction du "dumping social". Quant aux ONG, elles considèrent que le projet d’accord n’est compatible ni avec les accords internationaux déjà signés par les Etats membres de l’OCDE (c’est-à-dire les Etats même qui négocient l’AMI), ni même avec la politique de l’OCDE, ni avec les lois nationales visant à promouvoir le développement durable, à protéger l’environnement et à respecter les droits de la personne humaine. La plupart des Européens sont favorables aux clauses sociales et environnementales. La Suisse elle-même a exprimé son soutien à de telles clauses (mais le Conseiller fédéral Couchepin, fin avril, s’est empressé d’ajouter que "pour des raisons qui lui sont propres", et notamment du fait de la place qu’elle occupe dans l’investissement mondial, la Suisse restait "très favorable" à l’AMI et au maintien de la négociation dans le cadre de l’OCDE.
Le Parlement européen, enfin, a exprimé dans une résolution en mars 1998 sa préoccupation "du fait que, dans le projet d’accord multilatéral sur l’investissement (AMI), il existe un déséquilibre entre les droits et obligations des investisseurs, lesquels se voient octroyer une protection et des droits pleine et entiers, tandis que les Etats signataires sont soumis à de lourdes obligations qui pourraient laisser leurs populations sans protection". Inquiétude tout à fait légitime, et justifiée, mais dont l’objet est le coeur même du traité : ce déséquilibre entre les obligations des Etats et les droits des investisseurs est la condition de la cohérence de la démarche "néo-libérale" (pourquoi "néo", au fait ?) de l’AMI. Si cette condition n’est pas remplie, l’AMI n’a plus de sens, parce que son contenu n’a plus de cohérence.
"Nous écrivons la Constitution d’une économie mondiale unifiée" proclamait, en guise de présentation de l’AMI, le directeur général de l’OMC Renato Ruggiero. Une constitution, et celle-là comme les autres, fixe des règles dont vont, dans tous les domaines de l’activité politique et sociale, découler des lois, qui auront obligation de les respecter, et qui à leur tour détermineront des règlements qui devront y être conformes. Bref, la "constitution de l’économie mondiale unifiée" va déterminer la vie quotidienne, individuelle et collective, des gens, le fonctionnement des institutions politiques (du plus local jusqu’au plus global des niveaux), les limites de l’action des acteurs sociaux et politiques.
Or, caractérisé par le fait qu’il n’accorde de droits nouveaux qu’aux investisseurs en imposant des devoirs supplémentaires aux pouvoirs politiques et aux collectivités publiques, un accord comme l’AMI implique, du point de vue de ses conséquences, de considérables restrictions aux droits démocratiques, dans la mesure même où il exclut du champ du prononcement politique tout ce qui pourrait représenter une entrave à l’investissement -c’est-à-dire, au bout du compte, toute décision politique ayant des effets concrets.
C’est ainsi qu’un "monopole" public sans but lucratuf (un hôpital, une école, une prison même...) ne devrait plus agir que selon des critères commerciaux lors de l’achat ou de la vente de biens et services, et que tout critère d’utilité publique (d’une commande ou d’une prestation) pourrait être rendu caduc sur plainte d’in "investisseur" s’estimant lésé. C’est ainsi également qu’un gopuvernement n’aurait plus le droit de déterminer autrement que par les critères du marché les prix de biens ou de services, tels que (toujours par exemple) ceux des transports publics, les loyers des habitations subventionnées, les soins médicaux d’urgence ou indispensables à la survie de l’individu etc... On notera au passage qu’un secteur est expréssèment soustrait du champ d’application de l’AMI : la défense nationale -ce qui indique au moins que les complexes militaro-industriels nationaux ont pesé d’un poids plus grand dans les négociations que les organisations de protection sociale.
Pour le reste, les règles relatives aux "expropriations" et "indemnisations", telles que proposées par l’AMI, donneraient à toute entreprise ou investisseur étranger, dans quelque domaine que ce soit, le droit de contester à peu près n’importe quelle décision politique, à quelque niveau qu’elle soit prise (d’un Conseil municipal à un exécutif continental) et quelle que soit la manière (démocratique ou non) dont elle a été prise : des mesures fiscales à la protection de l’environnement, du droit du travail à la protection des consommateurs, du soutien à la création d’entreprises à la défense de catégories particulières de population ou de secteurs économiques, tous les champs possibles de l’action politique et sociales sont balisés.
La politique économique ? Mais quelle politique économique ? L’AMI n’en accepte aucune, et récuse toute intervention politique en considérant comme une faute toute mesure ou décision "ayant fait perdre à une société une occasion profitable" -qu’on nous dise donc quelle décision politique n’a pas pour conséquence de "faire perdre à une société" une occasion profitable...
Toute mesure de politique économique susceptible de provoquer une perte ou des revenus moins élevés que prévus par un investisseur (et, là encore, qu’on nous dise quelle mesure de politique économique n’a pas un tel effet...) est ainsi considérée comme une "expropriation", et réprouvée comme telle (à moins qu’une bonne et lourde indemnisation ne soit accordée). Une collectivité publique ne pourrait pas non plus décider de défendre ou de promouvoir tel ou tel secteur d’activité économique par le recours à des fonds publics, sauf à accorder aux investisseurs étrangers les mêmes aides (y compris s’ils n’en ont pas besoin) que celles accordées aux investisseurs indigènes. En d’autres termes : l’argent des contribuables serait mis à disposition d’entreprises extérieures à l’espace de perception de la contribution. S’agissant d’ailleurs de cette perception, si l’AMI ne contient aucune norme explicite en matière de fiscalité, ce n’est pas tant pour respecter les compétences publiques en la matière que pour préserver l’existence de paradis fiscaux : si basse que soit en effet une norme générale en matière de fiscalité, et si réduite que soit la fiscalité tolérée par une telle norme, elle irait en effet encore au-delà de l’absence totale de fiscalité sur les bénéfices et les plus-values dont les paradis fiscaux, pas plus que les entreprises qui en profitent, n’acceptent pas la remise en cause. Leur voix portant un peu plus loin, et plus fort, que celle des ONG et des syndicats internationaux, la fiscalité est exclue du processus de l’AMI
Et de s’intéresser, évidemment, aux privatisations d’entreprises publiques, en posant comme règle que les entreprises étrangères (dont évidemment les multinationales) doivent bénéficier d’un "traitement national", et en interdisant par exemple la garantie d’un accès privilégié des travailleurs de l’entreprise privatisée aux actions, par des prêts ou des exonérations fiscales.
En posant comme principe cardinal l’égalité de traitement de tout investisseur et de tout investissement, qu’ils soient étrangers ou nationaux, extérieurs ou intérieurs à l’espace de décision politique, l’AMI remet directement en cause les subventions à l’emploi, les aides aux régions défavorisées, les salaires minimums -voire les conventions collectives elles-mêmes, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision d’extension à l’ensemble du secteur ou que les collectivités publiques imposent leur respect comme condition d’accession aux appels d’offres et aux ouvertures de marchés publics. L’AMI va dans ces domaines assez loin pour s’appliquer à des normes de santé publique, en excluant par exemple l’interdiction d’un additif alimentaire (ou d’un matériau de construction), interdiction qui, évidemment, restreindrait les bénéfices de son fabricant.
Logiquement, donc, seraient interdites toutes les mesures mises en oeuvre en faveur de secteurs particuliers de la population ou de l’activité économiques (aides en faveur des petites et moyennes entreprises, aides à la création d’entreprises nouvelles, aides à la culture, à la paysannerie, aux groupes sociaux défavorisés sur le marché de l’emploi...) sous menace de dommages-intérêts, sauf à offrir ces mêmes aides aux multinationales -et l’on voit d’ici la FONDETEC contrainte d’offrir au groupe Hersant l’aide qu’elle envisage pour tel journal dominical local, ou la Ville de Genève accorder à CNN le soutien qu’elle accorde à "Léman Bleu"... Si, pour lutter contre le chômage, une municipalité, une région (un canton, par exemple) ou un Etat institue un dispositif d’aide à la réalisation de projets ou de création d’entreprises par des chômeurs, tout investisseur extérieur, multinationales comprises, devrait avoir accès à ce type de financement. Absurde ? Economiquement et socialement, sans aucun doute -mais idéologiquement, par contre, tout cela est parfaitement logique, dès lors que l’on pose en principe l’égalité fondamentale de Nestlé et de l’épicier du coin, de Novartis et du droguiste artisanal, de Volkswagen et du garagiste bricoleur...
Il va de soi, enfin, que le projet d’accord ne contient aucun engagement à respecter les droits fondamentaux des travailleurs : rien, là encore, que de très logique, puisqu’il s’agit d’attirer des investissements étrangers, au besoin par la sous-enchère salariale et sociale, en abaissant ou en violant les normes nationales ou internationales (en particulier toutes celles qui obligeraient les investisseurs étrangers. dont les multinationales, à traiter correctement leurs employés et à reconnaître les syndicats). Une clause sociale serait contradictoire de cet objectif, donc pas de clause sociale (même si, tardivement, quelques délégations ont fini par en exiger une, tout en sachant qu’elle irait à l’encontre des intentions de l’accord, sauf à être au départ privée de toute efficacité). Comme le reconnaît benoîtement le secrétaire général de l’OCDE Daniel Johnston, "on ne peut pas dire que l’AMI va améliorer le sort des travailleurs". Tel n’est ni son but, ni sa logique. M. Johnston ne s’en cache pas : "il y a une richesse générale créée par la libéralisation, mais il faut accepter que les bénéfices ne soient pas équitablement partagés dans la société". Une richesse générale, qu’est-ce à dire ? C’est-à-dire quelques très riches et beaucoup de pauvres, avec entre deux, pour amortir le conflit entre les premiers et les seconds, un nombre suffisant de ni riches, ni pauvres, se croyant assez riches pour se croire participer au monde des riches, et ayant assez peur de la pauvreté pour avoir peur des pauvres...
Ce qui vaut pour la politique sociale vaut pour la politique de l’environnement : il ne saurait en être question. Un Etat ou une collectivité publique intérieure qui déciderait de combattre la pollution industrielle en imposant des contraintes aux entreprises (retraitement des déchets, filtrage des rejets etc...) devrait les indemniser; de telles contraintes pourraient en outre être contestées sur le principe, dans la mesure où elles sont effectivement discriminatoires à l’égard des entreprises ne pouvant s’y soumettre.
On peut, au nom de principes de ce genre, en arriver à proclamer le principe du "pollué payeur" ou du "pollueur payé" : le traité de libre échange de l’Amérique du nord (ALENA), qui contient des dispositions comparables à celles de l’AMI, permet déjà à des entreprises de s’attaquer directement aux Etats leur imposant des normes environnementales pour exiger d’eux des dédommagements. C’est ainsi que le compagnie Ethyl a pu réclamer 247 millions de dollars de dédommagement au parlement canadien, en compensation d’une loi canadienne interdisant l’utilisation d’un additif toxique dans la benzine. La compagnie prétendait que celle loi équivalait à une "expropriation indirecte" de son usine canadienne et que le débat parlementaire sur l’interdiction de cet additif lui avait causé un tort commercial, puisque d’autres Etats, alertés par ce débat, risquaient eux aussi d’interdire le produit en question. De même, une entreprise qui avait projeté de créer un dépôt de déchets toxiques au Mexique a réclamé 400 millions de dollars au gouvernement mexicain après que celui-ci ait décidé de créer une réserve naturelle là où ces déchets auraient du être entreposés.
On ne s’étonnera pas que, ni dans le premier cas, ni dans le second, la nocivité des marchandises ou des services faisant l’objet d’investissements ne pose problème aux investisseurs réclamant un dédommagement : nous sommes dans l’ordre du libre-échange et de la mercantilisation, non dans celui des droits fondamentaux et de l’environnement. Quoi que vous vendiez, quoi que vous proposiez,. vous êtes a priori supposés être en droit de le vendre ou de le proposer, et d’être dédommagés si vous n’avez pu le vendre.
Il n’y a pour les concepteurs de l’AMI aucun domaine de l’activité humaine qui ne soit un domaine marchand : la réification marchande est générale, totale, absolue -et la culture, évidemment, n’y peut échapper. L’AMI la considère donc comme un champ d’investissement comme les autres, régi par les mêmes normes, soumis aux mêmes impératifs.
L’AMI, dans sa version initiale en tous cas, aboutissait à nier purement et simplement à des pouvoirs publics le droit de mener une politique culturelle concrète : les quotas ou les aides à la création en fonction de critères linguistiques, par exemple, étaient rendus impossibles, au nom du libre investissement. L’accord permettait ainsi aux géants de l’audiovisuel (américains pour la plupart, mais également européens et japonais -mais misant sur des programmations anglo-américaines- de demander une part des subventions françaises à la création francophone, ou espagnoles à la création hispanophones etc..., jusqu’à exiger pour des multinationales nord-américaines une part des aides prévues pour le cinéma du Burkina-Faso. Là encore l’absurdité de la revendication n’est qu’apparente : dès lors que l’on pose comme critère déterminant ceux du libre accès de tout investisseur à tout marché et de l’égalité des investisseurs entre eux, on suppose également Hollywodd et Ouagadougou, Steven Spielberg et Idriss Ouedraougo comme égaux. Que l’on sache bien qu’en réalité tel n’est pas le cas ne sera pas reçu comme une objection, puisque nous ne sommes pas dans l’ordre de la réalité mais du prédicat idéologique et du projet économique.
Les premières résistances institutionnelles à l’AMI se sont cependant appuyées sur cette volonté de mercantilisation du champ culturel pour combattre le projet, et assez rapidement (du moins dès que le contenu de l’accord fut connu), des gouvernements ont cédé face à la pression des milieux culturels : la France et le Canada, par exemple, ont affirmé leur volonté de continuer à subventionner leurs secteurs artistiques et culturels, y compris l’audiovisuel. Comme le relève le directeur de l’Office fédéral de la culture (par ailleurs adversaire pour le moins modéré de l’AMI), "les aides qui encouragent la création et la diffusion culturelles permettent aux biens culturels de voir le jour et d’avoir (...) accès aux marchés. Personne ne peut légitimement prétendre que les soutiens des Etats à leurs créateurs discriminent les créateurs ressortissants des autres pays". Personne, vraiment ? La logique de l’AMI, pourtant, l’affirme haut et fort, dès lors qu’elle considère par exemple comme une entrave à l’investissement une obligation d’user d’une langue particulière pour bénéficier d’une subvention.
L’AMI remet directement en cause la capacité des Etats, des régions et des communes de déterminer des critères culturels pour une politique culturelle; à ces critères, l’accord prétend substituer les seuls critères du marché -or sur le marché, une expression culturelle en anglo-américain représente une chance de profits évidemment plus importante qu’une expression culturelle en français, en allemand ou en italien (pour ne rien écrire du romanche...). De ce point de vue, l’exception culturelle revendiquée par les milieux culturels et par quelques Etats est une remise en cause de l’AMI, sur le fond de celui-ci.
C.5 La politique extérieure, les rapports nord-sud
Un accord du type de l’AMI, accord multilatéral, contraignant, s’imposant aux Etats et limitant les capacités de choix des collectivités publiques, n’a pas que des conséquences de politique intérieure : il détermine également les politiques extérieures et les politiques de développement. On rappelera à ce sujet que 9 pays en développement et 10 pays d’Europe centrale et orientale ont signé au total 741 accords bilatéraux sur les investissements (soit davantage que les 19 pays les plus développés), accords auxquels l’AMI va se surimposer.
l’AMI s’imposerait donc aux politiques extérieures et aux politiques de développement : si, pour promouvoir un projet de co-développement avec un pays du sud, un gouvernement signataire de l’AMI décidait de créer une société mixte (joint-venture) avec un pays africain non signataire de l’AMI, les firmes des pays signataires de l’AMI pourraient exiger de profiter des mêmes avantages, même si cela entrait en contradiction avec l’objectif de co-développement inhérent au projet, objectif qui suppose que soient privilégiées les firmes du pays non signataire de l’AMI -mais signataire de l’accord de joint-venture. Non seulement le pays en développement qui devait être le bénéficiaire de l’accord ne le serait plus, mais le pays développé qui avait conclu l’accord pour soutenir son partenaire se verrait contraint de soutenir, de facto, des investisseurs qui n’ont pris strictement aucune responsabilité de co-développement et n’assument aucun des risques de l’accord.
De nombreuses dispositions de l’AMI visent en outre à désarmer les pays du sud face à l’investissement du nord, et à les confiner au rôle de réserver de main d’oeuvre non-qualifiée : ainsi, l’AMI excluerait toute limitation de l’entrée de cadres étrangers dans les économies nationales de la périphérie, alors que les pays concernés consacrent des efforts considérables à former leurs propres cadres -et que nombre d’entre eux ont adopté des législations ou des réglementations restreignant les possibilités des investisseurs étrangers d’importer des équipes de direction ou d’encadrement entièrement constituées.
C’est user d’un euphémisme que d’écrire que la défense des droits fondamentaux de la personne humaine ne sont pas le souci premier (ni même dernier) de l’AMI. Si un tel accord avait été en vigueur dans les années ‘70 et ‘80, les restriction des investissements décidées à l’encontre de l’Afrique du Sud du temps de l’Apartheid auraient été déclarées illégales. Les violations des droits de l’Homme, si flagrantes et graves qu’elles puissent être, ne sont en effet pas, du point de vue de l’AMI, des raisons suffisantes pour restreindre les possibilités d’investir dans le pays concerné. A l’inverse, même si un investisseur commet des violations flagrantes des droits de l’Homme dans un pays, son droit d’y investir au même titre qu’une entreprise locale doit être garanti, et une puissance publique qui lui contesterait ce droit au nom du respect des droits de l’Homme pourrait se voir contrainte de l’indemniser, quels qu’aient été les actes pour lesquels son activité a été limitée. Une entreprise sanctionnée, par exemple, pour avoir mis sur pieds une "milice patronale" coupable de brutalités (voire, comme cela a si souvent été le cas, d’assassinats), ne pourrait se voir interdire, ni même contester, son "droit" à investir dans le pays même où ces brutalités (voire ces assassinats) ont été commis.
D. Que resterait-il des droits démocratiques ?
Il y a deux méthodes, deux manières, de réduire à rien ou à presque rien le champ des droits démocratiques : le première, brutale et simpliste, est la bonne vieille voie de la dictature (quelque forme qu’elle prenne, et quelque prétexte qu’elle se donne). La seconde, plus subtile, consiste à soustraire à l’exercice de la démocratie des domaines de plus en plus étendus, de plus en plus importants, jusqu’à ne laisser ces droits s’exercer que sur l’accessoire, le secondaire, ce qui n’a pas de conséquence. C’est cette seconde voie qu’empruntent des accords tels que l’AMI.
L’AMI n’a certes pas pour objectif explicite de réduire à rien le champ de la démocratie. Mais il y aboutit en conséquence de son contenu et de sa logique interne -ce que l’OCDE confirme benoîtement en reconnaissant que "L’AMI (...) aura pour effet de modérer dans une certaine mesure l’exercice de l’autorité nationale". Une "certaine mesure", en effet, pour ne pas dire une mesure certaine, et de réduction non seulement de l’"exercice de l’autorité nationale", mais surtout de la capacité de décision démocratique. Il est de ce point de vue significatif que l’accord prévoie des droits de recours pour les entreprises et les investisseurs, mais les exclue pour les citoyens et les associations. Significatif aussi le fait qu’ile prévoie de rendre les Etats responsables des manques à gagner dus à des "troubles de l’ordre public", concept assez vague et extensible pour englober tout à la fois une grève ou un boycott et une émeute ou une guerre, et qui ne peut avoir pour conséquence qu’un renforcement des dispositifs préventifs ou répressifs de ces hypothétiques "troubles à l’ordre public" -lesquels, au fond, ne sont plus que des "troubles à l’investissement privé", donnant aux investisseurs (mais à eux seuls) le droit d’exiger d’un Etat des dommages et intérêts si un projet d’investissement n’est pas mené à terme du fait d’une opposition populaire, même si cette opposition a été provoquée par les défauts du projet lui-même (que l’on pense par exemple aux oppositions suscitées par des projets de décharges pour déchets toxiques...).
De même, en niant tout simplement, au nom du libre investissement, à une collectivité publique (commune, région ou Etat central) la possibilité de mener une politique culturelle en fonction de critères qu’elle déterminerait elle-même (notamment de critères linguistiques ou géographiques, en privilégieant l’usage d’une langue, ou en favorisant les créateurs locaux), l’AMI nie à cette collectivité et à ses membres, à ses citoyens, la possibilité de se prononcer sur les contenus de l’investissement culturel public.
Il en va d’ailleurs ainsi de toute politique volontariste, dans quelque domaine que ce soit, dès lors qu’une telle politique implique un choix d’investisseurs au détriment d’autres, en fonction de critères sociaux au sens large du terme : exiger par exemple qu’une entreprise privée soit signataire d’une convention collective pour accéder à un marché public, c’est empêcher une entreprise non-signataire de la convention d’y accéder. Cette entreprise pourrait alors exiger des dommages et intérêts de la collectivité publique...
Elle le ferait avec d’autant moins de crainte qu’en signant l’AMI, les Etats s’engageraient à ne prendre aucune mesure "déraisonnable" à l’encontre des investissements. Mais le projet d’accord ne donne aucune définition précise de ce que pourrait être une mesure "déraisonnable", et charge une instance désignée par les investisseurs eux-mêmes de juger de l’aspect "déraisonnable" d’une décision politique...
Pour plus de liberté accordée aux investisseurs, l’AMI donnt aux investisseurs la possibilité de court-circuiter la législation des pays signataires (législation nationale ou régionale) et de soumettre leurs différends à une instance internationale de leur choix, dont la Chambre de Commerce Internationale, largement "pilotées" par les firmes multinationales -les seules à disposer des moyens de ce "pilotage". Aucun dispositif n’est au surplus prévu pour rendre les investisseurs et les firmes comptables de leurs actes devant les Etats et les citoyens des pays signataires, puisqu’aucune obligation de résultat n’est imposée aux investisseurs.
La question se pose donc : pourquoi des représentants d’Etats démocratiques abandonnent-ils aussi légèrement ce qui constitue la capacité même de décision démocratique -une capacité qui ne leur appartient pas puisqu’elle ne leur est que déléguée par le Souverain.
On le voit donc aisément : l’enjeu de tels accords, pour la démocratie elle-même, c’est-à-dire pour sa réalité, est considérable. Il est pour le moins légitime que cet enjeu fasse l’objet, non seulement d’un large débat démocratique -il est engagé- mais également d’un prononcement démocratique, c’est-à-dire d’une décision populaire. Il serait en effet inacceptable qu’un engagement de l’Etat dans un traité excluant de la décision démocratique des pans entiers de l’activité sociale, économique et culturelle, ne soit l’objet d’une décision populaire, puisqu’il s’agit des droits populaires eux-mêmes.
L’exigence d’un prononcement populaire sur un accord comme l’AMI est d’autant plus légitime que cet accord, une fois ratifié, lierait l’Etat signataire pour 20 ans : une clause prévoit que la partie contractante de l’accord qui voudrait s’en dégager ne puisse le faire qu’après 5 ans d’application des accords, ceux-ci devant encore être appliquée pendant quinze ans après que l’on s’en soit dégagé -le temps de rendre leurs effets irréversibles. Il va de soi qu’aucun droit n’est prévu pour les citoyens d’un pays qui, en toute légitimité démocratique, exigeraient une réorientation des choix politiques et sociaux de l’Etat, de la région (du canton) ou de la commune : ces choix seraient totalement enfermés pendant au moins vingt ans dans le cadre fixé par l’AMI...
Signer aujourd’hui, ou même envisager de le faire, un tel accord sans débat démocratique et sans que ce débat aille à son terme, c’est-à-dire à un vote populaire, serait commettre un acte contre la démocratie. Quoi que l’on pense du projet qu’exprime l’AMI, il importe que ce projet soit soumis au prononcement des citoyens, parce qu’il s’agit de leurs droits.
D.1 La démocratie locale réduite à néant
L’AMI (ou ses succédanés) engage l’ensemble des collectivités publiques : l’Etat signataires, bien sûr, et par définition, mais également ses instances internes, régions, cantons, communes. Et pour une commune, petite ou grande, pour une ville par exemple, ses effets sont dévastateurs sur la capacité de décision. Un tel accord rend effet impossible toute initiative locale en matière d’emploi (une législation établissant un niveau minimal d’emploi ou d’engagement des habitants d’une commune ou d’une région donnée est contraire à l’accord).
Serait contraire à l’accord toute décision politique favorisant des entreprises par rapport à d’autres en fonction de critères de localisation; contraire à l’accord, également, un effort en direction des investisseurs locaux -et contraires donc à l’accord des institutions locales comme, par exemple, la Fondetec à Genève. Contraire sans doute, enfin, à l’accord des contraintes du genre de celle-ci, imposée par la Ville de Genève aux entreprises participant à la mise au concours d’un mandat d’ingénierie civile : le prestataire doit avoir exercé pendant au moins trois ans, en étant insccrit dans un registre commercial ou professionnel, une activité comparable à celle mise au concours, et respecter les usages sociaux en vigueur à Genève...
Pour le surplus, on imagine assez aisément quelle type de "concurrence loyale" pourra s’établir entre une entreprise locale et une multinationale au nom de l’égalité des investisseurs.
Que l’AMI exprime (sous la forme habituelle du "discours d’expert" récusant a priori toute contestation) un projet politique, et une idéologie, que nous combattons est dans l’ordre des choses, c’est-à-dire dans l’ordre du monde : la transformation des Etats, des régions, des villes et des municipalités, bref de toute institution politique élue, en chambre d’enregistrement des décisions des entreprises multinationales participe précisément de ce projet "néo-libéral" ("néo" en ce seul sens qu’il renouvelle les formes, non le fond, du libéralisme classique) à l’oeuvre depuis le début des années ‘70.
Mais encore faudrait-il que ces choses fussent dites, et dites clairement, pour être comprises. Or la règle du silence et la méthode du travestissement règnent sur de tels projets : négociés dans l’ombre, ils n’apparaissent au jour, contre leur gré, que pour se farder de belles intentions sociales. L’argument "mondialiste" lui-même n’est que travestissement, dès lors que l’on tente d’exclure les pays du sud d’un processus de réglementation internationale, pour leur imposer ensuite le résultat de ce processus sans qu’ils aient jamais pu y participer. Les quelques moyens dont disposent les pays du sud de tirer quelque "profit" social et économique des investissements extérieurs leur seraient pratiquement enlevés.
Au fond, nous sommes bien devant une démarche exemplairement idéologique, et exemplairement totalitaire, en ce sens que le projet d’AMI a toutes les caractéristiques d’un prédicat idéologique, et toutes celles des édits religiieux qui naguère s’appuyaient sur tel de ces prédicats pour en imposer le respect à tous : nous sommes face à un texte globalisant, imposant des engagements quasiment irréversibles, sans clause de sauvegarde, créant ou renforçant des juridictions échappant à tout contrôle, et conférant à certains acteurs particuliers de l’échange social et économique des pouvoirs et des droits niés aux autres, en même temps que l’on impose à ces autres acteurs des devoirs auxquels l’on soustrait les premiers. On pourrait en ces termes écrire de l’Eglise catholique du Moyen-âge -mais on en écrit aujourd’hui des entreprises multinationales. Que l’"ordre" que l’on exprime ainsi soit celui de Dieu ou celui de l’argent importe peu : l’important est qu’il règne et que tous s’y plient.
Les promoteurs de l’AMI prennent bien quelques précautions rhétoriques, mais ce projet n’en implique pas moins un renoncement à la fois à la réalité de la démocratie, dès lors que l’on soustrait à la décision démocratique des champs politiques, sociaux et économiques considérables, et au vieux projet de "promotion du bien-être" individuel et collectif, auquel se substituerait l’impératif catégorique du profit des entreprises -et des entreprises seules, érigées en "cellules fondamentales" de la société mondialisée comme autrefois la famille dans le projet catholique traditionnaliste, ou la communauté des fidèles dans le projet protestant fondamentaliste.
Nous refusons l’AMI, ou tout projet reprenant sous un autre nom et dans une autre instance le contenu de l’AMI. Nous le refusons absolument, et totalement : ce projet n’est pas amendable ou, ce qui revient au même, n’est amendable que formellement, rhétoriquement. Ce que nous refusons en lui, ce sont ses bases mêmes, ses intentions fondatrices, ses références fondamentales. Nous ne saurions donc nous satisfaire des précautions et des cautèles que, par exemple, le Parlement européen, en mars 1998, a tenté d’y poser en lui demandant de "contribuer (...) à un développement responsable du pays d’établissement par la promotion de la technologie, de la croissance économique durable, de l’emploi, de relations sociales saines et de la protection de l’environnement", tous objectifs totalement contradictoires de la liberté absolue de l’investissement qui est l’objectif de l’AMI. De même, lorsque le Parlement européen considère que "l’AMI doit viser à prévenir toute concurrence néfaste pour les populations concernées et ruineuse entre les investisseurs pour promouvoir, à l’échelle de la planète, un développement économique durable qui soit respectueux de l’environnement, compatible avec les intérêts de la collectivité et équilibré au niveau régional", il se livre au même exercice qu’à celui auquel se livraient ceux qui attendaient du "communisme" stalinien qu’il adhère au respect des droits fondamentaux de la personne et des droits démocratiques -ce qu’il fit d’ailleurs à sa manière, en les inscrivant dans la constitution soviétique. Amender l’AMI, "civiliser" le capitalisme de la "bulle" financière, introduire quelques gènes sociaux-démocrates dans l’organisme néo-libéral : nous ne saurions nous satisfaire de tels bricolages.
"La nation a le droit inaliénable de réglementer les investissements étrangers et d’exercer son contrôle sur les investissements", proclame la Charte des droits et devoirs économiques des Etats de l’ONU (1974). La nation ? C’est-à-dire les citoyens. C’est-à-dire les peuples. Mais la nation, les citoyens, les peuples ne sont pas des catégories compréhensibles pour les promoteurs de l’AMI ou de ses succédanés. Eux ne connaissent que les investisseurs, les entreprises et, éventuellement, subsidiairement, les Etats. Les droits démocratiques leur sont une entrave -et si l’AMI ou quoi que ce soit qui y ressemble s’impose, ce sont eux, d’abord, qui en feront les frais, car ils sont ou peuvent être une "entrave à la liberté d’investir" dès lors qu’ils permettent d’y poser des critères sociaux, économiques, culturels, politiques.
Ce qui nous importe ici est le prononcement démocratique, la capacité des collectivités (ou pour le dire autrement : le pouvoir des citoyens) de décider des règles qu’elles vont appliquer à leurs propres fonctionnements économiques, et de choisir les partenaires (indigènes ou étrangers) qu’elle vont associer à ce fonctionnement. L’AMI leur nie cette capacité, les prive de ce pouvoir et ainsi réduit la démocratie à ne plus être qu’un pur discours légitimant son contraire. Telle est la première raison de notre refus de l’AMI, et cette raison nous suffit : la démocratie est soluble dans le marché financier tel que l’organise l’AMI.
Seul un vaste débat démocratique peut interrompre le processus lancé d’une soumission absolue de tout ce qui concrétise et manifeste les droits démocratiques aux critères du seul pouvoir économique multinational. Ce débat doit se mener partout, à tous les niveaux, dans tous les milieux, avant que les parlements ne soient saisis de la proposition d’adhésion aux accords multilatéraux sur les investissements -et si ces parlements acceptent ces propositions, il faudra encore relancer le débat pour que là où il le peut et comme il le peut (en Suisse, par exemple, par référendum populaire), il aboutisse à "casser" la décision parlementaire.
La mobilisation d’organisations citoyennes et de "milieux" (notamment culturels) particulièrement sensibilisés semble avoir contraint les promoteurs de l’AMI à un retrait. Ce retrait, cependant, pourrait bien n’être que tactique, et, sous un nom ou un autre, l’AMI être à nouveau remis à l’agenda.
L’AMI occupant la scène, son contenu continue à être négocié en coulisses, et le Fonds Monétaire International, notamment, mitonne une réforme de son fonctionnement et de son champ d’action qui lui donnerait le pouvoir d’exiger des pays membres qu’ils se soumettent à une libéralisation totale des mouvements de capitaux et démantèlent tous les contrôles dont ils disposent sur les paiements et les transferts financiers, pour transférer au seul FMI leur pouvoir de réglementation de ces mouvements de capitaux.
Mais le FMI n’est pas seul à remettre l’ouvrage sur le métier. Ainsi, le Département d’Etat américain a organisé à l’été 1998 une réunion d’information à l’intention de ONG, réunion lors de laquelle il est assez clairement apparu que des négociations continuuent -mais à l’échelon bilatéral, après le "gel" des négociations multilatérales. Les négociateurs américains menacent en outre de faire transférer les négociations de l’AMI au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’ils n’arrivent pas à les faire aboutir au niveau de l’OCDE d’ici au printemps 1999. Et de tenter de convaincre les ONG qu’il leur sera plus facile d’obtenir des garanties sociales, environnementales et démocratiques dans une négociation se déroulant dans le cadre de l’OCDE que dans une négociation menée dans le cadre de l’OMC (ou dans des négociations bilatérales); le chantage est évident : ou bien les négociations de l’AMI se poursuivent là où elles ont commencé, à l’OCDE, et vous avez votre mot à dire, ou bien elles sont transférées à l’OMC, et vous n’avez plus rien à dire.
Deux dates butoirs sont avancées : le 1er avril 1999 (réunion des ministres de l’OCDE) et le 2 septembre 1999 (réunion des ministres de l’OMC). Si à la première date, la résistance à une conclusion des négociations sur l’AMI dans le cadre de l’OCDE a réussi à empêcher cette conclusion, à la seconde date, ces négociations recommencent dans le cadre de l’OMC. Dans le même temps, les USA, l’Union européenne et le Canada continuent de négocier au niveau bilatéral (à Ottawa et à Londres, en juillet), sans aucune publicité. Même si les négociations au niveau de l’OCDE sont officiellement suspendues jusqu’en octobre (histoire de calmer les esprits), elles continuent de facto dans la même discrétion que celle qui régnait avant que les mouvements de citoyens et les milieux culturels n’alertent l’opinion. Des rumeurs circulent en outre sur l’obtention par la France d’une "exception culturelle" comparable à celle obtenue dans le cadre du GATT, en échange d’une tolérance à l’égard de la législation américaine autorisant des sanctions (lois Helms-Burton).
Et puis, il y a ce nouvel avatar de l’AMI, qui s’est d’abord appelé le New Transatlantic Market (en abrégé anglophone NTM... ) pour devenir en français le Nouveau Partenariat Economique Transatlantique (NPET), discuté lui aussi dans la plus totale opacité, accepté par les Commissaires de l’Union européenne sans vote ni débat le 11 mars, rejeté par le Conseil des ministres quelques jours plus tard, soumis au sommet euro-américain du 18 mai... L’intention est évidente : se replier temporairement sur le "partenariat" euro-américain pour contourner les débats citoyens suscités par l’AMI et les enceintes à large participation d’ONG (comme l’OMC ou l’OCDE). Mais une négociation entre les deux principales puissances économiques mondiales (les Etats-Unis et l’Union européenne) n’aurait pas moins d’effets, si elle aboutissait, qu’une négociation au sein de l’OCDE ou de l’OMC -où ces deux "géants" donnent de toutes façons le ton. L’argumentation de ce transfert de négociation d’un forum mondial à un couloir transatlantique est d’ailleurs d’une belle franchise : "Une telle démarche mettrait en valeur le rôle de leader des partenaires transatlantique dans le soutien et le développement du système commercial multilatéral". Le NPET est en suspens (comme, toujours, l’AMI, mais plus discrètement que lui).
A l’automne prochain, une révision des directives de l’OCDE sur les multinationales est agendée à Budapest. Il s’agit peut-être d’une tentative de détourner l’attention des organisations qui se sont mobilisées contre l’AMI, afin que celui-ci puisse refaire surface alors qu’on s’occupera d’autre chose. De toutes manières, les partisans d’un tel accord ne vont pas désarmer et une nouvelle réglementation des investissements internationaux sera adoptée -avec à la clef le même paradoxe d’une "réglementation de la déréglementation". Quel que soit le nom et le cadre de cette négociation, son contenu et ses ambitions seront les mêmes : briser les entraves à l’investissement, soumettre les politiques sociales, environnementales, économiques et culturelles au primat de la circulation du capital.
Nous ne saurions nous contenter face à cette menace de prudentes critiques et d’inconsistantes recommandations du genre de celles votées par le Parlement Européen en mars dernier : ne pas faire pression sur les pays en développement pour les inciter à adhérer à l’accord, saisir la CNUCED et l’OMC du dossier, respecter le principe du partenariat...
Ce qui en français s’abrège AMI, en anglais s’abrège MAI. "Mai", en italien, signifie "jamais". Nous nous en tenons à cette transformation du sigle en mot d’ordre :
Bien qu'une certaine Suisse (Novartis, UBS, Nestlé), riche et investissant beaucoup à l'étranger, bénéficierait de l'AMI, la grande majoité de la population et de l'économie de ce pays vivrait une réalité toute autre.
Les grosses entreprises étrangères pourraient exiger de la part de l'Etat les mêmes conditions de subvention que celles accordées aux entreprises locales. Celles-ci se verraient alors directement et fortement confrontées à la concurrence des multinationales.
L'AMI profiterait à une certaine économie internationale au détriment de celle, locale, qui créée, pourtant, beaucoup plus d'emplois.
Mais cet accord ne se contente pas uniquement de cela, il donne la possibilité à tout investisseur qui s'estimerait, d'une façon ou d'une autre, lésé par la Suisse, de l'attaquer devant un tribunal ad hoc international.
Moins il y a de barrières, plus il est facile pour les multinationales de déplacer leurs capitaux et leur production.
Renforcée par l'AMI, cette liberté de mouvement accentuera encore la pression sur les conditions de travail.
Dans sa version actuelle, l'AMI ne contient pas de clauses explicites visant à imposer aux investisseurs le respect de normes sociales dans leurs activités.
Le développement économique et social durable, respectueux de l'environnement et de l'être humain, est un des défis majeurs.
Les investisseurs étrangers peuvent y participer positivement, à conditions qu'ils soient contrôlés et orientés vers le bien commun et non simplement vers leurs intérêts particuliers.
Les investisseurs étrangers ne sont pas, actuellement, un facteur de développement pour les pays pauvres, bien au contraire. Non seulement ils engendrent régulièrement des dégradations graves de l'environnement et privent des populations de ressources vitales, mais surtout ils s'implantent dans des régions uniquement selon des critères de profit. Ainsi, 70 % des investissements directs à l'étranger dansles pays dits "en voie de développement" se concentrent dans 10 pays seulement, en l'Afrique n'en "bénéficie" quasiment pas.
Faciliter les activités des investisseurs et interdire aux Etats toute possibilité de régulation, comme le veut l'AMI, c'est livrer, purement et simplement, le monde aux appétits des acteurs économiques internationaux.
Tous les droits accordés par l'AMI vont aux investisseurs alors que tous les devoirs incombent aux Etats.
Alors que la plupart des traités internationaux prévoient un préavis de 6 mois pour qu'un pays puisse se retirer, celui de l'AMI est de 5 ans ! Une fois ce délai passé et le pays "libéré" de l'AMI, les règles de l'accord s'appliquent encore pendant 15 ans aux anciens investissements. Ainsi, si un gouvernement démocratiquement élu souhaite mettre fin à l'application de l'AMI dans son pays, il ne pourra concrètement pas faire grand chose... Il y a là un véritable verrou international visant à prémunir l'AMI et donc les investisseurs étrangers des "dangers de la démocratie".
Les investisseurs internationaux ont souvent une grande responsabilité dans la suresploitation des ressources naturelles. Bien peu sont ceux qui se soucient du développement durable et du bien commun.
L'AMI, plutôt que d'édicter des règles strictes visant à la protection de l'environnement, donne des moyens aux multinationales de contrer les lois nationales qui y sont dédiées.
Même si l'on s'achemine vraisemblablement vers une exception culturelle, l'AMI reste actuellement un danger pour la culture.
Si les activités culturelles devaient être considérées comme des investissements, la promotion de la culture locale serait mise en péril. En effet, au nom du "traitement national" qui veut que les investisseurs étrangers soient traités de la même façon ou mieux que les investisseurs nationaux, les grandes firmes de la "culture à vendre" pourraient exiger d'avoir au moins les mêmes conditions que les "investisseurs culturels locaux". Sont visés, les subventions et les soutiens des collectivités publiques, sous toutes leurs formes, à la création culturelle.
Au mois d'octobre, les négociations concernant l'Accord multilatéral sur les investissements (AMI) doivent reprendre dans le cadre de l'OCDE. Le Conseil fédéral a participé à ces négociations depuis mai 1995, derrière les portes hermétiques du "Club des Riches", alors que se manifestait déjà contre cet accord le mouvement international de résistance des organisations non gouvernementales (ONG). Lorsqu'on prévoit d'accorder aux multinationales le droit d'intenter des procès aux Etats en arguant de leurs manques à gagner présumés et lorsqu'on s'apprête à vider de sa substance la souveraîneté des Etats signataires, on ne souhaite évidemment pas une large information du public. Le Conseil fédéral renvoie certes à ses communiqués sur la politique économique extérieure, qui contiennent des informations sur les négociations concernant l'AMI, mais ceci ne diminue en rien le manque de transparence face au public.
La conclusion du traité, prévue pour avril 1998, a échoué après que les ONG eurent dénoncé les conséquences qu'aurait un tel accord. Les résultats des négociations menées jusqu'à présent laissent entrevoir un dumping social et écologique à l'échelle mondiale. A l'âge de la globalisation, l'édification d'un ordre mondial néo-libéral exclut une fois de plus les pays pauvres du Sud et de l'Est. La terminologie utilisée dans l'ensemble des dispositions de l'AMI est révélatrice : il y est question des "discriminations" dont les investisseurs pourraient être l'objet et la suppression des obstacles à l'investissement qu'on y prône nie de façon flagrante les acquis des luttes menées en ce siècle en faveur de la justice sociale. Ce n'est pas un hasard si l'AMI s'est négocié entre les 29 pays les plus riches, dont la Suisse : sur les 500 plus grandes entreprises multinationales, 477 ont leur siège dans les pays de l'OCDE. Selon les clauses déjà acceptées, ces entreprises doivent être gratifiées du même statut légal que les Etats nationaux et exercer ainsi une influence significative sur la politique d'investissement et sur la législation de leurs pays d'accueil.
Le Parti socialiste suisse demande que le Conseil fédéral commande une enquête indépendante et complète sur les répercussions sociales, écologiques et culturelles de l'AMI, ainsi que sur ses conséquences pour le développement, et qu'il oeuvre en faveur d'une plus grande transparence des négociations, de telle façon qu'un large débat public puisse avoir lieu. Nous voulons la garantie que les investisseurs multinationaux seront tenus de respecter des conventions à caractère contraignant -telles que les principales conventions de l'OIT et celles sur la protection de l'environnement-, c'est-à-dire des accords intégrant les normes des droits de l'Homme, du droit au travail et de l'environnement, du droit à la santé et à la protection du consommateur. Le Conseil fédéral devra en outre proposer des mesures contre le dumping fiscal, la corruption et les manipulations sur les prix de transfert. Les gouvernements des Etats et la société civile (syndicats, associations de protection de l'environnement, organisations de défense des droits de la femme et des droits de l'homme en général) devront être autorisées à déposer plainte contre les trusts devant une instance arbitrale internationale. Si ces conditions, qui clarifient le rapport entre la politique et l'économie, devaient ne pas être remplies, la résistance contre l'AMI deviendrait alors un devoir.
Monsieur le Président de la Confédération, Madame, Messieurs les Conseillers fédéraux,
Cet automne devraient aboutir, au sein de l'OCDE, les négociations relatives à l'Accord multilatéral sur les investissements (AMI).
Nous sommes particulièrement inquiets des conséquences que pourrait avoir un tel accord sur la Suisse et le reste du monde, en particulier sur l'ensemble des pays souffrant du mal-développement économique.
Nous attirons votre attention sur les points suivants :
Association pour le Commerce équitable 1 rue Camille Martin CH-1203 Genève
Robert HUE (PCF) :
Monsieur le Premier ministre, les négociations sur le projet AMI doivent reprendre à l'OCDE le 20 octobre. Chacun se souvient de l'émotion soulevée au printemps dernier par ce projet, qui a suscité un vaste mouvement de protestation de personnalités et d'organismes divers. La fin de non-recevoir du Gouvernement français a fortement contribué à son report, tout comme l'opposition de la France a porté un coup sévère au projet transatlantique dit NTM, concocté par M. Brittan, au nom de la Commission, et par l'administration américaine.
Depuis lors, ces tractations ont connu de nouveaux développements. Le 18 mai à Londres, en marge du sommet Europe-Etats-Unis, un arrangement a été conclu. Il inspire une nouvelle mouture du NTM, dite "partenariat économique transatlantique", à l'initiative du même M. Brittan, et qui entérine notamment les lois extraterritoriales américaines. Après plusieurs parlementaires communistes, notamment Jean-Claude Lefort auprès de Mme Lalumière, je souligne notre totale opposition à l'AMI, en raison des menaces qu'il faut peser sur nos choix politiques et sociaux comme sur notre souveraineté. Nous ne saurions cautionner un tel accord, même sous un habillage plus présentable : nous souhaitons son abandon. Pouvez-vous nous faire part des intentions du Gouvernement, à la veille de la reprise des négociations, et nous dire comment vous entendez mener celles-ci dans la transparence, notamment en y associant la représentation nationale ?
Lionel Jospin, Premier ministre :
En 1995, dans le cadre de l'OCDE, ont été engagées des négociations sur un accord multilatéral sur l'investissement, sans véritable transparence alors comme depuis. En février 1998, quand sont apparus les vrais enjeux et les risques du projet, et quand l'émotion s'est emparée d'une partie de l'opinion en France, mais aussi dans d'autres pays, le Gouvernement, notamment par la voix de M. Strauss-Kahn, a immédiatement posé quatre conditions à la poursuite de la négociation. Tout d'abord, l'exception culturelle : les biens culturels ne sont pas des marchandises. Ensuite, le refus d'accepter dans le mécanisme de l'accord les lois extra-territoriales américaines, dont nous refusons l'application sur notre territoire. Troisièmement, le respect des processus d'intégration européenne. Enfin, celui de normes sociales et environnementales.
En avril 1998, voyant que les choses ne pouvaient être clarifiées, le Gouvernement a demandé et obtenu une suspension des négociations pour six mois, afin de procéder à une évaluation et de consulter la société civile. Fin mai, j'ai chargé Mme Catherine Lalumière, députée au Parlement européen, de mener cette consultation. Durant de longues semaines, dans un remarquable travail, elle a rencontré les organisations non-gouvernementales, les associations concernées, les milieux culturels, les organisations syndicales, les représentants des fédérations professionnelles et des entreprises. Mme Lalumière m'a remis son rapport avant-hier. Les conclusions en sont claires. La contestation de ce projet ne porte pas sur des aspects sectoriels ou techniques, mais sur la conception même de cette négociation. Celle-ci pose notamment des problèmes fondamentaux touchant à la souveraineté des Etats, puisqu'ils sont soumis de s'engager de manière irréversible. Une chose est de procéder à des délégations de souveraineté dans une Communauté qui est la nôtre, et dans un processus contrôlé par les Etats; autre chose est de concéder dfes abandons de souveraineté à des intérêts privés ! Mais même du point de vue de nos entreprises -et nous sommes un pays qui investit puissamment à l'extérieur, l'accord pourrait n'avoir qu'un intérêt limité. Certains Etats en effet, et d'abord les Etats-Unis, ont émis des réserves considérables sur le contenu même de cet accord. La position américaine comporte 400 pages de réserves, dont celle-ci : l'accord ne pourrait s'appliquer aux Etats-Unis que dans la mesure où il ne remet pas en cause les compétences des Etats fédérés. Or la portion du territoire américain ne relevant pas d'Etats fédérés. Or la portion du territoire américain ne relevant pas d'Etats fédérés est plutôt réduite.
Dans ces conditions, le rapport conclut que l'accord n'est pas réformable. Mme Lalumière propose de rechercher un nouvel accord, d'une architecture différente, dans le cadre de l'OCDE ou de l'OMC.
Je vous annonce que la France ne reprendra pas les négociations dans le cadre de l'OCDE le 20 octobre. Nous avons commencé à en informer nos interlocuteurs.
La France proposera à ses partenaires de reprendre les négociations sur les problèmes d'investissements sur des bases totalement nouvelles et dans un cadre associant les pays en voie de développement. Ce cadre, à nos yeux, est tout naturellement l'OMC, dont les modes de travail, l'approche progressiste et le caractère universel garantissent un examen sérieux et équilibré.
La France souhaite rester un pays ouvert aux entreprises étrangères et aux investisseurs et elle est soucieuse d'appuyer le développement international de ses propres entreprises. Mais quand on voit les bouleversements récents, hâtifs et parfois irraisonnés, qui ont secoué les marchés, il ne nous paraît pas sage de laisser les intérêts privés mordre trop sur la sphère de souveraineté des Etats. Ceux-ci doivent rester des acteurs majeurs dans la vie internationale. C'est dans cet esprit que nous reprendrons les discussions et la représentation nationale en sera informée.
La République et canton de Genève s'oppose à toute tentative de renforcement du pouvoir de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du nouveau cycle de négociation prévu.
Le Parlement genevois, en tant que représentant démocratique de la population, est extrêmement inquiet de la perte de pouvoir des autorités publiques liée à une libéralisation croissante de l'économie mondiale.
L'Accord final du Cycle de l'Uruguay, signé en 1994 à Marrakech, ainsi que la création de l'OMC, ont été présentée à l'époque comme une opportunité d'assurer un bien être aux populations des pays membres de l'OMC par le développement du commerce. Force est aujourd'hui de constater l'échec de l'OMC sur cette question. Nous assistons au contraire à une concentration du "bien être" bénéficiant à une minorité, alors que la pauvreté ne cesse d'augmenter dans les pays les plus pauvres, comme dans les pays de l'OCDE.
Par ailleurs, les accord déjà conclus ont déjà dangereusement affaibli la capacité des collectivités de se protéger contre leurs conséquences sociales et environnementales. Une remise en cause de la politique poursuivie en est d'autant plus urgente.
L'instabilité croissante des marchés, particulièrement des marchés financiers, l'effondrement d'économies nationales et l'accroissement des inégalités, à la fois entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci, nous impose à tout le moins d'effectuer une pause dans ce processus destructeur et d'effectuer un bilan des politiques menées, particulièrement au sein de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale.
Par ailleurs, les accord déjà conclus ont déjà dangereusement affaibli la capacité des collectivités de se protéger contre leurs conséquences sociales et environnementales. Une remise en cause de la politique poursuivie en est d'autant plus urgente.
La République et canton de Genève s'oppose à toutes nouvelles négociations de libéralisation, particulièrement celles qui visent à introduire de nouveaux secteurs soumis à l'autorité de l'OMC, tels que les investissements, la concurrence ou de nouveaux services (qui imposeraient à terme les privatisations, notamment de la santé et de l'éducation). Elle s'oppose également vigoureusement à l'accord TRIP sur la propriété intellectuelle (Trade Related Aspects of intellectual Property Rights Agreement).
C'est pourquoi la République et canton de Genève s'associe à l'appel lancé par plus de 1800 ONG de par le monde, pour un moratoire sur toute nouvelle négociation visant à étendre les domaines d'action et le pouvoir de l'OMC. La République et canton de Genève demande également à ce que l'impact politique, social, environnemental et économique des accord existants de l'OMC soit évalué par une institution neutre et extérieure à l'organisation en s'assurant une juste collaboration avec les mouvements représentatifs de la société civile.

Votre adresse e-mail:
Votre URL:
Dans quel pays résidez-vous ?
De quelle nationalité êtes-vous (si vous n'êtes pas de celle de votre pays de résidence) ?
Souhaitez-vous recevoir régulièrement par E-Mail des informations ?
Souhaitez-vous adhérer à la Commission Socialiste de Solidarité Internationale ?
Encore quelque chose à dire ?
![]()
Cliquez ici pour souscrire a notre liste de diffusion (informations, débats) sur l'Algérie
![]()
Cliquez ici pour participer à la liste Forum Socialiste
Ce site fait partie du Struggle, Solidarity,
Socialism Webring dont la maintenance est assurée par
Socialist Sid .
Voulez-vous rejoindre le Struggle,
Solidarity, Socialism Webring?
[Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
 Votez
pour nous
Votez
pour nous